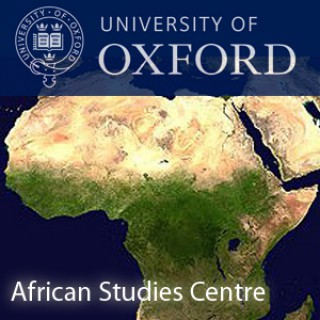Podcasts about mamadou diouf
- 13PODCASTS
- 18EPISODES
- 35mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Oct 25, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about mamadou diouf
Latest news about mamadou diouf
- The African Gaze Conscientious Photography Magazine - Sep 16, 2024
- Senegal’s Elites Wanted to Trash Democracy. Voters Didn’t. Jacobin - Mar 23, 2024
- Senegal's "Unraveling": President's Delay of Election Is Latest in String of Anti-Democratic Actions Democracy Now! - Feb 8, 2024
- Senegal President’s Delay of Election Prompts Mass Protests Amid Fears of Coup Truthout - Feb 8, 2024
- Art X Lagos Is Back & These Are 5 Things To Expect BellaNaija - Nov 3, 2022
Latest podcast episodes about mamadou diouf
«Deberlinization», comment sortir de l'impasse coloniale ? (Épisode 1)
Épisode 1 : Défaire le passé. Une conférence historique pour sortir de l'impasse coloniale où intellectuels et artistes se sont retrouvés à La maison des cultures du monde pour faire face à la Conférence de Berlin de 1885, quand l'Afrique a été partagée sans le consentement des Africains. 140 ans après, comment faire face au passé ? Berlin 1885. Le chancelier allemand Otto von Bismarck convoque une conférence à Berlin afin d'organiser le partage du continent africain entre les puissances industrielles et militaires émergentes. Cette réunion, à laquelle participèrent quatorze pays européens, les États-Unis et l'Empire ottoman, visait principalement à préserver leurs intérêts extractivistes et commerciaux. Ce processus a conduit à une profonde fragmentation des structures politiques endogènes du continent africain, marquant durablement son histoire politique, économique et sociale. Pour les Africains, ce processus inaugura une ère de résistance et de lutte pour l'autodétermination. Berlin 2001. Mansour Ciss Kanakassy, plasticien berlinois d'origine africaine, imagine le Laboratoire de Deberlinization. L'artiste développe des outils symboliques afin de tracer un chemin vers l'émancipation. Ce kit d'urgence comprend un Global Pass pour faciliter la liberté de circulation le monde, ainsi que l'AFRO, une monnaie imaginaire panafricaniste, libérée des contraintes du CFA (indexation sur les garanties de change et de la tutelle des banques centrales exogènes). À la croisée de la création artistique et de la critique sociale, le laboratoire de Deberlinization invite à la réflexion sur la possibilité (individuelle ou collective) d'une refonte du lien civil au sein et en dehors de l'État postcolonial. Berlin 2025. À l'initiative du Professeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, directeur de HKW, la Conférence Deberlinization s'inscrit dans la continuité de l'utopie performative imaginée par Mansour Ciss Kanakassy pour considérer les conditions possibles d'un récit alternatif sur l'ordre du monde et son avenir, une poétique transformatrice de la relation entre l'action créatrice et les formes de résistance, l'histoire, la mémoire, la prospective – bref, un champ d'expérience et un horizon d'attente. Ibou Coulibaly Diop et Franck Hermann Ekra sont les co-commissaires de Déberlinization (25 au 27 Avril 2025). Dans ce premier épisode, vous écoutez les voix de Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (directeur et directeur artistique de Haus der Kulturen der Welt), Magueye Kassé (Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal), Mansour Ciss Kanakassy (plasticien, Prix Léopold Sédar Senghor et le Prix Zuloga), Mamadou Diouf (historien, professeur à Columbia University), Franck Hermann Ekra (Critique d'art, co-curateur et éditeur du livre Deberlinization), Hildegaard Titus (comédienne, activiste), Soeuf el Badawi (poète, dramaturge, activiste) et Tiken Jah Fakoly, (chanteur et activiste) soutien de la manifestation. Un grand merci à toute l'équipe de HKW à Berlin et particulièrement à son directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikun. Découvrir La maison des cultures du monde et le programme Deberlinization. À paraître : - Deberlinization – Refabulating the World, A Theory of Praxis - Deberlinization - Les presses du réel (livre). À lire : Le pari acoustique de Tiken Jah Fakoly. À écouter : Le concert acoustique de Tiken Jah Fakoly enregistré par RFI Labo salle Pleyel à Paris.
Amadou Mahtar Mbow, premier Africain directeur de l'Unesco: La légende Mbow [2/2]
Au son des archives de RFI, nous racontons le siècle d'Amadou Mahtar Mbow, né en 1921 à Dakar et décédé en 2024, après l'enregistrement de ce portrait. Après avoir évoqué son enfance coloniale, sa formation à l'École coranique et française, sa passion familiale pour l'histoire de l'Afrique et ses grands résistants, sa vocation pour l'enseignement et sa vision philosophique de la libération des Africains. Nous retraçons l'engagement d'Amadou Mahtar Mbow pour la décolonisation, pour l'éducation de base, pour l'Unesco et sa vision avant-gardiste de la restitution des biens culturels et des œuvres d'art. (Rediffusion du 19/11/2021) Avec Lamine Sagna, sociologue et auteur du livre Amadou Mahtar Mbow, une légende à raconter, aux éditions Karan et la participation des chercheurs de Columbia University ; Souleymane Bachir Diagne, philosophe et Mamadou Diouf, historien des idées.
Amadou Mahtar Mbow, premier Africain directeur de l'Unesco: la méthode Mbow [1/2]
Au son des archives de RFI, nous racontons le siècle d'Amadou Mahtar Mbow, né en 1921 à Dakar et décédé en 2024, après l'enregistrement de ce portrait. Son enfance coloniale, sa formation à l'École coranique et à l'école française, sa passion familiale pour l'histoire de l'Afrique et ses grands résistants à l'occupation française, sa vocation pour l'enseignement, et sa vision philosophique et politique de la libération des Africains. Avec : Lamine Sagna, sociologue et auteur du livre Amadou Mahtar Mbow, une légende à raconter, aux éditions Karan et la participation des chercheurs de Columbia University Souleymane Bachir Diagne, philosophe Mamadou Diouf, historien des idéesÀ écouter aussiAmadou Mahtar Mbow, premier Africain directeur de l'Unesco (Épisode 2: La légende Mbow)
„Uwielbiam tego typu wyzwania” – Mamadou & Sama Yoon na Innym Wymiarze
W 2014 roku Mamadou Diouf wraz z Grzegorzem Rytką powołali do życia zespół łączący muzykę świata, afrobeat i reggae z dźwiękami etnicznymi. Jako zespół Mamadou & Sama Yoon wystąpią w rozszerzonym składzie podczas Innego Wymiaru – białostockiej odsłony festiwalu Wschód Kultury.… Czytaj dalej Artykuł „Uwielbiam tego typu wyzwania” – Mamadou & Sama Yoon na Innym Wymiarze pochodzi z serwisu Audycje Kulturalne.
durée : 00:32:27 - La Grande table idées - par : Olivia Gesbert - Afrique France, quel récit commun? Rendez-vous avec l'historien Mamadou Diouf pour la traduction française de "L'Invention de l'Afrique" (Valentin-Yves Mudimbe, Présence africaine, 2021), et Eric Fottorino, fondateur des revues "Le 1" et "Zadig". - réalisation : Thomas Beau - invités : Mamadou Diouf historien, spécialiste de l’Empire colonial français, enseignant à l’université de Columbia à New-York; Eric Fottorino Journaliste, écrivain fondateur et directeur de la publication du Journal Le 1, ancien dirigeant du Monde
DJ Wika i DJ Sebastian rozmawiają o Tolerancji. Gościem jest Mamadou Diouf - dziennikarz, muzyk, animator kultury i pisarz.
- Podczas pandemii zacząłem tworzyć refleksyjne utwory nagrywane a cappella, które publikuję na swoim kanale na YouTube. Dzięki temu przetrwałem - mówi Mamdou Diouf, pisarz, muzyk, Senegalczyk, który w Polsce mieszka od blisko 40 lat. - Ale wróciliśmy też do nagrywania online - zdradza w rozmowie z Maciejem Szajkowskim.
Invité Afrique - Djibril Tamsir Niane et le renouveau de l’histoire africaine
L'historien et écrivain guinéen Djibril Tamsir Niane est mort lundi dernier du Covid-19, à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 89 ans. Il fut l'un des pionniers du renouveau de l'histoire africaine, après les indépendances. C'est ce que rappelle l'historien sénégalais Mamadou Diouf, professeur à l'université de Columbia aux États-Unis, qui répond aux questions de Claire Fages. RFI : l’historien Djibril Tamsir Niane était votre aîné, comment l’avez-vous connu ? Mamadou Diouf : Je le connaissais parce qu’un moment nous étions collègues à l’université de Dakar. Et puis il est retourné en Guinée et je suis parti aux États-Unis. Mais j’ai gardé le contact et nous nous sommes souvent retrouvés dans des colloques et des séminaires qui discutaient d’histoire, de traditions orales et de culture africaine. Comment définiriez-vous cet intellectuel ? Djibril Tamsir Niane fait partie de cette génération de l’indépendance, qui a été formée à la fois dans un contexte colonial, qui a utilisé les ressources, la langue, les méthodes apprises à l’école française, pour ouvrir de nouveaux champs et recouvrer les cultures africaines et les mettre, comme je dis souvent, dans le temps du monde. Son nom est associé à l’écriture de l’Histoire générale de l’Afrique, lancée au milieu des années 1960. Sa contribution est majeure. C’est quelqu'un qui a participé à l’un des moments les plus importants de ce chantier de réécriture de l’histoire après la période coloniale. Il a été effectivement un acteur très actif dans le groupe qui a été mis en place par le directeur général de l’Unesco pour la production des huit volumes de l’histoire générale de l’Afrique. Il a dirigé les volumes sur l’histoire médiévale de l’Afrique. Soundjata, livre de référence Il a joué un rôle très important lorsqu'il a publié l’épopée de Soundjata. Je ne sais pas dans le monde francophone, mais ce livre est un des piliers des cours d’histoire africaine aux États-Unis. Il n’y a pas une année où il n’est pas sur la liste des livres des bibliographies qui sont soumises aux étudiants qui font de l’histoire africaine ou qui font de la littérature comparative. C’est un livre qui, aux États-Unis, est au moins chaque année dans une trentaine à une cinquantaine de cours. Que raconte l’épopée de Soundjata ? Elle raconte la construction de l’empire du Mali et l’importance de cet empire, non seulement dans l’imaginaire des Sahéliens mais dans l’imaginaire de toute l’Afrique à ce moment précis où l’Afrique sort de la nuit coloniale. Et ça a donné un statut d’une très grande importance à la poétique des traditions orales. Parce que ce n’est pas seulement un texte historique. Il est porté par une poésie qui est extraordinaire. C’est aussi de la littérature. Comment a-t-il travaillé sur cette période ? Avec quels matériaux ? Il a recueilli des traditions orales mais il s’est aussi lancé dans un travail beaucoup plus systématique en utilisant les traditions écrites, en particulier les traditions arabes, soit écrites par des voyageurs arabes ou par des Africains islamisés, les clercs, ou soit les traditions portugaises. Il a aussi utilisé les renseignements que l’archéologie a développés. Djibril Tamsir Niane est donc décédé à Dakar, mais il s’était beaucoup impliqué dans la vie culturelle en Guinée, à son retour d’exil ? J’ai toujours eu un énorme respect et j’ai toujours apprécié le travail qu’il faisait quand il est retourné en Guinée : le fait d’avoir créé un espace culturel, un espace de débat, mais aussi une librairie. Je pense qu’il a essayé effectivement de contribuer à une reconstruction de l’espace intellectuel et de l’espace public guinéens, à la mort de Sékou Touré.
Deuxième vague de COVID-19, et liberté universitaire et « mot en n »
Serge Brazeau, Réjean Hébert et Michel Grignon font le point sur la deuxième vague de la COVID-19 dans les résidences pour personnes âgées; Marie Grégoire et François Cardinal livrent leur chronique politique; Mamadou Diouf, Melchior Mbonimpa, Michèle D'Haïti et Babacar Faye discutent de liberté d'enseignement et de l'utilisation du « mot en n ».
Les manifestations aux États-Unis et le projet de loi 61 critiqué
Les manifestations antiracistes aux États-Unis avec Mamadou Diouf, directeur du département du Moyen-Orient de l'Asie du sud et de l'Afrique à la Columbia University à New York; discussion sur les États-Unis de Donald Trump avec quatre experts de la politique américaine; et les critiques du projet de loi 61 sur la relance économique du Québec.
Polsko-afrykańskie rozmowy o patriotyzmie i Dniu Niepodległości – Mamadou Diouf i Paweł Średziński
Czym jest patriotyzm z perspektywy Senegalczyka, który od 36 lat mieszka w Polsce? Jak moglibyśmy świętować Dzień Niepodległości? Z czego polskie społeczeństwo powinno być dumne? Jak jest w Senegalu z patriotyzmem jego mieszkańców? O patriotyzmie i świętowaniu Dnia Niepodległości, w Polsce i w Senegalu, rozmawiają Paweł Średziński z Nowej Konfederacji i Mamadou Diouf z Fundacji "Afryka Inaczej". Zapraszamy na dziesiąty odcinek z cyklu #PodcastNK „Nowy Dziwny Świat”. Mamadou Diouf – senegalski wokalista, dziennikarz, animator kultury i działacz społeczny, współzałożyciel Fundacji „Afryka Inaczej”. W 1983 roku przyjechał na studia do Polski. Prowadzi audycję poświęconą muzyce świata w Radiu Dla Ciebie. Zajmuje się również działalnością edukacyjną, prowadząc warsztaty poświęcone Afryce i migracji dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. dr Paweł Średziński – współpracownik NK, doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia historyk, politolog i dziennikarz. Miłośnik przyrody i Wileńszczyzny. Obecnie wspiera działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i prowadzi Magazyn Poświęcony Przyrodzie natropie.tv. Wesprzyj Nową Konfederację: https://nowakonfederacja.pl/wesprzyj-... Zapraszamy do śledzenia NK na pozostałych kanałach społecznościowych: Facebook: https://www.facebook.com/NowaKonfeder... Twitter: https://twitter.com/NKonfederacja Materiał sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
Mamadou Diouf delivers the James S. Coleman Memorial Lecture: Islam and the Making of the Public Space
Mamadou Diouf is Leitner Family Professor of African Studies. He leads Columbia University’s Institute of African Studies at the School of International and Public Affairs.
Islam, the ‘Originaires’ and the making of the public space in a colonial city: Saint Louis of Senegal
Mamadou Diouf from the University of Columbia gives the 2009 African Studies Annual Lecture on the influence of Islam in Post-Colonial Africa, in particular, the public spaces of the former French Colonial City of St Louis in Senegal.
Anthropologist Mara Leichtman (MSU) on religion, migration, and politics. Leichtman unveils her new book New Perspectives on Islam in Senegal (co-edited with Mamadou Diouf). She then discusses transnational Shia Islam in Dakar among Lebanese migrants and Senegalese converts, and in London at the Al-Khoei Foundation. A fine example of why we cannot properly analyze globalization without […]
Anthropologist Mara Leichtman (MSU) on religion, migration, and politics. Leichtman unveils her new book New Perspectives on Islam in Senegal (co-edited with Mamadou Diouf). She then discusses transnational Shia Islam in Dakar among Lebanese migrants and Senegalese converts, and in London at the Al-Khoei Foundation. A fine example of why we cannot properly analyze globalization without […]
[Bonus : Boulevard du 20 mai] - Le Cameroun, ancienne colonie allemande
Mamadou Diouf est professeur à l'université de Columbia.
[Bonus : Boulevard du 20 mai] - Le Cameroun accède à l’ONU (2/2)
Mamadou Diouf est professeur à l'université de Columbia.
[Bonus : Au monument de la Réunification] - Demander l'éclairage d'un historien
Mamadou Diouf est professeur à l'université de Columbia.