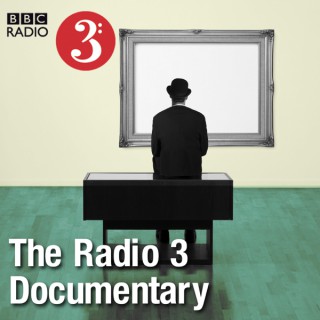Podcast appearances and mentions of Monica Green
Swedish politician
- 31PODCASTS
- 69EPISODES
- 59mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Jan 2, 2025LATEST

POPULARITY
Best podcasts about Monica Green
Latest news about Monica Green
- How a 16th century Italian anatomist came up with the word 'placenta': it reminded him of a cake English – The Conversation - Sep 18, 2023
Latest podcast episodes about Monica Green
S4E16: BOSSES SPOTLIGHT W/ QUEEN MONICA GREEN
CLEAN BUSINESS AND CLEAN CREATIONS ARE THE WORDS! GROW YOUR BUSINESS WITH BOSS LIVES! BOSSES....! GET IT HERE: Want to create live streams like this? Check out StreamYard: https://streamyard.com/pal/d/5532749777862656
Episode 241: The New Jersey Connection on Starpoint Radio - Soulful House & Dance, New & Modern Soul - December 17, 2022
The Soulful House & Dance Hour:Degrees of Motion - Do You Want It Right Now (King Street Mix),Sean Finn - Ain't Nobody,Ernie Mckone, The Family Mckone, Laura Jackson - Make A Move On Me,Tom Glide - Ocean One (feat. Umising) (Gipsy Tightrope Version),Louie Vega - Free To Love (David Morales Disco Juice Vocal Mix),Kenny Hamber - Open The Door (DJ Spen & Reelsoul Radio Edit),Wesley Holmes & Lars Gibbons - Half Light Sway,Kerri Chandler - The Piano Thing (Live),Kimara Lovelace & Roland Clark - When Can Our Love Begin (Fuminori Kajago Remix),The Soul Hour:J.J. Barnes - I Think I've Got A Good Chance (45, 1975),Output/Input - Here We Go Again,Jamison Ross & Avery Sunshine - One Day At A Time,Lisa Dietrich - Move Me No Mountain,Raja-Nee' - Take My Breath (from 'The Sovereign of 14742'),Degrees of Motion - So In Like With You, (1991)Dr. Baker - Save Your Love For Me (feat. Monica Green & Johnny Bristol), (12", 1992)Hil St Soul - Love And Fire (from 'Back In Love'),The Brothers - Are You Ready For This (45, 1975),Mike Jemison - Spread Love,Temprees - Just In Time ('Because We Love You' CD, 2000),Jerry Bell - Tell Me You'll Stay ('Winter Love Affair' LP 1981, 45 2022),Drizabone - Pressure, (1994)Saturdays on Starpoint Radiowww.starpointradio.com
In this episode, we dive into the world of rats. Sure, they can crawl up sewer pipes into your toilet and may have been at least partly responsible for the deaths of tens of millions of Europeans. But - they're also really smart, feel regret, and can show emotion with their ears. This is a special episode. In our first half, we share cool rat facts. And in the second half, we interview Professor Monica Green, who studies plague. We learned so much from her about plague, how it was spread, and even that it is still around today. We couldn't fit our whole interview with Professor Green into this episode, so we're including a longer interview on our feed. You should see it right behind this one. Thanks to our Patreon sponsor Henry for getting us excited about rats! If you'd like to be a Patreon sponsor, please click here: https://www.patreon.com/coolfactsaboutanimals
Rats and Plague with Prof. Monica Green (extended cut)
In this episode, we include many of the facts from our interview with Professor Green that we couldn't fit in our Rat episode. We do go into some detail about the plague and its continued existence, so please use discretion in whether you feel comfortable listening to this episode. Don't miss our rat episode that accompanies this episode, which includes additional facts about rats and also includes lots of interesting information from Professor Green.
Rebroadcast - Mega Plastic Episode with Dr. Jenna Jambeck
Today we are rebroadcasting our mega plastic episode. We're replaying this episode now because we just found out that one of the people we interviewed for this episode, Dr. Jenna Jambeck, was named as one of the 25 MacArthur Genius Grant recipients for 2022. This is a really big honor! We have a lot planned in the next few weeks. Stay tuned for an episode with Weird But True author Julie Beer about all sorts of animal trivia. And then – our episode about rats. As part of that episode, we'll speak with historian Monica Green about the black death. But for now, we hope you learn a lot and gets lots of great ideas after hearing from Dr. Jambeck and our other guests about plastic pollution.
playing all my fave pure house tracks from the second half of 2020, in the mix!Sexy Thing - Hotswing Primal Scream (Original Mix) - Vanilla Ace, Dharkfunkh Funked (Original Mix) - Moshem Control (Original Mix) - DJ Rose Da Da Da (Original Mix) - FDF (Italy) Safe Zone (DJ PP Remix) - Nima Gorji, DJ PP Walk Away (Original Mix) - White Ocean Focus Mine (Original Mix) - Jeff Costello Jingo (Original Mix) - Thanda Bamboo (Original Mix) - Richi Risco Bah Ke Lee (James Meid Remix) - David Herrero, Darksidevinyl, James Meid Don't Give A Damn (Tim Nice Remix) - Paul Parsons, Bronx Cheer, Tim Nice Perfect Jump - Lennox Greenfield Mbinguni Feat. Idd Aziz (Original Mix) - Alex Seda Riser - Mishqa Ritmo (Original Mix) - Broska, Mercko Area 51 (Original Mix) - Tim Taylor Sweet Autonomy (Original Mix) - Nick Hook Riot (Cooper Saver Remix) - Phenomenal Handclap Band, Cooper Saver Ballade D'amour (Mike Newman Remix) - Lebedev (RU), Mike Newman Hold On (Original Mix) - Weikum Night Moves (Kiko Navarro Let My Body Dub) - De Melero, Monica Green, Kiko Navarro Da Body (Original Mix) - Don Pelojo Control (Original Mix) - Karl Sierra You're Mine (Original Mix) - Sijay Deep Fusion - Kikko Esse, Pako Baldassarre Culture (Original Mix) - James Dexterhttps://www.facebook.com/1djbm#djbm #House #TechHouse #Dance #DejavuFM #Radio #Quality
Rubrica Green pass Avv. Monica Bombelli Decreto legge 5 gennaio 2022 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/key-editore/message
Today I welcome Monica Green, Eleanor Murray, Cecilia Tomori to discuss pandemic and endemic disease—and where COVID is headed in that discussion. And Jacob Steere-Williams is joins me as guest host today! Monica H. Green is a historian of medicine, currently serving as Suppes Visiting Professor of the History of Science at Stanford University. She specializes in the premodern period and global infectious diseases. She is writing a book on the Black Death that draws on evidence from genetics, archaeology, and historical sources to document the early origin and broad geographic extent of the 2nd Plague Pandemic. Cecília Tomori is Associate Professor and Director of Global Public Health and Community Health at Johns Hopkins School of Nursing. She is an anthropologist and public health scholar who studies breastfeeding and reproduction, health inequities, and how corporate interests shape health and policy. Eleanor Murray is an assistant professor at Boston University School of Public Health who focuses on improving methods for evidence-based decision-making and human-data interaction. Her work primarily focuses on applications to public health and clinical epidemiology, including applications to HIV, HPV, cancer, cardiovascular disease, psychiatric disorders, musculoskeletal disorders, social and environmental epidemiology, and maternal and adolescent health. Dr. Murray also conducts meta-research evaluating bias in existing research. During the COVID pandemic, Dr. Murray has been working on improving science communication about epidemiology and public health concepts, and identifying and addressing barriers to equitable vaccination distribution and acceptance.
with Monica Green hosted by Chris Gratien | For years, the historiography of the 14th-century Black Death produced more questions than answers. Then, roughly a decade ago, genomic research confirmed that the medieval Black Death was caused by the same bacteria, Yersinia pestis, which causes the modern bubonic plague. This settled the burning question of precisely which disease had caused the pandemic that produced colossal mortality in many parts of Europe, Asia, and North Africa. In this episode, we speak to Monica H. Green, whose recent work has raised new questions about the Black Death by showing that the chronology of the Black Death was incomplete. As she explains, prior outbreaks of plague in 13th-century Asia occurred at the edges of the ascendant Mongol Empire, roughly a century before the plague arrived in Western Europe. In our conversation, we learn how Green uncovered the new story of the "four Black Deaths" and in doing so, explore the historiography of the Black Death and how genetics, archaeology, and a fresh approach to textual sources have brought us to a deeper understand of one of history's deadliest pandemics. « Click for More »
with Monica Green hosted by Chris Gratien | For years, the historiography of the 14th-century Black Death produced more questions than answers. Then, roughly a decade ago, genomic research confirmed that the medieval Black Death was caused by the same bacteria, Yersinia pestis, which causes the modern bubonic plague. This settled the burning question of precisely which disease had caused the pandemic that produced colossal mortality in many parts of Europe, Asia, and North Africa. In this episode, we speak to Monica H. Green, whose recent work has raised new questions about the Black Death by showing that the chronology of the Black Death was incomplete. As she explains, prior outbreaks of plague in 13th-century Asia occurred at the edges of the ascendant Mongol Empire, roughly a century before the plague arrived in Western Europe. In our conversation, we learn how Green uncovered the new story of the "four Black Deaths" and in doing so, explore the historiography of the Black Death and how genetics, archaeology, and a fresh approach to textual sources have brought us to a deeper understand of one of history's deadliest pandemics. « Click for More »
In honour of the 20th anniversary of the publication of The Trotula, Danièle speaks with editor and translator Dr. Monica Green about this astonishing collection of medieval medical and cosmetic advice for women. You can support this podcast on Patreon - go to https://www.patreon.com/medievalists
Torna als escenaris el proper divendres
Avui entrevistarem la cantant Monica Green que aquest divendres 14 de maig actua al Poble Espanyol amb The Project Soul. A m
Today is a discussion of partnership w/the Lepage Center for History in the Public Interest of Villanova University, "The History of Plague - New Perspectives" with Monica Green and Tunahan Dumaz. Monica H. Green is an independent scholar specializing on the history of medicine in the Middle Ages. Although trained as a Europeanist, she has long recognized the intimate ties between Europe and the Islamic world, both of which suffered from the devastations of plague both in the early Middle Ages and again at the end of the medieval period. That work led her to explore the significance of new findings from genetics, which tells a story of plague's effects well beyond the confines of Europe. She is currently working on two books: a history of the medical translations of the 11th-century monk, Constantine the African; and The Black Death: A Global History, which looks at the spread of plague throughout Eurasia and Africa. Tunahan Durmaz is a first-year Ph.D. researcher in the Department of History and Civilization at the European University Institute, Florence. His research mainly focuses on Ottoman history with a special interest in social and cultural aspects of diseases. He specifically studies how urban communities of the Ottoman Empire, and the world around them, perceived the concept of disease in the seventeenth century and if/how their perceptions changed over time. Durmaz earned his M.A. degree at Sabanci University (Istanbul) in 2019 with his thesis titled “Family, Companions, and Death: Seyyid Hasan Nûrî Efendi’s Microcosm (1661-1665)”.
06 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
06 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
06 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
06 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
06 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noireDepuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l'histoire de la peste noire, par les réponses qu'ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu'ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l'appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d'une réflexion sur l'hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s'en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme.SommaireUn cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu'où faut-il mener l'histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d'un amateur de sciences, 2006)« La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde« Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009)Desserrer l'étau d'une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l'histoire. Remarques sur l'œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009)Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d'un textualisme péremptoire« Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-MatchUne expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l'histoireQu'est-ce qu'une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d'un fait nouveau ; mais je pense que c'est l'idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865)Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997)Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sicknessLe rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen ÂgeLes maladies ont une histoire : sur l'historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993)Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l'histoire des maladies, 2016)La septième pathocénose : un outil de périodisationQuand Yersinia pestis n'a pas besoin de nous : « l'homme n'est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d'un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d'une étude historique des maladies », Annales, 1969)Londres, 1348 : le cimetière d'East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011)Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu'est-ce qu'un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020)La collection ostéologique d'East-Smithfield : bioarchéologie de l'état sanitaire des populations (Sharon DeWitte)Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L'ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021)Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l'homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017)Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d'une biologisation de l'anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d'origine de l'Occident, 2014)La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l'évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011)2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011)Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladiesDe la peste justinienne à l'âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l'âgeDu stemma codicum à l'arbre phylogénétique : l'étrange familiarité d'une forme graphiqueLa peste justinienne et la peste noire de part et d'autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016)Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020)Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noireLa carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentairesRetour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ?« Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l'âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Depuis dix ans, les progrès de la paléogénomique relancent l’histoire de la peste noire, par les réponses qu’ils apportent, mais surtout par les nouvelles questions qu’ils ouvrent. En tentant de comprendre le cadre épistémologique qui préside à la reconstitution phylogénétique de Yersinia pestis, on l’appréhende à la fois comme outil de périodisation et comme épreuve d’une réflexion sur l’hétérogénéité des régimes documentaires. Le programme de recherche sur la peste noire s’en trouve redéfini, entre naturalisme et constructivisme. Sommaire Un cadavre exquis : Ramsès II au Val-de-Grâce en 1976 Un pharaon peut-il mourir de la tuberculose ? (Bruno Latour, « Jusqu’où faut-il mener l’histoire des découvertes scientifiques ? », Chroniques d’un amateur de sciences, 2006) « La science construit ses objets » (Gaston Bachelard) : objets de connaissance, objets dans le monde « Mais quelle raison a pu conduire Latour à récuser la réponse de bon sens ? » (Paul Boghossian, La Peur du savoir. Sur le relativisme et le constructivisme de la connaissance, 2009) Desserrer l’étau d’une opposition binaire entre réalités naturelles et construits sociaux (Étienne Anheim et Stéphane Gioanni, « La nature, la construction sociale et l’histoire. Remarques sur l’œuvre de Ian Hacking » dans Michel de Fornel et Cyril Lemieux dir., Naturalisme vs constructivisme, 2009) Constructivisme des faits et nominalisme radical : les séductions d’un textualisme péremptoire « Nos savants au secours de Ramsès II tombé malade 3 000 ans après sa mort » : la leçon de philosophie de Paris-Match Une expérience du temps historique : ouvrir le passé aux futurs de l’histoire Qu’est-ce qu’une expérience de pensée ? « On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte » (Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, 1865) Trois mots anglais pour dire la maladie : illness, disease, sickness (Horacio Fabrega, Evolution of Sickness and Healing, 1997) Le pouvoir médical, ou comment, diagnostiquant un disease, on transforme illness en sickness Le rôle social du lépreux dans la société de persécution au Moyen Âge Les maladies ont une histoire : sur l’historiographie des « années SIDA » (Neithard Bulst et Robert Delort dir., Maladies et sociétés, XIIe-XVIIe siècles, 1988 ; François-Olivier Touati dir., Maladies, médecines et sociétés, 1993) Histoire de longue durée et histoire immédiate : la pathocénose comme « communauté de maladies » (Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise Lambrichs dir., Le Concept de pathocénose de M.D. Grmek. Une conceptualisation de l’histoire des maladies, 2016) La septième pathocénose : un outil de périodisation Quand Yersinia pestis n’a pas besoin de nous : « l’homme n’est que son hôte secondaire, subsidiaire et, d’un point non anthropocentrique, peu important » (Mirko Grmek, « Préliminaires d’une étude historique des maladies », Annales, 1969) Londres, 1348 : le cimetière d’East-Smithfield (Barney Sloane, The Black Death in London, 2011) Sépultures de catastrophe et rites funéraires. Qu’est-ce qu’un cimetière de peste ? (Sacha Kacki, « Black Death: Cultures in Crisis », Encyclopedia of Global Archaeology, 2020) La collection ostéologique d’East-Smithfield : bioarchéologie de l’état sanitaire des populations (Sharon DeWitte) Depuis 2010, brève histoire de la paléogénomique (Ludovic Orlando, L’ADN fossile, une machine à remonter le temps, 2021) Quand le plus ancien en nous sert à mieux tolérer ce qui surgit de neuf : métissage, immunité innée et ingression archaïque (Lluis Quintana-Murci, « Génétique et histoire de l’homme : adaptation aux agents infectieux », dans Patrick Boucheron dir., Migrations, réfugiés, exils, 2017) Faut-il avoir peur de ce savoir ? Les mauvais souvenirs historiques d’une biologisation de l’anthropologie raciale (Jean-Paul Demoule, Mais où sont passés les Indo-Européens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014) La tentation de fin de non-recevoir (Alain Testard, « Les modèles biologiques sont-ils utiles pour penser l’évolution des sociétés ? », Préhistoires méditerranéennes, 2011) 2011, East Smithfield : une trace de Yersinia pestis (Kirsten I. Boos et al., « A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death », Nature, 478, octobre 2011) Une seule bactérie tueuse, plusieurs maladies De la peste justinienne à l’âge de Bronze : Quand Yersinia pestis prend de l’âge Du stemma codicum à l’arbre phylogénétique : l’étrange familiarité d’une forme graphique La peste justinienne et la peste noire de part et d’autre du « silence pathologique » (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Trois pandémies ou cinq pestes ? (Monica Green, « The Four Black Deaths », The American Historical Review, 125, décembre 2020) Un événement théorique en Asie centrale : le « Big Bang » de la polytomie avant la peste noire La carte au trésor : histoire globale et hétérogénéité des régimes documentaires Retour à Ramsès II : comment peut-on être tuberculeux sans avoir lu la Montagne magique de Thomas Mann ? « Mon corps est bien plus vieux que moi, comme si nous gardions toujours l’âge des peurs sociales auxquelles, par le hasard de la vie, nous avons touché » (Roland Barthes, Leçon, 1977).
05 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noireRésuméLes modes de transmission de Yersinia pestis font l'objet d'études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l'épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d'autres hypothèses sur la possibilité d'une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d'un récit global mais discontinu de l'épidémie.Sommaire« Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l'Institut PasteurDernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019)L'étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire)Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010)Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l'économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l'homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel)Tester rapidement l'antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007)En URSS des années 1920 aux années 1970 : l'impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019)Zoonose et sauts d'espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l'hommeUne progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014)Quand l'histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l'infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020)De la mort du rat à celle de l'homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017)Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016)Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018)La peste s'est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l'homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017)La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d'expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti)Pour en finir avec l'orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d'études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002)Mort et résurrection d'un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002)« We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000)Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012)Histoire de l'épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014)Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de BeringenModélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007)Sur la piste d'une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019)Qui comincia il contaggio : la mort d'Antonia Tarossi et de sa famille« A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n'en resta pas un seul : c'est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l'histoireHistoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinuAprès la nature, après l'histoire, restaurer la lisibilité de l'histoire en faisant droit à l'hétérogénéité des images« Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l'histoire naturelle, 2001)Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
05 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Les modes de transmission de Yersinia pestis font l’objet d’études biologiques et épidémiologiques de plus en plus poussées, à partir du tableau clinique actuel mais aussi de la modélisation rétrospective des sources du passé. Pourtant, la virulence de l’épidémie médiévale reste difficilement compréhensible en appliquant de tels modèles. Le cours suggère d’autres hypothèses sur la possibilité d’une contagion interhumaine et la persistance de foyers pesteux en Europe, qui prennent en compte la dimension environnementale d’un récit global mais discontinu de l’épidémie. Sommaire « Depuis longtemps, la peste est mon métier » : Henri Mollaret, Jacqueline Brossolet et le service de la Peste de l’Institut Pasteur Dernières nouvelles de la troisième pandémie de peste (Eric Bertherat, World Health Organization, Weekly epidemiological record, 25, 2019) L’étiologie actuelle : essentiellement trois formes cliniques (septicémique, bubonique et pulmonaire) Quand le bubon ne suffit plus à établir le diagnostic rétrospectif : à la recherche des carbunculi (Samuel Cohn, Cultures of Plague. Medical thinking at the end of Renaissance, 2010) Menaces sur la biodiversité, résistance aux antibiotiques et bioterrorisme : l’économie de la recherche sur le bacille « dont le pouvoir pathogène pour l’homme est le plus élevé dans le monde bactérien » (Elisabeth Carniel) Tester rapidement l’antigène F1 de YP : les risques du passé et les retombées des hantises du présent (Raffaela Bianucci et al., CR Biologies, 2007) En URSS des années 1920 aux années 1970 : l’impossible éradication de la peste (Susan D. Jones et al., PNAS, 2019) Zoonose et sauts d’espèce : le schéma général de la transmission du puce à la rat et du rat à l’homme Une progression par réplication de micro-événements (Monica Green, The Medieval Globe, 2014) Quand l’histoire passe par une piqûre de puce : microbiologie de l’infection (Amélie Dewitte et all, PLOS Pathogens, 2020) De la mort du rat à celle de l’homme : la peste au Caire en 1801 (Xavier Didelot, et al., J. R. Soc. Interface, 2017) Toujours au Caire, mais au XVe siècle, au temps du « grand anéantissement » (Stuart Borsch et Tarek Sabraa, Mamlῡk Studies Review, 2016) Un soupçon persistant sur pulex irritans (Katharine R. Dean et al., PNAS, 2018) La peste s’est diffusée dans les populations humaines avec une rapidité et une facilité qui ne sont guère compatibles avec le modèle classique de transmission du rat à la puce du rat puis à l’homme » (Isabelle Séguy et Guido Alfani, « La Peste : bref état des connaissances actuelles », Annales de démographie historique, 2017) La circulation des savoirs microbiologiques depuis Bombay, « théâtre d’expérimentation » de la peste (Pratik Chakrabarti) Pour en finir avec l’orientalisme épidémiologique : relectures historiennes des Rapports d’études sur la peste en Inde (Samuel Cohn, The Black Death Transformed, 2002) Mort et résurrection d’un paradigme (Samuel Cohn, « Black Death, End of a Paradigm » American Historical Review, 2002) « We believe that we can end the controversy: Medieval Black Death was Plague » : comment ne pas mettre fin à une controverse (Didier Raoult et al., PNAS, 2000) Des espèces aux milieux et de la Mongolie aux Alpes italiennes : cherchez la marmotte (V.V. Suntsov, Biol Bull Russ Acad Sci, 2012) Histoire de l’épidémie milanaise de 1567 et hypothèse sur la persistance de la peste en Europe (Ann Carmichael, The Medieval Globe, 2014) Retour aux sources : Avignon en 1348, Guy de Chauliac et Louis Sanctus de Beringen Modélisation épidémiologique des sources démographiques traditionnelles : le cas de Nonantola en 1630 (Guido Alfani et Samuel Cohn, « Nonantola 1630: Anatomia di une pestilenza e mecanismi del contagio », Popolazione e Storia, 2, 2007) Sur la piste d’une contamination interhumaine : surmortalité et densité des foyers humains (Guido Alfani et Marco Bonetti, « A survival analysis of the last great European plagues: The case of Nonantola (Northern Italy) in 1630 », Population Studies, 73, 2019) Qui comincia il contaggio : la mort d’Antonia Tarossi et de sa famille « A Marseille, sur 150 Frères Mineurs il n’en resta pas un seul : c’est bien ainsi » : Henry Knighton et les petitesses de l’histoire Histoire naturelle ou histoires naturelles ? Un récit global mais discontinu Après la nature, après l’histoire, restaurer la lisibilité de l’histoire en faisant droit à l’hétérogénéité des images « Le besoin de savoir était contredit par la tendance à fermer les yeux » (W.G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle, 2001) Les yeux écarquillés et les yeux bandés : retour sur la scène du crime (Henri Mollaret et Jacqueline Brossollet, À propos des « Pestiférés de Jaffa » de A.J. Gros, 1968).
01 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noire« In medias res » (introduction générale)RésuméLe passage de la mort dans la vie d'une femme, à Marseille, en 1348 : c'est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d'expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l'année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d'une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. SommaireQuand l'événement est en cours, commencer « au milieu des choses »Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d'afflictions »La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004)« La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin ArtaudRésilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009)Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016)Propter pestilentiam : l'écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017)Une société politique qui résiste et qui s'adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996)Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993)Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l'évidence de l'histoireAvril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) »)Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur »)Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c'est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L'histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l'histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020)Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001)Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016)Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008)Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l'expérience qui suit son cours de bouche en bouche »Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort »)Freud le travail de l'histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L'énigme du deuil, 2006)« La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915)Philippe Ariès et « l'humanité coutumière et résignée » d'avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020)Quand « l'ombre de l'objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917)L'effondrement mélancolique et l'épreuve de vérité.
01 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
01 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire « In medias res » (introduction générale) Résumé Le passage de la mort dans la vie d’une femme, à Marseille, en 1348 : c’est ainsi que commence le cours de cette année in medias res. On y parle d’expérience et de narration, dans la continuité des leçons données l’année dernière, mais aussi de deuil et de progrès scientifiques, présentant les principaux enjeux d’une histoire à la fois globale et sociale de la peste noire. Sommaire Quand l’événement est en cours, commencer « au milieu des choses » Marseille, août 1349 : Alayseta Paula devant son juge, « privée de tous ses proches, enceinte et affaiblie, continuellement remplie de chagrins et d’afflictions » La peste arrive à Marseille (Ole Jørgen Benedictow, The Black Death 1346-1353. The Complete History, 2004) « La terrible puanteur des morts » : une vision hallucinée de la peste noire, de Boccace à Antonin Artaud Résilience notariale et résistance sociale à Marseille, Perpignan et Bologne (Shona Kelly Wray, Communities and Crisis. Bologna during the Black Death, 2009) Alayseta Paula dans le portrait de groupe des travailleuses marseillaises (Francine Michaud, Earning Dignity. Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in Marseille, 2016) Propter pestilentiam : l’écho amorti de la catastrophe dans la documentation publique (François Otchakovsky-Laurens, La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), 2017) Une société politique qui résiste et qui s’adapte (Daniel Lord Smail, « Accommodating plague in Medieval Marseille », Continuity and Change, 1996) Pandémie et pestis universalis : « la violente mortalité due à la peste envoie en ce moment atrocement ses flèches partout » (Elisabeth Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la peste noire de 1348, 1962, rééd. 1993) Anno mortalitatis terribilis proxime decurso : un nom barré et l’évidence de l’histoire Avril 2020, un historien envoie sur internet une carte postale vidéo sur la peste noire (Daniel Lord Smail, « A Life in the Black Death: The Inventory of Alayseta Paula (Marseille, 1348) ») Avril 2020, un autre historien envoie sur internet une autre carte postale vidéo sur la peste noire (Patrick Boucheron, « Propos de chercheur ») Coïncidences ou concordance des temps ? Prétendre tirer les leçons du passé, c’est se préparer à « penser en retard » (Marc Bloch) : Guillaume Lachenal et Gaël Thomas, « L’histoire immobile du coronavirus », Comment faire ?, 2020 Globaliser la peste noire (Monica Green dir., Pandemic Disease in the Medieval World. Rethinking the Black Death, 2014) et faire l’histoire de la santé globale (Monica Green, « Emerging diseases, re-ermerging histories », Centaurus, 2020) Le progrès historiographique par accumulation de savoirs : une histoire sociale et politique de la peste noire (Jean-Louis Biget, La grande peste noire, CD audio « De vive voix », 2001) Le progrès historiographique par révolution des paradigmes (Pierre Toubert, « La Peste noire (1348), entre histoire et biologie moléculaire », Journal des savants, 2016) Séquençage génomique et histoire environnementale : une histoire profonde de la peste noire est-elle possible ? (Daniel Lord Smail, Deep history and the Brain, 2008) Qui racontera cette histoire ? Retour sur Le conteur de Walter Benjamin (1936), lorsque se rompt la chaîne de « l’expérience qui suit son cours de bouche en bouche » Recommencer depuis Boccace et son « horrible commencement » (cours du 16 janvier 2018, « Boccace, le survivant et la tyrannie de la mort ») Freud le travail de l’histoire et le Trauerarbeit (Laurie Laufer, L’énigme du deuil, 2006) « La mort ne se laisse plus dénier ; on est forcé de croire en elle » (Sigmund Freud, « Considérations actuelles sur la guerre et la mort », 1915) Philippe Ariès et « l’humanité coutumière et résignée » d’avant 1914 (Stéphanie Sauget, « En finir avec le déni de mort ? Autour de Philippe Ariès », Sensibilités, 2020) Quand « l’ombre de l’objet est tombé sur le moi » (Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1917) L’effondrement mélancolique et l’épreuve de vérité.
On the Bus with The Black Church PAC for Georgia Runoffs
On the Bus with The Black Church PAC for Georgia Runoffs GOTV with Bishop William Murphy of the dReam Center Church; Rev. Jamal Bryant of New Birth Missionary Baptist Church; Rev. Dr. E. Dewey Smith of the House of Hope; Rev. Daunta Long of Seed Planters Church; Monica Green of Black Voters Matter; and Rev. Barrett Berry of Empowered Living ChurchExecutive Producer: Adell ColemanProducer: Brittany TempleDistributor: DCP EntertainmentFor additional content: makeitplain.com See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
09 A New Leadership: Authenticity, Vulnerability and Empathy (HB5VV Special 2)
Part 2 of the HB5 Virtual Voyage special, this episode draws upon the value of authenticity, vulnerability and empathy in our leadership toolkits. It delves into the interplay between these three traits, how we develop them and use them to bring groups and people together. We explore why leadership increasingly needs us to show our human side, how we can connect on deeper levels with the people we represent to help better understand their vision and problems, and how we can also connect more deeply with our fellow leaders. Joining us in this episode, the largest we have ever done, are a suite of incredible women from all corners of the globe: Anna Madlener (a marine robotics engineer in Berlin), Monica Green (an environmental and sustainability tertiary educator in Australia), Nirvani Devcharan (an information technology specialist from Cape Town, South Africa), Roshni Sharma (a spatial scientist from Sydney, Australia), Nancy Glenn (a Professor of remote sensing of the environment from Sydney), Amie Figueiredo (a scientist working on environmental sustainable development policies in Switzerland), Carole Durussel (a Swiss marine scientist working on high seas biodiversity conservation in Germany), Joanna Sumner (a herpetologist managing the wildlife frozen tissue collection at Melbourne Museum), Judit Jimienez Sainz (a research scientist and molecular biologist from Yale Medical School), Jodi Salmond (a marine scientist based on the Gold Coast, Australia), Kristina Baltutis (a Veterinarian from North Carolina, US), Laurie LaPat (an Adjunct Professor at Arizona State University and an environmental engineer), Charlotte Francesiaz (a researcher studying migratory birds in France), Rachel Villani (a wetlands scientist in Baton Rouge, Louisiana), Priyanka Das Rajkakati (Indian-origin French who is an aerospace engineer, PhD candidate in GNSS and an artist), Xhi Hu (Sisi, originally from China, now working on infrastructure assistance modelling and climate change adaptation in the US) and Phillista Malaki (a Kenyan based in Nairobi, a Senior Research Scientist at the National Museum of Kenya).
New Generation Thinker short Feature: COVID and The Black Death, an imperfect fit.
It's understandable that, with the onset of a global pandemic, commentators have looked to the past for comparisons. But Dr Seb Falk is concerned that with the easy headlines about the mortality rate or the economic damage, or even the positive transformations inspired by plagues of the past and particularly in his field, the Black Death of the medieval period, more subtle comparisons emerging from exciting new Plague research are being overlooked. He hears from Dr Monica Green, a leading authority on the true origins and journey of the Black Death and finds, in her use of palaeogenetic research, refinements about the plague and its impact on those who lived with it. And he talks to Dr Zoë Fritz, consultant physician and Wellcome Fellow in Society and Ethics at the University of Cambridge, about the human responses beyond the science today that echo the experiences of our ancestors centuries ago. Rather than mortality rates and economic trauma, the more profound links might be the twin challenges of uncertainty and impotence and the human desire to overcome or deny both. Producer: Tom Alban
This episode finds your favorite podcast hosts in new territory. We welcomed complete strangers into the studio for the first time. Two representatives from a group that seeks to decriminalize marijuana in Oklahoma called "We are 788". Danna Malone and Monica Green came in as strangers but left as friends. Check it out. PLEASE BE SURE TO JOIN our Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/idontdrinkcoffee Anchor: https://bit.ly/2OxW89D Apple: https://apple.co/2ommode Breaker: https://bit.ly/2S2fc1Y Google: https://bit.ly/2MLwy09 Overcast: https://bit.ly/2BGcqGr Pocketcast: https://pca.st/I7CM RadioRepublic: https://bit.ly/2JljMDN Spotify: https://spoti.fi/2Wo0piN Stitcher: https://bit.ly/32PgqRc iHeart Radio: https://ihr.fm/2QYU5NU Youtube: https://bit.ly/301cRqv ListenNotes: https://bit.ly/31wonL2 Twitter: https://bit.ly/2OyX1yA Instagram: https://bit.ly/2vWkiUS PodBay: https://bit.ly/2S52UFT Facebook: https://bit.ly/39ewmz3 Facebook: https://bit.ly/399B40Q PodParadise: https://bit.ly/2DZWNP9 OwlTail: https://bit.ly/35H3Ib8
This episode finds your favorite podcast hosts in new territory. We welcomed complete strangers into the studio for the first time. Two representatives from a group that seeks to decriminalize marijuana in Oklahoma called "We are 788". Danna Malone and Monica Green came in as strangers but left as friends. Check it out. PLEASE BE SURE TO JOIN our Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/idontdrinkcoffee Anchor: https://bit.ly/2OxW89D Apple: https://apple.co/2ommode Breaker: https://bit.ly/2S2fc1Y Google: https://bit.ly/2MLwy09 Overcast: https://bit.ly/2BGcqGr Pocketcast: https://pca.st/I7CM RadioRepublic: https://bit.ly/2JljMDN Spotify: https://spoti.fi/2Wo0piN Stitcher: https://bit.ly/32PgqRc iHeart Radio: https://ihr.fm/2QYU5NU Youtube: https://bit.ly/301cRqv ListenNotes: https://bit.ly/31wonL2 Twitter: https://bit.ly/2OyX1yA Instagram: https://bit.ly/2vWkiUS PodBay: https://bit.ly/2S52UFT Facebook: https://bit.ly/39ewmz3 Facebook: https://bit.ly/399B40Q PodParadise: https://bit.ly/2DZWNP9 OwlTail: https://bit.ly/35H3Ib8
It's the second half of our Robin Hood: Prince of Thieves episode! Join us for a discussion of medieval childbirth, sheriffs, and our grades for the history and the movie! Sources: Medieval Obstetrics: Jeffrey Boss, "The Antiquity of Caesarean Section with Maternal Survival: The Jewish Tradition." Hossam E. Fadel, "Obstetrics in Islamic Medicine: An Historical Perspective." JIMA 28 (1996) Renate Blumenfeld-Kosinski, Not of Woman Born: Representations of Caesarean Birth in Medieval and Renaissance Culture. Cornell University Press, 1990. Monica Green, "Women's Medical Practice and Health Care in Medieval Europe," Signs 14, 2 (Winter 1989) Sara Verskin, "Gender Segregation and the Possibility of Arabo-Galenic Gynecological Practice in the Medieval Islamic World," in Gender, Health, and Healing, 1250-1550, ed. Sara Ritchey and Sharon Strocchia. Amsterdam University Press, 2020. Sheriffs: Veach, Colin. "Sheriff of Herefordshire: 1216–22." In Lordship in Four Realms: The Lacy Family, 1166–1241, 167-90. Manchester University Press, 2014. Accessed July 20, 2020. www.jstor.org/stable/j.ctt18mbfk9.13. PALMER, ROBERT C. "The Sheriff and His Staff." In The County Courts of Medieval England, 1150-1350, 28-55. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1982. Accessed July 20, 2020. doi:10.2307/j.ctvckq7zt.7. Jenkinson, C. Hilary, and Mabel H. Mills. "Rolls from a Sheriff's Office of the Fourteenth Century." The English Historical Review 43, no. 169 (1928): 21-32. Accessed July 21, 2020. www.jstor.org/stable/551764. Wilkinson, Louise J. Women in thirteenth-century Lincolnshire. Vol. 54. Boydell & Brewer, 2007. Wilkinson, Louise J. "Women in English Local Government: Sheriffs, Castellans and Foresters." In The Growth of Royal Government under Henry III, edited by Wilkinson Louise J. and Crook David, 212-26. Woodbridge, Suffolk, UK; Rochester, NY, USA: Boydell & Brewer, 2015. Accessed July 21, 2020. doi:10.7722/j.ctt17mvjrp.20. https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/significant-people-collection/nicola-de-la-haye/ Carpenter, D. A. "The Decline of the Curial Sheriff in England 1194-1258." The English Historical Review 91, no. 358 (1976): 1-32. Accessed July 21, 2020. www.jstor.org/stable/565189. https://www.nationalarchives.gov.uk/documents/education/magna-carta/magna-carta-lesson3-sources1-8.pdf
Doctor, Healer, Midwife, Witch: How the the Women’s Health Movement Created the Myth of the Midwife-Witch
Witches, Episode #1 of 4. In 1973, two professors active in the women’s health movement wrote a pamphlet for women to read in the consciousness-raising reading groups. The pamphlet, inspired by Our Bodies, Ourselves, looked to history to explain how women had been marginalized in their own healthcare. Women used to be an important part of the medical profession as midwives, they argued -- but the midwives were forced out of practice because they were so often considered witches and persecuted by the patriarchy in the form of the Catholic Church. The idea that midwives were regularly accused of witchcraft seemed so obvious that it quickly became taken as fact. There was only one problem: it wasn’t true. In this episode, we follow the convoluted origin story of the myth of the midwife-witch. Get the full transcript at digpodcast.org Bibliography & Further Reading Samuel S. Thomas, “Early Modern Midwifery: Splitting the Profession, Connecting the History,” The Journal of Social History 43 (2009), 115-138. Thomas Forbes, “Midwifery and Witchcraft,” The Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 17 (1962), 1966. David Harley, “Historians as Demonologists: The Myth of the Midwife-Witch,” in Brian P. Levack, Witchcraft, Healing, and Popular Diseases: New Perspectives on Witchcraft, Magic, and Demonology (Florence: Taylor and Francis Group, 2001) Leigh Whaley, Women and the Practice of Medical Care in Early Modern Europe, 1400-1800 (London: Palgrave Macmillan, 2011 Ritta Jo Horsley and Richard Horsley, “Who Were the Witches? Wise Women, Midwives, and the European Witch Hunts,” Women in German Yearbook: Feminist Studies in German Literature & Culture 3 (1986), Barbara Ehrenreich and Dierdre English, Witches, Midwives, and Nurses: A History of Women Healers (New York: The Feminist Press at CUNY, 1970), Monica Green, “Women’s Medical Practice and Health Care in Medieval Europe,” Signs 14 (1989), 434-473. Margaret Murray, The Witch Cult in Western Europe (London: Oxford University Press, 1921) Margaret Murray, The God of the Witches (London: Oxford University Press, 1931) Thomas Szasz, The Manufacture of Mental Illness: A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health Movement (Syracuse: Syracuse University Press, 1970) Jacqueline Simpson, “Margaret Murray: Who Believed Her, and Why?” Folklore 105 (1994) Jennifer Nelson, More than Medicine: A History of the Feminist Women’s Health Movement (New York: New York University Press, 2015). Diane Purkiss, The Witch in History: Early Modern and Twentieth Century Representations (London: Taylor and Francis Group, 1996). Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
When thinking of the past, one of the hardest things is to imagine what it would have been like to inhabit a physical body in a world so different in look, smell, and feel from our own. What was it like to go to the doctor 800 years ago? If you cut your finger and bled, what would that blood mean to you? What about the blood of saints—would that be different? What about exercising, eating, giving birth, having sex, burying the dead? The way we think about these experiences fundamentally changes how we experience them. So how has our thinking changed since the Middle Ages? Jack Hartnell’s new book, Medieval Bodies, explores the answers to these questions through a series of vivid objects, stories, texts, and paintings, starting with the head and meandering through skin and heart and stomach all the way to the feet. Along the way, he constructs a living, breathing body of evidence that helps us understand our physical past.Quick note: In our sign off, we promised a Thanksgiving episode—but a holiday cold has made liars of us, and we cannot put one out! We'll be back with a brand new interview on Friday, December 6th. Til then, take care, and stay warm!Go beyond the episode:Jack Hartnell’s Medieval Bodies: Life and Death in the Middle Ages (read an excerpt here)View a slideshow of related bodily medieval images on the episode pageFor more on medieval women’s medicine, check out Monica Green’s Making Women’s Medicine Masculine or her paper, “Gendering the History of Women’s Healthcare”For another unusual angle of medieval history, check out our interview with Marion Turner, who wrote an innovative biography of Geoffrey ChaucerTune in every week to catch interviews with the liveliest voices from literature, the arts, sciences, history, and public affairs; reports on cutting-edge works in progress; long-form narratives; and compelling excerpts from new books. Hosted by Stephanie Bastek. Follow us on Twitter @TheAmScho or on Facebook.Subscribe: iTunes • Feedburner • Stitcher • Google Play • AcastHave suggestions for projects you’d like us to catch up on, or writers you want to hear from? Send us a note: podcast [at] theamericanscholar [dot] org. And rate us on iTunes! Our theme music was composed by Nathan Prillaman. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
When thinking of the past, one of the hardest things is to imagine what it would have been like to inhabit a physical body in a world so different in look, smell, and feel from our own. What was it like to go to the doctor 800 years ago? If you cut your finger and bled, what would that blood mean to you? What about the blood of saints—would that be different? What about exercising, eating, giving birth, having sex, burying the dead? The way we think about these experiences fundamentally changes how we experience them. So how has our thinking changed since the Middle Ages? Jack Hartnell’s new book, Medieval Bodies, explores the answers to these questions through a series of vivid objects, stories, texts, and paintings, starting with the head and meandering through skin and heart and stomach all the way to the feet. Along the way, he constructs a living, breathing body of evidence that helps us understand our physical past.Quick note: In our sign off, we promised a Thanksgiving episode—but a holiday cold has made liars of us, and we cannot put one out! We'll be back with a brand new interview on Friday, December 6th. Til then, take care, and stay warm!Go beyond the episode:Jack Hartnell’s Medieval Bodies: Life and Death in the Middle Ages (read an excerpt here)View a slideshow of related bodily medieval images on the episode pageFor more on medieval women’s medicine, check out Monica Green’s Making Women’s Medicine Masculine or her paper, “Gendering the History of Women’s Healthcare”For another unusual angle of medieval history, check out our interview with Marion Turner, who wrote an innovative biography of Geoffrey ChaucerTune in every week to catch interviews with the liveliest voices from literature, the arts, sciences, history, and public affairs; reports on cutting-edge works in progress; long-form narratives; and compelling excerpts from new books. Hosted by Stephanie Bastek. Follow us on Twitter @TheAmScho or on Facebook.Subscribe: iTunes • Feedburner • Stitcher • Google Play • AcastHave suggestions for projects you’d like us to catch up on, or writers you want to hear from? Send us a note: podcast [at] theamericanscholar [dot] org. And rate us on iTunes! Our theme music was composed by Nathan Prillaman. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Centerpartiet presenterar "århundradets arbetsmarknadsreform" i Almedalen, men kommer resten av Alliansen att acceptera utspelet? I dagens specialavsnitt från Almedalen har turen kommit till Annie Lööf och Centerpartiet. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach annie-lyserar partiets nya förslag tillsammans med Ekots politikreporter Maggie Strömberg och Svenska Dagbladets dito Annie Reuterskiöld. Men hur mycket är C beredda att kompromissa efter valet? Tillsammans med Liza Pettersson på Novus har Fredrik Furtenbach tagit fram ett eget valtest för Det politiska spelet. Men när socialdemokratiska riksdagsledamoten Monica Green agerar försökskanin uppstår problem direkt. Dessutom fortsätter spinndoktorerna sitt varumärkesarbete med partierna. Den här gången gästar PR-konsulten Sofia Kacim podden och presenterar en reklam för C som får publiken att brista ut i jubel. Programledare: Henrik Torehammar Producent: Björn Barr
You know how much important is to be connected so it's time to join me on Social Media ! Facebook, Twitter and Instagram ! Facebook: https://www.facebook.com/LuisdelVillardj Twitter: https://twitter.com/LuisdelVillardj Instagram: https://instagram.com/luisdelvillardj/ SHOP ONLINE : https://shop.spreadshirt.es/1126927 WEBSITE: http://www.luisdelvillar.com Itunes: https://itunes.apple.com/podcast/ibiza-sensations-by-luis-del-villar/id521062568 Hearthis.at: https://hearthis.at/L6BkT28Z/ Soundcloud: http://soundcloud.com/luis-del-villar Podbean: https://luisdelvillardj.podbean.com/ Mixcloud: http://www.mixcloud.com/LuisdelVillar/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkkcPuwNMOLBwaoBzn_VC3A/videos The Tracklist is: 01 Aki Drope - House Is Yours (Original mix) 02 Pulse - Willing To Go (Vocal Mix) 03 The Checkup & Deeleegenz - My Kingdom 04 Sebb Junior - Feel The Same (Original Mix) 05 Vittorio Santorelli, Cinnamon Brown, Kings Of Soul - Give It Up (Kings Of Soul Vocal Mix) 06 Will Sonic - Times Are Changing (Will Sonic Edit) 07 Tom Misch, Detroit Swindle - South of the River (Detroit Swindle Remix) 08 De Melero, Monica Green, SP1DER - Night Moves (SP1DER Remix) 09 Vanilla Ace - Ghetto Track Feat. Enrique Ramil (Extended Mix) 10 Juan Diaz, Alexandra Prince, Peter Brown - Hotel Room (The Cube Guys Mix) 11 Josh Butler - Be Somebody (featuring Boswell) 12 Christian Nielsen - From The Dust (Original Mix)
TROPICAL VELVET PODCAST EP 72 MIXED BY KORT GUEST MIX WATER JUICE
www.youtube.com/channel/UC6rh-ipGRIfHAX_N7EuuJSA www.facebook.com/Tropical-Velvet-291983374288261/ twitter.com/TropicalVelvet www.instagram.com/tropicalvelvetrecords TRAXSOURCE: www.traxsource.com/label/18796/tropical-velvet BEATPORT: pro.beatport.com/label/tropical-velvet/40791 BEN AKA KORT IS BACK IN THE HOT SEAT, BRINGING YOU THE VERY BEST FROM THE UNDERGROUND & UPFRONT HOUSE. WITH A SPECIAL GUEST MIX FROM WATER JUICE 1. RIO DELA DUNA, KORT FT JAMIELISA - KISSING ME (DANCING DIVAZ REMIX) - TROPICAL VELVET 2. AVON STRINGER - HEAR THE MUSIC 3. JAMEISHA TRICE, JAMES CURD - SO TIGHT 4. SAMO - STRAIGHT ON 5. RONY BREAKER FT BRIAN LUCAS - WEEKEND (RICKY INCH REMIX) - TROPICAL VELVET 6. BALAPHONIC - BALINESE SAINTS 7. MAT.JOE - HEART TO FIND 8. GLEN HORSBOROUGH, INITTOGETHER - NOT OVER (KORT REMIX) - LTBH 9. DE MELERO, MONICA GREEN, SP1DER - NIGHT MOVES 10. GERD JANSON, SHAN - SURRENDER 11. RUDIMENTAL - FEEL THE LOVE (KORT'S TV VIP MIX) 12. APEXAPE, TAWIAH - AMEN - STRICTLY RHTYTHM CLASSIC TRACK: 13. ANN NESBY - CAN I GET A WITNESS (MOUSSE T'S FUNK 2000 MIX) GUEST MIX: WATER JUICE
HoP 281 - Monica Green on Medieval Medicine
An interview with Monica Green reveals parallels between medicine and philosophy in the middle ages.
Samtal med Monica Green, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige, om kvinnokonventionen. Jämställdhet är en mänsklig rättighet så varför behövs en särskild kvinnokonvention?
Ep. 15 – Monica Green; Pediatric Cancer, Grieving, & Motherhood
Meet Monica, a mother of three, whose son Mason was diagnosed with pediatric brain cancer. She shares the struggle of being caregiver for one child while still parenting her other children. Monica describes the challenges of being a primary caregiver and how that role changes when your loved one passes away. After Mason went to heaven, Monica said it was a challenge to allow herself, her husband, her son, and her daughter to grieve in their own, unique ways. Monica and her husband started the Mason Green Foundation, which raises money and awareness for pediatric brain cancer. Find the On Coming Alive Project, at OnComingAlive.com. Monica's Answers To The Fun Questions: • What are you loving right now? Being part of the On Coming Alive Project • What’s your favorite meal right now? Mexican and Italian. And Starbucks’ Chai Latte • What are you doing to take care of yourself? Eat better. Go for walks. Spend time alone and with each member of the family individually • What are you doing to be brave? Sharing her story and Mason’s life Connect with Monica: FACEBOOK: facebook.com/masongreenfoundation CARINGBRIDGE: caringbridge.org/visit/masongreen TWITTER: twitter.com/mason_memories Connect with Becky: BLOG: BeckyLMcCoy.com FACEBOOK: facebook.com/BeckyLMcCoy TWITTER: twitter.com/BeckyLMcCoy INSTAGRAM: instagram.com/BeckyLMcCoy NEWSLETTER: eepurl.com/bBOHH1 Share your Sucker Punched story at BeckyLMcCoy.com/Submissions Please subscribe to and rate this podcast to help others find Sucker Punched. NOTE: Sucker Punched is the podcast formerly known as Stories of Unfolding Grace
Dr. Llaila Afrika, Dr. Umar Johnson and Tony Browder
Listen to The African History Network Show, Thurs. Feb. 21st, 8pm-11pm EST with guests, Dr. Laila Afrika, Dr. Umar Johnson and Malaika Cooper. Dr. Llaila Afrika is a Wholistic Health Expert and Author. He'll talk about his upcoming lecture in St. Louis, Sat. Feb. 23rd, dealing with Nutricide, African Holistic Health, The Black Family and much more. Visit www.TheAfricanHistoryNetwork.com for more information. Michael Imhotep (host of The African History Network Show) will talk about his joint lecture with Dr. Llaila Afrika in St. Louis on Sat. Feb. 23rd at Pamoja Preparatory Academy, 3935 Enright Avenue, St. Louis, MO. 2pm- 8pm, $15 Adv, $20 at Door. Dr. Umar Johnson will talk about "The Meeting of the Minds-Detroit" Conference, Fri. March 1st-Sun. March 3rd in Detroit at Aisha Shule Preparatory Academy, 20119 Wisconsin St., Detroit. Tony Browder will talk about his upcoming lecture on Mon. Feb. 25th in Detroit. "Countering the Negative Perceptions of Blacks in the Media". It's taking place at The Shrine of The Black Madonna Church, 7625 Linwood @ Hogarth (3 blocks North of W. Grand Blvd), 6pm-8:30pm, Adm. $10. Mailaka Cooper and Monica Green of The Cleveland Natural Hair Care & Fitness Expo will talk about this Expo taking place, Sun. Feb. 24th at Hilton East/Beachwood, 3663, Park East Drive, Beachwood, OH. Michael Imhotep will be at this Expo doing a workshop also.
Egyptens unga blev en symbol för den arabiska våren när de fällde Mubarak. Nu samlas de åter på Tahrirtorget och vi undrar vad som kommer segra nu - ungdomlig idealism eller militär cynism? /// Siffran sju är inte bara ett turtal, antal dössynder eller den perfekta sizen på ett dvärgentourage - den är också den kritiska gränsen för räntan på statsobligationer - är det för att siffran är magisk? /// Deltagarna i Melodifestivalens första deltävlingar har presenterats. Vem vinner? Vi gör ryggradsreflex-testet på dagens sidekick Monica Green.
Vårdbråket drar rubriker - vi undersöker det politiska spelet bakom kulisserna: Vilken player plockar flest politiska poäng?! Mats Knutsson kommenterar. /// Efter 6 000 avlyssnade personer och ytterligare hackingavslöjanden frågar vi oss om brittisk press är störd eller bara hyperaktiv? /// Och så får Monica Green göra sitt viktigaste jobb som som sossarnas it-talesperson - internetfenomen:lolcat eller lolrus?