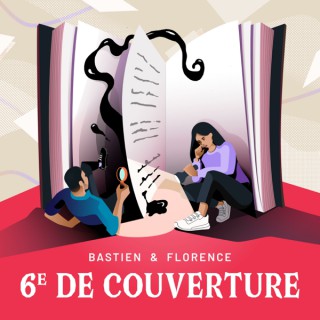Podcasts about Le Trait
Commune in Normandy, France
- 128PODCASTS
- 255EPISODES
- 30mAVG DURATION
- 1WEEKLY EPISODE
- Feb 9, 2026LATEST

POPULARITY
Best podcasts about Le Trait
Latest news about Le Trait
- Au-delà des promesses : Le traité numéro 8 et les droits des peuples autochtones The Walrus - Mar 5, 2025
Latest podcast episodes about Le Trait
L'Atlas, en mouvement.Le Trait a rencontré le peintre L'Atlas, alias Jules Dedet Granel, dans son atelier des Lilas. À quarante-six ans à peine, L'Atlas fait déjà l'objet d'une rétrospective au musée du Touquet, visible jusqu'au 25 mai 2026. Une reconnaissance significative pour cet artiste né en 1978, dont la notoriété s'est construite à la croisée du graffiti, de la calligraphie et de l'abstraction. Agnès b qui le représente dans sa galerie a été l'une des premières personnes à le collectionner. « Elle m'a sortie du milieu underground ».Autodidacte pour l'essentiel, il effectue néanmoins un bref passage par l'université en archéologie et en histoire de l'art, avant de prendre une décision fondatrice : partir au Maroc, dans le massif de l'Atlas, en 1999, pour rejoindre un maître calligraphe. Il ira aussi beaucoup en Asie ; la calligraphie orientale l'a beaucoup influencé.Il choisit le nom « L'Altas » ; une figure mythologique condamnée par Zeus (nom porté par ailleurs par l'un de ses proches amis, lui aussi artiste de street art et figure du post-graffiti) à soutenir la voûte céleste pour l'éternité. « L'Atlas, c'est un nom universel, explique-t-il. Le “L'” est une manière de le rendre unique, un clin d'œil à la French touch, et aussi un outil plastique : l'apostrophe m'aide à équilibrer mes compositions. »L'Atlas ne peut créer une œuvre s'il n'a pas un mot en tête. Chez lui, rien ne se créé sans le langage. «J'ai une formation de calligraphe. » Il aimerait faire entrer la lettre dans l'histoire de l'art. « La calligraphie est souvent cantonnée à l'archéologie. J'aimerais faire entrer l'histoire de l'écriture dans l'art, écrire un manifeste sur l'abstraction calligraphique. On est un mouvement (nous sommes beaucoup à venir du graffiti) qui a appris à peindre avec des lettres. On a une manière d'occuper l'espace par la lettre ». L'Altas a d'ailleurs créé une galerie aux Lilas pour faire exister ce mouvement : la galerie Liminal. « Nous avons appris à peindre avec des lettres. Nous avons une manière spécifique d'occuper l'espace par le signe. Le street art a été largement envahi par la figuration ; je pense que l'abstraction est plus universelle. »L'Atlas cherche à extraire une unité dans les écritures, une sorte d'espéranto calligraphique, où le noir et le blanc (principalement) dialoguent dans une dichotomie radicale. Ses compositions explorent sans cesse la frontière fragile entre lisibilité et abstraction, entre sens et pure forme. L'ambition est la création d'un mouvement artistique, « l'abstraction calligraphique. » A découvrir au Musée du Touquet-Paris-Plage et à la galerie Liminal, aux Lilas.https://letraitpodcast.paris/
Le Trait d'Union Montérégien-TUM lance une campagne de recrutement d'ami·e·s bénévoles. Brisons l'isolement une amitié à la fois Michel Lafrance a reçu Sylvie Tétreault en entrevue pour parler de cette campagne.See omnystudio.com/listener for privacy information.
Accord sur les Chagos : les conservateurs accusés de saboter le traité lors de la Question Time
Accord sur les Chagos : les conservateurs accusés de saboter le traité lors de la Question Time by TOPFM MAURITIUS
Le traité historique sur la haute mer entre officiellement en vigueur ce samedi
durée : 00:15:06 - Journal de 8 h - Il est censé protéger les océans. Le traité international sur la Haute mer entre officiellement en vigueur aujourd'hui.
Le traité historique sur la haute mer entre officiellement en vigueur ce samedi
durée : 00:15:06 - Journal de 8 h - Il est censé protéger les océans. Le traité international sur la Haute mer entre officiellement en vigueur aujourd'hui.
Le traité historique sur la haute mer entre officiellement en vigueur ce samedi
durée : 00:15:06 - Journal de 8 h - Il est censé protéger les océans. Le traité international sur la Haute mer entre officiellement en vigueur aujourd'hui.
Cliquez ici pour accéder gratuitement aux articles lus de Mediapart : https://m.audiomeans.fr/s/P-UmoTbNLs Des centaines d'agriculteurs sont venus manifester à Paris, jeudi 8 janvier, à l'appel notamment de la Coordination rurale, pour protester contre l'adoption de l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, qui devrait être signé vendredi à Bruxelles. Un reportage de Lucie Delaporte, publié le 8 janvier 2026 sur Mediapart, lu par Christine Pâris. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le traité du Mercosur, l'abandon des agriculteurs français ?
durée : 00:37:40 - Le 18/20 · Le téléphone sonne - Alors que l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur revient au premier plan, la contestation du monde agricole français reste intacte. Longtemps aux côtés de la France pour freiner le texte, l'Italie semble désormais prête à donner son feu vert. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Après «La cache», Christophe Boltanski en quête de sa famille maternelle dans «Le trait de côte»
Une photo de famille trônait dans une maison du Cotentin sur un secrétaire en acajou et elle serait restée muette si Christophe Boltanski n'avait décidé, à force de voir ce cliché immuable, de l'interroger. Qui sont les personnes photographiées et que raconte-t-elles de leur temps ? L'auteur aurait pu se préoccuper uniquement de généalogie, mais la quête de ces personnages se double d'une enquête sur la vie des douaniers de la côte normande, des tuberculeux ou celle des enseignants. Christophe Boltanski, journaliste et écrivain, était l'invité de Nathalie Amar sur RFI. « Le trait de Côte » paraît chez Stock. ► Chronique - Saison 1 Episode 1 Jessica Taieb nous plonge dans l'univers de la série culte Twin Peaks. Les trois saisons de ce monument de la télévision des années 1990 seront diffusées sur Arte à partir du 8 janvier, gratuitement et en intégralité, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de son créateur, David Lynch. Qui a tué Laura Palmer ? Dans la petite ville de Twin Peaks, l'agent spécial du FBI, Dale Cooper, mène l'enquête. ► Playlist du jour - Bourvil – La tendresse. - La Cafetera Roja - La vita e Bella. - David Lynch - Good Day Today.
Après «La cache», Christophe Boltanski en quête de sa famille maternelle dans «Le trait de côte»
Une photo de famille trônait dans une maison du Cotentin sur un secrétaire en acajou et elle serait restée muette si Christophe Boltanski n'avait décidé, à force de voir ce cliché immuable, de l'interroger. Qui sont les personnes photographiées et que raconte-t-elles de leur temps ? L'auteur aurait pu se préoccuper uniquement de généalogie, mais la quête de ces personnages se double d'une enquête sur la vie des douaniers de la côte normande, des tuberculeux ou celle des enseignants. Christophe Boltanski, journaliste et écrivain, était l'invité de Nathalie Amar sur RFI. « Le trait de Côte » paraît chez Stock. ► Chronique - Saison 1 Episode 1 Jessica Taieb nous plonge dans l'univers de la série culte Twin Peaks. Les trois saisons de ce monument de la télévision des années 1990 seront diffusées sur Arte à partir du 8 janvier, gratuitement et en intégralité, à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de son créateur, David Lynch. Qui a tué Laura Palmer ? Dans la petite ville de Twin Peaks, l'agent spécial du FBI, Dale Cooper, mène l'enquête. ► Playlist du jour - Bourvil – La tendresse. - La Cafetera Roja - La vita e Bella. - David Lynch - Good Day Today.
Mercosur : l'eurodéputée LFI Manon Aubry dénonce "l'opération d'intox généralisée" sur le traité de libre-échange
durée : 00:20:16 - 8h30 franceinfo - La députée européenne Insoumise était l'invitée du 8h30 franceinfo du samedi 20 décembre 2025. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
#76 Réaction à l'interview de Béata Umubyeyi Mairesse à la librairie Le Trait d'union
On vous avait promis de consacrer un épisode à Béata Umubyeyi Mairesse pour parler de ses nouvelles, et on va le faire dans cet épisode.
Préoccupations du CERD à Genève : Me Gavin Glover réfute et parle d'éléments erronés, confirmant que le traité sur les Chagos suivra son cours
Préoccupations du CERD à Genève : Me Gavin Glover réfute et parle d'éléments erronés, confirmant que le traité sur les Chagos suivra son cours by TOPFM MAURITIUS
La French touch selon Jean-Paul BathJean-Paul Bath est le directeur général de l'association Le FRENCH DESIGN depuis 10 ans. Cette association, sous la double tutelle du ministère de l'économie et du ministère de la culture, est le nouveau nom, plus compréhensible à l' international, du VIA (Valorisation de l'Innovation dans l'Ameublement) créée en 1979 pour promouvoir l'innovation et le design dans les secteurs du mobilier, de la décoration.Aujourd'hui, Le FRENCH DESIGN by VIA poursuit cet engagement à travers de nombreuses actions, dont l'exposition « Résurgences », qui met en lumière des pièces emblématiques rééditées du design français, visible jusqu'au 23 janvier dans sa galerie. Les pièces exposées portent notamment les signatures de René Dumas, Jean-Michel Frank, Pierre Guariche, Philippe Hurel, Jules Leleu, Christian Liaigre, Joseph-André Motte, Serge Mouille, Pierre Paulin ou Roger TalIon....parmi d'autres encore. Autant de figures majeures, rééditées par des fabricants français contemporains, qui témoignent de la richesse esthétique, technique et culturelle du design français du XXe siècle, ainsi que de son rayonnement international.Jean-Paul Bath a un parcours qui le qualifie pleinement pour cette mission. Ingénieur du bâtiment, il a toujours nourri un intérêt fort pour l'art et le dessin.« C'est vrai que pendant mes études d'ingénieur, j'ai beaucoup aimé le dessin d'architecture, qui est lié au design. Il y a dans l'ingénierie, un travail sur le dessin, la précision du dessin et la vision en 3D. L'innovation est aussi essentielle. Il faut comprendre comment les choses sont faites. J'ai aimé cet esprit de recherche : chercher le sens des objets. Je pense que cela m'est resté. Ce qui m'a également beaucoup influencé, c'est le lien entre la création et l'industrie ».Après avoir travaillé sur des plateformes pétrolières à l'étranger, il entame un virage professionnel et entre au Centre Pompidou pour faire du marketing (même s'il n'était pas d'usage à l'époque de parler marketing dans des institutions publiques aussi prestigieuses) puis monte une entreprise mettant en relation des artistes et des grandes entreprises pour organiser des évènements culturels. Plusieurs années après, le VIA le contacte pour le poste de DGIl estime que depuis qu'il occupe ces fonctions dans la culture, il « n'a jamais vraiment travaillé » tant les missions sont passionnantes. Le FRENCH DESIGN porte cette nécessité d'aller beaucoup plus vers l'international et notamment d'aider les PME. « On a en France cette chance d'avoir de très bon savoir-faire, de petites sociétés mais très qualitatives. Un panel d'offres que l'on ne trouve pas à l'international ».VERBATIM« J'ai un parcours un peu atypique. Je suis ingénieur du bâtiment, formé à des problématiques très techniques. Mais j'étais aussi très intéressé par la création, l'art et je voulais élargir mon champ de vision. Je suis ensuite rentré au Centre Pompidou, en commençant au bas de l'échelle.- C'est vrai que pendant mes études d'ingénieur, j'ai beaucoup aimé le dessin d'architecture, qui est lié au design. Il y a dans l'ingénierie, un travail sur le dessin, la précision du dessin et la vision en 3D. L'innovation est aussi essentielle. Il faut comprendre comment les choses sont faites. J'ai aimé cet esprit de recherche : chercher le sens des objets. Je pense que cela m'est resté. Ce qui m'a également beaucoup influencé, c'est le lien entre la création et l'industrie.- Le changement de nom de l'association de VIA à Le FRENCH DESIGN reflète la nécessité de se tourner davantage vers l'international. C'est d'ailleurs une nécessité pour toute l'industrie française. L'industrie française du meuble s'exporte surtout en Europe- Le cœur de mon métier est la relation entre les créateurs et les fabricants. Le FRENCH DESIGN dispose également d'un incubateur. Nous facilitons la relation entre créateurhttps://letraitpodcast.paris/
Le traité du Mercosur, le bras de fer des agriculteurs français
durée : 00:37:09 - Le 18/20 · Le téléphone sonne - La semaine dernière, Emmanuel Macron s'est montré “plutôt positif” sur le traité du Mercosur même s'il a entendu défendre les “intérêts de la France”. Cette sortie a été mal perçue par les agriculteurs qui ont montré leur mécontentement Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
#74 Réaction à l'interview de Gaël Faye à la Librairie Le Trait d'union
Gaël Faye est venu dans la petite commune de La Rochefoucauld en Angoumois. Il a passé l'après-midi avec de jeunes élèves, avant de faire une interview sur laquelle nous allons nous appuyer dans cet épisode.
SBS Easy French #264 : quel est le traité historique signé en Australie ?
Ecoutez le nouvel épisode de SBS Easy French. Pour recevoir la transcription de ce podcast, abonnez-vous à notre newsletter.
843 : Verdun, le traité qui a façonné l'Europe (après une guerre fratricide)
Après une violente guerre fratricide, les petits-fils de Charlemagne se partagent son Empire... En août 843, le traité de Verdun acte un découpage de l'Europe entre Lothaire, Charles le Chauve et Louis le Germanique. On peut considérer ce traité comme un "kilomètre zéro", un événement fondateur des futures nations français et allemandes ! Bonne écoute. ⚔️Un podcast du Studio Biloba, présenté par Gabriel Macé.
On peut être insolent, avoir eu une scolarité rebelle et devenir fondateur d'une école de design comme CY Ecole de design, aujourd'hui au top des classements en France après seulement 4 ans d'existence. Dominique Sciamma donne l'impression à la fois d'une grande assurance, d'une grande liberté et d'une fougue certaine...Une enfance en banlieue parisienne, un père professeur de mathématiques puis engagé dans la promotion du logement social expliquent sûrement ses deux moteurs depuis toujours : « la volonté de changer le monde » et une passion pour les maths et l'informatique, une grille de lecture du monde, une parmi d'autres, dit-il.« Je suis quelqu'un qui se fait virer de partout. Le déclic pour moi a été la découverte des mathématiques. J'aime dire non. J'ai découvert un langage. Je voulais être maître du monde. Les maths représentent un moyen de découvrir les structures du monde. Et l'informatique, c'est de la mathématique en action. Donc je dirais : les maths, c'est lire, l'informatique, c'est agir. L'important, c'est de savoir quel outil on se donne pour découvrir le monde ».Son parcours n'était pas tracé. Après des études en mathématiques, il devient professeur en lycée professionnel, se fait virer. Il reprend des études d'informatique puis entre chez Bull, où il reste pendant 12 ans cette fois. Il en garde la conviction que : « Les grandes entreprises ne sont pas toujours au courant qu'elles peuvent être des acteurs du changement. L'entreprise peut être un lieu de transformation ». Mais aussi que l'informatique, c'est de la politique, et que le numérique allait changer le monde.Il fait aussi un passage dans la presse comme directeur des éditions électroniques de La Tribune. Ces expériences le conduisent ensuite à l'école STRATE, où il devient responsable multimédia en 1998, au moment de l'explosion d'internet, avant d'être nommé directeur général en septembre 2013.On ne s'attardera pas sur la fin de son mandat à STRATE, mais il rebondit très vite et très fort en fondant CY École de Design au sein de l'université de Cergy-Pontoise. On comprend que Dominique Sciamma a créé l'école de ses rêves : une école pluridisciplinaire à l'image de ce qu'il conçoit comme le « profil complet » du designer. Il en parle avec passion et énumère :« CY a un contenu pédagogique qu'on ne trouve nulle part ailleurs : culture générale, histoire des idées politiques, culture du soin, culture du vivant, formation au dessin, volumes, perspectives, peinture, couleur, graphisme, cartographie, mais aussi philosophie, sciences humaines, design sensoriel, anthropologie... ».Dominique Sciamma a une définition très large du design qui, selon lui, n'appartient pas qu'aux designers : « ils en sont les porteurs éloquents, les garants, mais pas les propriétaires. Pour moi, le design, c'est contribuer à créer les conditions d'une expérience de vie réussie pour tous et chacun. C'est un travail d'équipe ».Il porte aussi la conviction que les écoles de design prendront la place qu'occupent aujourd'hui les écoles de management et d'ingénieurs, car la question « Pourquoi ? » remplacera les questions « Combien ? » et « Comment ? ».Bonne écoute.https://letraitpodcast.paris/
“Treaty is powerful. It's not just a document or an agreement of the past. It's a living agreement,” says Cree lawyer and advocate Deanne Kasokeo. For nearly 150 years, Treaty 5 has shaped the lives of Cree and Anishinaabe communities across northern Manitoba and Saskatchewan—and its story is far from settled. Also called the Winnipeg Treaty, it included more First Nation communities than any other in Canada and promised land, tools, education, and health care. In practice, those agreements have been unevenly realized, and communities continue to navigate their impacts today. In this episode, Kasokeo shares how her family history and her grandmother's teachings drive her to defend treaty rights and reconnect communities with their heritage. Then, Chief Maureen Brown of Opaskwayak Cree Nation reflects on the long-term effects of colonial policies, the importance of passing knowledge to the next generation, and why she remains hopeful for the future.To read the episode transcripts in French and English, and to learn more about historic Canadian milestones, please visit thewalrus.ca/canadianheritage.This podcast receives funding from The Government of Canada and is produced by The Walrus Lab.Check out the French counterpart podcast, Voyages dans l'histoire canadienne.--Aussi longtemps que coulera la rivière : L'héritage du Traité numéro 5« Le Traité numéro 5 est un outil puissant. Ce n'est pas simplement un document ou un accord du passé. C'est un document vivant, » affirmait l'avocate et défenseure des droits des peuples cris, Deanne Kasokeo. Depuis 150 ans, il façonne la vie des peuples cris et anichinabés du nord du Manitoba et de la Saskatchewan, et cette question demeure loin d'être résolue. Également connu sous le nom de Traité de Winnipeg, il a impliqué le plus grand nombre de communautés des Premières Nations au Canada, offrant des promesses de terres, d'outils, d'éducation et de soins de santé. Cependant, ces engagements ont été mis en œuvre de manière inégale. Les communautés des Premières Nations continuent de subir les conséquences au quotidien. Dans cet épisode, Deanne Kasokeo nous parle de l'histoire de sa famille et de l'impact des enseignements de sa grand-mère sur son engagement à défendre les droits issus des traités, tout en œuvrant pour reconnecter les communautés à leur héritage. Ensuite, la cheffe Maureen Brown de la Nation crie d'Opaskwayak partage ses réflexions sur les effets à long terme des politiques coloniales, l'importance de la transmission des savoirs aux nouvelles générations et les raisons qui nourrissent son optimisme pour l'avenir.Pour lire les transcriptions des épisodes en français et en anglais, et pour en savoir plus sur les jalons historiques canadiens, veuillez visiter le site thewalrus.ca/canadianheritage.Ce balado reçoit des fonds du gouvernement du Canada et est produit par The Walrus Lab.Découvrez le balado en français, Voyages dans l'histoire canadienne. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Le traité pour protéger la haute mer entrera en vigueur en janvier 2026
durée : 00:14:44 - Journal de 12h30 - Après des années d'attente pour les défenseurs des océans, le traité pour protéger la haute mer, désormais ratifié par 60 pays, prendra enfin vie fin janvier, donnant au monde un outil inédit pour mettre à l'abri des écosystèmes marins vitaux pour l'humanité. - réalisation : Alix Forgeot
Le traité pour protéger la haute mer entrera en vigueur en janvier 2026
durée : 00:14:44 - Journal de 12h30 - Après des années d'attente pour les défenseurs des océans, le traité pour protéger la haute mer, désormais ratifié par 60 pays, prendra enfin vie fin janvier, donnant au monde un outil inédit pour mettre à l'abri des écosystèmes marins vitaux pour l'humanité. - réalisation : Alix Forgeot
Un chef de cuisine est recherché pour Vézac en Dordogne
durée : 00:00:53 - Un chef de cuisine est recherché pour Vézac en Dordogne - En Dordogne, Le Trait d'Union, un bistrot, brasserie et guinguette situé à Vézac, en plein cœur du Périgord Noir, est à la recherche de son futur chef de cuisine. Ici, on ne fait pas que de la cuisine. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Laurence Benaïm : le goût des autresNous cherchions à interviewer Laurence Benaïm depuis près d'un an. Mais avec autant de casquettes ; journaliste (elle a travaillé pour Le Monde, L'Express et fondé Stiletto), auteur, éditrice, biographe (Saint Laurent, Marie-Laure de Noailles, Dior...) et une nouvelle biographie de la peintre italo-argentine Leonor Fini à paraître, en septembre, chez Gallimard, l'entretien a finalement eu lieu au début de l'été, à l'hôtel Nolinski (Paris 1er), un lieu qu'elle connaît bien. Elle y organise régulièrement des rencontres avec des designers et des créateurs, portée par le désir de transmettre son goût des autres, et en particulier pour les créateurs qu'elle soutient avec une passion indéfectible...Dans son roman « La sidération », paru en 2021, elle raconte son histoire familiale et évoque son grand père maternel polonais qui fabriquait des chapeaux et qui lui a, peut-être, transmis le goût des gestes, de l'artisanat :« J'aime la vérité et le silence des ateliers, dit-elle, la vérité des gestes, les instruments, les mots de la technique qui sont les complices de la main». Elle retrace l'histoire de ses parents médecins, juifs sépharades du côté de son père (Algérie) et ashkénazes du côté de sa mère, elle, installée à Paris durant la seconde guerre et qui doit se cacher à la campagne ; un épisode qu'elle ne racontera jamais vraiment. Sa mère ne se confiait d'ailleurs pas beaucoup et c'est son histoire, en particulier, que Laurence Benaïm s'attache à retracer dans ce roman alors qu'elle tombe gravement malade. « C'est un livre écrit sous forme d'une grande lettre : ce que je n'ai pas pu lui dire ».Elle a voulu « documenter », dit-elle, l'histoire de sa mère comme elle « documente » ses biographies : un travail d'enquête « Tout savoir, s'imprégner pour arriver à quelque chose de poétique ». La biographie de Saint-Laurent, qui est devenue un ouvrage de référence, lui a pris à peu près sept ans. Elle cite comme modèle Stephen Zweig et Pierro Citati.Laurence Benaïm est aussi la biographe du décorateur d'intérieur Jean-Michel Frank (1895-1941). Laurence Benaïm le raconte joliment : « Le personnage s'est imposé, car j'aime les grands silencieux :il était à la fois célèbre et inconnu. Il n'a pas vraiment donné d'interviews. Son travail a finalement été extrêmement copié et a, en même temps, quelque peu disparu. Il n'a fait partie d'aucun groupe, il était solitaire. J'ai été attiré par cette personnalité. Jean Cocteau disait qu'il donnait l'impression que ses intérieurs avaient été cambriolés. Il y a dans ses créations une forme d'opulence dans la retenue, une grande sensualité associée à une grande rigueur. Une épure qui est la grâce mais n'est pas de la raideur ou du minimalisme. Comme un tailleur de diamants, il enlève pour ajouter de la lumière. Même son dépouillement a quelque chose de solaire ».Laurence Benaïm aime autant tant l'extravagance que la retenue quand ils sont, l'un ou l'autre « au service d'un propos ou d'une intention. Je n'aime pas les choses obligatoires ou imposées, sans regard ».Elle a récemment apprécié le travail d'Edi Dubien au Musée de la Chasse. Elle aime aussi Claire Tabouret, « une artiste qui cultive le sens du trait et du regard », ainsi que Jean-Philippe Delhomme.Dans cet épisode du Trait, Laurence Benaïm nous raconte son parcours et évoque son travail en prenant toujours soin de choisir ses mots, ce qui finalement l'importe plus que tout.VERBATIM- «J'apprends avec le temps à essayer de me délester de mes notes de lecture, qui sont comme des épingles accrochées à des robes.- Le créateur, c'est celui qui dessine, qui a des idées, les met en scène, raconte des histoires. L'artisan, c'est le premier d'atelier qui peut tout changer à cause d'un entoilage.-La virtuosité, j'essaie de la mettre dans les mots.»https://letraitpodcast.paris/
Olivier Poivre d'Arvor : "On aura nos 60 ratifications et le traité sur la haute mer va pouvoir entrer en vigueur"
durée : 00:13:52 - L'invité du 13/14 - "Cinquante-cinq pays" ont ratifié le traité sur la haute mer, annonce ce vendredi sur France Inter l'ambassadeur français pour les océans Olivier Poivre d'Arvor. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
A l'hôtel avec Natacha FrogerLe Trait poursuit sa réflexion sur le design et l'« hospitalité » avec Nathalie Froger, architecte d'intérieur chez ATOME associés. Elle nous partage sa vision dans cet épisode.Issue d'une école d'arts appliqués, Natacha Froger a toujours souhaité évoluer dans ce secteur. L'emblématique collaboration entre la designer André Putman et Ian Schrager, co-fondateur du célèbre Studio 54, qui a donné naissance au légendaire hôtel Morgans à New York en 1984, a profondément inspiré son choix de carrière. Cet hôtel a marqué une rupture majeure dans le monde de l'hôtellerie, en réinventant les codes de l'accueil.Natacha Froger explique également l'équation économique singulière qui régit le secteur hôtelier et la résilience dont cette industrie a fait preuve depuis la crise COVID-19. Elle souligne aussi la nécessité d'offrir une expérience unique, portée par la création d'un lieu doté d'âme et de sens, notamment grâce à la collaboration avec un architecte d'intérieur.Selon elle, les hôteliers ont compris qu'ils doivent aller plus loin. « Et nous, concepteurs, avons un rôle clé à jouer dans cette transformation. »VERBATIM« Je suis profondément attachée à cette notion de "ville dans la ville". Un hôtel est un lieu qui rassemble toutes les fonctions essentielles : l'accueil, la restauration, le bien-être, le travail. C'est un écosystème à part entière.L'hôtellerie se décline selon des positionnements économiques très variés, du plus accessible au grand luxe. Notre défi est de concevoir un produit qui réponde précisément aux attentes d'un segment défini, tout en conservant une ambition d'excellence.Ce que j'ai toujours recherché dans mes équipes, ce sont des profils pluriels, des talents venus d'horizons différents, capables d'enrichir le projet par la diversité de leurs regards.Le programme est la colonne vertébrale du projet. Il intègre toutes les données économiques et de gestion nécessaires à l'exploitation de l'hôtel. C'est sur cette base solide que l'on conçoit un produit cohérent, désirable, et surtout pérenne. Il ne s'agit pas seulement de créer un bel objet, mais de proposer un outil de travail performant pour l'exploitant. »https://letraitpodcast.paris/
Le Trait a rencontré le « créateur » Mathias au salon « Révélations », qui a eu lieu au Grand palais en mai dernier.Mathias est le nom qu'il a emprunté à 29 ans pour repartir à zéro. Il s'est alors installé comme artisan rue de Charenton (12e) : «Cela a été 15 ans de labeur ; une période très perturbante, très difficile. Je me suis toujours dit que si je m'en sortais, j'aiderais les jeunes ». Il a tenu sa promesse en lançant l'association Matières libres en 2015 qui chaque année octroie le Prix Mathias doté d'une somme de 6000 euros, ouvert aux jeunes créateurs de moins de 30 ans sortant d'écoles ou autodidactes. Le jury est choisi parmi des personnalités des arts appliqués, du design, de la décoration, des médias ou chefs d'entreprise. L'originalité, le savoir-faire et la liberté créative sont particulièrement récompensés. Depuis 2023, la maison Baccarat (avec laquelle Mathias collabore depuis toujours dans son travail de designer) décerne aussi le prix «Alchimie de la joie», une résidence d'un mois à la manufacture Baccarat (Meurthe-et-Moselle). Il est encore possible de candidater pour le prix 2025 (jusque fin juillet).La découverte du verre a été capitale. Il trouve un procédé de verrerie qui pendant 15 ans lui a permis de «faire la plus belle verrerie du monde, après on m'a copié. Je me suis rendu compte que je pouvais utiliser d'autres matières. J'ai fait des couverts, des nappes ... ». La griffe Matthias était partout. Mathias estime que les jeunes designers doivent résister et imposer leur signature, même si c'est difficile. « La signature, c'est la vie ».Matthias a accepté de nous raconter avec passion et une grande émotion son parcours...institut-savoirfaire.fr/sites/default/files/brochure_-_mathias_matieres_libres_2019.pdfRévélations biennale internationale des métiers d'art et créationVERBATIM«J'ai commencé en 1972 au fond d'une cour d'immeuble. J'étais heureux mais le défi était de réussir et d'être reconnu.»«La parution dans un magazine vous donne la reconnaissance mais ne vous fait pas vivre. À l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux pour se faire connaître.»«J'ai pris l'appellation : Créations Mathias. Pour moi, création, c'est le mot essentiel de la vie. Mais personne ne l'utilisait à l'époque. Je ne me dis pas designer, c'est un terme anglais qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait. Le mot designer ne rend pas compte du métier de la main. Je ne me revendique pas artiste. Dès que l'on produit en multiple, nous ne sommes plus des artistes.»«La signature c'est la richesse de la vie.»«L'âme est ce qu'il y a de plus important dans la création.»https://letraitpodcast.paris/
N'oubliez pas le trait d'union ! du 05 juillet 2025
Les mots composés, il y en a des centaines en français, du siège-auto à l'appuie-tête, en passant par essuie-glace, belle-mère, grand-père, après-midi, Ile-de-France, Champs-Elysées, Saint-Flour, presse-citron, sèche-cheveux, crève-cœur, perce-oreille, trompe-l'œil, casse-pieds, casse-noisette, casse-bonbons.... Un véritable inventaire à la Prévert !Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Fordo, Natanz, Ispahan. Dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin, trois noms sont entrés dans l'actualité mondiale. Trois sites nucléaires iraniens visés par une série de frappes américaines, appuyées par Israël. Trois cibles symboliques du bras de fer nucléaire qui agite à nouveau le Moyen-Orient… et au-delà. Selon Donald Trump, le programme nucléaire iranien a été, je cite, « totalement détruit ». Mais un rapport du Pentagone, classifié puis fuité, parle lui d'un simple retard de quelques mois. Pourtant, depuis les années 1970, un accord est censé empêcher ces conflits : le Traité de non-prolifération nucléaire ? Il repose sur trois piliers : empêcher la prolifération des armes nucléaires, favoriser l'usage pacifique du nucléaire civil, et tendre un jour vers le désarmement. Alors, est-ce la fin d'un ordre nucléaire ? Le TNP est-il en train de mourir à petit feu ? Ou reste-t-il, malgré tout, un cadre indispensable, un garde-fou imparfait mais vital ? Avec : - Benjamin Hautecouverture, maître de recherche pour la Fondation pour la recherche stratégique - Emmanuelle Maître, maître de recherche pour la fondation pour la recherche stratégique.
Ce matin Romano refait la carte vitale des Français, le trait d'union de leur prénom pose problème ! Les conseils pas chers sur Skyrock !
Dans cette cinquième et dernière partie de notre série consacrée au Traité théologico-politique (TTP) de Spinoza, on étudie maintenant les chapitres finaux (en particulier le chapitre XX) du traité, et on réfléchit au sens du propos de Spinoza sur la liberté d'expression.
durée : 00:04:10 - Chroniques littorales - par : Jose Manuel Lamarque - Le Traité sur la haute Mer, acronyme BBNJ, sera sur la table de la 3ème Conférence des Nations Unies sur l'Océan, l'UNOC, à Nice la semaine prochaine. Qui mieux qu'Hervé Berville pour en débattre, ancien ministre de la mer et député breton…
Dans cette quatrième partie de la série consacrée au Traité théologico-politique (TTP) de Spinoza, on se penche sur les chapitres 7 à 11, qui sont consacrés à l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Dans ces chapitres, Spinoza tente d'historiciser les Écritures, et d'en tirer les conclusions qui s'imposent concernant leurs origines humaines
durée : 00:53:47 - Questions d'islam - par : Ghaleb Bencheikh - Le professeur Yann Richard présente pour le public francophone les Fulgurances d'Ahmad Ghazali, ce traité persan sur l'amour après l'avoir traduit et commenté. Il viendra présenter ce texte brûlant qui rappelle le dramatique engagement de l'amour sans lequel toute vie humaine est vaine. - réalisation : François Caunac - invités : Yann Richard Professeur émérite à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Dans cet épisode on poursuit les réflexions et l'étude du Traité théologico-politique. On s'intéresse cette fois à la question des miracles, ce que Spinoza nous en dit dans le TTP et ce que cela implique concernant la nature de la réalité, Dieu, la religion etc.
Pourquoi est-il si compliqué de fabriquer des armes nucléaires ?
Fabriquer une arme nucléaire, ce n'est pas simplement assembler des composants explosifs. C'est une des entreprises technologiques, scientifiques et industrielles les plus complexes jamais réalisées par l'être humain.La première grande difficulté, c'est la matière fissile. Deux substances peuvent être utilisées dans une bombe : l'uranium hautement enrichi (à plus de 90 % d'uranium 235) ou le plutonium 239. Or, dans la nature, l'uranium est présent à plus de 99 % sous forme d'uranium 238, inutile pour une bombe. Enrichir l'uranium, c'est donc séparer les isotopes, ce qui est extrêmement difficile.Les techniques d'enrichissement, comme la centrifugation gazeuse, demandent des infrastructures gigantesques, un contrôle précis, des matériaux résistants à des contraintes extrêmes, et surtout… du temps. C'est pourquoi la plupart des pays ne peuvent tout simplement pas le faire en secret.Deuxième option : le plutonium. Lui n'existe presque pas à l'état naturel. Il faut le produire dans un réacteur nucléaire spécifique, puis le séparer chimiquement du combustible irradié. Là encore, c'est une technologie très avancée, nécessitant des installations industrielles rares et surveillées.Ensuite vient le défi de l'implosion. Une bombe nucléaire ne se contente pas de faire exploser la matière fissile : il faut la comprimer de manière quasi parfaite, avec des explosifs classiques disposés autour du noyau fissile pour provoquer une réaction en chaîne. Ce système, appelé "détonateur à implosion", doit fonctionner à la microseconde près. Le moindre défaut, et l'arme ne fonctionne pas.Autre obstacle : la miniaturisation. Si une bombe nucléaire pèse plusieurs tonnes et ne peut pas être transportée efficacement, elle perd tout intérêt militaire. Les véritables puissances nucléaires maîtrisent la miniaturisation de leurs têtes nucléaires pour les placer sur des missiles balistiques. Cela nécessite une maîtrise avancée des matériaux, du design et des simulations nucléaires complexes.Enfin, il y a le secret et la non-prolifération. Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) limite très strictement l'accès aux technologies sensibles. De plus, les agences de renseignement internationales, comme l'AIEA, surveillent en permanence les installations suspectes.Bref, fabriquer une arme nucléaire, c'est réunir des compétences en physique nucléaire, en chimie, en ingénierie de précision, en explosifs, en logistique industrielle… tout en échappant à la surveillance internationale. C'est un véritable casse-tête technologique et politique. Et c'est précisément cette difficulté qui a permis, jusqu'à présent, de limiter le nombre de puissances nucléaires dans le monde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pierre MARLET revient sur le Traité de Brest-Litovsk signé le 3 mars 1918 et qui mettra fin aux combats et à la guerre sur le front de l'Est lors de la Première Guerre mondiale. Merci pour votre écoute N'hésistez pas à vous abonner également aux podcasts des séquences phares de Matin Première: L'Invité Politique : https://audmns.com/LNCogwPL'édito politique « Les Coulisses du Pouvoir » : https://audmns.com/vXWPcqxL'humour de Matin Première : https://audmns.com/tbdbwoQRetrouvez tous les contenus de la RTBF sur notre plateforme Auvio.be Retrouvez également notre offre info ci-dessous : Le Monde en Direct : https://audmns.com/TkxEWMELes Clés : https://audmns.com/DvbCVrHLe Tournant : https://audmns.com/moqIRoC5 Minutes pour Comprendre : https://audmns.com/dHiHssrEt si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement.
Biennale d'art contemporain de Lyon: le trait migrateur de Chourouk Hriech
Un tunnel long comme la carlingue d'un avion, des photos de clés de Gaza, un mur recouvert de pages d'un livre, la 17e Biennale de Lyon multiforme, réunit sur neuf sites 78 artistes français et étrangers, confirmés et émergents. Aux Grandes Locos, le cœur battant de l'événement, l'artiste franco-marocaine Chourouk Hriech présente ses dessins au crayonné fantastique dans une immense tente khaïma, abritant un monde libre comme les oiseaux.► Biennale d'art contemporain de Lyon jusqu'au 5 janvier 2025
Représenter le ciel (5/5) : Les lois de l'espace
En 1967, avec la Guerre froide, la Guerre au Vietnam en cours, celles du Cambodge et du Biafra qui commencent, tandis que la Chine fait exploser sa deuxième bombe nucléaire, l'ambiance mondiale n'est pas au beau fixe. Pourtant cette année-là, il y a un évènement de consensus: un accord inédit dans l'histoire de l'Humanité. Le Traité de l'espace fixe le comportement des Etats dans leurs explorations à venir. Le titre de cette décision collective est long et poétique : le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. On le décrypte avec Philippe Achilleas, professeur de droit public à Paris-Sud et directeur de l'Institut du droit de l'espace qui le connait bien.
Emmanuel Macron contre le traité du Mercosur : quel avenir pour nos agriculteurs ?
Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs, Pascale de La Tour du Pin reçoit deux invités pour des débats d'actualités. Avis tranchés et arguments incisifs sont aux programmes de 19h30 à 21h00.
Expliquez-nous par Laurent Neumann : Mercosur, le traité redouté par les agriculteurs - 25/10
Tous les matins à 7h50, Laurent Neumann prend le temps d'expliquer simplement un phénomène d'actualité complexe. Un rendez-vous pédagogique indispensable pour trouver les réponses aux questions soulevées par l'actualité du jour.
Les imaginaires paysans face aux phénomènes climatiques extrêmes, avec Jean-Pierre Devroey
Faites un don et recevez un cadeau : http://don.storiavoce.com/ Au cours de la période médiévale, l'économie paysanne est centrée sur les productions agricoles, l'élevage et la viticulture. La perception des épisodes météorologiques se trouve particulièrement influencée par la proximité de l'homme avec la nature, mais également par les institutions politiques et religieuses mises en place par les Carolingiens. Ainsi, l'éloignement ou la proximité avec les seigneurs laïcs et ecclésiastiques influencent le type de réponse face aux menaces du ciel. Le Traité sur la grêle et le tonnerre d'Agobard de Lyon permet de mieux comprendre le terreau politique et religieux sur lequels se développent les imaginaires paysans. De multiples aspects culturels, psychologiques et sociaux apparaissent, ce qui nous éclaire sur les manières d'appréhender le climat au cours du haut Moyen Âge. Tempestaires, rites païens, sorcières sont ainsi analysés sous le regard d'un religieux du IXe siècle. L'invité : Professeur émérite à l'université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique, Jean-Pierre Devroey est l'un des plus grands spécialistes des sociétés du haut Moyen Âge. Après avoir publié La Nature et le Roi. Environnement, pouvoir et société à l'âge de Charlemagne (740-820) (Albin Michel, 2019, 592 p. 25€), il vient de faire paraître De la grêle et du tonnerre. Histoire médiévale des imaginaires paysans, (Seuil, 2024, 448 p. 26 €). *** Facebook : https://www.facebook.com/HistoireEtCivilisationsMag Instagram : https://www.instagram.com/histoireetcivilisations/ Twitter : https://twitter.com/Storiavoce
L'Affaire Calas, d'une erreur judiciaire à un appel à la tolérance
En 1761, un père de famille protestant est accusé d'avoir tué de ses mains son propre fils parce qu'il voulait se convertir au catholicisme. Le procès et la condamnation de Jean Calas font tant de bruit qu'ils parviennent aux oreilles de Voltaire, alors en exil en Suisse. Fervent défenseur de la tolérance, l'homme des Lumières fait du procès Calas l'une des plus célèbres affaires judiciaires françaises, et un réquisitoire contre le fanatisme religieux. L'affaire Calas aurait pu rester un banal fait divers, mais le contexte religieux extrêmement tendu du XVIIIe siècle lui donne une autre tournure. Depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, le protestantisme est officiellement interdit et ses fidèles subissent des vagues de répression. La famille Calas, qui réside à Toulouse, compte parmi les quelque 200 protestants de la ville de 50 000 habitants. Le 13 octobre 1761, le père de la famille, Jean Calas, retrouve son fils aîné pendu. Pour cacher l'infamie du suicide, il prétend que c'est un assassinat. Mais l'enquête se retourne contre le père Calas : la rumeur court qu'il aurait lui-même tué son fils qui souhaitait se convertir au catholicisme ! Jean Calas est condamné à mort, torturé et exécuté en mars 1762. Contraint à l'exil par Louis XV, Voltaire ne s'est pas engagé aux côtés de Calas pendant le procès. C'est en examinant l'affaire de plus près que l'écrivain se persuade que le fanatisme des juges catholiques doit être condamné. Le Traité sur la Tolérance qu'il rédige pour démontrer l'innocence de Calas, qui a agité toutes les cours européennes à sa sortie, est un texte intemporel. En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, il s'est arraché en librairie. Thèmes abordés : procès, religion, édit de Nantes, catholicisme, protestantisme "Au cœur de l'histoire" est un podcast Europe 1 Studio- Présentatrice : Virginie Girod - Auteure : Sandrine Brugot- Production : Caroline Garnier- Réalisation : Nicolas Gaspard- Direction artistique : Julien Tharaud- Composition de la musique originale : Julien Tharaud et Sébastien Guidis- Edition et Diffusion : Nathan Laporte- Promotion et Coordination des partenariats : Marie Corpet- Visuel : Sidonie Mangin Sources https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/laffaire-calas https://books.openedition.org/pumi/26196?lang=fr https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-marche-de-l-histoire/voltaire-et-l-affaire-calas-1993220 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/autant-en-emporte-l-histoire/autant-en-emporte-l-histoire-du-samedi-14-janvier-2023-5337190 https://www.philomag.com/articles/le-traite-sur-la-tolerance-de-voltaire-large-succes-dans-les-librairies Découvrez l'abonnement "Au Coeur de l'Histoire +" et accédez à des heures de programmes, des archives inédites, des épisodes en avant-première et une sélection d'épisodes sur des grandes thématiques. Profitez de cette offre sur Apple Podcasts dès aujourd'hui !
Saint François de Sales ou l'exigence évangélique 2024-05-07 Le Traité de l'amour de Dieu
Thème: Pour donner envie de lire le Traité de l'amour de Dieu Avec Chantal Touvet, auteur de « Histoire des sanctuaires de Lourdes » (éditions NDL, 3 tomes) et de « Tout commença par un souffle » (édtions Béatitudes)
Représenter le ciel (5/5) : les lois de l'espace
En 1967, avec la Guerre froide, la Guerre au Vietnam en cours, celles du Cambodge et du Biafra qui commencent, tandis que la Chine fait exploser sa deuxième bombe nucléaire, l'ambiance mondiale n'est pas au beau fixe. Pourtant cette année-là, il y a un évènement de consensus: un accord inédit dans l'histoire de l'Humanité. Le Traité de l'espace fixe le comportement des Etats dans leurs explorations à venir. Le titre de cette décision collective est long et poétique : le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. On le décrypte avec Philippe Achilleas, professeur de droit public à Paris-Sud et directeur de l'Institut du droit de l'espace qui le connait bien.
La Sorcellerie, ses réalités , ses types, son danger et comment le traité - Oustaaz Oumar DIALLO
La Sorcellerie, ses réalités , ses types, son danger et comment le traité - Oustaaz Oumar DIALLO by XamSaDine
Pourquoi le traité de Lausanne (1923) a-t-il privé les Kurdes d'un État indépendant ?
durée : 00:03:39 - Le Pourquoi du comment : histoire - par : Gérard Noiriel - Pour comprendre pourquoi le Kurdistan n'est pas devenu un État indépendant, il faut rappeler que le modèle politique des États-nations, fondé sur le principe de la souveraineté du peuple, s'est imposé en Europe et en Amérique au 19e siècle.
Les agriculteurs n'en veulent pas. Emmanuel Macron va refuser de signer ce traité de libre échange. Qu'est-ce qu'il y a de si menaçant dans cet accord ? Ne fait-il que des perdants ? Certains pays défendent-ils ce traité ? Ecoutez L'éco & You du 01 février 2024 avec Martial You.
Pourquoi dit-on que le Traité de Paris (1763) a mis fin à la "Première Guerre mondiale" ?
durée : 00:03:36 - Le Pourquoi du comment : histoire - par : Gérard Noiriel - La guerre de Sept Ans – qui s'est terminée par le traité de Paris en 1763 - a provoqué une césure majeure non seulement dans l'histoire de l'Europe, mais même dans l'histoire mondiale.
LE LIVRE DU JOUR - "Le traité sur les apparitions et les vampires" d'A. Calmet et Philippe Charlier
Découvrez le livre du jour des Grosses Têtes. Retrouvez tous les jours le meilleur des Grosses Têtes en podcast sur RTL.fr et l'application RTL.