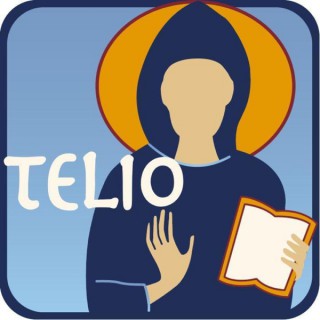Podcasts about ainsi
- 2,261PODCASTS
- 11,868EPISODES
- 31mAVG DURATION
- 1DAILY NEW EPISODE
- Jan 30, 2026LATEST
POPULARITY
Categories
Best podcasts about ainsi
Latest news about ainsi
- Être vieux dans le monde grec: De Solon à Philopœmen AWOL - The Ancient World Online - Dec 22, 2025
- Tapping Into Africa’s 230-Million AI Jobs Opportunity Memeburn - Oct 7, 2025
- Unconscious mind player box organizer Thingiverse - Newest Things - Mar 13, 2025
- Lachez Tout - Annie Le Brun libcom.org - Dec 23, 2024
- De Naïja à Abidjan Africa Is a Country - Sep 11, 2024
- Média Web Services WatchUSeek Watch Forums - Jun 10, 2024
- Atlas Stream Processing est désormais disponible ! MongoDB | Blog - May 2, 2024
- Gâchis Astronomique LessWrong - Apr 26, 2024
- Arturia teasing announcement, livestream keynote for Tuesday CDM Create Digital Music - Apr 8, 2024
Latest podcast episodes about ainsi
Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle jugé une “sorcière” en 1944 ?
L'histoire d'Helen Duncan est l'une des plus incroyables anomalies du XXᵉ siècle. Car oui : en pleine Seconde Guerre mondiale, au cœur d'une Grande-Bretagne moderne, avec radars, avions et bombes, une femme est condamnée… sous une loi sur la sorcellerie. Elle est souvent présentée comme la dernière “sorcière” emprisonnée au Royaume-Uni.Helen Duncan naît en Écosse en 1897. Elle grandit dans un monde où le spiritisme est très populaire : après la Première Guerre mondiale, des milliers de familles endeuillées cherchent à “parler” avec les morts. Duncan devient médium et organise des séances. Elle prétend faire apparaître des esprits grâce à une substance mystérieuse : l'ectoplasme, qu'elle “produit” devant les participants. Beaucoup y croient. D'autres dénoncent un spectacle… voire une arnaque.Tout bascule pendant la Seconde Guerre mondiale.En 1941, lors d'une séance, Helen Duncan aurait annoncé le naufrage du cuirassé britannique HMS Barham, alors que l'information n'avait pas encore été rendue publique. Dans une période où tout est sous contrôle militaire, l'affaire inquiète : comment cette femme aurait-elle pu connaître un secret de guerre ? Don ou fuite d'information ? Les autorités prennent l'affaire très au sérieux.En janvier 1944, elle est arrêtée lors d'une séance à Portsmouth. Le procès qui suit est surréaliste. Plutôt que de l'accuser simplement de fraude, l'État choisit une arme juridique plus spectaculaire : le Witchcraft Act de 1735, une loi qui ne punit pas la “magie” au sens médiéval, mais le fait de prétendre avoir des pouvoirs surnaturels.Autrement dit : Helen Duncan n'est pas condamnée parce que le tribunal croit aux sorcières… mais parce qu'on l'accuse de manipuler le public en se faisant passer pour une sorcière ou une intermédiaire avec les morts. Elle est condamnée à neuf mois de prison.Cette histoire devient un symbole : celui d'un pays qui, en temps de guerre, utilise un vieux texte archaïque pour faire taire une personne jugée gênante. Après sa libération, Duncan promet d'arrêter… mais continue. Elle sera de nouveau arrêtée plus tard, et meurt en 1956.Son cas choque durablement l'opinion. Et il contribue à une réforme : en 1951, le Witchcraft Act est abrogé et remplacé par une loi visant plus directement les fraudes spirites.Ainsi, Helen Duncan restera dans l'histoire comme une figure trouble et fascinante : pour certains, une escroc ; pour d'autres, une victime d'une chasse aux sorcières moderne — au sens presque littéral. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Fashion Week : secrets et coulisses de la haute couture
Cette année, la Fashion Week a encore battu son plein à Paris. Mais derrière les podiums et les flashs, il y a surtout des semaines de travail intense. Rose Torrente, fondatrice de la maison Torrente, a habillé des générations de femmes et de grandes stars. À travers ses souvenirs, elle redonne à la haute couture son vrai visage : celui du travail, de l'exigence, mais aussi des rapports de force. En studio également, Martine Houdet, qui a passé près de 50 ans dans les ateliers de Dior et Chanel, nous plonge dans l'envers du décor : le travail précis des "petites mains". Ainsi que Sophie Brafman, journaliste, animatrice et chroniqueuse mode, elle décryptera la mode d'aujourd'hui et ce que nos vêtements disent de nous.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
La Guadeloupe porte un nom qui sonne presque comme une évidence aujourd'hui… mais il est en réalité le résultat d'un choc entre deux mondes : les Caraïbes amérindiens et l'Europe de la fin du XVe siècle. Et derrière ce nom, il y a une histoire étonnante, à la fois religieuse, politique et coloniale.Avant l'arrivée des Européens, l'île n'avait évidemment pas “Guadeloupe” pour nom. Les peuples amérindiens qui l'habitaient — notamment les Kalinagos, qu'on appelle souvent Caraïbes — utilisaient d'autres noms. Le plus connu est “Karukera” ou “Karu Kera”, souvent traduit par “l'île aux belles eaux”, en référence à ses rivières, cascades et sources abondantes. Cette expression correspond parfaitement au paysage guadeloupéen : une île volcanique, verte, humide, généreuse en eau douce.Le nom “Guadeloupe” apparaît au moment de la seconde expédition de Christophe Colomb vers le “Nouveau Monde”. En novembre 1493, Colomb atteint l'île. Et comme souvent à cette époque, il ne reprend pas le nom local : il la rebaptise selon ses propres références culturelles, religieuses et symboliques. Il l'appelle “Santa María de Guadalupe”.Ce choix n'est pas anodin. En Espagne, “Guadalupe” est un lieu extrêmement célèbre : le monastère royal de Santa María de Guadalupe, situé en Estrémadure. C'est l'un des grands sanctuaires de la chrétienté ibérique, associé à une Vierge noire très vénérée. Le site est un symbole puissant de l'Espagne catholique, dans une période où la monarchie veut affirmer son autorité et sa mission religieuse.Il faut se souvenir que 1492-1493, ce sont les années où l'Espagne est en pleine exaltation : la Reconquista vient de s'achever avec la prise de Grenade, les souverains catholiques Isabelle et Ferdinand affirment un projet impérial, et l'expansion maritime s'accompagne d'une lecture spirituelle du monde : explorer, c'est aussi “christianiser”.Donc, en nommant l'île “Guadalupe”, Colomb fait plus que baptiser un territoire : il l'inscrit dans un imaginaire chrétien et espagnol. C'est une manière de marquer la possession symbolique : renommer, c'est déjà prendre.Avec le temps, “Santa María de Guadalupe” se raccourcit et devient “Guadeloupe”. Le nom s'impose, malgré la colonisation française ultérieure, et finit par effacer dans les usages officiels les noms amérindiens plus anciens.En résumé : la Guadeloupe s'appelle ainsi parce que Christophe Colomb l'a rebaptisée en 1493 en hommage à la Vierge de Guadalupe, grande figure religieuse espagnole. Un nom qui raconte à lui seul l'entrée brutale des Caraïbes dans l'histoire européenne. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-elle jugé une “sorcière” en 1944 ?
Pour écouter les deux épisodes recommandés:1/ Pourquoi votre opinion change-t-elle sans que vous ne vous en rendiez compte ?Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/us/podcast/pourquoi-votre-opinion-change-t-elle-sans-que-vous/id1048372492?i=1000746638428Spotify:https://open.spotify.com/episode/0dzW7snN390LBqxeDluaoW?si=kTTF4LlVSMGVOQ9S_5XAEA2/ Dans quel pays est-il interdit de chanter en playback ?Apple Podcast:https://podcasts.apple.com/us/podcast/dans-quel-pays-est-il-interdit-de-chanter-en-playback/id1048372492?i=1000746550059Spotify:https://open.spotify.com/episode/3Ocem5LLM6sPtRnuyrll6W?si=MEBGO8qeSFGMVpiqLh9_3A--------------------------L'histoire d'Helen Duncan est l'une des plus incroyables anomalies du XXᵉ siècle. Car oui : en pleine Seconde Guerre mondiale, au cœur d'une Grande-Bretagne moderne, avec radars, avions et bombes, une femme est condamnée… sous une loi sur la sorcellerie. Elle est souvent présentée comme la dernière “sorcière” emprisonnée au Royaume-Uni.Helen Duncan naît en Écosse en 1897. Elle grandit dans un monde où le spiritisme est très populaire : après la Première Guerre mondiale, des milliers de familles endeuillées cherchent à “parler” avec les morts. Duncan devient médium et organise des séances. Elle prétend faire apparaître des esprits grâce à une substance mystérieuse : l'ectoplasme, qu'elle “produit” devant les participants. Beaucoup y croient. D'autres dénoncent un spectacle… voire une arnaque.Tout bascule pendant la Seconde Guerre mondiale.En 1941, lors d'une séance, Helen Duncan aurait annoncé le naufrage du cuirassé britannique HMS Barham, alors que l'information n'avait pas encore été rendue publique. Dans une période où tout est sous contrôle militaire, l'affaire inquiète : comment cette femme aurait-elle pu connaître un secret de guerre ? Don ou fuite d'information ? Les autorités prennent l'affaire très au sérieux.En janvier 1944, elle est arrêtée lors d'une séance à Portsmouth. Le procès qui suit est surréaliste. Plutôt que de l'accuser simplement de fraude, l'État choisit une arme juridique plus spectaculaire : le Witchcraft Act de 1735, une loi qui ne punit pas la “magie” au sens médiéval, mais le fait de prétendre avoir des pouvoirs surnaturels.Autrement dit : Helen Duncan n'est pas condamnée parce que le tribunal croit aux sorcières… mais parce qu'on l'accuse de manipuler le public en se faisant passer pour une sorcière ou une intermédiaire avec les morts. Elle est condamnée à neuf mois de prison.Cette histoire devient un symbole : celui d'un pays qui, en temps de guerre, utilise un vieux texte archaïque pour faire taire une personne jugée gênante. Après sa libération, Duncan promet d'arrêter… mais continue. Elle sera de nouveau arrêtée plus tard, et meurt en 1956.Son cas choque durablement l'opinion. Et il contribue à une réforme : en 1951, le Witchcraft Act est abrogé et remplacé par une loi visant plus directement les fraudes spirites.Ainsi, Helen Duncan restera dans l'histoire comme une figure trouble et fascinante : pour certains, une escroc ; pour d'autres, une victime d'une chasse aux sorcières moderne — au sens presque littéral. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Chez les personnes de plus de 40 ans, l'arthrose et les douleurs associées à cette forme de rhumatisme représentent le premier motif de consultation médicale, après les maladies cardiovasculaires. Maladie articulaire la plus répandue, elle peut à terme entraîner un réel handicap. Quels sont les symptômes de l'arthrose ? Quelle prise en charge est possible ? Quelle alimentation privilégier ? Existe-t-il des traitements non médicamenteux ? Genou, hanches, vertèbres ou mains : nos articulations peuvent toutes, un jour ou l'autre, être concernées par l'arthrose, le rhumatisme le plus fréquent qui résulte en partie d'une dégradation du cartilage, d'une inflammation, de petites déformations osseuses. À l'échelle de la planète, l'arthrose concernerait un adulte sur six. Un rhumatisme douloureux Les douleurs associées à l'arthrose peuvent freiner la mobilité et altérer la qualité de vie, d'où l'importance d'en comprendre l'origine, les mécanismes, et de savoir qui est particulièrement concerné. Ainsi, les femmes sont presque deux fois plus touchées que les hommes. Ce rhumatisme, qui peut apparaître sans cause identifiée ou à la suite d'un événement (infection, maladies chroniques fracture), est lié à trois grands facteurs : vieillissement, sédentarité et surpoids. Prise en charge plurielle En termes de prise en charge, traiter l'arthrose, ne se limite pas – loin de là – à prendre des médicaments… Il s'agit de : Trouver le soulagement, en faisant des exercices appropriés Changer certaines habitudes alimentaires, pour mieux se porter Limiter les poussées douloureuses, en comprenant la maladie, et les facteurs d'aggravation Une approche plurielle permet de définir les solutions les mieux adaptées à chacune, à chacun. Avec : Pr Francis Berenbaum, professeur de Rhumatologie à Sorbonne Université, chef du service de Rhumatologie à l'Hôpital Saint-Antoine, APHP, et enseignant chercheur à l'Inserm. Co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de l'arthrose, aux éditions Eyrolles Jérôme Auger, kinésithérapeute du sport, expert de l'arthrose. Co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de l'arthrose, aux éditions Eyrolles. Fondateur d'IK, réseau de cabinets de kinésithérapie Pr Landry Missounga, professeur de Rhumatologie à l'Université des Sciences de la Santé de Libreville. Rhumatologue au CHU de Libreville au Gabon. Programmation musicale : ► Alabama Shakes – Hold on ► Erik Pedurand – Cinema
Chez les personnes de plus de 40 ans, l'arthrose et les douleurs associées à cette forme de rhumatisme représentent le premier motif de consultation médicale, après les maladies cardiovasculaires. Maladie articulaire la plus répandue, elle peut à terme entraîner un réel handicap. Quels sont les symptômes de l'arthrose ? Quelle prise en charge est possible ? Quelle alimentation privilégier ? Existe-t-il des traitements non médicamenteux ? Genou, hanches, vertèbres ou mains : nos articulations peuvent toutes, un jour ou l'autre, être concernées par l'arthrose, le rhumatisme le plus fréquent qui résulte en partie d'une dégradation du cartilage, d'une inflammation, de petites déformations osseuses. À l'échelle de la planète, l'arthrose concernerait un adulte sur six. Un rhumatisme douloureux Les douleurs associées à l'arthrose peuvent freiner la mobilité et altérer la qualité de vie, d'où l'importance d'en comprendre l'origine, les mécanismes, et de savoir qui est particulièrement concerné. Ainsi, les femmes sont presque deux fois plus touchées que les hommes. Ce rhumatisme, qui peut apparaître sans cause identifiée ou à la suite d'un événement (infection, maladies chroniques fracture), est lié à trois grands facteurs : vieillissement, sédentarité et surpoids. Prise en charge plurielle En termes de prise en charge, traiter l'arthrose, ne se limite pas – loin de là – à prendre des médicaments… Il s'agit de : Trouver le soulagement, en faisant des exercices appropriés Changer certaines habitudes alimentaires, pour mieux se porter Limiter les poussées douloureuses, en comprenant la maladie, et les facteurs d'aggravation Une approche plurielle permet de définir les solutions les mieux adaptées à chacune, à chacun. Avec : Pr Francis Berenbaum, professeur de Rhumatologie à Sorbonne Université, chef du service de Rhumatologie à l'Hôpital Saint-Antoine, APHP, et enseignant chercheur à l'Inserm. Co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de l'arthrose, aux éditions Eyrolles Jérôme Auger, kinésithérapeute du sport, expert de l'arthrose. Co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de l'arthrose, aux éditions Eyrolles. Fondateur d'IK, réseau de cabinets de kinésithérapie Pr Landry Missounga, professeur de Rhumatologie à l'Université des Sciences de la Santé de Libreville. Rhumatologue au CHU de Libreville au Gabon. Programmation musicale : ► Alabama Shakes – Hold on ► Erik Pedurand – Cinema
Nous sommes au tout début du XIIIe siècle, les ducs de Brabant, qui règnent sur Bruxelles et sa région, sont devenus les propriétaires de la forêt de Soignes. C'est un événement fondateur qui scelle le destin du massif : elle devient domaine de prestige dédié à la chasse. Cette appartenance princière permet à la forêt d'échapper aux grands défrichements médiévaux qui ont transformé le reste de l'Europe. Soignes est, aujourd'hui, une véritable machine à remonter le temps. Ainsi conserve-t-elle, sous ses strates les traces d'un village fortifié vieux de plus de 5000 ans. Elle nous rappelle la chute de l'Empire romain et la naissance de frontières entre pays germaniques et pays latins. La présence des communautés religieuses, comme Rouge-Cloître, qui y géraient les étangs et les ressources dès le XIVe siècle. A la fin du XVIIIe siècle, un jardinier autrichien impose la plantation systématique de hêtres, créant une sorte de cathédrale naturelle. Au XIXe siècle, la forêt subit un dépeçage brutal perdant plus de 60 % de sa surface initiale au profit du capitalisme naissant. Le roi Léopold II contribuera à sa sauvegarde et à son embellissement en léguant à l'État des domaines prestigieux comme l'Arboretum de Tervuren, mais cela n'empêchera pas les amputations provoquées par le développement des transports comme le chemin de fer et, plus tard, la voiture. La forêt n'échappera pas non plus aux conséquences de la régionalisation de sa gestion. Aujourd'hui, la protection de ce poumon vert est renforcée par son classement au réseau Natura 2000. Et en 2017, la reconnaissance internationale lui est acquise par l'inscription d'une partie du territoire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un patrimoine unique qui reste fragile. Promenons-nous dans la forêt de Soignes avec respect, humilité et vigilance pour l'avenir … Avec nous : Isabelle Douillet de Pange, historienne de l'art et curatrice à la Fondation Folon. « La forêt de Soignes, sous les feuilles, l'histoire » (avec ALAIN ROBYNS), éd. [aparté] Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
durée : 00:20:15 - Lectures du soir - "Je sentais que dès que Jeanne ouvrirait les yeux il se passerait quelque chose de décisif. Sa tête avait glissé de l'oreiller […] Ainsi, dans cette pose où il y avait de la grâce, on eût dit qu'elle m'aimait encore, que rien ne s'était passé, qu'elle s'éveillerait en souriant…"
Comment un pâtissier français a déclenché une guerre ?
Imaginez une guerre déclenchée… non pas par un roi, un général ou une frontière contestée, mais par un pâtissier. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé au XIXᵉ siècle avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Guerre des Pâtisseries.L'histoire commence au Mexique, dans les années 1830. Le pays est jeune, instable politiquement, secoué par des révoltes et des coups d'État. Dans ce chaos, des commerces étrangers sont régulièrement pillés. Parmi eux, une pâtisserie tenue par un Français installé près de Mexico : Monsieur Remontel. Un jour, des soldats mexicains auraient saccagé sa boutique, consommant et détruisant ses marchandises sans payer.L'affaire aurait pu rester un simple fait divers. Mais Remontel réclame réparation. Il évalue ses pertes… et demande une indemnisation énorme : 60 000 pesos, une somme jugée extravagante. Surtout pour une pâtisserie. Mais son cas devient symbolique : il cristallise les plaintes de nombreux ressortissants français au Mexique, qui accusent les autorités de ne pas protéger leurs biens.La France décide alors d'intervenir. En 1838, le gouvernement de Louis-Philippe exige du Mexique le paiement d'indemnités, pour Remontel et d'autres commerçants français, à hauteur de 600 000 pesos. Le Mexique refuse ou traîne. Paris s'impatiente.Et là, la diplomatie bascule dans la démonstration de force. La France envoie une flotte dans le golfe du Mexique et impose un blocus maritime du port de Veracruz, l'un des points stratégiques du commerce mexicain. Quand le Mexique ne cède pas, les Français bombardent la forteresse de San Juan de Ulúa, qui protège l'entrée du port.Le conflit devient réel : il y a des combats, des morts, et même une figure célèbre qui s'y illustre… Antonio López de Santa Anna, futur homme fort du Mexique. En affrontant les Français, il perd une jambe, ce qui renforce sa légende nationale.Finalement, le Mexique cède. En 1839, un accord est signé : le pays accepte de payer l'indemnité exigée et la France lève le blocus. Ainsi se termine cette guerre au nom improbable… née d'un commerce de gâteaux.Derrière l'anecdote, la “Guerre des Pâtisseries” révèle surtout une réalité du XIXᵉ siècle : les grandes puissances européennes utilisent parfois des prétextes — même une pâtisserie pillée — pour imposer leur influence et protéger leurs intérêts économiques à l'étranger. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Parfois, de tout petits accidents peuvent faire bifurquer le cours de l'Histoire. Ainsi de ce prince héritier capétien, fils aîné de Louis VI qui, au XIIe siècle, est mort d'une chute de cheval, pour avoir simplement buté …sur un porc domestique ! Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
En Inde, la ville de New Delhi face au problème des chiens errants
La capitale indienne – qui compte plus de 33 millions d'habitants – est aussi le refuge de plus d'un million de chiens. Un véritable problème de santé publique alors qu'un tiers des cas de rage dans le monde sont recensés dans le pays le plus peuplé de la planète. En novembre, la Cour suprême a ordonné le retrait des chiens des lieux sensibles et leur placement dans des chenils. Une décision qui a lancé un vaste débat dans le pays. De notre envoyé spécial à New Delhi, Présence incontournable des rues de la capitale de l'Inde, compagnon du quotidien pour beaucoup. Une vingtaine de chiens dans des cages serrées attendent, anxieux, de passer sur la table d'opération d'un centre public de vaccination et de stérilisation, situé dans le quartier de Ghazipur. « Ce centre est l'un des meilleurs de Delhi. Nous offrons une méthode appropriée pour traiter et soigner ces animaux », affirme un vétérinaire. Le docteur nous emmène vers son modeste bloc opératoire. Après avoir endormi le chien, il le place sur un papier journal avant de lui retirer ses testicules ou ses ovaires. Un geste qu'il répète une vingtaine de fois par jour. Une goutte d'eau, alors qu'un million de chiens se trouvent dans les rues de la capitale. « Nous avons besoin de faire plus d'opérations. Pour cela, il nous faut plus de place et plus d'infrastructures », estime-t-il. « Le scénario le plus commun, c'est qu'on prend un chien non vacciné, non stérilisé. On l'opère, on le vaccine et, après trois jours de soins postopératoires, on le relâche à l'endroit où on l'a trouvé », raconte Anjana, qui travaille pour le centre de vaccination. Avec seulement 20 centres pour un million de chiens, il est impossible d'appliquer la décision de la Cour suprême qui prévoit leur retrait des rues une fois vaccinés et stérilisés. Une décision dangereuse pour les militants de la cause animale. L'ONG Save the Stray Dog (« sauve un chien errant », en français) nourrit chaque jour des centaines de chiens et en garde certains quelques semaines, quelques mois s'ils ont besoin d'assistance médicale. « Si vous ramassez tous les chiens et que vous les mettez dans un chenil pour qu'ils meurent, c'est inhumain et aussi irréalisable. Nous n'avons pas assez de place pour mettre autant de chiens dans des endroits confinés. Ainsi, ils vont mourir automatiquement à cause du manque de soutien, d'éducation, d'infrastructures et de médicaments. Qui va s'en occuper ? Qui sera responsable ? », interroge le fondateur de l'ONG. C'est aussi un débat sur l'agressivité de certains chiens, trop agressifs pour pouvoir retourner dans les rues. « Je comprends tout à fait. Cette peur sera toujours là et elle continuera d'exister. Si un chien est agressif, placez-le dans un chenil avec un vétérinaire expérimenté s'il a besoin d'un dressage spécifique », estime-t-il. Après une large campagne de mobilisation citoyenne, la Cour suprême doit de nouveau rendre une décision sur le sujet en janvier. À lire aussiÀ New Delhi, la grève des livreurs bridée par les faibles gains sociaux de leur mouvement
À la Une: élection présidentielle tendue en Ouganda
« Des élections tendues, considérées comme un test de la force de Musévéni » : c'est ainsi que le Monitor titre son article sur la journée d'hier. Le journal ougandais en ligne, considéré comme indépendant du pouvoir, ne se fait pas l'écho des problèmes techniques survenus hier pendant la journée de vote, mais précise toutefois que « le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance policière et militaire. Les autorités ont coupé l'accès à Internet dans tout le pays, mardi, afin de lutter contre ce qu'elles qualifient de désinformation concernant l'élection ». Quant aux enjeux de l'élection, le journal ougandais estime « qu'elle est largement perçue comme un test de la force politique de Museveni, 81 ans, et de sa capacité à éviter le genre de troubles qui ont secoué ses voisins, la Tanzanie et le Kenya, alors que les spéculations vont bon train quant à sa succession éventuelle ». Le résultat du scrutin ne fait toutefois aucun doute, comme le rappelle Africanews : « Le président Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis plus de quarante ans, est donné largement vainqueur pour un septième mandat, bénéficiant d'un contrôle quasi-total de l'Etat et des forces de sécurité ». Un scrutin émaillé d'incident techniques, ajoute Africanews : « De nombreux bureaux de vote ont enregistré plusieurs heures de retard en raison de la lenteur de l'arrivée des urnes et du dysfonctionnement des machines biométriques … » L'attente continue Au Bénin, les résultats des élections de dimanche se font toujours attendre. « Le suspens continue », titre la Nouvelle Tribune. « A ce jour, précise le quotidien béninois, même si les délais légaux ne sont pas encore échus, ni les grandes tendances du vote ni les résultats officiels n'ont été rendus publics par les autorités compétentes ». Ce qui ne contribue pas à un climat serein : « Dans l'espace politique, explique la Nouvelle Tribune, l'absence de chiffres officiels alimente toute sorte de spéculations et de calculs d'avant-bureaux. Certains états-majors de partis affirment disposer de "leurs propres estimations" basées sur des remontées locales, tandis que d'autres appellent à la patience et au respect du processus légal avant toute proclamation ». En attendant les résultats, certains médias béninois ont choisi de faire de la pédagogie. Ainsi la Nation, qui titre « Non à la désinformation électorale », et publie à l'intention de ses électeurs, une série de recommandations indiquant « les bons réflexes à avoir face à une information douteuse ». Le journal béninois conseille d'abord « de prendre du recul et de ne pas réagir immédiatement, face à une information, quelle que soit sa nature ». Autre conseil : « Identifiez la source de votre information, c'est-à-dire recherchez qui parle et dans quel but, car une information n'a de valeur que si l'on sait clairement d'où elle vient. » Suivent d'autres conseils judicieux, à lire dans la Nation. Visas pour la Coupe du monde de football Au Nigeria, le journal le Guardian revient sur la décision prise par Donald Trump d'interdire de visas 75 pays étrangers. L'inquiétude est à l'ordre du jour. « L'interdiction de voyager imposée par Donald Trump laisse les Nigérians dans l'incertitude quant à la Coupe du Monde » explique ainsi le Guardian. « Les fans de football nigérians qui prévoyaient de se rendre aux Etats-Unis pour assister à la Coupe du Monde, pourraient ne pas concrétiser leur projet, suite à l'interdiction de voyager imposée par l'administration de Donald Trump à certains pays africains », ajoute le quotidien nigérian indépendant, qui remarque toutefois « que cette interdiction ne concernerait qu'un nombre limité de fans ». En effet, ajoute-t-il, « le coût du voyage pour la Coupe du Monde, notamment le prix des billets, fait que seuls les plus riches peuvent se permettre de se rendre en Amérique du Nord, pendant la compétition ». Et il leur faudrait encore fournir de multiples assurances, dont celle-ci : « Prouver des liens solides avec le Nigéria, et une intention claire de retourner au pays ».
Le tea time anglais, ou afternoon tea, est aujourd'hui l'un des symboles les plus reconnaissables de la culture britannique. Pourtant, cette tradition si codifiée est née assez tardivement, au début du XIXᵉ siècle, et doit beaucoup à une femme aujourd'hui presque oubliée : Anna Russell.Pour comprendre son origine, il faut d'abord regarder les habitudes alimentaires de l'Angleterre victorienne. À cette époque, les classes aisées ne prenaient que deux repas principaux : un petit-déjeuner relativement léger et un dîner servi très tard, souvent entre 19 et 21 heures. Entre les deux, la journée pouvait sembler interminable, surtout pour les femmes de l'aristocratie, soumises à un emploi du temps rigide fait de visites, de promenades et de réceptions mondaines.Anna Russell, septième duchesse de Bedford et proche de la reine Victoria, se plaint régulièrement d'un malaise très précis : ce qu'elle appelle the sinking feeling, une sensation de faim et de fatigue en milieu d'après-midi. Pour y remédier, elle prend l'habitude de se faire servir, vers 16 heures, une tasse de thé accompagnée de pain, de beurre et de petits gâteaux, dans ses appartements privés. Ce geste, au départ purement pratique, va rapidement prendre une dimension sociale.La duchesse commence en effet à inviter ses amies à la rejoindre pour partager ce moment. Très vite, ce rendez-vous devient une véritable institution mondaine. Le thé n'est plus seulement une boisson, mais un prétexte à la conversation, à l'élégance et à la sociabilité. La pratique se diffuse dans l'aristocratie, puis dans la bourgeoisie, à mesure que le thé devient plus accessible grâce au commerce avec l'Empire britannique.Le teatime s'accompagne alors de règles précises : vaisselle raffinée, pâtisseries délicates, sandwiches au concombre, scones servis avec crème et confiture. Ce rituel incarne parfaitement les valeurs victoriennes : retenue, politesse, maîtrise de soi. Rien n'y est excessif, tout est mesuré, du geste à la parole.Il est important de distinguer l'afternoon tea du high tea, souvent confondus. Contrairement aux idées reçues, le high tea était un repas plus copieux, pris en fin de journée par les classes populaires. L'afternoon tea, lui, est un rite aristocratique, né dans les salons feutrés de l'élite.Ainsi, le teatime anglais n'est pas une tradition ancestrale immuable, mais une invention sociale née d'un simple creux dans l'estomac. Grâce à Anna Russell, un besoin personnel s'est transformé en un rituel emblématique, rappelant que l'Histoire se construit aussi autour de petites habitudes devenues grandes traditions. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Jusqu'en 1493, la Guadeloupe porte deux noms donnés par les Amérindiens qui habitent les deux îles qui la composent. Basse-Terre est appelée Karukera et Grande-Terre Cibuqueira. Et puis le 4 novembre de cette année, un certain Christophe Colomb y accoste. Dans "Ah Ouais ?", Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Un podcast RTL Originals.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Nous sommes le 18 février 1943, à Washington. Il est 12h15, lorsque Madame Chiang Kai-shek, l'épouse du dirigeant de la République de Chine, le chef du parti nationaliste, franchit les portes du Capitole où siège le pouvoir législatif. Elle est l'une des très rares femmes — et la première chinoise — à s'adresser à une session du Congrès. Le discours qu'elle s'apprête à prononcer appelle les Américains à soutenir davantage son pays dans son combat contre l'agression japonaise. Éduquée aux États-Unis, Madame Chiang connaît intimement la culture américaine et sait comment toucher son public. Elle est un pont entre deux mondes. Elle incarne à la fois l'espoir et la résistance… mais aussi les ambiguïtés d'un régime en quête de légitimité. Ainsi, deux ans plus tard, en décembre 1945, le « Boston Post » rapportera les propos de la « first lady américaine » Eleanor Roosevelt qui estimait que Madame Chiang « pouvait parler de façon très convaincante de démocratie, mais ne savait pas comment la vivre ». Mais pour l'heure, en février 1943, Madame Chiang séduit. Figure charismatique, elle représente la Chine moderne, tournée vers l'Occident, elle devient en quelques semaines une véritable icône médiatique. Son charme, son intelligence et sa maîtrise des codes séduisent la presse comme le public. Mais derrière le vernis se cache une réalité plus complexe. Madame Chiang Kai-shek est aussi la voix d'un régime autoritaire, miné par la corruption et les rivalités internes. Elle enjolive la situation de son pays, tait les faiblesses du gouvernement nationaliste et utilise son influence pour consolider le pouvoir de son mari. Admirée pour son courage diplomatique, critiquée pour son habileté propagandiste, elle demeure une personnalité lumineuse et controversée. Tentons de faire la part des choses … Avec nous : Philippe Paquet, sinologue, journaliste à La Libre Belgique, enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Auteur de « Madame Chiang Kai-shek: Un siècle d'histoire de la Chine » aux éditions Les Belles Lettres Sujets traités : Chiang Kai-Shek, Chine, américaine, Eleanor Roosevelt, icône, complexe, nationaliste Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Pourquoi les Égyptiens dormaient-ils sur des oreillers en pierre ?
Dans l'Antiquité, les Égyptiens dormaient souvent la tête posée sur un objet qui nous semblerait aujourd'hui totalement inconfortable : un oreiller en pierre, parfois en bois, appelé appui-tête. Pourquoi faire subir un tel supplice à ses cervicales ? La réponse est bien plus raffinée qu'il n'y paraît.D'abord, il faut comprendre que le sommeil, en Égypte ancienne, n'était pas un simple repos, mais un moment chargé de sens symbolique et religieux. Dormir, c'était entrer dans un état intermédiaire entre le monde des vivants et celui des dieux. Or, la tête était considérée comme le siège de l'âme, de l'identité et de la conscience. La surélever pendant la nuit permettait donc de la protéger, physiquement et spirituellement.Ces appuis-tête avaient aussi une fonction très pratique. Le climat chaud de l'ancienne Égypte rendait les nuits étouffantes. En maintenant la tête au-dessus du matelas — souvent une simple natte — on favorisait la circulation de l'air autour du visage et du cou, réduisant la transpiration et l'inconfort. Dormir à plat, la tête collée à une surface chaude, aurait été bien plus pénible qu'on ne l'imagine.Autre avantage essentiel : la protection contre les insectes et les animaux. Scorpions, serpents ou scarabées étaient une menace bien réelle, surtout la nuit. En surélevant la tête, on limitait le risque qu'un animal vienne ramper jusqu'au visage. L'appui-tête devenait ainsi un objet de sécurité domestique.Mais sa dimension la plus fascinante reste symbolique et funéraire. Ces oreillers étaient fréquemment placés dans les tombes, sous la tête des momies. Dans l'au-delà, il s'agissait de garantir que le défunt puisse se relever, respirer et renaître. Certains appuis-tête portaient même des inscriptions protectrices ou des représentations de dieux chargés d'éloigner les forces du chaos pendant le sommeil éternel.Enfin, il faut oublier notre idée moderne du confort. Les Égyptiens n'associaient pas le bien-être à la mollesse, mais à l'ordre, à la stabilité et à la protection. Un objet dur, solide, éternel comme la pierre, incarnait ces valeurs bien mieux qu'un coussin moelleux.Ainsi, loin d'être une bizarrerie, l'oreiller en pierre révèle une civilisation où le corps, le sommeil et l'au-delà étaient intimement liés. Une leçon qui rappelle que le confort est aussi… une construction culturelle. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
C dans l'air du 9 janvier 2026 - Trump : après le Venezuela, l'Iran ?Le mouvement de contestation, qui a débuté fin décembre en Iran, se poursuit et s'étend à travers tout le pays. Jeudi, une foule compacte s'est rassemblée sur l'un des principaux axes du nord-ouest de Téhéran, au douzième jour d'une nouvelle vague de protestations contre le régime des mollahs, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.Avant la coupure d'Internet intervenue jeudi dans tout le pays, des vidéos montrant d'importantes manifestations dans de nombreuses villes iraniennes ont pu être mises en ligne. On y voit des foules scandant des slogans tels que « Mort à [Ali] Khamenei », le Guide suprême iranien, et « C'est la dernière bataille, Pahlavi reviendra », en référence à la dynastie du même nom, renversée en 1979 par la révolution islamique, dans plusieurs villes du pays.Après s'être dit « à l'écoute » des protestataires aux premiers jours de la contestation, le régime iranien a basculé dans une répression violente à mesure que le mouvement s'amplifiait. Selon un bilan publié jeudi par l'IHR, une ONG établie en Norvège qui dispose d'un large réseau d'informateurs en Iran, au moins 45 manifestants, dont huit mineurs, ont été tués depuis le début de la mobilisation.Aux États-Unis, lors d'un entretien avec l'animateur radio conservateur Hugh Hewitt, Donald Trump a réitéré hier soir ses menaces contre l'Iran : « Je leur ai fait savoir que s'ils commençaient à tuer des gens, ce qu'ils ont tendance à faire pendant leurs émeutes — ils ont beaucoup d'émeutes —, s'ils le font, nous les frapperons très fort », a-t-il prévenu. Le Guide suprême iranien, de son côté, a averti ce vendredi que « l'arrogant » dirigeant américain serait « renversé » et a prévenu que son pays ne « reculerait pas » face à des manifestants qualifiés de « saboteurs » et de « vandales ».Alors, que va faire Donald Trump ? Après le Venezuela, les États-Unis pourraient-ils frapper l'Iran ? Quelques heures seulement avant la capture du leader vénézuélien — allié de l'Iran —, le président américain avait déjà averti Téhéran que le régime n'avait pas intérêt à tuer des manifestants, faute de quoi les États-Unis interviendraient.Depuis, le président Donald Trump, totalement désinhibé, multiplie les menaces à l'égard de Cuba, du Groenland — dépendance du Danemark, membre de l'OTAN — de la Colombie, du Mexique, et renforce sa mainmise sur le Venezuela. Ainsi, malgré les mises en garde de Moscou, Washington a saisi ces derniers jours plusieurs pétroliers accusés de contourner le blocus contre le Venezuela, dont un qui battait depuis peu pavillon russe. Au risque d'une escalade du conflit entre la Russie et l'Occident ?Le président américain a également annoncé hier que les États-Unis allaient mener des frappes « au sol » contre les cartels de la drogue mexicains, sans préciser exactement où.Nos experts :- Isabelle LASSERRE - Correspondante diplomatique - Le Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique- Général Dominique TRINQUAND - Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur de D'un monde à l'autre- Lucas MENGET - Grand reporter, réalisateur du documentaire Des trains dans la guerre- Patricia ALLÉMONIÈRE - Grand reporter, spécialiste des questions internationales- Armin AREFI (en Duplex) - Grand reporter spécialiste de l'Iran –Le PointÉmission : C dans l'air - L'intégraleAnimé par:Aurélie CasseProduit par : France Télévisions - Mediawan
« L'usage de la force est permis. Mais cet usage de la force doit être encadré par des règles. Sans ces règles, le monde est soumis à la loi du plus fort. » Ainsi s'exprimait Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français sur France 2 le 4 janvier 2026. 80 ans après la première assemblée générale de l'ONU, les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité, pratiquent l'ingérence et l'agression envers un autre État, le Venezuela, au mépris des valeurs fondamentales des Nations unies dont la première assemblée générale se déroulait le 10 janvier 1946. Au son de nos archives, je vous propose de revivre cet évènement fondateur pour la sécurité internationale et le maintien de la paix, afin de revenir à la source d'une utopie dont les États précurseurs se sont faits les fossoyeurs. « L'intervention américaine a sapé un principe fondamental du droit international », déclarait le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme le mardi 6 janvier, plus de 48h après l'intervention américaine au Venezuela ayant conduit à l'arrestation du président Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait pour sa part qualifié les faits de « dangereux précédent ». Avec la participation de l'historienne spécialiste de l'ONU Chloé Maurel et l'écrivain et ancien officier Guillaume Ancel. Les livres de Chloé Maurel : - Les Grands Discours à l'ONU, Paris, éditions du Croquant, 2024, préface de Pascal Ory de l'Académie française, postface de Jean Ziegler. - Une brève histoire de l'ONU au fil de ses dirigeants, Paris, éditions du Croquant, 2017, 175 p. - Histoire des idées des Nations unies. L'ONU en 20 notions, Paris, L'Harmattan, 2015, 340 p. La page de Chloé Maurel sur le site de l'Ecole Normale Supérieure Chloé Maurel dans La marche du monde sur les grands discours de l'Unesco Les livres de Guillaume Ancel préfacés par l'historien Stéphane Audouin-Rouzeau : - Saint-Cyr, à l'école de la Grande Muette, aux éditions Flammarion. - Un casque bleu chez les Khmers rouges, Rwanda, la fin du silence, Vent glacial sur Sarajevo aux éditions Les Belles Lettres. Le blog de Guillaume Ancel ⇒ Blog Pour ne pas subir Pour aller plus loin avec Guillaume Ancel : À lire aussi« Si tu veux la paix, prépare la guerre » À lire aussiGuillaume Ancel, rompre le silence À lire aussiGuillaume Ancel, écrire pour ne pas subir
Ainsi va le monde - De l'école à l'université (1ère diffusion : 08/11/1946 Chaîne Nationale)
durée : 00:29:51 - Les Nuits de France Culture - par : Philippe Garbit - Par Michel Robida - Avec entre autres Marie-Renée Bacherigon et André Lirondelle (Recteur) - réalisation : Virginie Mourthé
durée : 00:13:02 - L'invité du 13/14 - la prise en charge des grands brûlés de cet incendie. Plusieurs sont soignés en France...notamment à Metz...par le Docteur Glavnik. Ainsi que Julie Bourges...elle même brulé à 40% il y a 10 ans...et qui depuis témoigne Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Pourquoi la passe de Khyber occupe une place centrale dans l'histoire ?
Ce corridor montagneux d'une cinquantaine de kilomètres, situé entre l'actuel Afghanistan et le Pakistan, constitue l'un des très rares passages naturels permettant de franchir la barrière redoutable de l'Hindou Kouch. À travers les siècles, il a servi de porte d'entrée stratégique vers l'Inde, faisant de cette région un point névralgique des conquêtes, des échanges et des conflits.La géographie explique d'abord son importance. Coincée entre des massifs escarpés et hostiles, la passe de Khyber est l'itinéraire le plus praticable pour relier l'Asie centrale aux plaines fertiles du Pendjab. Quiconque voulait atteindre les richesses de l'Inde – terres agricoles, villes prospères, routes commerciales – devait presque inévitablement passer par là. Cette contrainte géographique a transformé la passe en goulet d'étranglement militaire, facile à défendre mais aussi difficile à contourner.Dès l'Antiquité, les grands conquérants l'ont empruntée. Alexandre le Grand traverse la région au IVe siècle avant notre ère lors de sa campagne vers l'Inde. Plus tard, les envahisseurs indo-grecs, les Scythes, les Kouchans puis les Huns y font passer leurs armées. À chaque époque, la passe de Khyber devient le théâtre d'affrontements sanglants entre envahisseurs et royaumes indiens cherchant à protéger leurs frontières.Au Moyen Âge, son rôle stratégique ne faiblit pas. Les armées musulmanes venues d'Asie centrale l'utilisent pour pénétrer dans le sous-continent. Mahmoud de Ghazni, au XIe siècle, mène plusieurs raids dévastateurs en Inde en empruntant cette route. Plus tard, Babur, fondateur de l'Empire moghol, passe lui aussi par la Khyber pour conquérir Delhi en 1526. La passe devient alors un symbole durable de domination et de vulnérabilité pour l'Inde du Nord.À l'époque moderne, la passe de Khyber conserve toute son importance géopolitique. Les Britanniques, soucieux de protéger l'Empire des Indes contre une éventuelle avancée russe, y mènent de nombreuses campagnes militaires au XIXe siècle. La région, peuplée de tribus pachtounes farouchement indépendantes, reste difficile à contrôler et dangereuse pour toute armée étrangère.Ainsi, depuis plus de deux millénaires, la passe de Khyber n'est pas seulement un passage montagneux : elle est un carrefour de civilisations, de conquêtes et de violences, un lieu où la géographie façonne l'histoire du continent indien. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
[REDIFF] EX MEMBRE DU CARTEL DE CALI (COLOMBIE) : ULTRA VIOLENCE, COMMENT IL A TOUT QUITTÉ POUR DEVENIR PRÊTRE
Merci à Octavio d'être passé nous voir chez LEGEND ! Octavio Bermeo Valencia est un ancien membre du cartel de Cali en Colombie devenu pasteur, le cartel rival et ennemi de Pablo Escobar. Il découvre très jeune la violence du cartel, les meurtre dans les rues, l'assassinat d'un de ses amis juste à côté de lui.À tout juste 18 ans, il s'engage dans le Cartel, à la récolte et la confection de cocaïne dans les laboratoires artisanaux, jusqu'à un évènement qui va changer sa vie et le guider vers une vocation de pasteur.Retrouvez Octavio sur Instagram ➡️ https://www.instagram.com/octaviobermeovalencia/Ainsi que sa fille ➡️ https://www.instagram.com/annabelleforjesus/Pour toutes demandes de partenariats : legend@influxcrew.comRetrouvez-nous sur tous les réseaux LEGEND !Facebook : https://www.facebook.com/legendmediafrInstagram : https://www.instagram.com/legendmedia/TikTok : https://www.tiktok.com/@legend Twitter : https://twitter.com/legendmediafr Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Quand médias et ONG sont entravés par le droit: entretien avec Sophie Lemaître
La juriste française Sophie Lemaître publie Réduire au silence, un livre dans lequel elle décrit « comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG » dans des régimes autoritaires… Mais aussi dans des démocraties comme la France. [Rediffusion de l'émission du 13 septembre 2025] Sophie Lemaître, docteure en droit, dépeint un phénomène mondial, le lawfare, qui menace gravement la liberté d'expression et l'espace civique. Si ce concept vient du domaine de la guerre, il « se transvase très bien pour tout ce qui est atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté d'association », explique-t-elle. Elle qualifie cette pratique d'« arme de dissuasion massive parce que le droit n'est plus à nos côtés, il est utilisé contre nous, contre la liberté d'informer et notre droit d'être informé ». Les cibles sont clairement identifiées : les journalistes et les défenseurs des droits humains. La stratégie est simple : « à partir du moment où vous travaillez sur des sujets qui dérangent des intérêts puissants, qu'ils soient politiques ou privés, on va utiliser le droit pour vous réduire au silence ». Les « poursuites bâillons » ou SLAPP (Strategic lawsuits against public participation) sont emblématiques de cette tactique. Leur objectif premier n'est pas de gagner le procès, mais d'« épuiser financièrement, émotionnellement, personnellement » la cible. Ainsi, dit-elle, « c'est la procédure qui vous étouffe ». La diffamation est la procédure la plus couramment travers le monde. Son danger réside dans le fait que « dans plein de pays, la diffamation est criminalisée. Donc, on peut avoir une une amende, mais on peut également aller en prison. » L'effet est « vraiment dissuasif. (...) Est-ce que vous allez continuer à écrire sur la corruption ou sur les atteintes dans l'environnement ? Vous allez peut-être vous poser deux fois la question avant de publier un article ou une enquête sur le sujet. » Sophoe Lemaître cite l'exemple du groupe français Bolloré qui a déposé « une vingtaine de plaintes en diffamation » dès qu'un article « pouvait déranger ». Les poursuites transfrontalières, où la plainte est déposée « non pas dans le pays dans lequel le journaliste vit mais à l'étranger », amplifient la difficulté : « Vous ne connaissez pas le pays, vous ne maîtrisez peut-être pas la langue. Clairement vous ne maîtrisez pas le système judiciaire. Donc ça va vous obliger à devoir trouver un avocat spécialisé et ça va vous coûter beaucoup plus cher. » Les États ne sont pas en reste. « Ils ont tout un arsenal disponible qu'ils peuvent utiliser contre les médias et les associations. » Les lois sur les « agents de l'étranger » en Russie, en Hongrie ou en Géorgie en sont un exemple typique. Les avocats qui défendent des journalistes deviennent eux aussi parfois des « cibles prioritaires ». Face à ces menaces, Sophie Lemaître souligne l'importance de la riposte et de l'union. Elle mentionne la « directive européenne contre les poursuites bâillons » comme un pas significatif. Pour les citoyens, l'action est cruciale : « une première chose que l'on peut faire, c'est de repartager quand vous voyez des enquêtes de journalistes, repartager leurs enquêtes. [...] alertez, parlez-en autour de vous. » Elle conclut sur le « sentiment d'urgence » qui l'a fait écrire ce livre : « On est à un point de bascule. On peut très facilement aller du côté d'une démocratie illibérale ou une autocratie. » Il est donc « essentiel de se mobiliser, de soutenir les associations, les journalistes, mais aussi les magistrats qui sont ciblés ».
Nous sommes en décembre 1673. Jusque-là, en matière de reconnaissance d'enfants naturels, les rois de France ont eu l'habitude de mentionner la filiation du côté paternel comme du côté maternel. Ce qui, dans le cas de Madame de Montespan, maîtresse de Louis XIV, est impossible car les enfants seraient considérés comme doublement adultérins et leurs droits pourraient être contestés par le mari de la dame. Qu'à cela ne tienne, le roi n'y va pas par quatre chemins. Ainsi, dans les lettres qu'il signe pour légitimer les trois premiers enfants de la marquise, il passe le nom de la mère sous silence et n'établit que la seule parenté paternelle et royale. Le roi écrit : « La tendresse que la nature nous donne pour nos enfants, et beaucoup d'autres raisons qui augmentent considérablement en nous ces sentiments, nous obligent de reconnaître Louis-Auguste, Louis-César, et Louis-Françoise, et leur donner des marques publiques de cette reconnaissance. Pour assurer leurs états, nous avons estimé nécessaire d'expédier à cet effet nos lettres patentes pour déclarer notre volonté ; à quoi nous portons bien volontiers, que nous avons lieu d'espérer qu'ils répondront à la grandeur de leur naissance, et aux soins que nous faisons prendre de leur éducation ». A la différence de leurs prédécesseurs de la dynastie des Valois, les premiers souverains Bourbon assument leurs maîtresses et enfants naturels. Ils forment ensemble une autre famille, parallèle à la lignée légitime. Mais comment ces deux familles se comportent-elles entre elles ? Se font-elles concurrences ? Quelles sont les privilèges des unes et des autres ? Qu'en est-il de la crédibilité du pouvoir ? Les origines roturières, bourgeoises, courtisanes de certaines favorites ternissent-elles les couleurs du trône ? Les fortunes colossales amassées par la Montespan ou la Du Barry sont-elles sources de scandales ? La « contre-famille » royale a-t-elle contribué au déclin de la monarchie avant la Révolution ? Invitée : Flavie Leroux, chargée de recherche au Centre de recherche du château de Versailles. « L'autre famille royale -Bâtards et maîtresses d'Henri IV à Louis XVI » paru aux éd. Passés/composés. sujets traités : Bâtards, maitresses, Madame de Montespan, Louis XIV, Valois, Bourbon, Du Barry Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les manifestations s'étendent en Iran, ainsi que les griefs contre le régime des mollahs
durée : 00:05:20 - La Revue de presse internationale - par : Catherine Duthu - Après les commerçants, les étudiants : de nouvelles manifestations sont prévues ce mercredi en Iran, pour protester contre la vie chère, la dégradation de la situation économique mais aussi, plus largement, contre le régime des mollahs.
Anatole Deibler, bourreau de père en fils Nous sommes le 1er février 1914, à Paris. Ce jour-là, Alfred Peugnez, auteur d'un double assassinat , est guillotiné devant les prisons de la Roquette, dans le 11e arrondissement. C'est la première fois qu'Anatole Deibler, fils et petit-fils de bourreaux, officie dans la capitale. Les jours suivants, une partie de la presse fait part de son enthousiasme quant à la tâche exécutée. Ainsi, dans les « Annales politiques et littéraires » du 12 février, on peut lire : « Tous les journaux s'accordèrent à rendre justice au jeune monsieur Deibler qui montra, pour ses débuts à Paris, un tournemain et une aisance de vieux praticien. Jeune, élégant, vêtu d'une redingote de couleur sombre, comme un témoin de duel sélect, il réalise dans la perfection le type du bourreau moderne. On peut, après cet heureux essai, lui prédire une belle carrière et un nombre respectable de représentations. » D'autres se montrent plus réservés, un certain Jean Lorrain, par exemple, écrit : « De la descente de voiture au couperet, le rythme est un peu trop rapide. Cela enlève de la solennité qui constitue pourtant la raison d'être d'une exécution. » Anatole Deibler, dit-on, avait le goût du travail bien fait, soucieux de mériter la confiance que lui témoignait la République. Entre 1885 et 1939, il appliquera à 395 reprises la peine de mort. S'il fut, en effet, un exécuteur consciencieux, les carnets qu'il a rédigés tout au long de sa pratique témoignent d'un homme au caractère complexe, en proie au doute et au questionnement, bien loin du portrait qu'en ont fait les journaux à sensation de l'époque. Retour sur un parcours hors-norme… Invité : Gérard A. Jaeger, auteur de « Anatole Deibler, l'homme qui trancha 400 têtes » éditions du Félin. Sujets traités :Anatole Deibler, bourreau , père, fils, Alfred Peugnez, guillotiné, assassinat Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ordinateur quantique : la prochaine révolution de l'informatique ? [REDIFF]
Sommes-nous en train d'assister à une révolution d'ampleur dans l'informatique ? Depuis les années 1980, ce milieu rêve d'une supermachine universelle, capable de résoudre des calculs encore insolubles aujourd'hui et de casser tous les codes de chiffrement, le tout en un rien de temps : l'ordinateur quantique.Longtemps, ce doux rêve est resté cantonné à de la recherche en laboratoire. Mais ces derniers mois, des avancées technologiques ont changé la donne, suscitant espoirs et investissements. Ainsi, pour la première fois, des start-up se lancent dans la course à l'ordinateur quantique, et des grandes entreprises, à l'instar de Google ou Microsoft, les financent.Comment expliquer ce regain d'intérêt ? Ces avancées technologiques annoncent-elles un miracle à venir, ou bien l'ordinateur quantique reste-t-il un mirage ? Dans cet épisode du podcast « L'Heure du Monde », David Larousserie, journaliste au service Sciences du Monde, nous raconte pourquoi la course à l'ordinateur quantique s'est récemment accélérée, et ce que l'on peut en attendre.Un épisode de Marion Bothorel. Réalisation et musiques : Thomas Zeng. Présentation et rédaction en chef : Jean-Guillaume Santi. Dans cet épisode : extraits de la bande-annonce du film Imitation Game et du film Colossus. The Forbin Project.Cet épisode a été diffusé le 10 mai 2024---Pour soutenir "L'Heure du Monde" et notre rédaction, abonnez-vous sur abopodcast.lemonde.fr Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Trump : ses plans pour l'Ukraine... et le Groenland - L'intégrale -
C dans l'air du 29 décembre 2025 - Trump : ses plans pour l'Ukraine... et le GroenlandDonald Trump est-il près du but ? Le président américain a estimé, dimanche 28 décembre, être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une rencontre en Floride avec Volodymyr Zelensky et un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. De « grandes avancées » ont été réalisées, s'est de son côté félicité le président ukrainien à l'issue de cette rencontre. Ainsi, Volodymyr Zelensky l'a affirmé face à un parterre de journalistes : « 90 % » du plan de paix en vingt points a été « approuvé ».Le projet d'accord a été retravaillé ces dernières semaines par la Maison-Blanche, après d'âpres négociations réclamées par Kiev et les pays européens, qui jugeaient la première version, dévoilée fin novembre, beaucoup trop proche des revendications russes. Le nouveau plan de paix devra désormais être soumis à un référendum en Ukraine, a annoncé Volodymyr Zelensky au média RBK. Mais avant d'en arriver là, plusieurs points cruciaux restent en suspens.La question des territoires est toujours au centre des discussions, notamment le Donbass. La gestion de la centrale de Zaporijjia demeure un sujet majeur, ainsi que les garanties de sécurité. Sur ce dernier point, Volodymyr Zelensky a évoqué des « garanties de sécurité » pour l'Ukraine, « approuvées » pour certaines et « presque approuvées » pour d'autres. « Il y aura des garanties de sécurité. Elles seront fortes. Et les pays européens sont très impliqués », a de son côté assuré le président américain. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé ce lundi une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier, autour de cette question.Au même moment, Volodymyr Zelensky a estimé, lors d'une conférence de presse en ligne, que « le plan (de paix) devra être signé par quatre parties : l'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et la Russie ». Le dirigeant en a aussi profité pour critiquer Vladimir Poutine, dont les agissements, via l'armée russe en Ukraine, ne correspondent pas à ses propos « pacifiques » tenus auprès de Donald Trump.Parallèlement, Donald Trump continue de s'en prendre à l'Europe. Après les propos de J.D. Vance sur la « menace » nucléaire de Paris, l'interdiction de séjour de Thierry Breton aux États-Unis et la nomination du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, au poste d'« envoyé spécial au Groenland », l'hostilité de l'administration Trump envers l'Union européenne franchit un nouveau cap en cette fin d'année 2025. Entre sa bienveillance à l'égard de la Russie, ses taxes imposées aux pays de l'UE et sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, la nation dirigée par Donald Trump ne cache plus son basculement. Et les Européens sont divisés sur la manière de réagir.Alors, un accord de paix en Ukraine est-il proche ? Quel est l'avenir des relations transatlantiques ? Pourquoi Donald Trump rêve-t-il du Groenland ?Nos experts :- Gallagher FENWICK - Journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur de Volodymyr Zelensky : l'Ukraine dans le sang- James ANDRÉ - Grand reporter - France 24- Patricia ALLEMONIÈRE - Grand reporter, spécialiste des questions internationales, auteure de Au cœur du chaos - Pierre HAROCHE - Maître de conférences en politique européenne et internationaleUniversité Catholique de Lille, auteur de Dans la forge du monde
Trump : ses plans pour l'Ukraine... et le Groenland - Vos questions sms -
C dans l'air du 29 décembre 2025 - Trump : ses plans pour l'Ukraine... et le GroenlandDonald Trump est-il près du but ? Le président américain a estimé, dimanche 28 décembre, être plus près que jamais d'un accord de paix en Ukraine, après une rencontre en Floride avec Volodymyr Zelensky et un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. De « grandes avancées » ont été réalisées, s'est de son côté félicité le président ukrainien à l'issue de cette rencontre. Ainsi, Volodymyr Zelensky l'a affirmé face à un parterre de journalistes : « 90 % » du plan de paix en vingt points a été « approuvé ».Le projet d'accord a été retravaillé ces dernières semaines par la Maison-Blanche, après d'âpres négociations réclamées par Kiev et les pays européens, qui jugeaient la première version, dévoilée fin novembre, beaucoup trop proche des revendications russes. Le nouveau plan de paix devra désormais être soumis à un référendum en Ukraine, a annoncé Volodymyr Zelensky au média RBK. Mais avant d'en arriver là, plusieurs points cruciaux restent en suspens.La question des territoires est toujours au centre des discussions, notamment le Donbass. La gestion de la centrale de Zaporijjia demeure un sujet majeur, ainsi que les garanties de sécurité. Sur ce dernier point, Volodymyr Zelensky a évoqué des « garanties de sécurité » pour l'Ukraine, « approuvées » pour certaines et « presque approuvées » pour d'autres. « Il y aura des garanties de sécurité. Elles seront fortes. Et les pays européens sont très impliqués », a de son côté assuré le président américain. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé ce lundi une réunion des alliés de Kiev à Paris début janvier, autour de cette question.Au même moment, Volodymyr Zelensky a estimé, lors d'une conférence de presse en ligne, que « le plan (de paix) devra être signé par quatre parties : l'Ukraine, l'Europe, l'Amérique et la Russie ». Le dirigeant en a aussi profité pour critiquer Vladimir Poutine, dont les agissements, via l'armée russe en Ukraine, ne correspondent pas à ses propos « pacifiques » tenus auprès de Donald Trump.Parallèlement, Donald Trump continue de s'en prendre à l'Europe. Après les propos de J.D. Vance sur la « menace » nucléaire de Paris, l'interdiction de séjour de Thierry Breton aux États-Unis et la nomination du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, au poste d'« envoyé spécial au Groenland », l'hostilité de l'administration Trump envers l'Union européenne franchit un nouveau cap en cette fin d'année 2025. Entre sa bienveillance à l'égard de la Russie, ses taxes imposées aux pays de l'UE et sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, la nation dirigée par Donald Trump ne cache plus son basculement. Et les Européens sont divisés sur la manière de réagir.Alors, un accord de paix en Ukraine est-il proche ? Quel est l'avenir des relations transatlantiques ? Pourquoi Donald Trump rêve-t-il du Groenland ?Nos experts :- Gallagher FENWICK - Journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur de Volodymyr Zelensky : l'Ukraine dans le sang- James ANDRÉ - Grand reporter - France 24- Patricia ALLEMONIÈRE - Grand reporter, spécialiste des questions internationales, auteure de Au cœur du chaos - Pierre HAROCHE - Maître de conférences en politique européenne et internationaleUniversité Catholique de Lille, auteur de Dans la forge du monde
«Le Monde après Gaza» de l'écrivain indo-britannique Pankaj Mishra
L'essai Le Monde après Gaza de l'écrivain indo-britannique Pankaj Mishra s'ouvre sur les derniers jours de l'insurrection dans le ghetto de Varsovie en 1943, réprimée dans le sang par les nazis. Comparant l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à l'anéantissement de Gaza par Israël sous le regard complice des puissances démocratiques occidentales, Mishra pointe du doigt la radicalisation de la société israélienne et s'inquiète de l'effondrement moral généralisé. Puisant sa réflexion aussi bien chez Primo Levi, Hannah Arendt, Edward Said que James Baldwin, ce livre relit l'histoire contemporaine à travers une grille morale et invite ses lecteurs à construire le monde d'après en s'appuyant sur une nouvelle conscience politique et éthique. RFI : C'est le sentiment de découragement face à l'effondrement moral généralisé qui vous a conduit à vous lancer dans l'écriture du Monde après Gaza. J'aimerais que vous nous expliquiez les raisons de votre découragement ? Pankaj Mishra : Je me suis retrouvé dans la situation de nombreuses personnes complètement déconcertées par la réaction d'Israël au 7-Octobre. Nous avons vécu des mois d'extermination de masse diffusés en direct, quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En même temps, ce qui a été également inédit ces derniers mois, c'est de voir les démocraties occidentales qui prétendent défendre un ordre international fondé sur des règles, qui prétendent se battre pour la démocratie et les droits humains, appuyer Israël en lui apportant leur soutien tant diplomatique, militaire que moral. En conséquence, tout un système de normes, tout un système de lois, toute une manière de comprendre le monde, notre place en son sein, notre perception de nous-mêmes, de nos possibilités, et de ce que nos sociétés pourraient être à l'avenir, désormais tout cela est remis en cause. C'est de cela que je parle quand je vous dis que nous assistons à un effondrement moral généralisé. Je suis étonné de votre réaction. Vous semblez avoir oublié les violences des guerres coloniales, les atrocités commises en Corée et au Vietnam, la mauvaise foi qui a conduit à la guerre en Irak… Je pense que les gens de ma génération n'ont pas oublié les longues guerres et les atrocités de l'impérialisme. Je n'avais pas vraiment beaucoup d'illusions sur la nature de la démocratie occidentale ni sur cette rhétorique des droits de l'homme. Mais je dois admettre que, même pour des personnes comme moi, formées à l'histoire mondiale, les événements de Gaza - au cours desquels on a vu les gens abandonner leurs principes pour se ranger du côté des auteurs d'un génocide - ont été un choc immense. À quand situez-vous la corrosion morale dans la société israélienne que vous pointez et que vous n'êtes d'ailleurs pas le seul à évoquer ? Pour la plupart des observateurs, cette corrosion morale commence avec l'endoctrinement de la population israélienne et la construction d'une identité nationale fondée sur la Shoah et l'expérience juive en Europe. Pendant les premières années de l'existence d'Israël, la Shoah ne faisait pas partie de l'image que ce pays se faisait de lui-même. Les premiers dirigeants israéliens méprisaient les survivants de l'Holocauste : ils les voyaient comme des êtres faibles qui déshonoraient le pays parce qu'ils étaient allés à la mort sans résistance. Ce n'est que plus tard, à partir des années 1960, que le récit de la Shoah a été redécouvert et élaboré afin d'imposer une identité nationale cohérente. Ainsi, plusieurs générations d'Israéliens ont été endoctrinées avec ce message très dangereux selon lequel le monde qui les entoure serait rempli de gens cherchant à les tuer et à les éradiquer. Dans votre ouvrage, vous revenez longuement sur les mises en garde lancées en leur temps par d'éminents philosophes tels que Hannah Arendt et Primo Lévi contre cet endoctrinement. Pourquoi n'ont-ils pas été écoutés? C'est parce que le récit de l'Holocauste a d'abord été confisqué par l'État d'Israël, puis perverti pour servir les intérêts d'un État violent et expansionniste. Des penseurs comme Hannah Arendt, qui avaient vu en Europe les pires excès du nationalisme, étaient très conscients du risque de voir ressurgir ces dangers dans un nouvel État-nation tenté par le fascisme, le suprémacisme ethnique et racial. C'est pourquoi elle s'est farouchement opposée à l'idée du sionisme comme doctrine constitutive de l'Etat d'Israël. Primo Levi, lui, qui croyait en l'idée d'un Israël socialiste, fut totalement horrifié en découvrant les preuves des atrocités israéliennes commises contre les Libanais et les Palestiniens. Ces penseurs ne pouvaient concevoir que la Shoah serve de fondement à la légitimité d'Israël. Pour eux, cette légitimité ne pouvait reposer que sur le comportement éthique d'Israël dans l'ici et maintenant. C'est pourquoi je crois qu'il est de notre devoir, d'une certaine manière, de sauver la mémoire de la Shoah des mains de ceux qui l'ont tant instrumentalisée en Israël. Ne me méprenez pas : il n'est nullement question d'oublier la Shoah, mais il est seulement question de la délivrer de l'emprise de l'État d'Israël. Comment voyez-vous le monde après Gaza, qui est le titre de votre essai ? Vous savez, lorsque je songe à l'avenir, ce qui m'inspire véritablement de l'espoir, c'est la façon dont la jeunesse a su incarner à travers le monde une forme rare d'empathie et de compassion envers les victimes de la violence à Gaza. Ils l'ont fait en se levant, en se mobilisant, en donnant voix à leur indignation, et, ce faisant, ils nous ont renvoyé à nos propres manquements — nous, les aînés, ceux qui détenons le pouvoir, dans la politique, les affaires ou les médias. Ils nous ont rappelé, parfois avec sévérité, combien nous nous étions compromis, soit en tolérant ce génocide, soit en gardant le silence face à lui. Ces jeunes manifestants, ces étudiants sont descendus dans la rue, ils ont dénoncé les atrocités, nous poussant à écouter davantage la voix de notre conscience. J'espère qu'à mesure qu'ils vieilliront, accédant à leur tour à des positions d'influence et de responsabilité, ils se souviendront des positions profondément morales qu'ils ont su adopter dans ces temps sombres que nous venons de vivre. Et j'espère qu'ils trouveront le moyen de perpétuer ces valeurs de compassion et de solidarité qu'ils ont su si magnifiquement incarner au cours de ces 15 derniers mois marqués par la brutalité et la souffrance. Oui, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Le Monde après Gaza, par Pankaj Mishra. Essai traduit de l'anglais par David Fauquemberg. Editions Zulma, 304 pages, 22,50€
Être l'ainé ou le cadet, être le beau-père d'une famille recomposée... Trouver sa place dans la famille peut ne pas être évident. Ainsi, qu'un enfant soit l'aîné ou le dernier, sa position dans la fratrie a des conséquences sur la relation tissée avec ses parents, mais aussi avec ses frères et sœurs. De même, après une nouvelle union, l'adulte nouvellement arrivé doit créer des liens avec des enfants qui ne sont pas les siens, mais qui partagent son quotidien. (Rediffusion) Comment trouver sa place au sein de la famille ? Que faire quand la place qu'on se voit attribuer ne nous convient pas ? Dr Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris. Autrice de « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? » chez Marabout. ► En fin d'émission, nous faisons un point sur les actualités thérapeutiques de la sclérose en plaques avec le Pr Laure Michel, neurologue au CHU de Rennes et vice-présidente du comité médico-scientifique de la Fondation France Sclérose en Plaques. Programmation musicale : ► Fleetwood Mac – Family man ► Bejo, Dj pimp – Tutti frutti.
Être l'ainé ou le cadet, être le beau-père d'une famille recomposée... Trouver sa place dans la famille peut ne pas être évident. Ainsi, qu'un enfant soit l'aîné ou le dernier, sa position dans la fratrie a des conséquences sur la relation tissée avec ses parents, mais aussi avec ses frères et sœurs. De même, après une nouvelle union, l'adulte nouvellement arrivé doit créer des liens avec des enfants qui ne sont pas les siens, mais qui partagent son quotidien. (Rediffusion) Comment trouver sa place au sein de la famille ? Que faire quand la place qu'on se voit attribuer ne nous convient pas ? Dr Marie-Claude Gavard, médecin psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste à Paris. Autrice de « Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? » chez Marabout. ► En fin d'émission, nous faisons un point sur les actualités thérapeutiques de la sclérose en plaques avec le Pr Laure Michel, neurologue au CHU de Rennes et vice-présidente du comité médico-scientifique de la Fondation France Sclérose en Plaques. Programmation musicale : ► Fleetwood Mac – Family man ► Bejo, Dj pimp – Tutti frutti.
À la Une: l'adoption en Algérie de la proposition de loi criminalisant la colonisation française
La presse algérienne revient largement sur cette adoption de la proposition de loi criminalisant la colonisation française. « Adoption à l'unanimité » par les membres de l'APN, l'Assemblée populaire nationale en plénière, souligne le journal algérien El Moudjahid. Le média parle d'« une démarche inédite [qui va] dans le sens de la préservation de la mémoire nationale et de l'établissement des responsabilités, d'autant plus que, jusque-là, la France coloniale se refuse à reconnaître ses crimes coloniaux en Algérie ». Le journal algérien Le Soir décrit la proposition de loi : « Structurée en cinq chapitres comprenant 27 articles, [elle] s'appuie sur "les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique et à la justice historique et la fin de l'impunité". » Le quotidien algérien L'Expression analyse ce « texte mémoriel aux enjeux stratégiques ». Cette proposition est « un acte fondateur de justice historique », explique le média, qui décrit le texte en deux temps. D'abord : « Sur le plan interne, l'adoption de ce texte est présentée comme un levier de renforcement du Système législatif national en matière de protection de la mémoire. (…) ». « Mais, souligne L'Expression, au-delà de sa dimension mémorielle, cette initiative revêt [aussi] des enjeux stratégiques et géopolitiques majeurs. (…) ». Ainsi « en portant le débat sur le terrain juridique, l'Algérie cherche à internationaliser la question des crimes coloniaux et à les inscrire dans les normes relatives aux crimes contre l'humanité ». À lire aussiAlgérie: le Parlement valide la loi de criminalisation de la colonisation française « Une première en Afrique » Et, cette loi criminalisant le colonialisme est aussi présentée comme « une première en Afrique », explique le journal en ligne algérien TSA. Il revient notamment sur les propos de l'expert en politique internationale Abdelkader Soufi, sur les ondes de la Radio algérienne. Le spécialiste explique que cette loi vise « à établir un cadre juridique clair pour qualifier, reconnaître et condamner les crimes commis par la puissance coloniale ». La nouveauté dans ce texte réside dans « la classification détaillée des crimes, incluant désormais des faits longtemps marginalisés ou passés sous silence (...) » c'est-à-dire « la torture, les exécutions sommaires, les massacres de masse, les enfumades, les kidnappings et les viols » qui sont des pratiques « rarement reconnues dans les textes officiels auparavant ». Ce texte va donc au-delà de la reconnaissance symbolique, souligne la presse. Il criminalise la colonisation pour reconnaître les crimes car « la loi qualifie explicitement la colonisation française, qui s'est étendue de 1830 à 1962, de crime d'État », rappelle Afrik.com. « En cinq chapitres, elle recense les exactions commises durant cette période ». Des excuses officielles attendues de la part de la France Et, cette proposition de loi réclame notamment des « excuses officielles » de l'État français pour les crimes commis. Des excuses « présentées comme un préalable indispensable à toute "réconciliation mémorielle" entre les deux pays », souligne Afrik.com. Pour rappel, en 2021, le président français, Emmanuel Macron, avait qualifié la colonisation de l'Algérie de « crime contre l'humanité », mais sans présenter d'excuses officielles au nom de l'État français. « Une nuance que les autorités algériennes n'ont jamais cessé de souligner », commente le média. La loi prévoit également une « indemnisation complète et équitable pour les préjudices matériels et moraux causés par la colonisation. Elle appelle la France à restituer l'ensemble des archives liées à cette période ». Autre point mentionné par la proposition de loi : la décontamination des sites affectés par les essais nucléaires français. Le texte possède également des dispositions pénales qui répriment la glorification de la colonisation. « Les relations avec l'ancienne puissance coloniale demeurent fragiles » Et, les réactions de Paris sont commentées aussi. Le média Observalgerie mentionne les déclarations du Quai d'Orsay : « Paris estime que cette loi va à l'encontre de la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et d'un travail serein sur les enjeux mémoriels ». Par ailleurs, le Quai d'Orsay a précisé que « la France n'avait pas vocation à commenter la politique intérieure algérienne. [Le Quai d'Orsay] a toutefois rappelé "l'ampleur du travail engagé par le président" Emmanuel Macron sur les questions mémorielles, notamment à travers une commission mixte d'historiens des deux pays. » Dans sa déclaration, le ministère français a également réaffirmé sa volonté de « continuer à travailler à la reprise d'un dialogue exigeant avec l'Algérie ». Ce qu'il faut retenir, souligne Afrik.com, c'est qu'« au-delà de ses effets juridiques concrets, cette loi marque un tournant : celui d'un État qui choisit de faire de la mémoire un acte législatif, et de l'histoire un enjeu pleinement politique, au moment même où les relations avec l'ancienne puissance coloniale demeurent fragiles et chargées de non-dits ». À lire aussiFrance-Algérie: le président Macron évoque une reprise du dialogue avec Alger
Ep.125 Anissa Ali "Dating, la grande illusion" : avant le dating, regardons nos amitiés, est-on capable de créer des relations de qualité ?
Anissa Ali (la_freudzone sur Instagram), thérapeute conjugale et familiale, a écrit le livre "Dating, la grande illusion. Sortir de la spirale des rencontres superficielles et créer de vraies relations" (éditions Le Courrier du Livre / Tredaniel). Je lui ai proposé un cadre inédit pour l'enregistrement car elle vit dans la région : la plage Saint-Clair. Vous aurez donc la joie d'entendre les vagues tout au long de nos échanges. C'est mon cadeau pour les fêtes ! Dans cet épisode, Anissa propose des solutions pour sortir de la dating fatigue, en se posant les bonnes questions, avec des exercices pratiques à retrouver dans son livre. Pour les personnes non concernées par le sujet des rencontres (définitivement ou temporairement), on fait le point aussi sur la qualité de nos relations amicales. Retenez bien cette phrase (p.229), à 20'36 dans l'épisode "la durée d'une relation ne détermine pas sa qualité, aussi faites des check-in (vérifications) fréquents sur vos amitiés." "Si vous êtes entouré.e de gens qui incarnent des valeurs fortes et authentiques (...), vous aspirerez à des relations plus sincères, équilibrées et profondes (...) cela influencera aussi vos postures dans le couple." Pour avoir appliqué ces conseils, je vous confirme que ça marche, c'est un soulagement.Votre temps est précieux ! Bonne écoute ! Retrouvez Anissa Ali sur les réseaux sociauxhttps://www.instagram.com/la_freudzone En librairies : https://www.editions-tredaniel.com/dating-la-grande-illusion-p-12258.html https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782702929759-dating-la-grande-illusion-anissa-ali/ Références citées dans l'épisode ou en bonus (à suivre) AVERTISSEMENT IMPORTANT : Ne jamais s'inscrire sur une application ou site de rencontres payant sans 1) lire les avis sur Google (Play store) ou Apple (App store) 2) lire les conditions tarifaires de l'abonnement. Ainsi je vous déconseille fortement le site PARSHIP, qui pratique l'extorsion : on ne peut pas résilier avant 1 an obligatoire, même si on n'utilise plus le service, qui n'est pas satisfaisant, car très peu de personnes dans votre région. Le service clients n'a que mépris pour les clients et le service communication ne veut rien entendre (un comble), aucun arrangement possible. Donc évitez une dépense inutile. Episode enregistré en octobre 2025, sur la plage Saint-Clair (au Lavandou, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur), photos disponibles sur leur compte Instagram https://www.instagram.com/lelavandoutourismePrise de son, montage et mixage : Isabelle FieldMusique : Nouveau générique ! Vous l'avez reconnu ? C'est le générique de la série mythique des années 90 "Code Quantum" avec Scott Bakula. J'adore cette série, féministe, inclusive. Dédicace à Richard Gaitet (Arte Radio), auteur, fan inconditionnel aussi de cette série.Virgules sonores : Edouard JoguetLogo conçu par Lynda Mac-ConnellHébergement : Podcloud
POUR COMMANDER MON LIVRE : Sur Amazon : https://amzn.to/3ZMm4CY Sur Fnac.com : https://tidd.ly/4dWJZ8O
À la Une: la CAN, un instrument de soft power pour le Maroc
Avant de parler de la Coupe d'Afrique des nations, les journaux s'intéressent aussi au renouvellement du mandat de la Monusco. Ce week-end, les Nations unies ont renouvelé, pour un an, le mandat de leur mission en République démocratique du Congo. Et ce alors même que « la mission onusienne avait amorcé un processus de désengagement, notamment au Sud-Kivu, après plus de deux décennies de présence sur le sol congolais », rappelle Le Potentiel en RDC. Mais le contexte sécuritaire aura eu raison de cette volonté : la situation est « particulièrement préoccupant[e] », rappelle actualite.cd, en raison des affrontements dans l'est du pays. « La rébellion de l'AFC/M23, soutenue par le Rwanda, occupe de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Lubero et Walikale », pointe ainsi le titre. Conclusion : une « aggravation » des crises humanitaire et sécuritaire. Mais après plus de 20 ans de mandats successifs, le média burkinabè Le Pays s'interroge : « Que peut-on encore attendre de cette mission onusienne ? (…) À quoi servira ce renouvellement de mandat ? » Le quotidien est circonspect, même s'il admet que ce n'est pas entièrement la faute de la Monusco. Celle-ci aurait bien besoin, pour agir, « d'un mandat robuste, comme ce fut le cas en 2013 », ce qui lui avait à l'époque permis « de mettre le M23 en déroute », se remémore Le Pays. Tout de même, le journal accorde au moins un mérite à la Monusco : celui de pouvoir être « une force tampon » et d'être « mise à contribution dans le cadre de la sécurisation des populations ». Le Maroc et la CAN en étendard Les journaux marocains ne sont pas peu fiers que leur pays héberge la compétition. Ainsi de L'Opinion, qui s'enorgueillit que « le nom du Maroc [soit] devenu un véritable label d'excellence dans le monde très concurrentiel du football ». Le 360 se gargarise de la même manière de cette « organisation grandiose » et de « la ferveur déjà palpable dans chaque ville, chaque rue, chaque café ». Accueillir la compétition est autant une preuve des mérites du Maroc qu'une occasion d'éblouir encore un peu plus le monde entier, « une opportunité majeure, de doper davantage ce soft power en présentant (…) au monde entier notre meilleur visage », poursuit l'Opinion. H24 Info ne s'y trompe pas non plus : sur le terrain comme ailleurs, le pays « n'a pas le droit à l'erreur » ; le sélectionneur Walid Regragui fait face à « une énorme pression » tandis que le président de la Fédération royale marocaine de football « doit rendre une copie parfaite du point de vue de l'organisation ». Le Royaume a donc mis les petits plats dans les grands. Le Monde Afrique parle même de « moyens hors norme ». Quitte parfois à s'attirer les foudres de la société civile. Car le dispositif impliquant « surveillance avec drones, caméras avec systèmes de reconnaissance faciale, commissariats à l'intérieur des enceintes sportives » est regardé d'un mauvais œil, quelques semaines après le mouvement Gen Z 212 qui a vu des dizaines de milliers de jeunes manifester pour réclamer un meilleur accès aux soins ou au logement. Une vitrine au-delà de la CAN Dans quatre ans, le royaume chérifien remet le couvert avec cette fois la Coupe du monde, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal. Ce qui fait du Maroc, rappelle H24 Info, le « deuxième pays africain à accueillir une Coupe du monde, 20 ans après l'Afrique du Sud ». La Coupe d'Afrique des nations a donc des airs de « répétition générale », pour faire du pays « une vitrine internationale », abonde L'Économiste. C'est d'ailleurs pour cela, rappelle Le Monde Afrique, que Rabat a investi l'équivalent de près de deux milliards d'euros dans « ses infrastructures hôtelières, aéroportuaires, routières et sportives » et dans la rénovation de ses stades. Puis il est aussi question, bien sûr, de soft power. Ici, le ballon rond est surtout un prétexte pour « renforcer l'influence économique et diplomatique du royaume sur la scène internationale, et pas seulement en Afrique ». Dans cette perspective, chaque Marocain est rien de moins qu'un « ambassadeur de son pays », estime L'Opinion. Pour reprendre les mots de Walid Regragui : « remporter la CAN n'est pas un choix », c'est « une obligation ».
Beaucoup d'équipes sont déjà éliminées des playoffs, mais pour autant certaines ont de quoi entrevoir un avenir plus radieux. Petite revue des équipes concernées, avec une projection sur celles qui ont la meilleure chance de rebondir en 2026.On se projette également sur le match qui va opposer les Broncos aux Jaguars en tête de la conférence AFC. Ainsi que sur tous les matchs de cette semaine 16 avant de finir par les paris avec notre partenaire Unibet. Victor Roullier et Raoul Villeroy sont au micro.Bonne écoute ! Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le Royaume s'apprête à organiser à partir de dimanche la 35è édition de la Coupe d'Afrique des nations. Pendant près d'un mois, tous les regards seront tournés vers le Maroc qui mise sur le sport pour s'étendre. Ainsi, Rabat co-organisera en 2030 avec l'Espagne et le Portugal la Coupe du monde de football. Tous les voyants semblent au vert, mais le Maroc est fragilisé par une contestation menée par la génération Z qui dénonce des services publics défaillants et des inégalités sociales persistantes. Afrique, Europe : quels sont les axes d'évolution du Maroc ? Jusqu'où le Royaume peut-il aller ? Qu'est-ce qui pourrait le faire chuter ? Pour en débattre - Fadwa Islah, grand reporter au magazine Jeune Afrique, spécialiste du Maroc - Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et coauteur de l'article Vers une communauté de l'Atlantique oriental, publié dans la revue Le Grand Continent - Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, basé à Rabat.
Pourquoi la Colombie porte-t-elle le nom de Christophe Colomb ?
La Colombie porte le nom de Christophe Colomb, mais le navigateur génois n'a jamais mis les pieds sur le territoire colombien actuel. Cette apparente contradiction s'explique par l'histoire complexe de la découverte de l'Amérique et par la construction politique des jeunes États du continent au XIXᵉ siècle.Christophe Colomb est avant tout associé à l'arrivée des Européens en Amérique en 1492. En réalité, il n'a jamais atteint le continent nord-américain et n'a exploré que certaines îles des Caraïbes, ainsi que les côtes de l'Amérique centrale. Pourtant, son voyage marque un tournant majeur : il inaugure durablement les échanges entre l'Europe et le continent américain, ce que l'on appelle souvent la « rencontre de deux mondes ».Lorsque les colonies espagnoles d'Amérique du Sud commencent à lutter pour leur indépendance au début du XIXᵉ siècle, leurs dirigeants cherchent des symboles forts capables de fédérer des territoires immenses et très divers. Christophe Colomb s'impose alors comme une figure fondatrice, perçue à l'époque comme l'initiateur de l'histoire moderne du continent américain, même si cette vision est aujourd'hui largement critiquée.En 1819, après plusieurs victoires militaires contre l'Espagne, le général Simón Bolívar proclame la création d'un nouvel État : la Gran Colombia. Cet ensemble politique regroupe alors les territoires de l'actuelle Colombie, du Venezuela, de l'Équateur et du Panama. Le choix du nom « Colombia » est hautement symbolique : il rend hommage à Colomb tout en affirmant une rupture avec la domination espagnole. Il s'agit d'un hommage paradoxal, car Colomb était lui-même un acteur de la conquête européenne, mais son nom est détaché de la couronne espagnole et transformé en mythe fondateur.La Gran Colombia se disloque rapidement, dès 1830, en plusieurs États indépendants. L'un d'eux conserve le nom de Colombie, qui devient officiel en 1886 avec la République de Colombie. Le nom est désormais enraciné dans l'identité nationale.Il faut aussi rappeler qu'au XIXᵉ siècle, l'image de Christophe Colomb est très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Il est alors célébré comme un héros visionnaire et un explorateur audacieux, tandis que les violences de la colonisation sont largement passées sous silence. Ce n'est que plus tard que l'historiographie et les débats publics viendront nuancer, voire contester, ce récit.Ainsi, la Colombie porte le nom de Christophe Colomb non pas parce qu'il l'a découverte, mais parce que son nom est devenu un symbole politique et historique, choisi à un moment clé pour construire une nation et lui donner une place dans l'histoire du continent américain. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Quel est le lien entre Napoléon III et la dictée ?
À première vue, Napoléon III et la dictée semblent appartenir à deux mondes très différents : l'un est un empereur, l'autre un exercice scolaire. Et pourtant, c'est sous son règne que la dictée moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a pris une importance décisive dans l'école française. Le lien entre les deux est à la fois politique, social et culturel.Lorsque Napoléon III arrive au pouvoir en 1852, il hérite d'un pays où l'éducation reste inégale et où la maîtrise de la langue française varie fortement selon les régions. Pour renforcer l'unité nationale et stabiliser son régime, l'empereur voit dans l'instruction un outil essentiel. Il encourage donc une réforme ambitieuse de l'école primaire, portée notamment par le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy. L'objectif : diffuser une culture commune, améliorer la discipline et garantir une meilleure maîtrise du français.C'est dans ce contexte que la dictée devient un exercice central. Elle incarne parfaitement l'esprit de l'époque : rigueur, ordre, respect des règles et uniformisation linguistique. Dans une France encore marquée par les patois, la dictée sert à imposer une langue écrite standardisée et à former des citoyens capables de lire les textes administratifs et les lois. Devenue obligatoire dans les écoles publiques à partir des années 1860, elle devient un symbole de l'école républicaine… avant même la République.Mais le lien le plus célèbre entre Napoléon III et la dictée vient d'un épisode littéraire presque anecdotique devenu mythique : la dictée de Mérimée. En 1857, l'écrivain Prosper Mérimée, académicien et ami du couple impérial, crée une dictée volontairement redoutable pour divertir la cour pendant les séjours aux Tuileries ou à Compiègne. Il y convoque des pièges orthographiques, des accords subtils et un vocabulaire rare.Napoléon III s'y essaie, comme les invités, et obtient un résultat… catastrophique : plus de soixante fautes selon les témoignages. Cet épisode, relayé plus tard avec humour, contribue à populariser l'idée que la dictée est un exercice prestigieux, capable de révéler le niveau linguistique des plus puissants comme des simples élèves. Mérimée n'inventait pas la dictée, mais il en faisait un objet culturel, un défi intellectuel, presque un jeu de société aristocratique.Ainsi, entre réforme scolaire, uniformisation du français et anecdote impériale, Napoléon III a joué un rôle majeur dans la place centrale qu'occupe encore aujourd'hui la dictée dans la tradition éducative française. Une drôle d'alliance entre pédagogie, pouvoir et orthographe. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Nous sommes au mois d'août 1779, au château de Versailles. De retour de ses couches, Marie Antoinette paraît dans les jardins du Petit Trianon, vêtue d'une simple robe de mousseline attachée à la taille par un ruban. Cette robe dite « de gaulle » ou « en gaulle » est si légère qu'elle va provoquer le scandale sous le nom de « chemise à la reine ». Elle choque car c'est la première fois qu'une reine de France porte en public une tenue « négligée ». Ainsi en 1783, quand Elisabeth Vigée-Lebrun représente la souveraine « en chemise » et sans bijou, le teint frais sous son chapeau de paille, le tableau fait tellement scandale qu'il est aussitôt remplacé par un portrait en robe de cour, beaucoup plus classique, avec une rose à la main. Ce qui n'empêchera pas les élégantes de s'empresser de l'imiter, à Versailles en France, puis dans le monde entier. La longue histoire du vêtement est parsemée de ruptures, de remises en question des codes établis, de contestations de l'ordre régnant. Parcourons quelques-unes de ces grandes étapes… Sujets traités : vêtement, contestataire, Marie Antoinette , gaulle , Elisabeth Vigée-Lebrun, Versailles,codes, Avec nous : Jean-Luc Petit, du Service éducatif et de médiation des publics des Musées Ville de Bruxelles. Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Ainsi commence la série des Contes de One Thing In A French Day. Des histoires avec un peu de magie, redécouvertes dans les archives du podcast, la malle aux trésors. Le premier conte présente un personnage très important pour Micaela lorsqu'elle avait trois ans. Grand Doudou. Ensuite, nous ferons la connaissances de sorcières pas très commodes, les sorcières du placard à balais. Complétez l'expérience audio du podcast avec mes Lettres parisiennes et découvrez d'autres outils pour progresser en français : la curiosité, la culture et de nouvelles obsessions. Les lettres qui accompagnent les Contes de One Thing In a French Day proposent des outils particulièrement destinés aux apprenants qui travaillent seuls ou qui veulent travailler les bases du français, avec une routine très simple. Rendez-vous sur www.onethinginafrenchday.com
Retraites : le défi n'est pas l'âge légal, mais l'emploi des seniors
durée : 00:02:37 - Le Fil éco - On n'a pas tourné la page du sujet des retraites. Ainsi, s'il existe des marges de manœuvre pour discuter des paramètres d'une telle réforme, d'un point de vue économique, il apparaît nécessaire de décaler l'âge de départ moyen. - réalisation : Cassandre Puel
Pourquoi le “sous-projet 94” voulait transformer des animaux en armes vivantes ?
Au cœur de la guerre froide, les États-Unis comme l'URSS multiplient les programmes secrets les plus extravagants. Parmi eux, un dossier longtemps resté dans l'ombre porte un nom anodin : le “sous-projet 94”. Derrière cette appellation administrative se cachait pourtant une idée déroutante : utiliser certains animaux comme outils militaires, capables d'espionner, de détecter des cibles, voire d'endommager des infrastructures ennemies. Un projet qui en dit long sur l'imagination — et l'inquiétude — des stratèges de l'époque.Les documents déclassifiés évoquent plusieurs pistes explorées en parallèle. D'abord, l'idée d'exploiter les capacités sensorielles exceptionnelles de certains animaux, notamment les oiseaux, les chiens ou les mammifères marins. L'objectif n'était pas de les transformer en armes au sens létal, mais plutôt d'utiliser leurs talents naturels là où la technologie humaine était encore limitée. Ainsi, durant les années 1960, on espérait qu'un oiseau dressé puisse discrètement transporter un dispositif d'écoute miniature, ou qu'un dauphin reconnaisse une forme sous-marine suspecte mieux qu'un sonar.Dans le cadre du sous-projet 94, les chercheurs examinaient également comment ces animaux réagissaient au dressage, à la contrainte ou à des environnements inhabituels. Le but était de contrôler leur comportement suffisamment précisément pour les déployer dans des missions délicates : repérage d'un sous-marin, surveillance d'un port, détection d'explosifs. Rien de spectaculaire, mais une volonté très pragmatique d'exploiter la biologie comme un complément à la technologie.Cependant, ce projet s'est heurté à deux obstacles majeurs. Le premier est éthique : la simple idée d'utiliser des êtres vivants comme instruments militaires soulevait déjà des résistances, même dans un contexte de tension internationale extrême. Le second est pratique : les animaux ne sont pas des machines. Ils restent imprévisibles, sensibles au stress, aux bruits, aux environnements inconnus. Leur “fiabilité opérationnelle” s'est révélée largement insuffisante, au point que plusieurs lignes du programme furent rapidement abandonnées.Avec le temps, le sous-projet 94 est devenu un symbole des limites de la science militaire. Il incarne cette époque où l'on croyait encore que la biologie pourrait être modelée à volonté, sans mesurer la complexité du vivant. Aujourd'hui, il demeure un épisode fascinant : un projet à la fois ambitieux, dérangeant et révélateur des angoisses technologiques de la guerre froide, où l'on cherchait désespérément à trouver l'avantage décisif — quitte à regarder du côté du règne animal. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Lorsque George Orwell commence à écrire 1984, à la fin de l'année 1947, il est dans une situation à la fois physique et morale extrêmement fragile. L'image de l'écrivain lent, perfectionniste, travaillant patiemment son manuscrit, ne correspond pas du tout à la réalité. La vérité, c'est qu'Orwell s'est lancé dans une course contre la montre. Une course littérale : il sait qu'il est en train de mourir.Depuis plusieurs années, Orwell souffre de tuberculose, une maladie alors difficile à soigner. À l'époque, il se retire sur l'île écossaise de Jura, un lieu isolé, froid, humide… exactement le contraire de ce qu'un médecin recommanderait. Mais il s'y sent libre, protégé du monde qu'il fuit : celui des totalitarismes, des manipulations politiques, des propagandes qui défigurent les mots et les idées. Là-bas, enfermé dans une petite maison rudimentaire, il écrit dans une urgence fébrile.Pourquoi cette précipitation ?D'abord parce qu'il craint que sa santé l'abandonne avant qu'il ne parvienne au bout de son roman. Il écrit donc douze heures par jour, parfois jusqu'à l'épuisement, tapant sur sa machine malgré la fièvre, malgré la toux qui l'étouffe. Les brouillons montrent des corrections hâtives, des phrases reprises à la va-vite. C'est un travail de survie autant que de création.Mais il y a une autre urgence, plus intellectuelle cette fois. Orwell pense que l'histoire est en train de basculer vers un monde où la liberté de pensée recule. La guerre froide commence, les blocs se durcissent, la propagande devient partout un outil central. Pour lui, 1984 n'est pas un roman d'anticipation : c'est un avertissement immédiat, un signal d'alarme. Il doit sortir maintenant, pas dans cinq ans. Attendre serait presque une forme de complicité.Cette double urgence — biologique et politique — explique pourquoi 1984 a été écrit aussi vite. Orwell achève le manuscrit en 1948, l'envoie à son éditeur dans un état d'épuisement total, et meurt quelques mois après la parution, en janvier 1950. Il n'aura jamais vu l'ampleur du phénomène que son livre deviendra.Ainsi, 1984 est né dans une singularité rare : un roman écrit en hâte non pas par négligence, mais par nécessité vitale. C'est peut-être cette intensité, cette urgence brûlante, qui lui donne encore aujourd'hui une telle force prophétique. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi Les demoiselles d'Avignon de Picasso ne sont-elles pas d'Avignon ?
Le titre du tableau de Picasso induit souvent en erreur : Les Demoiselles d'Avignon ne renvoient absolument pas à la célèbre ville du sud de la France. Rien, dans l'histoire du tableau ou dans l'intention de l'artiste, ne renvoie à Avignon. L'origine véritable du titre est bien plus surprenante et profondément liée à la jeunesse de Picasso à Barcelone.En 1907, lorsque Picasso peint ce tableau révolutionnaire, il cherche à représenter les prostituées d'une maison close située dans la rue d'Avinyó, une rue populaire du quartier gothique de Barcelone. À l'époque, cette rue était connue pour ses bordels, que le jeune Picasso fréquentait régulièrement avec ses amis artistes. Le tableau s'appelait d'ailleurs d'abord « Le Bordel d'Avinyo », un titre beaucoup plus explicite mais jugé trop scandaleux par ses proches. L'appellation “Demoiselles” est une façon euphémisée de désigner ces femmes, et la transformation d'“Avinyó” en “Avignon” serait venue d'un malentendu ou d'un choix délibéré de ses amis marchands pour adoucir le sujet.En réalité, la déformation du nom a permis de détourner l'attention du public d'un titre jugé trop cru et choquant au début du XXᵉ siècle. Le mot “Avignon” sonnait plus neutre, presque poétique, tout en conservant une résonance étrangère. Avec le temps, ce nom s'est imposé et est devenu indissociable du tableau, même si son lien géographique est totalement erroné.Mais au-delà du titre, ce tableau marque une rupture fondamentale dans l'histoire de l'art. Picasso y représente cinq femmes nues, aux corps anguleux, aux visages inspirés des masques africains et de l'art ibérique, un choc visuel radical pour l'époque. La perspective traditionnelle est abandonnée, les formes sont disloquées, les corps comme taillés dans la pierre. Ce style préfigure ce qui deviendra le cubisme, mouvement fondé avec Georges Braque et qui bouleversera tous les codes de la peinture occidentale.Aujourd'hui, Les Demoiselles d'Avignon est conservé au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, où il est considéré comme l'un des tableaux les plus importants du XXᵉ siècle. Et malgré son titre trompeur, son ancrage demeure bien celui de la Barcelone de Picasso, et non de la Provence française.Ainsi, les Demoiselles ne sont pas d'Avignon… mais d'Avinyó, rue discrète d'où partit une révolution artistique. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi l'histoire du président américain James Garfield est-elle fascinante ?
James Garfield est sans doute l'un des présidents les plus étonnants et les moins connus de l'histoire américaine. Son parcours ressemble à une ascension miraculeuse : né en 1831 dans une cabane en rondins dans l'Ohio, orphelin de père à deux ans, il commence sa vie comme garçon de ferme et conducteur de bateau sur un canal. Rien — absolument rien — ne le prédestinait à la Maison-Blanche.Garfield possède pourtant un don rare : une intelligence fulgurante. Il apprend le latin en quelques semaines, le grec ancien en quelques mois, au point de pouvoir écrire simultanément un texte en grec d'une main et en latin de l'autre. Brillant orateur, autodidacte infatigable, il devient professeur, puis président d'université avant même ses 30 ans.Quand éclate la guerre de Sécession, Garfield s'engage comme simple officier mais gravit les échelons grâce à son sens tactique et son sang-froid. À 31 ans, il est déjà général. Après la guerre, il entame une carrière politique impressionnante : élu au Congrès pendant 17 ans, il devient l'une des figures intellectuelles majeures du Parti républicain.Mais son accession à la présidence en 1880 tient presque du hasard. Garfield ne voulait même pas être candidat ; il venait pour soutenir un autre prétendant. Pourtant, lors de la convention républicaine, après 36 tours de scrutin chaotiques, les délégués se tournent soudain vers lui comme compromis providentiel. Il devient président malgré lui.Et c'est tragiquement là que commence la seconde partie de son histoire — celle qui a marqué la médecine moderne. Le 2 juillet 1881, seulement quatre mois après son investiture, Garfield est victime d'un attentat : un déséquilibré, Charles Guiteau, lui tire dessus dans une gare de Washington. La balle n'est pas immédiatement mortelle… mais les médecins, en sondant la plaie avec des doigts non désinfectés, provoquent une infection massive. Alexander Graham Bell lui-même tente de localiser la balle avec un détecteur métallique expérimental — un des tout premiers de l'histoire — mais l'échec tient à un détail tragique : le lit du président est en métal.Garfield agonise pendant 79 jours, dans ce qui deviendra l'un des premiers grands cas médicaux médiatisés du pays. Sa mort, en septembre 1881, bouleverse les États-Unis et accélère des réformes cruciales, notamment l'assainissement des pratiques médicales et la lutte contre le système des nominations politiques corrompues.Ainsi, Garfield reste l'un des présidents les plus brillants… et l'un des plus tragiques. Un génie autodidacte, un héros de guerre, un président par accident, et une victime de la médecine d'avant l'hygiène moderne. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi les présidents américains prêtent-ils serment sur la Bible ?
Lors de l'investiture d'un président américain, l'image est devenue presque rituelle : une main levée, l'autre posée sur une Bible. Pourtant, contrairement à ce que beaucoup imaginent, aucune loi n'impose d'utiliser un texte religieux. La Constitution américaine est très claire : le futur président doit simplement prêter serment, mais rien n'est précisé concernant l'objet sur lequel il doit poser la main. Cette pratique relève donc de la tradition, non de l'obligation.Alors, pourquoi la Bible s'est-elle imposée ? D'abord pour des raisons historiques. En 1789, lors de la toute première investiture, George Washington choisit spontanément d'utiliser une Bible empruntée à une loge maçonnique voisine. Ce geste, hautement symbolique dans une jeune nation encore imprégnée de culture protestante, inspira ses successeurs et donna naissance à une coutume. La Bible devint un marqueur d'autorité morale, un moyen d'afficher probité et continuité. Au fil du temps, cet acte fut perçu comme un signe de respect envers la tradition américaine, mais non comme une règle impérative.Ensuite, il faut rappeler que les États-Unis, bien que fondés en partie par des croyants, ont inscrit dans leur Constitution le principe de séparation de l'Église et de l'État. Le serment présidentiel reflète cet équilibre : religieusement neutre dans son texte, mais culturellement empreint de symboles. Le président peut donc décider du support utilisé, ou même… de ne rien utiliser du tout.Ainsi, plusieurs présidents n'ont pas prêté serment sur la Bible, ce qui démontre bien que le geste reste optionnel. Le cas le plus célèbre est celui de John Quincy Adams, qui choisit en 1825 de prêter serment sur un livre de lois, considérant que son engagement devait se référer à la Constitution plutôt qu'à un texte religieux. Theodore Roosevelt, en 1901, prêta serment sans aucune Bible, faute d'en avoir une disponible lors de sa prestation inattendue après l'assassinat de McKinley. Plus récemment, certains élus locaux ou fédéraux ont utilisé le Coran, la Torah, ou même des ouvrages symboliques liés aux droits civiques.L'essentiel à retenir est donc simple : la Bible n'est qu'une tradition. Le véritable engagement du président est celui envers la Constitution et le peuple américain. Le support choisi n'a aucune valeur juridique : c'est un symbole, et chacun est libre de l'interpréter à sa manière.Ainsi, prêter serment sur la Bible n'est pas une règle, mais un héritage culturel que certains perpétuent… et que d'autres préfèrent réinventer. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Trump lâche l'Europe, le Kremlin jubile... - Vos questions sms -
C dans l'air du 8 décembre 2025 - Trump lâche l'Europe, le Kremlin jubile...Sous pression américaine, Volodymyr Zelensky est reçu aujourd'hui à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer, en présence du président Emmanuel Macron et du chancelier allemand Friedrich Merz. Objectif : faire le point et peser sur les négociations en cours en Floride entre les Ukrainiens et les Américains. Les discussions qui se déroulent aux États-Unis interviennent dans le cadre du plan américain visant à mettre fin à la guerre déclenchée voilà bientôt quatre ans par la Russie. Les Européens entendent peser sur les discussions depuis plusieurs semaines et éviter la rupture avec une administration américaine qui multiplie les gestes hostiles.Ainsi, les États-Unis ont dévoilé vendredi dernier leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Dans ce document de 33 pages, qui trace leurs priorités de politique étrangère, Washington est d'une violence inédite vis-à-vis des Européens. Cette nouvelle doctrine américaine salue la montée en puissance des « partis européens patriotiques » – situés à l'extrême droite de l'échiquier politique – et justifie son ingérence dans les affaires européennes au prétexte de la préservation de l'identité et des valeurs du Vieux Continent. Celui-ci est présenté comme menacé « d'un effacement civilisationnel », en raison notamment de l'immigration, de la « censure » de la liberté d'expression ou encore de l'« asphyxie réglementaire ».Le document stratégique, qui reprend finalement les propos énoncés à Munich en février 2025 par le vice-président américain J. D. Vance, marque un tournant historique amorcé depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.Au sein de l'UE comme à Londres, les réactions se veulent mesurées pour ne pas creuser davantage un fossé de plus en plus béant. Berlin a ainsi réagi promptement via son ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, estimant que l'Allemagne n'avait pas besoin de « conseils venant de l'extérieur », notamment sur « la liberté d'expression » ou « l'organisation des sociétés libres ».Mais les sujets de friction se multiplient : l'amende de 120 millions d'euros infligée par Bruxelles à X, le réseau social d'Elon Musk, pour manquement aux règles européennes, suscite la colère de Washington. Elon Musk lui-même a appelé dans un tweet au démantèlement de l'Union européenne. Il a également répondu « c'est à peu près ça » à un message d'une utilisatrice comparant l'UE à l'Allemagne nazie et la qualifiant de « quatrième Reich ». « Cela fait partie de la liberté d'expression que nous chérissons dans l'UE, et qui permet les déclarations les plus folles », a réagi la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho.Nos experts :- Gallagher FENWICK - Journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur de Volodymyr Zelensky : l'Ukraine dans le sang - Vincent HUGEUX - Journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux- Pierre HASKI - Chroniqueur international - France Inter et Le Nouvel Obs- Laure MANDEVILLE - Grand reporter - Le Figaro, autrice de L'Ukraine se lève - Hélène KOHL ( en duplex) - Journaliste – Le Podkast
C dans l'air du 8 décembre 2025 - Trump lâche l'Europe, le Kremlin jubile...Sous pression américaine, Volodymyr Zelensky est reçu aujourd'hui à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer, en présence du président Emmanuel Macron et du chancelier allemand Friedrich Merz. Objectif : faire le point et peser sur les négociations en cours en Floride entre les Ukrainiens et les Américains. Les discussions qui se déroulent aux États-Unis interviennent dans le cadre du plan américain visant à mettre fin à la guerre déclenchée voilà bientôt quatre ans par la Russie. Les Européens entendent peser sur les discussions depuis plusieurs semaines et éviter la rupture avec une administration américaine qui multiplie les gestes hostiles.Ainsi, les États-Unis ont dévoilé vendredi dernier leur nouvelle stratégie de sécurité nationale. Dans ce document de 33 pages, qui trace leurs priorités de politique étrangère, Washington est d'une violence inédite vis-à-vis des Européens. Cette nouvelle doctrine américaine salue la montée en puissance des « partis européens patriotiques » – situés à l'extrême droite de l'échiquier politique – et justifie son ingérence dans les affaires européennes au prétexte de la préservation de l'identité et des valeurs du Vieux Continent. Celui-ci est présenté comme menacé « d'un effacement civilisationnel », en raison notamment de l'immigration, de la « censure » de la liberté d'expression ou encore de l'« asphyxie réglementaire ».Le document stratégique, qui reprend finalement les propos énoncés à Munich en février 2025 par le vice-président américain J. D. Vance, marque un tournant historique amorcé depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.Au sein de l'UE comme à Londres, les réactions se veulent mesurées pour ne pas creuser davantage un fossé de plus en plus béant. Berlin a ainsi réagi promptement via son ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, estimant que l'Allemagne n'avait pas besoin de « conseils venant de l'extérieur », notamment sur « la liberté d'expression » ou « l'organisation des sociétés libres ».Mais les sujets de friction se multiplient : l'amende de 120 millions d'euros infligée par Bruxelles à X, le réseau social d'Elon Musk, pour manquement aux règles européennes, suscite la colère de Washington. Elon Musk lui-même a appelé dans un tweet au démantèlement de l'Union européenne. Il a également répondu « c'est à peu près ça » à un message d'une utilisatrice comparant l'UE à l'Allemagne nazie et la qualifiant de « quatrième Reich ». « Cela fait partie de la liberté d'expression que nous chérissons dans l'UE, et qui permet les déclarations les plus folles », a réagi la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho.Nos experts :- Gallagher FENWICK - Journaliste, spécialiste des questions internationales, auteur de Volodymyr Zelensky : l'Ukraine dans le sang - Vincent HUGEUX - Journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux- Pierre HASKI - Chroniqueur international - France Inter et Le Nouvel Obs- Laure MANDEVILLE - Grand reporter - Le Figaro, autrice de L'Ukraine se lève - Hélène KOHL ( en duplex) - Journaliste – Le Podkast