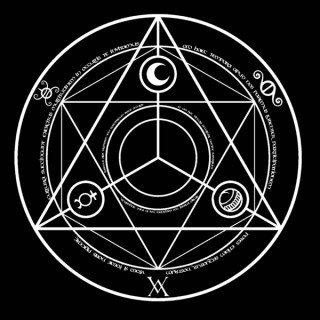Podcasts about xviie
- 374PODCASTS
- 1,099EPISODES
- 32mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Feb 18, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about xviie
Latest news about xviie
- Open Access Journal: Technè AWOL - The Ancient World Online - Dec 3, 2025
- Professions And Occupations Of The Jews Of Morocco – Analysis Eurasia Review - Oct 14, 2024
Latest podcast episodes about xviie
Pour parler des langues, on utilise souvent un vocabulaire du vivant : il y aurait des “familles” de langues, des “langues-mères”, dans un “arbre généalogique” des langues. D'ailleurs, certaines langues seraient menacées, vivantes, voire… mortes ! Mais c'est quoi, une langue morte ? On pourrait dire que c'est comme nous : une langue, mais qui n'aurait plus ses fonctions vitales. En tout cas, on peut dire que les historiens, les archéologues, les chercheurs du passé, les langues mortes, ça les connaît ! C'est même un sacré enjeu, parce que, pas le choix : il y a des sources qu'on est bien obligé de lire dans leur langue d'origine ! Et voilà pourquoi on fait un petit épisode dessus…Bonne écoute !
[SPONSORISÉ] Le manoir du Tertre a tout du petit paradis. C'est une belle demeure du XVIIe siècle, que l'on rejoint en s'aventurant sur les chemins de la forêt de Paimpont, en Ille et Vilaine. Vous connaissez sûrement ces bois sous un autre nom hérité du mythe arthurien : Brocéliande. Au coeur des terres de Merlin et de la fée Morgane, la demeure est aujourd'hui une maison d'hôte atypique, réputée notamment pour son étrange activité nocturne. Bruits mystérieux résonnant depuis les étages, diligence s'évaporant dans la brume, pieds translucides aperçus grimpant les marches sans corps à leur suite… Les phénomènes paranormaux sont légion entre les vieilles pierres du manoir. Cette hantise serait liée à une ancienne propriétaire des lieux. Prophétesse célèbre des années 30 et 40, elle aura l'oreille attentive du régime de Vichy. Entre bois mystiques, médiumnité et accointances avec le IIIe Reich, voici l'histoire rocambolesque de Geneviève Zaepffel.Paranormal • Histoires Vraies est une production Minuit.
Révélations des Victoires de la Musique classique, 2e volet ; Ensemble Cordance ; Les Surprises ont 15 ans
durée : 01:28:16 - Révélations des Victoires de la Musique classique, 2e volet ; Ensemble Cordance ; Les Surprises ont 15 ans - par : Clément Rochefort - Révélations des Victoires de la Musique classique (2/2) : Tamara Bounazou et Julie Peyramaure, sopranos ; l'Ensemble Cordance, avec Marine Chagnon, mezzo-soprano ; l'ensemble Les Surprises, pour souffler 15 bougies autour de la musique anglaise du XVIIe siècle - réalisé par : Claire Lagarde Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
durée : 01:28:34 - Relax ! du vendredi 13 février 2026 - par : Lionel Esparza - Plongez au cœur de l'âge baroque et embarquez pour un voyage musical de l'Angleterre à l'Italie. Purcell, Monteverdi, Haendel, Vivaldi... Une heure avec les compositeurs qui ont façonné l'oratorio, le concerto et le madrigal, et qui illustrent toute la richesse musicale des XVIIe et XVIIIe siècles. - réalisé par : Doria Zénine Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
(Désolé pour la prononciation en Alsacien, nous ferrons mieux la prochaine fois)Aujourd'hui, on part à la découverte de l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire des chasses aux sorcières en Europe : les procès pour sorcellerie des enfants de Molsheim, en Alsace. Entre 1620 et 1630, la ville devient le centre d'une vague d'accusations, de tortures et d'exécutions visant non seulement des adultes… mais aussi des dizaines d'enfants, parfois âgés de 5 à 10 ans. Envie d'en savoir plus ? Alors c'est parti pour un nouveau moment d'Occulture. --------------------------- Devenez membre de cette chaine pour bénéficier d'avantages exclusifs : https://www.youtube.com/c/Occulture/membership --------------------------- Tous les liens utiles de la chaine (réseaux sociaux, boutiques, chaine secondaire...) : bento.me/occulture --------------------------- Sources : Blutbuch archives Municipales de Molsheim cote FF18 volume 2 Archives départementales de Strasbourg La sorcellerie à Molsheim (1589-1697) de Louis Schlaefli La Serie 2 B des archives Départementales du Bas-Rhin La sorcellerie au XVIe et au XVIIe siècle particulièrement en Alsace https://www.alsace-histoire.org/netdba/leopold-dautriche/ https://ere.alsace/wp-content/uploads/2023/08/Ch3-La-rafle-des-enfants-de-Molsheim.pdf https://antonpraetorius.de Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
durée : 01:28:34 - Relax ! du vendredi 13 février 2026 - par : Lionel Esparza - Plongez au cœur de l'âge baroque et embarquez pour un voyage musical de l'Angleterre à l'Italie. Purcell, Monteverdi, Haendel, Vivaldi... Une heure avec les compositeurs qui ont façonné l'oratorio, le concerto et le madrigal, et qui illustrent toute la richesse musicale des XVIIe et XVIIIe siècles. - réalisé par : Doria Zénine Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
[FLASHBACK] L'affaire Canson : le calvaire d'une riche héritière
Parmi les 10 000 tableaux composant les collections du département des peintures au Louvre, un en particulier peut retenir votre attention. Dans la salle 718 est exposé un portrait en pied, immortalisant un jeune homme d'une vingtaine d'années : il s'agit de Iñigo Melchior Fernández de Velasco de Frías, noble espagnol, cousin de Jean IV le Restaurateur, roi de Portugal au XVIIe siècle. Intitulée Le gentilhomme sévillan, on doit cette œuvre datée de 1659 au peintre Bartolomé Esteban Murillo. Les présentations sont faites, demandons-nous maintenant ce qui lui vaut une telle attention, au point de voler la vedette à De Vinci, Géricault et autres confrères... Au fond, ce n'est pas tant la peinture en elle-même qui intrigue, mais la manière dont elle est parvenue jusque-là. Et si l'un des plus grands musées au monde avait fermé les yeux sur sa provenance douteuse ? Et si ce tableau avait en réalité du sang sur sa toile ?Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
ENTRETIEN - Depuis quand les rues sont éclairées en France ? - Avec Sophie Reculin
L'éclairage public, de nos jours, il y en a à beaucoup d'endroits, et ce n'est pas rare qu'il soit éteint aux heures creuses de la nuit pour lutter contre la pollution lumineuse. Mais à ses débuts, c'était une toute autre histoire, parce qu'il a été très mal reçu par les habitants ! Et quand je parle de ses débuts, ce n'est pas le 19e siècle avec l'électricité, car l'éclairage public, il est né en France dans la deuxième moitié du 17e siècle ! Mais alors, comment ça s'est fait ? Eh bien pour le découvrir, j'ai eu le plaisir de recevoir dans un nouvel entretien historique l'historienne Sophie Reculin, dont c'est la spécialité, pour qu'elle nous éclaire à ce sujet ! Je vous souhaite une bonne écoute sur Nota Bene !➤ Pour approfondir le sujet, découvrez : ➜ Le livre de Sophie “L'invention de l'éclairage public en France. De la nuit illuminée à la nuit éclairée (1697-1789)” : https://www.septentrion.com/FR/livre/?GCOI=27574100084770➜ Sa page Academia : https://univ-lille.academia.edu/SophieReculin
Unexpected Adventure: Locked in the Louvre's Secret Room
Fluent Fiction - French: Unexpected Adventure: Locked in the Louvre's Secret Room Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.com/fr/episode/2026-01-10-08-38-20-fr Story Transcript:Fr: Dans les vastes couloirs du Louvre, où chaque peinture murmure des secrets du passé, Chantal et Luc marchaient sans hâte.En: In the vast corridors of the Louvre, where each painting whispers secrets of the past, Chantal and Luc walked unhurriedly.Fr: Chantal rêvait devant chaque tableau, perdue dans ses pensées, tandis que Luc, amusé, la suivait en traînant des pieds.En: Chantal dreamed in front of each painting, lost in her thoughts, while Luc, amused, followed her dragging his feet.Fr: Sa passion pour l'art était un mystère pour lui, mais il adorait taquiner.En: Her passion for art was a mystery to him, but he loved teasing.Fr: "Regarde, Chantal, encore un monsieur avec un chapeau bizarre," plaisantait Luc en pointant du doigt un portrait du XVIIe siècle.En: "Look, Chantal, another man with a strange hat," joked Luc pointing to a 17th-century portrait.Fr: Elle sourit, mais ne répondit pas, envoûtée par les couleurs sur la toile.En: She smiled but did not reply, captivated by the colors on the canvas.Fr: Mais voilà que le guide arrivait, un sourire enthousiaste collé au visage, prêt à déverser sa cascade de faits historiques.En: Then the guide arrived, an enthusiastic smile glued to his face, ready to pour out his cascade of historical facts.Fr: Luc avait déjà entendu bien trop de détails sur la Joconde.En: Luc had already heard far too many details about the Mona Lisa.Fr: Il voulait seulement une pause, quelque chose d'excitant pour briser la routine.En: He just wanted a break, something exciting to break the routine.Fr: "Chantal !En: "Chantal!Fr: Viens, on va prendre un raccourci par-là !"En: Come, let's take a shortcut over there!"Fr: murmura-t-il, pressant sa cousine vers une petite porte discrète.En: he murmured, urging his cousin toward a small discreet door.Fr: Ils entrèrent dans une salle sombre, remplie d'odeurs de peinture et de nettoyant.En: They entered a dark room, filled with the smells of paint and cleaner.Fr: "Je crois qu'on est dans une sorte de réserve," dit Chantal en regardant autour.En: "I think we're in some kind of storage room," said Chantal, looking around.Fr: Des balais et des pots de peinture la cernaient.En: Brooms and paint cans surrounded her.Fr: Mais lorsque Luc essaya d'ouvrir la porte pour sortir, elle resta obstinément fermée.En: But when Luc tried to open the door to leave, it remained stubbornly closed.Fr: "Oups !En: "Oops!Fr: On est enfermés," dit-il, feignant la panique mais riant en cachette.En: We're locked in," he said, feigning panic but secretly laughing.Fr: "Bravo Sherlock, ton astuce nous a conduits ici !"En: "Bravo Sherlock, your trick led us here!"Fr: répliqua Chantal, mi-amusée, mi-inquiète.En: replied Chantal, half amused, half worried.Fr: Alors qu'ils fouillaient la pièce pour une solution, Luc tomba sur une clé attachée à un petit mot mystérieux.En: As they scoured the room for a solution, Luc stumbled upon a key attached to a mysterious note.Fr: "Chantal, ça ressemble à une chasse au trésor !"En: "Chantal, this looks like a treasure hunt!"Fr: s'exclama-t-il avec un regain d'énergie, montrant le papier qui évoquait des indices pour libérer leurs esprits.En: he exclaimed with renewed energy, showing the paper that hinted at clues to free their minds.Fr: Avec un mélange d'excitation et de hâte, ils essayèrent la clé sur la porte.En: With a mix of excitement and haste, they tried the key on the door.Fr: Juste au moment où ils l'ouvraient, un gardien apparut, un sourire amusé aux lèvres.En: Just as they opened it, a guard appeared, an amused smile on his face.Fr: "Alors, on fait le pitre dans les réserves ?"En: "So, playing the fool in the storage rooms?"Fr: demanda-t-il, en inclinant légèrement la tête.En: he asked, tilting his head slightly.Fr: Chantal et Luc s'échangèrent un regard complice puis éclatèrent de rire.En: Chantal and Luc exchanged a knowing look and then burst into laughter.Fr: Sous le regard du gardien, ils glissèrent doucement hors de la réserve et rejoignirent le courant des visiteurs.En: Under the guard's gaze, they slowly slipped out of the storage room and rejoined the flow of visitors.Fr: Cette aventure avait changé leur perspective : Chantal réalisa que l'art pouvait être vécu avec légèreté et Luc découvrit qu'une touche de chaos rendait les peintures bien plus palpitantes.En: This adventure had changed their perspective: Chantal realized that art could be experienced with lightness and Luc discovered that a touch of chaos made the paintings much more thrilling.Fr: Souriant, ils reprirent leur promenade, en promettant de rendre leur prochaine visite encore plus mémorable.En: Smiling, they resumed their stroll, promising to make their next visit even more memorable. Vocabulary Words:the corridor: le couloirto whisper: murmurerunhurriedly: sans hâteto drag: traînerto tease: taquinerthe hat: le chapeaucaptivated: envoûtéecanvas: la toilethe guide: le guidethe break: la pausethe shortcut: le raccourcidiscreet: discrètethe broom: le balaistubbornly: obstinémentto feign: feindresecretly: en cachettethe trick: l'astucethe solution: la solutionto stumble upon: tomber surthe treasure hunt: la chasse au trésorthe clue: l'indicethe guard: le gardiento tilt: inclinerto exchange: échangerto slip: glisserthe flow: le courantto promise: promettrethe thrill: le palpitementmemorable: mémorablethe adventure: l'aventure
Écoutez la suite du récit consacré à Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, raconté par l'historienne Virginie Girod.Les complots et coups bas se poursuivent à la cour de France, mais Anne d'Autriche parvient à s'en dégager habillement.Le 5 septembre 1638, après 22 ans de mariage et 4 fausses couches, Anne d'Autriche met au monde son premier enfant, un garçon. La reine a alors 37 ans.Mais dans un climat de défiance à la cour, elle doit organiser son futur. À travers son fils aîné, Anne d'Autriche prépare sa régence. Louis XIII, en mauvaise santé, meurt en 1643. Le nouveau roi, Louis XIV, a alors 4 ans.Anne d'Autriche tient enfin son rôle de régente. Dans sa tâche, elle peut compter sur le soutien du premier ministre, le Cardinal Mazarin. Ensemble, ils vont faire face à l'un des événements les plus tragiques du XVIIe siècle : la Fronde.C'est à la fin de cette période que Louis XIV, bien qu'adolescent, s'impose comme le roi de France. Peu à peu, il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, et Anne d'Autriche, la reine mère, perd définitivement son pouvoir politique. (rediffusion)Au Cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1.- Ecriture et présentation : Virginie Girod - Production : Camille Bichler (avec Florine Silvant)- Direction artistique : Adèle Humbert et Julien Tharaud - Réalisation : Clément Ibrahim - Musique originale : Julien Tharaud - Musiques additionnelles : Julien Tharaud et Sébastien Guidis - Visuel : Sidonie ManginBibliographie : - Jean-François Solnon, Anne d'Autriche, reine de France au rang des plus grands rois, Perrin, 2022. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Chemins d'histoire-Madame de Sablé, avec A. Cousson-29.12.25
Deux-cent-quarantième numéro de Chemins d'histoire, treizième numéro de la septième saison, émission animée par Luc Daireaux Émission diffusée le lundi 29 décembre 2025 Thème : Madame de Sablé, préciosité et jansénisme au XVIIe siècle Invitée : Agnès Cousson, professeure de littérature française du XVIIe siècle à l'université Grenoble-Alpes, autrice de deux livres consacrés à Madame de Sablé (1599-1678), une biographie sous-titrée « Le lustre du siècle », ainsi que l'édition critique des Œuvres complètes de l'autrice, Honoré Champion, 2025.
Toute l'histoire du Québec en 40 minutes | L'Histoire nous le dira # 297
C'est quoi l'histoire du Québec ? Adhérez à cette chaîne pour obtenir des avantages : https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/join Écriture et réalisation: Laurent Turcot Montage et animation: Martin Bérubé de @proposmontreal Effets sonore: Diane. Artémis Production | artemisproduction.framer.website Vignette: Charles Boidin Merci à Isabelle Picard et Jonathan Lainey pour la révision sur la partie autochtone. Merci à Samuel Rabouin pour ses précieux commentaires sur le script. Pour soutenir la chaîne, au choix: 1. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous la vidéo. 2. Patreon: https://www.patreon.com/hndl 00:00 Introduction 01:02 Période préhistorique 02:29 Période autochtone 04:33 Nouvelle-France 09:43 Régime britannique 11:18 Le Canada 13:45 Révolution industrielle 18:55 Premières nations 20:34 20e siècle 24:20 Après-guerre 26:45 Révolution tranquille 28:35 Notre culture 37:55 21e siècle 39:55 Et le suite... Musique issue du site : epidemicsound.com Images provenant de https://www.storyblocks.com Abonnez-vous à la chaine: https://www.youtube.com/c/LHistoirenousledira Les vidéos sont utilisées à des fins éducatives selon l'article 107 du Copyright Act de 1976 sur le Fair-Use. Sources et pour aller plus loin: acques Lacoursière, J. Provencher et D. Vaugeois, Canada Québec 1534-2023, Septentrion, 2023. Jacques Lacoursière, Histoire populaire du Québec, Septentrion. 1995. Jacques Lacoursière, Une histoire du Québec racontée par Jacques Lacoursière, Septentrion, 2002. Éric Bédard, Histoire du Québec pour les nuls, First, 2012. Martin Pâquet et Stéphane Savard, Brève histoire de la révolution tranquille, Boréal, 2021. Patrick Couture, La préhistoire du Québec, Fides, 2019. Peter Gossage et J.L. Little, Une histoire du Québec : entre tradition et modernité, Hurtubise, 2015. Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique du Nord XVIe-XVIIIe siècle, PUL, 1991. Micheline Dumont, Féminisme québécois raconté à Camille, Remue-Ménage, 2010. Jean-Pierre Charland et Sabrina Moisan, Histoire du Québec en 30 secondes, Hurtubise, 2021. Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l'Amérique française, Flammarion, 2019. Adeline Vasquez-Parra, Histoire du Québec des origines à nos jours, Tallandier, 2025. Paul-André Linteau, René Durocher et Jean_Claude Robert, Histoire du Québec contemporain, Montréal, Boréal, 1989. Jean-Michel Lacroix, Histoire du Canada des origines à nos jours, Tallandier, 2016. Jean Provencher, Chronologie du Québec depuis 1534, Boréal, 2017. Jean Provencher, Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, Boréal, 1996. John A. Dickinson et Brian Young, Brève histoire socio-économique du Québec, Septentrion, 1995. Gilles Laporte, Brève histoire des patriotes, Septentrion, 2015. Daniel de Montplaisir, Histoire du Canada, biographie d'une nation, Perrin, 2019. Martin Pâquet et Stéphane Savard, Brève histoire de la révolution tranquille, Boréal, 2021. Marcel Trudel, Mythes et réalités dans l'histoire du Québec, Boréal, 2004-2008. Allan Greer, Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Boréal, 1998. Jacques Paul Couturier en coll. avecW. Johnson et R. Oullette, Un passé composé, le Canada de 1850 à nos jours, Éditions d'Acadie, 1996. Denyse Baillargeon, Repenser la nation : l'histoire du suffrage féminin au Québec, Remue-Ménage, 2019. Cole Harris, Le pays revêche, PUL, 2012. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ils étaient l'Amérique, de remarquables oubliés, Lux, 2022. Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québev, 1760-1896, Fides, 2000. Jocelyn Létourneau, Le Québec, les Québécois, un parcours historique, Fides, 2004. Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850, Fides, 1971. Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Boréal, 1988. Serge Courville et Normand Séguin, Le Pays laurentien au XIXe siècle, PUL, 1995. Laurent Turcot, L'Histoire nous le dira : Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec, Bibliothèque québécoise, 2025. Laurent Turcot, L'Histoire nous le dira 2 : La Conquête, les bungalows et autres marqueurs de l'identité québécoise, Hurtubise, 2024. Janette Bertrand, en collaboration avec Laurent Turcot, Cent ans d'histoire, vous m'avez raconté le Québec, Librex, 2025. Autres références disponibles sur demande. #histoire #documentaire #quebec #québec #quebectourism
durée : 01:27:34 - En pistes ! du mardi 16 décembre 2025 - par : Emilie Munera, Rodolphe Bruneau Boulmier - Entre instruments rares et associations sonores inattendues, l'album de l'Ensemble Capella Leonis nous propose une écoute renouvelée de la musique du XVIIe siècle, riche en contrastes et en émotions. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
durée : 01:27:34 - En pistes ! du mardi 16 décembre 2025 - par : Emilie Munera, Rodolphe Bruneau Boulmier - Entre instruments rares et associations sonores inattendues, l'album de l'Ensemble Capella Leonis nous propose une écoute renouvelée de la musique du XVIIe siècle, riche en contrastes et en émotions. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
[SPONSORISÉ] Les volets rouges du château de Martel sont clos. Les terres accolées à la petite commune de Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ont pris les allures d'un domaine hanté. La famille De Védrines, noble et protestante, implantée dans la région depuis le XVIIe siècle, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Voilà des semaines, des mois, des années, que l'on ne voit plus aucun de ses membres. Ils congédient tout visiteur, rasent les murs les jours de marché, annulent chaque été leur festival d'art lyrique, et demeurent reclus nuit et jour derrière les enceintes de leur forteresse. Ils ont confié leur patrimoine, leur libre-arbitre et leur vie à une simple voix qui, par téléphone, dicte le moindre de leurs faits et gestes. Un protecteur, un maître à penser, un gourou pensent certains, qui leur répète inlassablement quoi dire, quoi penser, envers qui se méfier : l'État, les banques, les francs-maçons, et le monde entier.Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
[INÉDIT] Les reclus de Monflanquin : une riche famille sous emprise • L'Intégrale
Les volets rouges du château de Martel sont clos. Les terres accolées à la petite commune de Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ont pris les allures d'un domaine hanté. La famille De Védrines, noble et protestante, implantée dans la région depuis le XVIIe siècle, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Voilà des semaines, des mois, des années, que l'on ne voit plus aucun de ses membres. Ils congédient tout visiteur, rasent les murs les jours de marché, annulent chaque été leur festival d'art lyrique, et demeurent reclus nuit et jour derrière les enceintes de leur forteresse. Ils ont confié leur patrimoine, leur libre-arbitre et leur vie à une simple voix qui, par téléphone, dicte le moindre de leurs faits et gestes. Un protecteur, un maître à penser, un gourou pensent certains, qui leur répète inlassablement quoi dire, quoi penser, envers qui se méfier : l'État, les banques, les francs-maçons, et le monde entier.Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
[INÉDIT] Les reclus de Monflanquin : une riche famille sous emprise • 3/3
Les volets rouges du château de Martel sont clos. Les terres accolées à la petite commune de Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ont pris les allures d'un domaine hanté. La famille De Védrines, noble et protestante, implantée dans la région depuis le XVIIe siècle, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Voilà des semaines, des mois, des années, que l'on ne voit plus aucun de ses membres. Ils congédient tout visiteur, rasent les murs les jours de marché, annulent chaque été leur festival d'art lyrique, et demeurent reclus nuit et jour derrière les enceintes de leur forteresse. Ils ont confié leur patrimoine, leur libre-arbitre et leur vie à une simple voix qui, par téléphone, dicte le moindre de leurs faits et gestes. Un protecteur, un maître à penser, un gourou pensent certains, qui leur répète inlassablement quoi dire, quoi penser, envers qui se méfier : l'État, les banques, les francs-maçons, et le monde entier.En décembre 2009, une véritable délégation se mobilise à Oxford. Me Picotin, l'avocat de Jean Marchand, a réuni autour de lui des psychanalystes, des psychologues, une criminologue, un détective... Il lance l'opération Bow Window, du nom de l'adresse où vivent encore les derniers reclus, et inspirée de l'Exit Counseling : la méthode, importée des États-Unis, consiste à désamorcer en douceur les mensonges d'un gourou, ou d'une secte, enrayer leur discours, les mécanismes de manipulation, pour redonner aux victimes leur libre-arbitre.Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
[INÉDIT] Les reclus de Monflanquin : une riche famille sous emprise • 2/3
Les volets rouges du château de Martel sont clos. Les terres accolées à la petite commune de Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ont pris les allures d'un domaine hanté. La famille De Védrines, noble et protestante, implantée dans la région depuis le XVIIe siècle, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Voilà des semaines, des mois, des années, que l'on ne voit plus aucun de ses membres. Ils congédient tout visiteur, rasent les murs les jours de marché, annulent chaque été leur festival d'art lyrique, et demeurent reclus nuit et jour derrière les enceintes de leur forteresse. Ils ont confié leur patrimoine, leur libre-arbitre et leur vie à une simple voix qui, par téléphone, dicte le moindre de leurs faits et gestes. Un protecteur, un maître à penser, un gourou pensent certains, qui leur répète inlassablement quoi dire, quoi penser, envers qui se méfier : l'État, les banques, les francs-maçons, et le monde entier.Depuis presque deux ans, le quotidien de Ghislaine, sa mère, ses frères, ses belles-soeurs, ses enfants, ses neveux et nièces, se suit et se ressemble : spartiate et monotone. Plus personne ne travaille, plus personne ne sort, ou presque.Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
Questions autour de l'alexandrin 2/3 : Chemins de la connaissance - Une leçon de diction ; Le plaisir de lire
durée : 00:38:40 - Les Nuits de France Culture - par : Philippe Garbit - En 1992, Françoise Lebrun recevait le comédien Christian Rist. Il détaillait les subtilités de la diction des vers en alexandrin dans l'art théâtral classique, puis en compagnie du metteur en scène Jean-Marie Villégier, elle abordait le plaisir de la lecture des tragédies du XVIIe siècle. - réalisation : Virginie Mourthé
[INÉDIT] Les reclus de Monflanquin : une riche famille sous emprise • 1/3
Les volets rouges du château de Martel sont clos. Les terres accolées à la petite commune de Monflanquin, dans le Lot-et-Garonne, ont pris les allures d'un domaine hanté. La famille De Védrines, noble et protestante, implantée dans la région depuis le XVIIe siècle, n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Voilà des semaines, des mois, des années, que l'on ne voit plus aucun de ses membres. Ils congédient tout visiteur, rasent les murs les jours de marché, annulent chaque été leur festival d'art lyrique, et demeurent reclus nuit et jour derrière les enceintes de leur forteresse. Ils ont confié leur patrimoine, leur libre-arbitre et leur vie à une simple voix qui, par téléphone, dicte le moindre de leurs faits et gestes. Un protecteur, un maître à penser, un gourou pensent certains, qui leur répète inlassablement quoi dire, quoi penser, envers qui se méfier : l'État, les banques, les francs-maçons, et le monde entier.Ghislaine de Védrines, épouse Marchand, n'oubliera jamais sa rencontre avec lui. En 1997, elle avait 51 ans, vivait avec son mari Jean, à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Après avoir travaillé chez Citroën, au service presse et relations publiques, puis auprès de la couturière Sonia Rykiel, ou pour Givenchy, elle s'apprêtait à relever un nouveau défi.Crimes • Histoires Vraies est une production Minuit. Notre collection s'agrandit avec Crimes en Bretagne, Montagne et Provence.
Filles du Roy : entre espoir, scandale et survie | L'Histoire nous le dira # 298
Qui sont les Filles du roi ? Aujourd'hui on tâche de comprendre leur importance dans la grande et la petite histoire du Québec. Script: Amylie Chiasson Vignette: Julia Pierre 00:00:00 - Introduction 00:01:20 - Définition des filles du roi 00:02:46 - Les filles du roi et les autres immigrantes 00:03:47 - L'origine du titre « filles du roi » 00:04:29 - Le voyage des filles du roi 00:10:12 - La vie des filles du roi en Nouvelle-France 00:12:58 - La vie après le mariage 00:14:39 - Les difficultés rencontrées par les filles du roi 00:15:27 - Conclusion Adhérez à cette chaîne pour obtenir des avantages : https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/join Pour soutenir la chaîne, au choix: 1. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous la vidéo. 2. Patreon: https://www.patreon.com/hndl Musique issue du site : epidemicsound.com Images provenant de https://www.storyblocks.com Abonnez-vous à la chaine: https://www.youtube.com/c/LHistoirenousledira Les vidéos sont utilisées à des fins éducatives selon l'article 107 du Copyright Act de 1976 sur le Fair-Use. Sources et pour aller plus loin: HÉBERT, Anne, Le premier jardin, Paris, Seuil, 1988, 189p. LANDRY, Yves, Les Filles du roi au XVIIe siècle: orphelines en France, pionnières au Canada: suivi d'un Répertoire biographique des Filles du roi, Montréal, Leméac, coll. « Ouvrages historiques », 1992, 434p. MARSAN, Jean-Sébastien, Histoire populaire de l'amour au Québec, de la Nouvelle-France à la Révolution tranquille, Québec, Fides, coll. « Titre de la couverture : Histoire populaire de l'amour au Québec », 226p. OUIMET, Raymond et Nicole MAUGER, Catherine de Baillon : enquête sur une fille du roi, Sillery, Septentrion, 2001, 262p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières de la seigneurie de Demaure, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2024, 347p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières des seigneuries de Varennes et de Verchères, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2022, 471p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières de la Seigneurie de Repentigny, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2021, 395p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy de la Côte-de-Beaupré, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2019, 92p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières de la Seigneurie de La Prairie, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2019, 571p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières de Montréal, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2017, 679p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy de 1663, Québec, Septentrion, coll. « Filles du Roy », 2016, 242p. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY, Les Filles du Roy pionnières des seigneuries de la Côte-du-Sud, Québec, Septentrion, 400apr. J.-C., 594p. Site web SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES FILLES DU ROY https://www.histoirefillesroy.ca TOUGAS, Rémi, L'Allemande : la scandaleuse histoire d'une fille du roi, 1657-1722, Sillery, Septentrion, 2003, 159p. PORTER, Isabelle, Une fille du roi, un million de descendants, Le Devoir, 7 mai 2018 SIONNEAU, Yoann, Filles du roi, mères de la nation québécoise, Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française, article 734, 2013 OUELLET Marie-Ève, D'«Orphelines en France» à «mères de la nation», la trajectoire commémorative des filles du roi, Le Devoir, 18 juin 2024 Autres références disponibles sur demande. #histoire #documentaire #fillesduroy #quebec
Faire des bébés, une histoire québécoise ? | L'Histoire nous le dira # 299
Comment les canadiens français ont réussi à se maintenir, eux qui étaient entourés d'un océan anglophone, au sud comme à l'est et même à l'ouest ? Adhérez à cette chaîne pour obtenir des avantages : https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/join 00:00:00 - Introduction 00:01:23 - Contexte historique : La conquête britannique 00:01:46 - Explication du phénomène de la revanche des berceaux 00:02:39 - La fécondité des femmes de la Nouvelle-France 00:04:52 - Impact démographique de la Revanche des Berceaux 00:05:04 - L'influence de l'Église catholique 00:06:16 - Les trois étapes de la revanche des berceaux 00:08:43 - La « revanche des berceaux » : un mythe fondateur 00:08:56 - Critiques du concept de la revanche des berceaux 00:12:27 - Conclusion Script: Amylie Chiasson, Mémorante en histoire à l'UQAM Animations: Martin Bérubé de @proposmontreal Vignette : Julia Pierre Pour soutenir la chaîne, au choix: 1. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous la vidéo. 2. Patreon: https://www.patreon.com/hndl Musique issue du site : epidemicsound.com Images provenant de https://www.storyblocks.com Abonnez-vous à la chaine: https://www.youtube.com/c/LHistoirenousledira Les vidéos sont utilisées à des fins éducatives selon l'article 107 du Copyright Act de 1976 sur le Fair-Use. Sources et pour aller plus loin: BAILLARGEON, Denyse, « Chapitre 9 Splendeurs et misères de la « revanche des berceaux » », dans Je me souviens, j'imagine, Les Presses de l'Université de Montréal, 2021, p. 175‑195. BOUCHARD, Gérard et Richard LALOU, « La surfécondité des couples québécois depuis le XVIIe siècle, essai de mesure d'interpréation », Recherches sociographiques, vol. 34, n° 1, 12 avril 2005, p. 9‑44. FOURNIER, Daniel, « Pourquoi la revanche des berceaux ? L'hypothèse de la sociabilité », Recherches sociographiques, vol. 30, n° 2, 1989, p. 171‑198. GAUVREAU, Danielle et Benoît LAPLANTE, « La fécondité au Canada durant le baby-boom. Divergence et convergence des comportements », Annales de démographie historique, vol. 132, n° 2, 2016, p. 65‑110. LACROIX, Jean-Michel, Histoire du Canada. Des origines à nos jours, Tallandier, 2019. MONTPLAISIR, Daniel de, Histoire du Canada. Biographie d'une nation, Perrin, 2019. NADEAU, Jean-François, Ces mères héroïques, Le Devoir, 8 janvier 2024 Autres références disponibles sur demande. #histoire #documentaire #quebec #natalité #babyboom
Pourquoi la Renaissance a changé notre façon de voir le monde | L'Histoire nous le dira # 300
En direct de Florence, on se pose la question: qu'est-ce que c'est que la Renaissance italienne et comment ça s'est déployé ? Adhérez à cette chaîne pour obtenir des avantages : https://www.youtube.com/channel/UCN4TCCaX-gqBNkrUqXdgGRA/join Montage: Diane, Artémis Production | artemisproduction.framer.website 00:00 Introduction 02:14 Qu'est-ce que la Renaissance 06:03 Humanisme et philosophie 09:29 Néoplatonisme et culte de la beauté 13:19 Sciences et découvertes 17:27 Peinture et perspective 25:57 Corps et beauté 34:01 L'Italie Pour soutenir la chaîne, au choix: 1. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous la vidéo. 2. Patreon: https://www.patreon.com/hndl Musique issue du site : epidemicsound.com Images provenant de https://www.storyblocks.com Abonnez-vous à la chaine: https://www.youtube.com/c/LHistoirenousledira Les vidéos sont utilisées à des fins éducatives selon l'article 107 du Copyright Act de 1976 sur le Fair-Use. Sources et pour aller plus loin: ANTONETTI, Pierre. Les Médicis. Paris, PUF, 1997. ARASSE, Daniel, L'Homme en perspective - Les primitifs d'Italie, Paris, Hazan, 2008 ARASSE, Daniel et A. TONNESMANN. La Renaissance maniériste. Paris, Gallimard, 1997. BARBIER, Frédéric. L'Europe de Gutenberg, le livre et l'invention de la modernité occidentale (XIIIe-XVIe siècle). Paris, Belin, 2006. BAXANDALL, Michael. L'œil du Quattrocento. Paris, Gallimard, 1985. BAXANDALL. M. Les humanistes à la découverte de la composition en peinture, 1340-1450. Paris, Seuil, 1989. BENNASSAR, Bartolomé et Jean Jacquart, Le 16e siècle, Paris, Armand Colin, 2002 (1972). BONNEY, Richard. The European Dynastic States, 1494-1660. Oxford, Oxford University Press, 1991. BLOCH, Ernst. La philosophie de la Renaissance. Paris, Payot, 2007 (1972). BRIOIST, Pascal, La Renaissance, 1470-1570, Paris, Atlande, 2003. BURKE, Peter, La Renaissance européenne, Paris, Le Seuil, 2000. CHASTEL, André. Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique. Paris, PUF, 1959. CHASTEL, André. Le geste dans l'art. Paris, Liana Levi, 2001. CASSAN, Michel, L'Europe au XVIe siècle, Paris, Armand Colin, 2008. CONSTANT, Jean-Marie. Naissance des États modernes. Paris, Belin, 2000. CLOULAS, Ivan (dir.). et al. L'Italie de la Renaissance, un monde en mutation 1378-1494. Paris, Fayard, 1990. CROUZET-PAVAN, Élisabeth, Venise, une invention de la ville XIIIe-XVe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997. DAMISH, H. L'origine de la perspective. Paris, Flammarion, 1987. DAUMAS, Maurice, Images et sociétés dans l'Europe moderne, 15e-18e siècle, Paris, Armand Colin, 2000. DAUSSY Hugues, Patrick Gilli et Michel Nassiet, La Renaissance (vers 1470-vers 1560), Paris, Belin, 2003 DELUMEAU, Jean. La civilisation de la Renaissance. Paris, Arthaud, 1967. DELUMEAU, Jean. L'Italie de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 1997 (1974). DUPRAT, Annie, Images et Histoire. Outils et méthodes d'analyse des documents iconographiques, Paris, Belin, 2007. LEBRUN, François, L'Europe et le monde, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1997. GARIN, Eugenio. L'humanisme italien. Paris, Albin Michel, 2005 (1947). GOLDWAITE. R.A. The building of Renaissance Florence. An Economic and Social History. Baltimore and London, The John Hopkins University Press, 1980. GUENÉE, B. L'Occident aux XIVe et XVe siècles. Paris, PUF, 1998. HAVELANGE, Carl. De l'œil et du monde. Une histoire du regard au seuil de la modernité. Paris, Fayard, 1998. HALE, John Rigby. La civilisation de l'Europe à la Renaissance. Paris, Perrin, 1998. HEERS, Jacques. Les temps dits « de transition » (1300 à 1520 environ). Paris, Mentha, 1992. HEERS, Jacques. La vie quotidienne à la cour pontificale au temps des Borgia et des Médicis (1420-1520). Paris, Hachette, 1986. HÉLIE, Jérôme. Petit Atlas historique des temps moderne, Paris, Armand Colin, 2016 (2000). JAHAN, Sébastien. Les renaissances du corps en occident : 1450-1650. Paris, Belin, 2004. JONES-DAVIS, Marie-Thérèse (dir.). L'oisiveté au temps de la Renaissance, Paris, PUPS, 2002 MANDROU, Robert. Introduction à la France moderne, 1500-1640, Essai de psychologie historique. Paris, Albin Michel, 1988 (1961). MUCHEMBLED, Robert (dir.), Les XVIe et XVIIe siècles, histoire moderne, Paris, Bréal, 1995. PERONNET, M. et L. Roy, Le XVIe siècle, 1492-1620, Paris, Hachette, 2005. POUSSOU, J.P. (dir.), Le Renaissance. Enjeux historiographiques, méthodologie, bibliographie commentée, Paris, Armand Colin, 2002. SALLMANN, Jean-Michel. Géopolitique du XVIe siècle, 1490-1618, Paris, Seuil, 2003. TENENTI, Alberto, Florence à l'époque des Médicis, de la cité à l'État, Paris, Flammarion, 1968. ZIMMERMAN, Susan and R.F.E. WEISSMANN. Urban Life in the Renaissance. Newark, University of Delaware Press, 1988. Autres références disponibles sur demande. #histoire #documentaire #renaissance #florence #italy #italie
Sans dire son nom, c'est une république qui s'installe à Londres au milieu du XVIIe siècle, sous la tutelle dictatoriale du très puritain Cromwell. Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Inventer les Etats-Unis (2/5) : La guerre d'indépendance
Après la guerre de sept ans (1756-1763), la Grande-Bretagne est victorieuse mais ses finances vont mal. Afin de remplir ses caisses qui crient famine, elle sollicite ces Treize colonies d'Amérique du Nord qui refusent de voir cette souveraineté lointaine mettre le nez dans leur gouvernement local. Cette métropole a-t-elle encore une raison d'être alors que la démographie et le commerce se portent si bien dans cette Amérique d'avant les Etats-Unis ? La question est posée et une guerre d'indépendance s'apprête à éclater au nom de la liberté. Avec Agnès Delahaye, professeure d'histoire et de civilisation américaines, spécialiste de la colonisation anglaise aux XVIIe et XVIIIe siècles et autrice de Aventuriers, pèlerins, puritains: Les mythes fondateurs de l'Amérique (Editions Passés composés).
La marquise de Sévigné, figure emblématique du Grand Siècle, incarne l'élégance et l'esprit de son époque. À travers ses lettres, elle nous livre un témoignage précieux de la vie à la cour de Louis XIV, alliant finesse, humour et une étonnante modernité. Mère dévouée et observatrice avisée, elle se distingue par son talent littéraire et sa capacité à immortaliser les mœurs et les événements de son temps. Par ses écrits, la marquise de Sévigné reste une voix incontournable du XVIIe siècle, un modèle d'esprit et de raffinement."Secrets d'Histoire" est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production ©2024 SEP / France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Dominique Leeb.Un podcast présenté par Stéphane Bern. Avec la voix d'Isabelle Benhadj.Vous pouvez retrouver Secrets d'Histoire sur France 3 ou en replay sur France.tv, et suivre l'émission sur Instagram et Facebook.Crédits du podcastProduction exécutive du podcast : Initial StudioProduction éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg, assistées de Marine Boudalier Montage : Johanna Lalonde Hébergé par Audion. Visitez https://www.audion.fm/fr/privacy-policy pour plus d'informations.
Pourquoi y a-t-il des taches noires sur le Soleil ?
À première vue, le Soleil semble être une boule de feu parfaitement uniforme. Mais observé de près, à l'aide de filtres spéciaux, sa surface révèle des zones sombres : les taches solaires. Ces marques, visibles depuis la Terre depuis plus de quatre siècles, intriguent encore les astrophysiciens. Elles ne sont pas des “trous” dans le Soleil, mais les symptômes spectaculaires de son activité magnétique.Des zones plus froides, donc plus sombresLe Soleil est une immense sphère de gaz en fusion, animée de mouvements de convection : la matière chaude remonte, la froide redescend. Ces mouvements génèrent des champs magnétiques puissants, qui peuvent se tordre et s'entremêler. Lorsque ces champs deviennent trop intenses, ils perturbent la circulation de la chaleur à la surface, dans la région appelée photosphère.Résultat : certaines zones se refroidissent légèrement, passant d'environ 5 800 °C à 3 800 °C. Cette différence de température suffit à les rendre visiblement plus sombres que leur environnement. C'est ce contraste thermique qui crée l'illusion d'une “tache noire”, même si ces régions continuent à émettre énormément de lumière et d'énergie.Un phénomène magnétique cycliqueLes taches solaires n'apparaissent pas au hasard. Elles suivent un cycle de 11 ans, au cours duquel l'activité magnétique du Soleil croît puis décroît. Au maximum solaire, des dizaines, voire des centaines de taches peuvent parsemer sa surface ; au minimum, elles disparaissent presque totalement.Ce cycle s'accompagne d'autres manifestations spectaculaires : éruptions solaires et éjections de masse coronale, capables de projeter dans l'espace des milliards de tonnes de particules. Ces événements, liés aux zones où les champs magnétiques se reconnectent, peuvent perturber les communications, les satellites et même les réseaux électriques sur Terre.Un miroir de la santé du SoleilLes taches solaires servent aujourd'hui d'indicateurs précieux pour les scientifiques. En les observant, on mesure l'évolution du champ magnétique solaire, la rotation différentielle de l'étoile et la dynamique de son plasma interne.Historiquement, leur étude a aussi permis de grandes découvertes : dès le XVIIe siècle, Galilée les utilisait pour prouver que le Soleil tournait sur lui-même. Aujourd'hui, grâce aux sondes spatiales comme Solar Orbiter ou Parker Solar Probe, les chercheurs cartographient leur structure en trois dimensions.En somme, les taches solaires sont les pulsations visibles du cœur magnétique du Soleil — des fenêtres sur les forces colossales qui animent notre étoile et rythment la vie de tout le système solaire. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Œuvrer pour la paix, histoire de la diplomatie 3/4 : Des Amériques aux Indes, diplomaties au bout du monde
durée : 00:59:18 - Le Cours de l'histoire - par : Xavier Mauduit, Maïwenn Guiziou - À partir du XVIIe siècle, la diplomatie devient une affaire véritablement mondiale. Des Petites Antilles à la Nouvelle-France, l'équilibre géopolitique européen excède désormais les frontières du Vieux Continent. - réalisation : Thomas Beau - invités : Éric Schnakenbourg Professeur d'histoire moderne à l'Université de Nantes, directeur du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique; François Ternat Professeur d'histoire à l'INSPE de l'université de Rouen
Pourquoi la virilité d'un marquis a-t-elle changé la loi ?
Oui, cette histoire est tout à fait vraie, et elle illustre à merveille les mœurs étonnantes — et souvent cruelles — de la justice d'Ancien Régime. Jusqu'au XVIIIe siècle, la France connaissait une institution pour le moins singulière : les tribunaux d'impuissance, chargés de juger si un mari était, ou non, capable de “remplir son devoir conjugal”. Ces procès, souvent spectaculaires, mêlaient droit, médecine, religion… et humiliation publique. Et c'est un noble français, le marquis de Langey, qui, bien malgré lui, mit fin à cette pratique absurde.L'affaire éclate en 1659. Le marquis de Langey, jeune aristocrate d'une vingtaine d'années, épouse Mademoiselle de Saint-Simon de Courtemer. Mais très vite, leur union tourne court : l'épouse, frustrée, l'accuse d'impuissance, c'est-à-dire d'incapacité physique à consommer le mariage. À cette époque, cette accusation n'est pas anodine : un mariage non consommé peut être annulé, privant l'époux de son honneur et de ses droits. La femme dépose donc plainte, et l'affaire est portée devant le Parlement de Paris.Ce qui suit confine au cauchemar. Le marquis est sommé de se soumettre à une “épreuve de virilité” : une inspection médicale complète, menée devant médecins, sages-femmes et témoins. Puis vient la fameuse “épreuve du congrès”, une procédure officielle au cours de laquelle l'accusé devait, en présence d'experts, tenter d'accomplir l'acte sexuel avec son épouse. Les contemporains décrivent cette scène avec un mélange d'effroi et de curiosité. Évidemment, sous la pression, le marquis échoue. Il est déclaré impuissant et, par conséquent, incapable de mariage. Le verdict est rendu public : humiliation totale.Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après, le marquis quitte Paris et se réfugie en Italie, où il se remarie. Cette fois, miracle : il a plusieurs enfants. La nouvelle fait scandale et ridiculise la justice française. Comment un homme officiellement reconnu “impuissant à jamais” peut-il devenir père ailleurs ? Le Parlement, embarrassé, annule la décision précédente, et le tribunal du congrès est définitivement supprimé en 1677 par le roi Louis XIV lui-même, sur avis de ses juristes.Cette affaire du marquis de Langey mit ainsi un terme à une procédure qui relevait plus du théâtre que du droit. Elle révèle aussi combien la sexualité, au XVIIe siècle, était perçue comme une affaire publique, surveillée et jugée — jusqu'à ce qu'un homme humilié prouve, au fond, que la justice pouvait être bien plus impuissante que lui. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
L'info du matin - Ce matin, Grégory Ascher et Justine Salmon ont parlé d'un lycée américain qui remplace les heures de colle par des heures de randonnée ! Le winner du jour - Notre premier winner, un policier, intervient pour un tapage nocturne et finit sur la piste de danse ! - À San Francisco, des habitants commandent par erreur 50 robots-taxis en même temps dans une même rue, créant un joyeux chaos. Le flashback du jour - Avril 1999 : un flashback 100 % féminin avec trois artistes incontournables : Larusso et son tube "Tu m'oublieras", resté numéro 1 près de deux mois et demi, Britney Spears qui la détrône avec "...Baby One More Time" et Mylène Farmer, qui sortait le 7 avril son cinquième album "Innamoramento". Les savoirs inutiles - C'est grâce aux marins du XVIIe siècle que seraient nées les premières poupées à usage sexuel, ancêtres des poupées gonflables ! La chanson du jour - Måneskin "Baby Said" 3 choses à savoir sur Banksy Qu'est-ce qu'on fait ? - Si vous êtes autour de Dax, Géraldine propose le festival "CLAP sur le polar", consacré au cinéma, à la littérature et à la pop culture. - Et à Troyes, "Les Nuits de Champagne" démarrent dimanche avec Hoshi, Adé, Jérémy Frérot et Waxx. Le jeu surprise (Ni oui ni non) - Éric de Chambéry repart avec une gourde AirUp. La Banque RTL2 - Olivia de Théréval (vers Saint-Lô) gagne 500 €. - Marine d'Arles remporte un séjour de deux nuits pour deux personnes en hôtellerie haut de gamme Hôtels & Préférence. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Georges de La Tour, le virtuose du noir et de la lumière en majesté au musée Jacquemart-André
Georges de La Tour est en majesté dans le bel hôtel particulier du musée Jacquemart-André à Paris. Peintre du XVIIe siècle à la production rare, on lui connait une quarantaine d'œuvres dont on peut voir plus de la moitié dans l'exposition. Des tableaux où l'artiste se joue avec virtuosité du noir et de la lumière, ce qui lui vaut le surnom de « Caravage français ». L'artiste célèbre de son vivant tombe ensuite dans l'oubli pour être redécouvert au début du XXe siècle. ► Exposition Georges de La Tour, entre ombre et lumière, du 11 septembre 2025 au 25 janvier 2026
L'énigme de la « mauresse de Moret » : Qui était cette mystérieuse religieuse protégée par l'entourage de Louis XIV ?
A la fin du XVIIe siècle, le couvent de Moret compte une religieuse noire sur laquelle court une folle rumeur : elle serait de sang royal. C'est le point de départ d'une énigme qui a fasciné des générations d'auteurs, dont le grand Voltaire. Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Critique expo : rétrospective dans l'ombre et la lumière de Georges de La Tour
durée : 00:14:20 - Les Midis de Culture - par : Marie Labory - Le Musée Jacquemart-André célèbre l'un des maîtres du XVIIe siècle avec une exposition unique consacrée à Georges de La Tour. Le musée poursuit son voyage au cœur du caravagisme en offrant une plongée inédite dans l'univers lumineux et profondément spirituel de cet artiste majeur. - réalisation : Laurence Malonda - invités : Sally Bonn Maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie Jules Verne, auteure, critique d'art et commissaire d'exposition.; Sarah Ihler-Meyer Critique d'art et commissaire d'exposition
Georges de la Tour : Redécouvert après 3 siècles d'éclipse, que savons nous de ce peintre ?
Après trois siècles d'une éclipse à peu près totale, l'un des grands peintres du XVIIe siècle est redécouvert au début du XXe. Est-ce à dire que nous savons précisément qui fut Georges de La Tour ? Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Après trois siècles d'une éclipse à peu près totale, l'un des grands peintres du XVIIe siècle est redécouvert au début du XXe. Est-ce à dire que nous savons précisément qui fut Georges de La Tour ?Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
"'Arc républicain' : ne nous trompons pas", "Ruptures conventionnelles : oui, il faut agir" et "La liberté d'expression n'est pas d'extrême droite"
Répliquant à la phrase de François Hollande, disant qu'il condamne les outrances et débordements de LFI, mais il ne les met pas en équivalence avec le RN qui promet la discrimination et la préférence nationale. Ruth Elkrief nous met en garde de ne pas nous tromper. Du côté de LFI, est-ce vraiment de critiquer la démocratie représentative et de défendre un système de l'irrévocable ? On découvre dans un document laissé par François Bayrou, après-coup, qu'il y avait bien d'autres pistes pour faire des économies, en particulier, sur les ruptures conventionnelles. Il y en a, aujourd'hui, plus de 45 000 par mois. C'est-à-dire, plus de 500 000 par an. Elle est en croissance continue depuis sa création en 2008. Selon François Lenglet, il faut agir sur ce sujet. Comme les libéraux anglais, ils ont abandonné le drapeau, les hymnes nationaux, le patriotisme à l'extrême droite, de peur de faire leur jeu. Depuis les années 2000, Abnousse Shalmani voit un glissement de la liberté d'expression, qui est pourtant un acquis depuis la glorieuse révolution anglaise du XVIIe siècle, une espèce d'abandon suicidaire à l'extrême droite. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Dans cette édition :François Bayrou, Premier ministre, tente de convaincre de la nécessité de réduire la dette publique et fait des concessions sur la suppression des jours fériés, faisant face à l'opposition du Parti Socialiste et du Rassemblement National.Une rave party illégale est organisée dans l'Aude, au milieu des zones ravagées par les incendies de l'été, indignant les habitants de la région.La rentrée scolaire s'accompagne de nouvelles mesures comme l'interdiction du portable au collège et la réforme du contrôle continu pour le baccalauréat.Des squats de migrants se multiplient en France, facilitées par les connexions entre le milieu associatif et la mouvance contestataire, créant des tensions dans certaines villes.Une bande dessinée retrace l'histoire rocambolesque du crâne de René Descartes, l'un des plus grands penseurs français du XVIIe siècle.Notre équipe a utilisé un outil d'Intelligence artificielle via les technologies d'Audiomeans© pour accompagner la création de ce contenu écrit.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Passions humaines et divines du baroque espagnol
durée : 01:28:47 - En pistes ! du lundi 25 août 2025 - par : Emilie Munera, Rodolphe Bruneau Boulmier - L'Accademia del Piacere et Fahmi Alqhai mettent en lumière les influences chrétiennes, musulmanes, juives et américaines de la musique espagnole des XVIe et XVIIe siècles. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Passions humaines et divines du baroque espagnol
durée : 01:28:47 - En pistes ! du lundi 25 août 2025 - par : Emilie Munera, Rodolphe Bruneau Boulmier - L'Accademia del Piacere et Fahmi Alqhai mettent en lumière les influences chrétiennes, musulmanes, juives et américaines de la musique espagnole des XVIe et XVIIe siècles. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Rendez-vous avec la maîtresse : Histoire : pourquoi l'année 1789 appartient-elle au XVIIIe siècle et non au XVIIe ?
Dans cet épisode, Muriel Gilbert explique pourquoi l'année 1789 appartient au XVIIIe siècle et non au XVIIe. Elle aborde le concept de décalage des siècles, l'absence d'année zéro et donne des astuces pour déterminer le siècle d'une année donnée. L'émission se termine sur une note musicale avec une référence à une chanson de Pierre Bachelet.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Moulay Ismaïl : le Roi Soleil des mille et une nuits (1/3)
Moulay Ismaïl, sultan du Maroc au XVIIe siècle, incarne un souverain impitoyable et visionnaire, déterminé à affirmer sa domination. Fondateur de la dynastie alaouite, il mène un règne de fer, marqué par une centralisation du pouvoir et la construction d'une armée redoutée. Son autorité s'étend sur tout le royaume, mais c'est sa politique de terreur et de contrôle qui forge sa légende. À la fois conquérant et bâtisseur, Moulay Ismaïl laisse une empreinte durable sur l'histoire du Maroc, où sa quête de pouvoir absolu et ses méthodes autoritaires le rendent aussi craint et respecté."Secrets d'Histoire" est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme produite par la Société Européenne de Production ©2024 SEP / France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine de Meaux.Un podcast présenté par Stéphane Bern. Avec la voix d'Isabelle Benhadj.Vous pouvez retrouver Secrets d'Histoire sur France 3 ou en replay sur France.tv, et suivre l'émission sur Instagram et Facebook.Crédits du podcastProduction exécutive du podcast : Initial StudioProduction éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg, assistées de Marine Boudalier Montage : Johanna Lalonde Hébergé par Audion. Visitez https://www.audion.fm/fr/privacy-policy pour plus d'informations.
À visiter cet été - Le château de Versailles, haut lieu de la République !
Cet été, découvrez le meilleur d'Au cœur de l'Histoire, avec Virginie Girod ! Depuis le XVIIe siècle, le château de Versailles est associé à la monarchie française. Mais saviez-vous que depuis la seconde partie du XIXe siècle, la demeure de Louis XIV est également un haut lieu de la République ? En 1875, dans l'aile du Midi, un grand hémicycle est construit en six mois. La salle du Congrès doit accueillir les parlementaires, alors que le gouvernement a quitté Paris. Quatorze présidents de la République y seront élus. 150 ans après les lois constitutionnelles qui entérinent la proclamation de la IIIe République, Virginie Girod vous emmène en visite guidée dans ce lieu incontournable de la vie parlementaire française, en compagnie de Frédéric Lacaille, conservateur en chef, chargé des peintures du XIXe siècle et des Galeries Historiques au château de Versailles.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Grandes idées du temps de Molière 1/4 : Louis XIV et Molière, l'absolutisme entre en scène
durée : 00:58:30 - Le Cours de l'histoire - par : Xavier Mauduit, Maïwenn Guiziou - Louis XIV accède au pouvoir en 1643. En 1658, Molière conquiert Paris, et bientôt la cour, où il devient l'un des artistes attitrés du Roi-Soleil. Quels sont les rapports de Molière avec le pouvoir absolu ? En quoi éclairent-ils les liens entre théâtre et politique au temps du Grand Siècle ? - réalisation : Alexandre Manzanares - invités : Patrick Dandrey Professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à Sorbonne Université; Thierry Sarmant Conservateur général aux Archives nationales
Qui était l'aventurier Jean-Baptiste Tavernier, diamantaire du Roi Soleil ?
L'une des figures les plus atypiques du XVIIe siècle fut sans conteste l'aventurier Jean-Baptiste Tavernier, qui parcourut le monde à la recherche de pierres précieuses. Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Il y a eu 350 ans, Vatel, le grand organisateur des fêtes du XVIIe siècle, se donnait la mort pour n'avoir pu satisfaire le roi…Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les sociétés secrètes - Des Rose-Croix aux Anonymous
L'histoire des sociétés secrètes modernes commence dans l'Allemagne du début du XVIIe siècle avec la circulation de manifestes mystérieux qui annoncent l'existence d'une confrérie invisible aux pouvoirs prodigieux. Ses membres affirment être en mesure de sauver l'Europe d'une destruction imminente. Cette révélation se répand comme une traînée de poudre : c'est la « révolution Rose-Croix » qui embrase en quelques années le continent tout entier. Depuis quatre siècles, l'intérêt pour ces confréries n'a jamais faibli et l'emblématique phénix renaît sans cesse de ses cendres.Des premiers Rose-Croix aux actuels Anonymous, en passant par les Francs-maçons, les Illuminati, les Carbonari, les sinistres membres du Ku Klux Klan, la Loge P2 ou QAnon, tous se revendiquent maîtres des secrets. Pierre-Yves Beaurepaire, spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie, nous raconte ce monde où les limites entre réalité et fiction s'estompent en une source intarissable d'intrigues, de scénarios improbables ou de fake news.L'auteur, l'historien Pierre-Yves Beaurepaire, est avec nous en studioDistribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Stéphane Bern plonge dans le canal du Midi ou plutôt dans l'histoire de ce canal, le plus grand projet d'ingénierie du XVIIe siècle qui a permis de relier l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, un projet titanesque sorti de l'imagination d'un certain Pierre-Paul Riquet, soutenu par le roi Louis XIV qui signe là, après Versailles, l'autre grande réalisation de son règne… Qui était Pierre-Paul Riquet ? Comment a-t-il eu l'idée d'un chantier d'une telle ampleur au XVIIème siècle ? En quoi le canal du Midi est-il devenu un point géographique stratégique ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Gérard Crevon, historien, spécialiste du canal du Midi et auteur de "Pierre-Paul Riquet, l'audace et la ténacité" (Editions Vérone) Au Coeur de l'Histoire est réalisée par Guillaume Vasseau. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Pierre-Vincent Letourneau. Journaliste : Clara Leger.Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Bienvenue dans ce nouvel épisode d'«Au Cœur de l'Histoire» ! Ce matin, nous vous emmenons à la rencontre d'un personnage clé du XVIIe siècle français : Henri de La Tour d'Auvergne, plus connu sous le nom de maréchal de Turenne.Dès son plus jeune âge, Turenne baigne dans un environnement marqué par les conflits. Né dans une famille protestante, il grandit au cœur de la guerre de Trente Ans, un vaste conflit qui ravage l'Europe pendant trois décennies. Très jeune, il manifeste des qualités de stratège et d'organisateur qui ne tardent pas à être remarquées. Après avoir fait ses armes auprès de son oncle aux Pays-Bas, il rejoint l'armée française et gravit rapidement les échelons, devenant l'un des plus brillants généraux de son temps.Sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, Turenne va jouer un rôle déterminant dans les conflits qui opposent la France à l'Espagne et à l'Autriche. Ses victoires décisives, notamment lors de la guerre de Hollande, lui valent une renommée sans égale. Tacticien hors pair, Turenne privilégie une approche indirecte, cherchant à désorganiser et à surprendre l'ennemi plutôt que de l'affronter de front.
Qui a le meilleur français ? La cour, le palais ou la ville ? 2521 — Mercredi 11 juin 2025
La semaine dernière, j'ai passé les portes de la Sorbonne, la célèbre université, la plus ancienne de France qui existe depuis le XIIIe siècle. J'y allais pour rencontrer le linguiste Gilles Siouffi qui vient d'écrire un livre sur l'histoire linguistique de Paris. Son livre s'intitule « Paris Babel ». J'ai adoré ce livre qui se lit comme un roman et qui permet de s'approprier l'histoire du français comme on ne nous l'a jamais racontée. Un siècle très important dans l'histoire du français, c'est le XVIIe siècle. On se bat pour savoir qui a le meilleur français. C'est ce que Gilles Siouffi va nous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Il va aussi nous parler des modes de prononciations. www.onethinginafrenchday.com #frenchcourtlanguage #versaillesfrench #17thcenturyfrench #frenchpronunciationhistory #sociallanguagetrendsfrance #frenchclassdistinctions #parisvsversailles #frenchlanguagefashions #historicalfrenchspeech #frenchlinguisticsorbonne
On lui a donné les surnoms de « Prince des pirates » et « Robin des Bois des mers » : C'est dire si le jeune Samuel Bellamy, au début du XVIIe siècle, s'est fait un nom dans l'univers de la piraterie.Mention légales : Vos données de connexion, dont votre adresse IP, sont traités par Radio Classique, responsable de traitement, sur la base de son intérêt légitime, par l'intermédiaire de son sous-traitant Ausha, à des fins de réalisation de statistiques agréées et de lutte contre la fraude. Ces données sont supprimées en temps réel pour la finalité statistique et sous cinq mois à compter de la collecte à des fins de lutte contre la fraude. Pour plus d'informations sur les traitements réalisés par Radio Classique et exercer vos droits, consultez notre Politique de confidentialité.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.