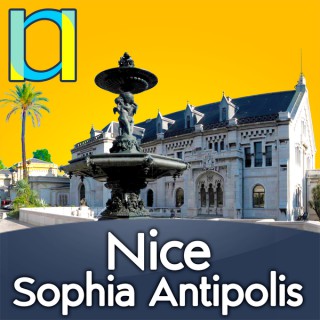Podcasts about colloque
- 210PODCASTS
- 2,965EPISODES
- 36mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Dec 3, 2025LATEST
POPULARITY
Categories
Best podcasts about colloque
Latest news about colloque
- Propylaeum-DOK: Digital Repository: Ancient History AWOL - The Ancient World Online - Dec 26, 2025
- Benveniste, Dumézil, Lejeune and the decipherment of Linear B Progressive Geographies - Jan 5, 2025
- Colloque, au Centre Culturel International de Cerisy, en France Freakonometrics - Sep 12, 2024
Latest podcast episodes about colloque
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Introduction
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Introduction : Jean-Jacques HublinPrésentationLe temps est une dimension fondamentale du vivant. Des rythmes moléculaires qui régulent l'expression des gènes aux grandes trajectoires de l'histoire évolutive, les systèmes biologiques sont à la fois façonnés par le temps et acteurs de sa dynamique. Développement, vieillissement, mémoire, régénération, cycles veille-sommeil, voire perception du temps : autant de phénomènes qui illustrent l'imbrication profonde entre vie et temporalité. En réunissant des spécialistes de génétique, de biologie du développement, de neurosciences et de biologie évolutive, cette journée explorera les multiples manières dont la biologie s'inscrit dans le temps, à travers les échelles, les niveaux d'organisation et les disciplines. Conférences en anglais.Les Journées François JacobLes Journées François Jacob, organisées par l'institut de biologie du Collège de France, rassemblent chaque année les meilleurs spécialistes français et étrangers autour d'un thème à la pointe des enjeux de la recherche en biologie.Le lauréat du prix Antoine Lacassagne, attribué chaque année par le Collège de France à un chercheur en biologie, est traditionnellement invité à recevoir son prix lors des Journées François Jacob et à y donner un séminaire en relation avec ses travaux.Ces journées sont nommées en l'honneur de François Jacob, titulaire de la chaire Génétique cellulaire du Collège de France (1964-1991), prix Nobel de physiologie ou médecine 1965 avec André Lwoff et Jacques Monod pour la découverte de la régulation génétique de la synthèse des enzymes et des virus.
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Metabolic Timing of the Need to Sleep
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Metabolic Timing of the Need to SleepAnissa KempfBiozentrum University of Basel, Switzerland
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Timescales of Adaptation and the Baldwin Effect
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Timescales of Adaptation and the Baldwin EffectAmaury LambertChercheur, Centre Interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) – Professeur à l'École normale supérieure
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : A Mind Set in Stone: Fossil Traces of Human Brain Evolution
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026A Mind Set in Stone: Fossil Traces of Human Brain EvolutionPhilipp GunzDepartment of Human Origins, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Allemagne
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Linking Developmental Timing with Human Brain Evolution
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Linking Developmental Timing with Human Brain EvolutionPierre VanderhaeghenVIB - KU Leuven University
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Mechanics of Mammalian Development
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Mechanics of Mammalian DevelopmentJean-Léon MaitreInstitut Curie, Paris France
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Integrating Time Scales to Preserve the Maternal Inheritance
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Integrating Time Scales to Preserve the Maternal InheritanceMarie-Hélène VerlhacDirectrice du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CIRB) – DRCE2 CNRS
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Conclusions
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026ConclusionsDenis DubouleProfesseur du Collège de FranceJean-Jacques HublinProfesseur du Collège de France
Colloque - Journée François Jacob – The Living Clock: Biology in the Flow of Time : Epigenetic Timekeepers: Reconstructing the Biological Ages of Ancient Individuals
ColloqueJournée François JacobThe Living Clock: Biology in the Flow of TimeCollège de FranceAnnée 2025-2026Epigenetic Timekeepers: Reconstructing the Biological Ages of Ancient IndividualsLudovic OrlandoCentre d'Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CNRS UMR 5288, université de Toulouse)
Interprété lors du colloque de l'Iliade par La Compagnie francilienne, ce chant célèbre la vie simple, courageuse et fidèle de ceux qui veillent sur les troupeaux et les hauteurs. Symbole d'un lien intime entre l'homme, la nature et le sacré, il rappelle la noblesse des métiers enracinés et l'harmonie du monde paysan.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Table ronde : entre désir d'émancipation et risque de sujétion, les ambiguïtés du revenu universel
Persistance d'un chômage massif et paupérisation de franges croissantes de la population, multiplication des travailleurs pauvres, et déclin du salariat, remise en cause de la « valeur travail », et fin des carrières linéaires, essor des « bullshit jobs » et ubérisation des emplois, apoplexie d'un système social devenu aussi illisible qu'inéquitable et maintenant crainte de la disparition de nombreux emplois par le recours à l'IA… Pour remédier aux tensions et contradictions d'un système économique et social à bout de souffle, certains auteurs mettent en avant la solution que constituerait, selon eux, l'instauration d'un « revenu universel ». Mais force est de constater que cette solution est, elle-même, lourde de contradictions et d'interrogations. Au-delà de la question triviale mais essentielle de son financement, impossible à évacuer dans des économies européennes déjà très endettées, le revenu universel pose aussi d'innombrables questions philosophiques, politiques et même civilisationnelles. Est-il l'expression d'une utopie égalitariste et collectiviste ou, au contraire, la ruse d'une flexibilisation totale du marché du travail ? Constitue-t-il un nouveau pacte social ou le vecteur d'une radicalisation de l'individualisme contemporain. Représente-t-il une forme renouvelée de solidarité entre membres de la communauté nationale ou un nouveau ferment de son archipélisation ? Permet-il d'en finir avec un assistanat humiliant pour les plus pauvres ou, à l'inverse, en est-il la généralisation à toute la population ? Et malgré ses promesses d'émancipation des individus ne risque-t-il pas de devenir un nouvel instrument de contrôle social et de sujétion à l'État ? Et enfin : le revenu universel peut-il être, pour les peuples européens, l'utopie mobilisatrice qu'espèrent certains de ses promoteurs ou est-il plutôt le symptôme d'une fatigue collective conduisant certains à préférer l'allocation à la création, la consommation à la production ? Ce sont à ces questions et à quelques autres que répondront les participants à cette table ronde. ‣ Xavier Van Lierde est journaliste et consultant en communication. Il s'intéresse particulièrement aux mutations affectant le travail, l'entreprise et leurs places dans la société. ‣ Thierry Baudet est un homme politique, écrivain et orateur néerlandais. Fondateur en 2014 du Forum pour la Démocratie, un groupe de réflexion et parti politique, il en est le chef de groupe parlementaire depuis 2017. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages. ‣ Philippe d'Arvisenet, Docteur d'État en économie, a été chercheur au Polytechnicum de Lille et chargé de mission au Commissariat au Plan. Ancien directeur de la recherche d'une banque internationale et auteur d'une dizaine d'ouvrages, il enseigne à Paris II, et diverses universités en France et à l'étranger. Il est également consultant économique auprès d'un think tank. ‣ Marc de Basquiat est consultant, formateur, essayiste et conférencier. Il préside le think tank AIRE, spécialisé dans l'étude du système socio-fiscal français. Il est diplômé de Centrale-Supélec, d'ESCP Europe et docteur en économie de l'université d'Aix-Marseille. Son dernier ouvrage : L'ingénieur du revenu universel, aux éditions de L'Observatoire.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Françoise Favel : colloque à l'occasion des 45 ans de Ganénou
At the Institut Iliade's 12th Annual Colloquium in Paris, Zsófia Rácz explored the central - yet often overlooked - role of unpaid labour, most frequently carried out by women: household tasks, child-rearing, charitable work, and religious involvement. This invisible effort, absent from economic statistics, forms the true social backbone of our civilisation. Through historical examples, contemporary reflections - such as the “tradwife” phenomenon- and personal testimony, she called for a re-evaluation of what “work” really means. Beyond remuneration, it is this selfless dedication that sustains the continuity and vitality of our European communities.
Colloque “Henri Vincenot : une œuvre indéracinable”. Conférences du groupe Helix Dijon en partenariat avec l'Institut Iliade (01/06/2024). À l'occasion de leur colloque consacré à Henri Vincenot, les militants du groupe Helix Dijon explorent trois grands thèmes chers à l'écrivain bourguignon : l'écologie, le sacré et l'enracinement. À travers ces interventions, ils cherchent à montrer comment l'œuvre du « barde des friches et des bois » demeure une source d'inspiration pour ceux qui veulent rester debout face aux tempêtes du monde moderne. Vincenot nous invite à (re)découvrir nos terres, nos traditions et nos racines ; autant de repères essentiels pour renouer avec la profondeur du vivant et la continuité de notre héritage. Un regard passionné de la jeunesse bourguignonne sur celui qu'elle considère comme un grand-père spirituel, témoin et gardien de l'âme de la Bourgogne.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Travail, souveraineté, puissance, prospérité : quel modèle pour l'Europe de demain
Intervention de Lionel Rondouin le samedi 5 avril 2025 à La Maison de la Chimie. XIIe colloque de l'Institut Iliade : Penser le travail de demain. Identité, communauté, puissance. Notre société a dévalorisé l'image des agents économiques primaires : ingénieurs, ouvriers, paysans. Elle les a appauvris. Cela découle du mirage de la « société de services », des délocalisations et de l'accaparement du bénéfice des entreprises qu'on appelle « création de valeur pour l'actionnaire ». Une économie de rente s'est développée sans création de richesse réelle, au profit de la technostructure qui, de surcroît, multiplie les normes pour entretenir un semblant d'activité économique. Or cette économie des normes, des jobs et des produits inutiles est entrée dans une crise durable. C'est l'une des causes de la faible croissance des économies européennes et du recours à la dette publique. Il s'ensuit une perte d'autonomie et de souveraineté des nations occidentales. Ce sont les dirigeants qui ont désindustrialisé la France, réduit l'autonomie agricole du pays, appauvri les producteurs. Ce n'est pas une loi de nature. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Une action politique est donc possible, par la redéfinition du périmètre d'action et des modes de fonctionnement de l'État, redevenu à la fois minimal et stratège. Mais cette action politique présuppose une prise de conscience culturelle de l'ensemble des acteurs économiques, dont les consommateurs, autour des notions d'utilité, de durabilité et de sobriété. Face à l'essoufflement de notre système, le retour à la souveraineté et à la puissance se fondera sur une priorité : la production de biens et services réels et utiles, à proximité des lieux de consommation, avec un partage plus équitable de la valeur au profit des producteurs. Lionel Rondouin, ancien élève de l'École normale supérieure (rue d'Ulm, Lettre), a fait carrière dans l'Armée de terre, au sein des parachutistes des Troupes de marine, puis dans l'industrie. Il a enseigné dans diverses écoles de management ou d'ingénieurs. Aujourd'hui, il enseigne l'anglais dans un collège hors-contrat, à titre bénévole.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Table ronde : Quels métiers d'avenir pour les Européens ? Samedi 5 avril 2025 à La Maison de la Chimie, XIIe colloque de l'Institut Iliade - Penser le travail de demain. Identité, communauté, puissance. L'actualité fait en permanence la chronique des évolutions spectaculaires du monde du travail, parfois sur un ton quasiment messianique, parfois en prédisant l'apocalypse. Le FMI va jusqu'à prédire que "60% des emplois des économies avancées sont menacés par l'intelligence artificielle" (janvier 2024). Dans ce contexte de mutations en accélération exponentielle, dans quels secteurs se joueront la puissance et l'indépendance de l'Europe dans les décennies à venir ? Dans quels métiers, savoir-faire et compétences sera-t-il essentiel d'investir, individuellement et collectivement, pour donner du sens au travail, et contribuer à la vitalité de la civilisation européenne ? Enfin, quels conseils donner à un jeune Européen à l'heure des choix ? C'est à ces trois questions que s'efforceront de répondre une table ronde réunissant des professionnels de l'industrie, de la technologie et de l'enseignement académique. Les regards croisés permettront d'imaginer le futur et d'en tirer des leçons pratiques. Avec Axelle Girard, Thierry Lafont, Stefano Vaj et Aliénor Cantarel. Table ronde animée par Antoine de Leudeville.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Interprété par La Compagnie francilienne lors du XIIe colloque de l' Institut Iliade, ce chant rend hommage aux hommes partis bâtir les villes de France, porteurs de courage, de savoir-faire et d'enracinement.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
L'immigration, armée de réserve du capital, par Jean-Yves Le Gallou
L'immigration de travail n'est pas une nécessité, mais le fruit de la cupidité des employeurs, de la paresse des consommateurs et de la stupidité des politiques. À l'ère de l'intelligence artificielle et de la robotique, la vraie question n'est plus la pénurie, mais l'excédent de main-d'œuvre. Jean-Yves Le Gallou est cofondateur de l'Institut Iliade, essayiste et président de Polémia. Colloque Iliade 2025.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
L'intelligence artificielle, que le grand public découvre à peine, façonne déjà depuis longtemps la communication et l'ingénierie. La robotique, encore à ses débuts, pourrait bientôt compenser les pénuries de main-d'œuvre liées au déclin démographique et réduire la dépendance aux migrations. Faut-il s'en méfier ou y voir un espoir ? Intervention de Carlomanno Adinolfi le samedi 5 avril 2025 à La Maison de la Chimie.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Les défunts sont ceux qui rassemblent les vivants et le peuple. Ils nous entourent aussi longtemps que leur souvenir est perpétué par leur descendance. Par-là se justifient le culte des ancêtres et le devoir de faire respecter leur nom. Découvrez la chronique de Romain Petitjean pour Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Jean-Yves Camus, Jean-Yves Le Gallou : le choc des mémoires politiques
Notre époque ressemble à une mer sur laquelle il faut, contraint ou forcé, bien naviguer. Alors pour comprendre tous les ressacs de l'histoire, éviter les vagues scélérates et aller en profondeur dans les eaux troubles de la politique française et européenne, mieux vaut s'embarquer avec un capitaine au long cours. Cela tombe à pic car Jean-Yves Le Gallou vient de faire paraître ses Mémoires identitaires : 1968-2025 – Les dessous du Grand Basculement, aux éditions Via Romana. Aux côtés du politologue Jean-Yves Camus, journaliste et chercheur français spécialiste des mouvements nationalistes et identitaires en Europe, nous analyserons la montée des eaux depuis 1968. Que reste-t-il de l'idéologie soixante-huitarde et de ses hérauts recyclés dans le néoconservatisme ? Quelles idées, quels mots, quelles représentations se sont imposés pour orienter le cours de l'histoire ? Quelles écoles théoriques et idéologiques ont su résister au prêt à penser ? Autant de questions qu'il est nécessaire de poser sans oublier de remonter à la surface pour étudier les bancs de poissons conformistes de la politique et les grands prédateurs qui ont su s'imposer au cours des cinquante dernières années… Une plongée en eaux troubles en espérant que nos deux invités apportent un peu de clarté sur le paysage politique et idéologique de ces cinquante dernières années et les perspectives qui s'offrent à la France et à l'Europe plus que jamais à un tournant de leur histoire. Pour aborder ce sujet, nous recevons : - Jean-Yves Camus, politologue, dirige depuis 2014 l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean-Jaurès. Chercheur associé à l'IRIS, il est également essayiste et collaborateur régulier de médias comme Charlie Hebdo et Le Monde diplomatique. - Jean-Yves Le Gallou, essayiste, haut fonctionnaire et homme politique français, a été membre du GRECE et cofondateur du Club de l'Horloge. Passé successivement par l'UDF, le FN puis le MNR, il a mené un parcours politique dense au cours duquel il a formulé et popularisé le concept de préférence nationale. Créateur du think tank Polémia, il a également cofondé en 2014 l'Institut Iliade. Vous pourrez retrouver les chroniques des auditeurs de l'Iliade : - "Perspectives identitaires" de Raphaël Ayma, auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l'Institut Iliade. - Autour d'un vers, le rendez-vous poétique de Frédérique de Saint-Quio, auditrice de la promotion Homère. - Les chroniques musicales de Pierre Leprince, auditeur de la promotion Patrick Pearse de l'Iliade. - La boussole artistique de Gabrielle Fouquet, auditrice de la promotion Homère.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Jean-Luc Mélenchon, figure incontournable de la gauche française, agite depuis des années l'idée d'une nouvelle France. La publication toute récente du livre "Mélenchon, le bruit et la fureur", de Rodolphe Cart, aux éditions de La Nouvelle Librairie, permet d'en savoir un peu plus. Découvrez la chronique de Romain Petitjean pour Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - De la mimesis à la katharsis : formalisation mathématique et apprentissage machine dans la création musicale
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - De la mimesis à la katharsis : formalisation mathématique et apprentissage machine dans la création musicaleCarmine-Emanuele CellaAssociate Professor, University of California, BerkeleyRésuméCette conférence propose une réflexion sur le rôle croissant de l'apprentissage machine dans la création musicale contemporaine, à la croisée de l'intuition artistique et de la formalisation mathématique. À partir de mes travaux sur la créativité computationnelle, l'orchestration assistée et la co-composition homme-machine, j'examinerai comment les algorithmes peuvent dépasser l'imitation (mimesis) pour devenir les vecteurs d'une transformation sensible et cathartique (katharsis).Il s'agira de montrer comment les modèles mathématiques – loin de se limiter à une fonction d'optimisation – peuvent structurer des processus esthétiques, révéler des formes émergentes et ouvrir de nouveaux espaces d'écoute et d'invention. J'aborderai notamment des systèmes où les architectures neuronales dialoguent avec des logiques musicales profondes, où représentation symbolique et perceptive s'articulent dans un même geste créatif.Ce déplacement épistémologique, qui délègue certaines dimensions du jugement ou du style à des agents computationnels, interroge nos cadres habituels d'auteur, d'œuvre et d'écoute. Entre science et pratique artistique, je défendrai l'idée d'une coévolution entre humains et machines, fondée sur des structures partagées, des langages en devenir et la puissance inachevée de la création musicale.Carmine-Emanuele CellaCarmine-Emanuele Cella est compositeur, mathématicien appliqué et professeur associé à l'université de Californie, Berkeley, où il codirige le Center for New Music and Audio Technologies (CNMAT). Il est également directeur de la recherche artistique à l'Ircam (Paris) sous une chaire de Sorbonne Université. Son travail explore les croisements entre intelligence artificielle, mathématiques avancées et création artistique, avec un intérêt particulier pour l'orchestration, la créativité computationnelle et la recherche hybride réunissant compositeurs, interprètes et scientifiques.
Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - Grammaire générative et intelligence artificielle générative : deux programmes complémentaires
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - Grammaire générative et intelligence artificielle générative : deux programmes complémentairesLuigi RizziProfesseur du Collège de France
Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - (Dé)formations artificielles de l'esprit : l'IA, entre technologie intellectuelle et déraison computationnelle
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - (Dé)formations artificielles de l'esprit : l'IA, entre technologie intellectuelle et déraison computationnelleAnne AlombertMaîtresse de conférence en philosophie, université Paris-VIIIRésuméÀ rebours des comparaisons entre esprits humains et machines informatiques, je propose de considérer ladite « intelligence artificielle » comme une « technologie intellectuelle », qui forme et déforme nos esprits. Si la révolution numérique constitue une mutation comparable à l'apparition de l'écriture alphabétique, comme l'affirmaient déjà Nora et Minc en 1978, et si l'écriture constitue une « technologie intellectuelle » qui transforme nos manières de penser, comme le montrait Goody dans les années 1970, alors le développement fulgurant de l'IA générative ne représente pas seulement une révolution technologique et industrielle, mais ouvre aussi une révolution psychique, cognitive et culturelle.Ces nouvelles « machines d'écriture » amorcent une nouvelle étape dans l'automatisation du langage, qui soulève de nombreux enjeux. Si l'écriture alphabétique avait donné lieu à une « raison graphique », je soutiendrai que les IA génératives risquent de conduire à une « déraison computationnelle », en prenant de vitesse les activités d'interprétation et de réflexion par les calculs probabilistes.Pour faire face à ce risque, j'insisterai sur la nécessité de concevoir et de développer des technologies numériques herméneutiques et délibératives, permettant de soutenir les activités de pensée, et non de les court-circuiter. À travers plusieurs exemples, je montrerai qu'il est possible de mobiliser les technologies d'« intelligence artificielle » pour produire de nouveaux instruments spirituels, afin de mettre les automates numériques au service de nouvelles formes d'intelligences.Anne AlombertAnne Alombert est maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'université Paris-VIII. Ses recherches portent sur les rapports entre vie, techniques et esprits dans la philosophie contemporaine ainsi que sur les enjeux sociaux et politiques des technologies numériques et de l'« intelligence artificielle ». Elle est autrice de Schizophrénie numérique (Allia, 2023), Penser l'humain et la technique (ENS Éditions, 2023), Le capital que je ne suis pas ! (Fayard, 2024) et Penser avec Bernard Stiegler (PUF, 2025).
Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - L'intelligence générale artificielle : mirage ou faux raccord ?
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Intelligence, formalismes et création - L'intelligence générale artificielle : mirage ou faux raccord ?Daniel AndlerProfesseur émérite Sorbonne Université & département d'études cognitives, ENSRésuméLes performances des systèmes d'intelligence artificielle, tout particulièrement des grands modèles de langage (LLM) dont le plus connu, mais non le seul, est ChatGPT, sont stupéfiantes. Si l'on s'accorde très largement sur le fait que, pour autant, ils ne sont pas encore véritablement intelligents, beaucoup d'utilisateurs et de spécialistes sont convaincus que les progrès qu'ils ne cessent de faire annoncent l'arrivée prochaine de systèmes pleinement intelligents, dotés de ce que l'on appelle « intelligence générale artificielle ». Mais il y a des sceptiques, qui estiment que les progrès que l'on peut attendre des techniques disponibles sont limités : l'impression que le but est proche serait un mirage. Je défendrai quant à moi l'idée qu'il manque aux systèmes d'intelligence artificielle par leur nature même une dimension essentielle de l'intelligence humaine : ils ne semblent s'en approcher que par l'effet d'un faux raccord.Daniel AndlerDaniel Andler is professor emeritus of philosophy at Sorbonne Université and a member of the Académie des sciences morales et politiques. He founded and directed a number of institutions, among which the Department of Cognitive Studies (DEC) at École normale supérieure, where he currently works, the Sorbonne-CNRS research team Sciences, normes, démocratie (SND), the Société de philosophie des sciences (SPS), the master's program in cognitive science (ENS-EHESS-Univ, Paris-Descartes), and co-founded the European Society for Philosophy and Psychology (EuroSPP). He started out as a mathematical logician (with a PhD from Berkeley and a doctorat d'État from Paris 7) before moving to philosophy of science, with a focus on cognitive science and artificial intelligence. His interests range from the philosophical issue of naturalism to the impact of cognitive science on the social sciences and on societal issues such as education, collective decision making and public policy. His recent books are La Silhouette de l'humain. Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui? (2016), (as co-editor) La Cognition. Du neurone à la société (2018), and Intelligence artificielle, intelligence humaine : la double énigme (2023) (translated in Italian, Arabic and soon in Mandarin).
Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Faut-il craindre l'IA ?
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Faut-il craindre l'IA ?Philippe AghionProfesseur du Collège de France
Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Une vision collectiviste et économique de l'IA
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Une vision collectiviste et économique de l'IAMichael I. JordanU.C. Berkeley et InriaRésuméLes technologies de l'information sont en pleine révolution, où la collecte de données omniprésente et l'apprentissage automatique impactent le monde humain comme jamais auparavant. Le terme « intelligence » est utilisé comme une étoile polaire pour le développement de cette technologie, la cognition humaine étant considérée comme une base. Cette vision néglige le fait que les humains sont des animaux sociaux et qu'une grande partie de notre intelligence est d'origine sociale et culturelle. De plus, la vision actuelle néglige les conséquences sociales de la technologie. La voie à suivre ne réside pas simplement dans davantage de données et de calcul, ni dans une plus grande attention portée aux représentations cognitives ou symboliques, mais dans une fusion approfondie des concepts économiques et sociaux, tels que les marchés, les incitations, la conception de l'information, le commerce, les prix, les contrats et les externalités, avec les concepts computationnels et inférentiels, y compris la gestion de l'incertitude tant au niveau individuel qu'au niveau du système, au service de conceptions systémiques où le bien-être social est partie intégrante du processus de conception.Michael I. JordanMichael I. Jordan est directeur de recherche à l'Inria Paris et professeur émérite à l'université de Californie à Berkeley. Ses recherches portent sur les sciences computationnelles, statistiques, cognitives, biologiques et sociales. Le Pr Jordan est membre de l'Académie nationale des sciences, de l'Académie nationale d'ingénierie, de l'Académie américaine des arts et des sciences et membre étranger de la Royal Society. Il a remporté le prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA en 2025 et a été le premier lauréat du prix de la World Laureates Association (WLA) en 2022. Il a été conférencier plénier au Congrès international des mathématiciens en 2018. Il a reçu le prix Ulf Grenander de l'American Mathematical Society, la médaille John von Neumann de l'IEEE, le prix d'excellence en recherche de l'IJCAI, le prix David E. Rumelhart et le prix Allen Newell de l'ACM/AAAI.
Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Comment l'IA transforme le droit et la justice
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - Comment l'IA transforme le droit et la justiceBenoît FrydmanProfesseur à la faculté de droit de l'université libre de Bruxelles (ULB)RésuméLes techniques d'IA ont été introduites depuis longtemps dans le domaine du gouvernement et de la régulation, et se déploient désormais à grande vitesse dans toutes les branches du droit en transformant considérablement les outils et la logique de l'action administrative et judiciaire. Ce développement s'inscrit dans le projet formulé déjà par Leibniz au XVIIe siècle d'un droit mathématisé et calculable, mais recourt à des techniques, comme le profilage, qui trouvent leur source première dans l'usage normatif des probabilités au XIXe siècle. Leur déploiement à large échelle, souvent de manière prématurée et sans contrôle adéquat, met au défi les bases de l'État de droit, spécialement le contrôle des pouvoirs, la protection des droits et la motivation des décisions qui les affectent. En dépit de plusieurs catastrophes d'ampleur industrielle déjà causées par les erreurs qu'elles ont provoquées, ces innovations s'inscrivent dans un modèle de régulation qui est là pour durer et qui nécessite la mise en place de contre-feux et de garanties adaptées qui reposent également sur l'innovation technologique.Benoît FrydmanPhilosophe du droit, Benoît Frydman est professeur à la faculté de droit de l'université libre de Bruxelles (ULB). Il est docteur honoris causa des universités de Genève et d'Aix-Marseille et membre de l'Académie royale de Belgique. Ces travaux portent sur le droit global, l'évolution des instruments normatifs et sur l'histoire de la raison juridique.
Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - IA et culture : « je t'aime, moi non plus… »
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Opportunités économiques, enjeux juridiques, défis sociétaux - IA et culture : « je t'aime, moi non plus… »Alexandra BensamounUniversité Paris-SaclayRésuméEntre opposition structurelle et attirance réciproque, l'IA et la culture entretiennent des liens chaotiques. Si la (ré)conciliation est nécessaire, le droit doit inciter à l'émergence d'un marché éthique et compétitif, respectant la chaîne de valeur et donc rémunérant les contenus culturels utilisés par les IA.Alexandra BensamounAlexandra Bensamoun est professeure de droit à l'université Paris-Saclay, spécialiste en régulation du numérique et en droit de la propriété intellectuelle. Elle a créé et dirige le M2/LLM Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques (PIFTN), en codiplômation avec l'Université Laval (Québec) et l'Université ade Madrid (Espagne). Elle est l'auteur de nombreuses recherches individuelles ou collectives, notamment un Traité collectif sur le droit de l'intelligence artificielle (LGDJ/Lextenso, 2e éd., 2022). Investie dans divers réseaux de recherche nationaux et internationaux, elle est membre du comité exécutif de l'ALAI (et vice-présidente de l'Afpida, branche française) et de l'Institut DATAIA, Cluster IA de l'université Paris-Saclay. Experte pour l'Unesco et pour différentes autorités, « personnalité qualifiée » au CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, ministère de la Culture français), elle a fait partie en France de la commission interministérielle de l'intelligence artificielle qui a remis son rapport sur la stratégie française en IA, IA : notre ambition pour la France, en mars 2024, au président de la République. Elle a produit de nombreux rapports officiels sur le numérique, et en particulier sur l'intelligence artificielle, à la demande de la ministre de la Culture française, sur la mise en œuvre du Règlement européen sur l'IA (déc. 2024) et sur les modèles de rémunération des contenus culturels utilisés par les IA (juin 2025).
Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Machine arrière : Averroès, Marx et le general intellect
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Machine arrière : Averroès, Marx et le general intellectJean-Baptiste BrenetProfesseur, université Paris 1 Panthéon-SorbonneRésuméAverroès fut maudit dans l'histoire européenne pour sa conception d'un intellect humain radicalement séparé des corps, éternel, et unique pour toute l'espèce. On y a vu la ruine de la pensée personnelle, la fin de l'individu-sujet. On veut mettre cela en rapport à la fois avec ce que dit Marx du « general intellect » dans son Fragment sur les machines, et l'aliénation que notre époque dénonce dans l'intelligence artificielle.Jean-Baptiste BrenetNé en 1972 à Marseille ; agrégé de philosophie, docteur HDR de l'EPHE (section des sciences religieuses) ; médiéviste, traducteur, spécialiste de philosophie arabe et latine. Professeur de philosophie arabe à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Colloque de rentrée 2025 - Formes de l'intelligence : Ouverture
Colloque de rentrée 2025 - Formes de l'intelligence : OuvertureFormes de l'intelligence : IA, connaissance, déduction, apprentissageL'essor de l'IA met à l'épreuve sinon les pratiques, du moins les épistémologies de toutes les disciplines. Par ailleurs, cette avancée technologique a des répercussions politiques, économiques et sociales si puissantes (et si imprévisibles) qu'elle amène le Collège de France à retrouver sa mission première : mettre la science devant la société. Voici donc ce qui justifie d'y consacrer le colloque de rentrée de cette année, dans une optique résolument interdisciplinaire. Il ne s'agit nullement de faire catalogue, ou étalage, de tout ce que les sciences attendent ou craignent de l'IA, en demeurant dans le registre des usages. On ne cherchera donc pas à répliquer les initiatives nombreuses, qu'elles soient publiques ou institutionnelles, que l'IA suscite aujourd'hui. On proposera au contraire de rassembler les réflexions autour d'une question centrale : comment les mutations actuelles de l'IA peuvent-elles se nouer avec la compréhension, en longue durée, de l'idée que l'on se fait des formes de l'intelligence – c'est-à-dire, plus précisément, des rapports entre apprentissage, connaissance et déduction ?Thomas Römer
Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Sur l'évolution technique de l'intelligence : une histoire artificielle
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Sur l'évolution technique de l'intelligence : une histoire artificielleDavid BatesProfessor, University of California, BerkeleyRésuméCet article retrace une histoire artificielle de l'intelligence naturelle, affirmant que, depuis l'émergence de la pensée moderne lors de la révolution scientifique en Europe, l'esprit et ses capacités ont été appréhendés comme intriqués dans les corps, les machines et les technologies prothétiques de la pensée, comme l'écriture. L'intelligence humaine a donc été appréhendée en termes d'automatisme. Compte tenu de l'hypertechnologisation contemporaine de la vie humaine, marquée par une automatisation croissante grâce aux infrastructures numériques, l'automatisation constitue une menace pour l'indépendance humaine tout en exigeant des décisions politiques et sociales d'une importance cruciale. Cette histoire artificielle tente de renouer avec une tradition de pensée de l'intelligence comme résistance à l'automatisme. Autrement dit, malgré la relation intime, voire constitutive, de l'esprit avec la technologie, celui-ci peut néanmoins abriter les moyens de ce que Bernard Stiegler appelle la désautomatisation, et ainsi réhabiliter la capacité humaine de décision. Partant de Descartes et du concept d'automate à l'époque moderne, cet article s'inscrit dans une réflexion qui intègre les conceptions de l'esprit, du cerveau et des machines aux XIXe et XXe siècles, les premiers dispositifs informatiques, la cybernétique et les théories d'après-guerre de l'interaction homme-machine, afin de suivre une certaine interaction entre l'esprit humain et l'ouverture au sein des formes techniques et machiniques de détermination. Nous conclurons par une critique de l'intelligence artificielle, affirmant que l'intelligence naît de la confrontation de l'esprit à l'automatisme, et non des processus automatiques en soi.David W. Bates is Professor in the Department of Rhetoric at the University of California, Berkeley, an affiliate with the Center for Science, Technology, Medicine and Society, and past Director of the Berkeley Center for New Media. He received his PhD in European History from the University of Chicago. His research and teaching is focused on the relations between technology and cognition, and the history of political and legal thought. His book An Artificial History of Natural Intelligence: Thinking with Machines from Descartes to the Digital Age will be published by the University of Chicago Press in Spring 2024. He has previously published two books on early modern thought — Enlightenment Aberrations: Error and Revolution in France (Cornell, 2002) and States of War: Enlightenment Origins of the Political (Columbia, 2011) — and edited (with Nima Bassiri) a volume Plasticity and Pathology: On the Formation of the Neural Subject (Fordham, 2015). Other publications include articles on topics such as Cybernetics, Artificial Intelligence, and 20th-century political and legal theory.
Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Comment le cerveau humain se compare-t-il aux intelligences artificielles actuelles ? Quelques défis issus des sciences cognitives
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Comment le cerveau humain se compare-t-il aux intelligences artificielles actuelles ? Quelques défis issus des sciences cognitivesStanislas DehaeneProfesseur du Collège de FranceFormes de l'intelligence : IA, connaissance, déduction, apprentissageL'essor de l'IA met à l'épreuve sinon les pratiques, du moins les épistémologies de toutes les disciplines. Par ailleurs, cette avancée technologique a des répercussions politiques, économiques et sociales si puissantes (et si imprévisibles) qu'elle amène le Collège de France à retrouver sa mission première : mettre la science devant la société. Voici donc ce qui justifie d'y consacrer le colloque de rentrée de cette année, dans une optique résolument interdisciplinaire. Il ne s'agit nullement de faire catalogue, ou étalage, de tout ce que les sciences attendent ou craignent de l'IA, en demeurant dans le registre des usages. On ne cherchera donc pas à répliquer les initiatives nombreuses, qu'elles soient publiques ou institutionnelles, que l'IA suscite aujourd'hui. On proposera au contraire de rassembler les réflexions autour d'une question centrale : comment les mutations actuelles de l'IA peuvent-elles se nouer avec la compréhension, en longue durée, de l'idée que l'on se fait des formes de l'intelligence – c'est-à-dire, plus précisément, des rapports entre apprentissage, connaissance et déduction ?Thomas Römer
Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - La fabrique de l'intelligence : du mot à la chose
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - La fabrique de l'intelligence : du mot à la choseWilliam MarxProfesseur du Collège de FranceRésuméLe concept d'intelligence prend une place de plus en plus importante au fil du XIXe siècle dans la réflexion anthropologique et philosophique européenne, s'imposant contre des concurrents tels que l'esprit et l'entendement. Il concourt à une biologisation et une naturalisation de la réflexion historique (Comte). Par le biais de la théorie de l'évolution, le terme instaure une dialectique entre l'individu et le collectif (Spencer, Galton, Ribot). Il prend une dimension politique (Maurras, Benda). On assiste concurremment à des entreprises de dépersonnalisation et de formalisation du problème de l'intelligence (Taine, Binet, Valéry) qui ouvrent la voie aux théories de l'intelligence artificielle.
Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Comment étudier les formes de l'intelligence ? Les questions d'Alfred Binet (1857-1911)
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Comment étudier les formes de l'intelligence ? Les questions d'Alfred Binet (1857-1911)Stéphanie DupouyMCF faculté de philosophie Strasbourg/Archives Henri-PoincaréRésuméLe psychologue français Alfred Binet (1857-1911) est célèbre pour avoir inventé l'échelle métrique de l'intelligence, ancêtre du QI, entre 1904 et 1911. Cette communication reviendra sur les transformations conceptuelles préalables qui ont permis à l'intelligence de faire l'objet de ce type d'approche, et sur les questionnements d'A. Binet sur la question de la définition de l'intelligence et des méthodes grâce auxquelles on peut l'étudier ou, en un certain sens, la mesurer.Stéphanie DupouyMaîtresse de conférences à la faculté de philosophie de Strasbourg et affiliée aux AHP-Prest (Nancy/Strasbourg). Mes recherches portent sur l'histoire de la psychologie et de la médecine en France (XIXe-XXe siècles), l'épistémologie des sciences psychologiques et des sciences humaines, ainsi que de la médecine.
Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Les Grecs et leur « miracle » : ce que l'intelligence fait à l'histoire et retour
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - Une histoire de l'intelligence est-elle possible ? - Les Grecs et leur « miracle » : ce que l'intelligence fait à l'histoire et retourVinciane Pirenne-DelforgeProfesseur du Collège de FranceRésuméLa plupart des ouvrages traitant de l'intelligence, quel que soit le profil de leur auteur, font un détour par les Grecs, fût-il bref. La place des philosophes grecs – ces « professionnels de l'intelligence » – dans le bagage culturel européen explique pour partie un tel passage obligé. C'est aussi l'un des effets persistants du prétendu « miracle grec » qui, même battu en brèche par les historiens, continue d'innerver une certaine représentation de la Grèce antique, voire sa récupération. Dans les limites de cette présentation, il s'agira de convoquer des traditions narratives, notamment poétiques, pour rendre compte de la complexité des formes de ce que nous appelons « intelligence » dans une culture censée en avoir dessiné la scène primordiale.
Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - L'intelligence du geste : du scalpel au robot
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - L'intelligence du geste : du scalpel au robotJocelyne TroccazDirectrice de recherche émérite, CNRSRésuméL'excellence d'un chirurgien ou plus généralement d'un médecin interventionnel ne se résume pas à des capacités intellectuelles permettant de poser le bon diagnostic ou de choisir la bonne stratégie thérapeutique ; elle repose aussi sur la capacité du médecin à réaliser avec maîtrise et dextérité un geste opératoire impliquant son propre corps via ses mains et tous ses sens. Dans ce cadre, comme dans tant d'autres activités, l'outil conçu par l'esprit humain est venu prolonger sa main. Si le silex a permis de réaliser les premières trépanations il y a plusieurs milliers d'années, les interventions modernes intègrent robots, caméras et ordinateurs. C'est le domaine très interdisciplinaire du geste médico-chirurgical assisté par ordinateur, né avec l'imagerie 3D il y a environ un demi-siècle.Après une introduction du domaine et un bref panorama des évolutions tant au niveau des applications cliniques que des approches et outils développés, nous nous attarderons sur quelques travaux actuels et sur les défis pour le futur.Jocelyne Troccaz est directrice de recherche émérite du CNRS au laboratoire TIMC à Grenoble, France. Elle a obtenu un doctorat en informatique de l'Institut national polytechnique de Grenoble en 1986 sur le thème de la programmation automatique de robots pour la robotique industrielle et spatiale. Depuis 1990, elle se consacre exclusivement aux applications médicales. Son activité de recherche porte sur la robotique et l'imagerie médicales et plus généralement a pour objectif l'assistance pour le diagnostic et la thérapie. Elle entretient des collaborations étroites avec des équipes cliniques localisées à Grenoble et à Paris, et elle a apporté des innovations significatives dans plusieurs domaines cliniques (urologie, radiothérapie, chirurgie cardiaque, orthopédie, etc.). Grâce au transfert industriel, des centaines de milliers de patients, dans le monde entier, ont bénéficié des travaux qu'elle a conduits.Elle est membre fellow des sociétés savantes MICCAI (2010) et IEEE (2018). Elle a reçu le prix de l'Académie nationale de chirurgie (2014), la médaille d'argent du CNRS (2015), le prix MICCAI Enduring Impact (2022). Elle est chevalier de la Légion d'honneur (2016) et officier de l'Ordre national du mérite (2023). Elle est membre de l'Académie de chirurgie depuis 2014 et de l'Académie des sciences depuis 2022.
Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Mystères mathématiques d'intelligences pas si artificielles
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Mystères mathématiques d'intelligences pas si artificiellesStéphane MallatProfesseur du Collège de FranceRésuméLes réseaux de neurones de l'intelligence artificielle sont entraînés pour estimer les réponses à des questions, par un calcul statistique. La précision de ces réponses, malgré l'explosion de l'ensemble des possibles, montre qu'ils exploitent la structure sous-jacente des problèmes. Cela constitue une forme de connaissance. On donnera un éclairage mathématique de cette structure, bien qu'elle demeure en grande partie mystérieuse. La conférence mettra en évidence les liens profonds avec les approches philosophiques de la connaissance, la neurophysiologie et la physique statistique.
Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Quel sera l'impact de l'IA sur les mathématiques dans les prochaines années ?
Collège de FranceAnnée 2025-2026Colloque de rentrée 2025 - IA et sciences, allers-retours - Quel sera l'impact de l'IA sur les mathématiques dans les prochaines années ?Timothy GowersProfesseur du Collège de FranceRésuméL'IA a déjà eu de multiples impacts sur les mathématiques, qu'il s'agisse de travailler en collaboration avec des mathématiciens humains en suggérant des conjectures ou en effectuant des recherches plus intelligentes, ou encore de produire des preuves entières sans aide. Je discuterai des limites actuelles de l'IA et je spéculerai sur ce que nous pourrions voir dans un avenir pas si lointain.
Archéofuturisme : concilier racines et technologies pour une Europe durable
Figée dans un éternel présent sans horizon mais se donnant l'illusion du dynamisme grâce à l'idéologie du progrès, notre société est pourtant atone et stérile. Le bilan de la convergence des crises qui nous assaillent est explosif : économie chancelante, démographie en berne, immigration incontrôlée, transmission culturelle brisée, nature dévastée... Ajoutez à cela un vide idéologique abyssal, il n'y a plus de débat de fond, mais juste des échanges de termes creux et de slogans vides qui font flotter la population dans un néant consensuel et rassurant. Découvrez la chronique de Romain Petitjean pour Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Colloque - Mireille Calle Gruber : Des Œuvres complètes aux Cahiers Butor. Éditer Michel Butor ou comment faire vivre « l'amoureux vêtement sans fin de la littérature »
Carlo OssolaChaire Littératures modernes de l'Europe néolatineCollège de FranceAnnée 2025-2026Colloque : Michel Butor : « une histoire entière de l'humanité »Des Œuvres complètes aux Cahiers Butor. Éditer Michel Butor ou comment faire vivre « l'amoureux vêtement sans fin de la littérature »Colloque - Mireille Calle Gruber : Des Œuvres complètes aux Cahiers Butor. Éditer Michel Butor ou comment faire vivre « l'amoureux vêtement sans fin de la littérature »Mireille Calle Gruber
Colloque - Michel Butor : Pierre Leloup par Michel Butor
Carlo OssolaChaire Littératures modernes de l'Europe néolatineCollège de FranceAnnée 2025-2026Colloque : Michel Butor : « une histoire entière de l'humanité »Pierre Leloup par Michel ButorColloque - Michel Butor : Pierre Leloup par Michel ButorEntretien entre Michel Butor et Pierre Leloup.
Damien est sorti de son trou! Shamelessplug Hackfest Swag Join Hackfest/La French Connection Discord Join Hackfest us on Masodon Conférence GoSEC 2025 - Montréal - 10-11 sept 2025 - Colloque cybersécurité et protection des données personnelles - Saint-Hyacinthe - 2 octobre 2025 Hackfest - Québec - 16-17-18 Octobre 2025 POLAR - Québec - 16 Octobre 2025 Montréal Connecte 2025 - Montréal - 28-31 octobre 2025 - Cyberchess les 29-30 octobre - Latvia Nouvelles Câble sous-marin coupé Microsoft s'excuse pour la “latence” de son flux Azure. C'est rappeler que les fonds sous-marins ne cachent pas que des monstres et autres Kraken. Arnaque cinglée : faux avis de « maniaque » et piège financier De fausses affiches annonçant un « maniaque » mènent via QR code à une arnaque financière sur Telegram. Une fraude mêlant peur publique et cybercriminalité. Touriste en Grèce : quand des cafards IA deviennent une arme de chantage numérique Un touriste en Grèce a utilisé l'intelligence artificielle pour générer de faux cafards et obtenir une réduction d'hôtel. Une fraude qui révèle le potentiel inquiétant de l'IA dans la cybercriminalité. Astronaute fictif, vraie arnaque au Japon Un faux astronaute a escroqué une grand-mère japonaise de 6 200 € en prétextant un besoin d'oxygène spatial. En France, ce sont les “chanteurs” à la mode qui sont utilisés dans des escroqueries. Exemple avec Julien Doré Thaïlande : arrestation d'escrocs au SMS, sous-traitants d'un réseau chinois Arrestation à Bangkok : deux Thaïlandais utilisaient un SMS blaster pour diffuser de faux messages bancaires, sous la direction d'un réseau chinois. Un hacker andalou faussait ses notes grâce à un piratage Un étudiant arrêté à Séville pour piratage de notes sur Séneca. L'affaire révèle la vulnérabilité des systèmes éducatifs aux cyberattaques. Cyberattaque contre Rosneft en Allemagne : un procès sous haute tension Procès à Berlin d'un hacker accusé d'avoir saboté Rosneft Deutschland. Révèle la vulnérabilité énergétique allemande face au cyberconflit. Fermeture de Nsw2u et de sites pirates de jeux vidéo Le FBI et le FIOD ont démantelé Nsw2u et d'autres sites pirates de jeux Switch et PS4. Illustre l'enjeu cyber et économique du secteur vidéoludique. Démantèlement de Streameast, le géant du piratage sportif Démantèlement de Streameast en Égypte : la plus grande plateforme de streaming sportif illégal. Accusée de blanchiment de 6 millions d'euros, elle est neutralisée. Un seul fournisseur, toute une nation en otage Miljödata, fournisseur RH suédois, piraté. 200 communes paralysées. Une leçon choc sur les risques d'un numérique centralisé sans résilience. 62IX et HKVD, l'ombre numérique derrière les failles des infrastructures critiques (RUSSE) 62IX GROUP et HKVD : intrusion réelle ou campagne d'influence ? Décryptage des récits techniques, commerciaux et idéologiques autour des infrastructures critiques. Cyberattaque au Muséum d'histoire naturelle : activités perturbées et exposition annulée Cyberattaque au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Recherche paralysée, exposition annulée, enquête en cours. Inquiétude croissante face aux menaces numériques. Le phishing fatal : comment « Sombreofficiel » a failli faire vaciller GRDF Un simple clic a suffi à « Sombreofficiel », mineur au moment des faits. Accès aux données de centaines de clients de GRDF. Revente via Telegram et jugement au tribunal pour enfants de Paris. Arnaque au trading crypto : l'affaire Marginswap, Lucas BTC et Tianna Escroquerie crypto Marginswap orchestrée par Lucas BTC et Tianna. Promesses de gains, blocage des retraits, extorsion, nettoyage de preuves. Témoignages, analyse du modus operandi et pistes pour les victimes et autorités cyber. Crew Patrick Mathieu Damien Bancal Crédits Montage audio par Hackfest Communication Music par Nibana – Earth From Above - Legacy (feat. Suduaya) Locaux virtuels par Streamyard
Damien est sorti de son trou! Shamelessplug Hackfest Swag Join Hackfest/La French Connection Discord Join Hackfest us on Masodon Conférence GoSEC 2025 - Montréal - 10-11 sept 2025 - Colloque cybersécurité et protection des données personnelles - Saint-Hyacinthe - 2 octobre 2025 Hackfest - Québec - 16-17-18 Octobre 2025 POLAR - Québec - 16 Octobre 2025 Montréal Connecte 2025 - Montréal - 28-31 octobre 2025 - Cyberchess les 29-30 octobre - Latvia Nouvelles Câble sous-marin coupé Microsoft s'excuse pour la “latence” de son flux Azure. C'est rappeler que les fonds sous-marins ne cachent pas que des monstres et autres Kraken. Arnaque cinglée : faux avis de « maniaque » et piège financier De fausses affiches annonçant un « maniaque » mènent via QR code à une arnaque financière sur Telegram. Une fraude mêlant peur publique et cybercriminalité. Touriste en Grèce : quand des cafards IA deviennent une arme de chantage numérique Un touriste en Grèce a utilisé l'intelligence artificielle pour générer de faux cafards et obtenir une réduction d'hôtel. Une fraude qui révèle le potentiel inquiétant de l'IA dans la cybercriminalité. Astronaute fictif, vraie arnaque au Japon Un faux astronaute a escroqué une grand-mère japonaise de 6 200 € en prétextant un besoin d'oxygène spatial. En France, ce sont les “chanteurs” à la mode qui sont utilisés dans des escroqueries. Exemple avec Julien Doré Thaïlande : arrestation d'escrocs au SMS, sous-traitants d'un réseau chinois Arrestation à Bangkok : deux Thaïlandais utilisaient un SMS blaster pour diffuser de faux messages bancaires, sous la direction d'un réseau chinois. Un hacker andalou faussait ses notes grâce à un piratage Un étudiant arrêté à Séville pour piratage de notes sur Séneca. L'affaire révèle la vulnérabilité des systèmes éducatifs aux cyberattaques. Cyberattaque contre Rosneft en Allemagne : un procès sous haute tension Procès à Berlin d'un hacker accusé d'avoir saboté Rosneft Deutschland. Révèle la vulnérabilité énergétique allemande face au cyberconflit. Fermeture de Nsw2u et de sites pirates de jeux vidéo Le FBI et le FIOD ont démantelé Nsw2u et d'autres sites pirates de jeux Switch et PS4. Illustre l'enjeu cyber et économique du secteur vidéoludique. Démantèlement de Streameast, le géant du piratage sportif Démantèlement de Streameast en Égypte : la plus grande plateforme de streaming sportif illégal. Accusée de blanchiment de 6 millions d'euros, elle est neutralisée. Un seul fournisseur, toute une nation en otage Miljödata, fournisseur RH suédois, piraté. 200 communes paralysées. Une leçon choc sur les risques d'un numérique centralisé sans résilience. 62IX et HKVD, l'ombre numérique derrière les failles des infrastructures critiques (RUSSE) 62IX GROUP et HKVD : intrusion réelle ou campagne d'influence ? Décryptage des récits techniques, commerciaux et idéologiques autour des infrastructures critiques. Cyberattaque au Muséum d'histoire naturelle : activités perturbées et exposition annulée Cyberattaque au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Recherche paralysée, exposition annulée, enquête en cours. Inquiétude croissante face aux menaces numériques. Le phishing fatal : comment « Sombreofficiel » a failli faire vaciller GRDF Un simple clic a suffi à « Sombreofficiel », mineur au moment des faits. Accès aux données de centaines de clients de GRDF. Revente via Telegram et jugement au tribunal pour enfants de Paris. Arnaque au trading crypto : l'affaire Marginswap, Lucas BTC et Tianna Escroquerie crypto Marginswap orchestrée par Lucas BTC et Tianna. Promesses de gains, blocage des retraits, extorsion, nettoyage de preuves. Témoignages, analyse du modus operandi et pistes pour les victimes et autorités cyber. Crew Patrick Mathieu Damien Bancal Crédits Montage audio par Hackfest Communication Music par Nibana – Earth From Above - Legacy (feat. Suduaya) Locaux virtuels par Streamyard
Un colloque sur l'Histoire des juifs de France boycotté par des universitaires : pour Rachida Dati, « Trop, c'est trop ! »
Chroniqueurs : - Eliot Deval, journaliste - Gauthier le Bret, journaliste - Elisabeth Assayag, animatrice de télévision Vous voulez réagir ? Appelez-le 01.80.20.39.21 (numéro non surtaxé) ou rendez-vous sur les réseaux sociaux d'Europe 1 pour livrer votre opinion et débattre sur grandes thématiques développées dans l'émission du jour.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
[Échange d'été] Éthique et Psycho - Interviews au colloque antispéciste de Rennes
Coucou, ce mois-ci je vous propose de découvrir d'autres podcasts engagés qui abordent également la question du spécisme.Et aujourd'hui, je vous parle d'Éthique et Psycho, le podcast animé par Yohann Hoarau qui analyse les oppressions, notamment par le biais de la psychologie sociale, mais aussi avec d'autres disciplines comme la sociologie, les sciences politiques, l'histoire, etc.C'est vraiment une ressource de qualité, avec beaucoup d'attention et de soin à la précision et à robustesse des positions présentées à chaque fois, et qui fait le tour de questions assez transversales, notamment le spécisme mais aussi beaucoup d'autres questions sociales importantes. Je vous recommande chaudement le double épisode avec Jérôme Segal sur la situation israélo-palestinienne qui fait vraiment bien le point sur les facteurs historiques et contemporains pour éclairer en partie ce qui a mené à la situation présente catastrophique du génocide en cours. Il y a aussi un épisode que j'ai adoré avec Sarah Zanaz sur le spécisme pensé comme un système sociale, c'est extrêmement quali : il faut à tout prix l'écouter ! Dans sa thèse, Sarah définit le spécisme comme une oppression et ça change de la définition très individualisante qui était jusqu'à maintenant donnée en philosophie. Mais bon, aujourd'hui je me suis dis que je vous diffuserais un épisode plus court, un des derniers publiés sur le podcast de Yohann qui était présent comme moi à un colloque universitaire très enrichissant à Rennes en juin dernier, et qui a eu la bonne idée de faire des courtes interviews avec plusieurs intervenant-es pour garder une trace des idées brassées, et montrer ce qui se fait de mieux dans la recherche contemporaine sur la question animale. Voilà pensez bien à vous abonner à Éthique et psycho, à suivre les futurs épisodes qui seront assurément passionnants, et bonne écoute !___________________________________Série de courtes interviews réalisées lors du colloques universitaires de Rennes sur la libération animale du 4 et 5 juin 2025.Lien vers les 3 interviews en anglais : • Colloque antispéciste de Rennes - Intervie... Merci à Takara et Laurent Tissot pour leur doublage !Me soutenir sur Ko-fi ou Tipeee :https://ko-fi.com/mangayohhttps://fr.tipeee.com/yohann-hoarau-e...00:00 Intro03:30 Sarah Zanaz05:38 Mathis Poupelin08:45 Nolwenn Veillard12:18 Nicolas Poirel15:27 Eloïse Ly Van Tu17:49 Tom Bry-Chevalier23:14 Émilie Dardenne25:55 Jules Braly-Nova28:27 Matti Wilks31:48 Bob Fisher35:22 Oscar Horta
Discussion d'été de DDoS à la Chine Shamelessplug Hackfest Swag Join Hackfest/La French Connection Discord Join Hackfest us on Masodon Conférence GoSEC 2025 - Montréal - 10-11 sept 2025 - Colloque cybersécurité et protection des données personnelles - Saint-Hyacinthe - 2 octobre 2025 Hackfest - Québec - 16-17-18 Octobre 2025 POLAR - Québec - 16 Octobre 2025 Montréal Connecte 2025 - Montréal - 28-31 octobre 2025 - Cyberchess les 29-30 octobre - Latvia Nouvelles Europol Disrupts NoName057(16) Hacktivist Group Linked to DDoS Attacks ‘123456' password exposed info for 64 million McDonald's job applicants PATCH YOUR SYSTEMS ! Microsoft - Fortinet - Cisco - Citrix - ZScaler - VMWare - Google Chrome - SonicWall Cyber Threat Intelligence Report: Australia H1 2025 China-Backed Salt Typhoon Hacks US National Guard for Nearly a Yea Spain awards Huawei contracts to manage intelligence agency wiretaps Russian vodka producer reports disruptions after ransomware attack FCC wants to ban Chinese tech from undersea cables RFTA - Submarine Cables Face Increasing Threats Amid Geopolitical Tensions and Limited Repair Capacity Global operation targets NoName057(16) pro-Russian cybercrime network Chinese Hackers Target Taiwan's Semiconductor Sector with Cobalt Strike, Custom Backdoors Cloudflare says 1.1.1.1 outage not caused by attack or BGP hijack Cloudflare 1.1.1.1 incident on July 14, 2025 PerfektBlue Bluetooth flaws impact Mercedes, Volkswagen, Skoda cars Four arrested in UK over M&S, Co-op, Harrods cyberattacks Co-op confirms data of 6.5 million members stolen in cyberattack Trump administration to spend $1 billion on ‘offensive' hacking operations A Little-Known Microsoft Program Could Expose the Defense Department to Chinese Hackers WeTransfer clarifies it won't use your files to train AI _ Mashable Crew Patrick Mathieu Francis Coats Steve Waterhouse Crédits Montage audio par Hackfest Communication Music par Sinewinder – Superstring - Spaghettification Locaux virtuels par Streamyard
Combat de Roomba Shamelessplug Hackfest Swag Join Hackfest/La French Connection Discord Join Hackfest us on Masodon Conférence GoSEC 2025 - Montréal - 10-11 sept 2025 - Colloque cybersécurité et protection des données personnelles - Saint-Hyacinthe - 2 octobre 2025 Hackfest - Québec - 16-17-18 Octobre 2025 POLAR - Québec - 16 Octobre 2025 Montréal Connecte 2025 - Montréal - 28-31 octobre 2025 - Cyberchess les 29-30 octobre - Latvia Nouvelles RBC remet la sécurité dans les mains de ses clients Canada suspends Hikvision operations over national security concerns The Expanding Front: CCP Espionage and Strategic Ambition Since 2020 New spyware strain steals data from Russian industrial companies Nearly 300,000 people were impacted by cyberattack on Nova Scotia Power Anatsa mobile malware returns to victimize North American bank customers update 20250707 - Ingram Micro outage caused by SafePay ransomware attack Microsoft July 2025 Patch Tuesday fixes one zero-day, 137 flaws Alleged Chinese hacker tied to Silk Typhoon arrested for cyberespionage Digital threats from China unlike any ever encountered, top cyber firm warns Une vidéo prémonitoire des ratés de SAAQclic Hydro-Québec réinvestit près de 1,4 G$ dans les compteurs «intelligents» AT&T rolls out “Wireless Lock” feature to block SIM swap attacks CISA and Partners Urge Critical Infrastructure to Stay Vigilant in the Current Geopolitical Environment The People's Liberation Army Cyberspace Force FalconFeed Report - North America Under Digital Siege Invité Loic J'ai hacké mon Roomba GitHub Crew Patrick Mathieu Francis Coats Steve Waterhouse Crédits Montage audio par Hackfest Communication Music par Xenofish - Encoder - Leviathan Locaux virtuels par Streamyard
Incontournables sanctuaires de France 2025-06-17 Sanctuaire de Vézelay
Avec le Père Olivier Artus, recteur de la Basilique de Vézelay https://www.basiliquedevezelay.org/ Colloque "Osons l'espérance" du 20 au 22/07/2025: https://openagenda.com/fr/jerusalem-vezelay/events/colloque-les-intervenants