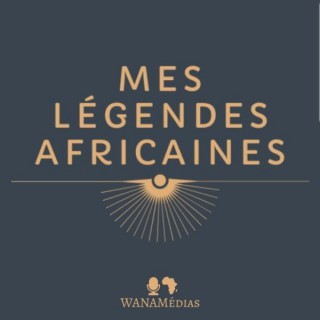Podcasts about africaines
- 231PODCASTS
- 582EPISODES
- 35mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Feb 24, 2026LATEST
POPULARITY
Best podcasts about africaines
Latest news about africaines
- De Naïja à Abidjan Africa Is a Country - Sep 11, 2024
- Open Access Journal: Études d'Antiquités africaines AWOL - The Ancient World Online - Jun 20, 2023
- Delivering on our $1B commitment in Africa Official Google Africa Blog - Oct 5, 2022
Latest podcast episodes about africaines
En Côte d'Ivoire, HEC Challenge + tente de faire émerger des start-up africaines
Il y aurait environ 300 start-up actives en Côte d'Ivoire selon les estimations du gouvernement. Pour lancer leur activité, certains entrepreneurs cherchent à suivre des formations jugées prestigieuses. C'est le cas de Challenge + Afrique, un programme de la célèbre école de commerce française HEC Paris. Dans la salle de classe, une vingtaine de participants, hommes et femmes, suivent leur premier cours. L'idée ? Comprendre comment leur petite entreprise peut gagner de la valeur. Mariama Kaba vient du Sénégal. Cette spécialiste de la validation des acquis de l'expérience se lance dans l'entrepreneuriat. Son idée : faire certifier les compétences des travailleurs du secteur informel : « J'ai déjà participé à des projets d'entreprise, mais je restais toujours derrière. Là, c'est l'occasion de me concentrer sur mon propre projet, d'acquérir des compétences… parce que la finance, c'est un "gros mot" [pour moi]. Là, ce matin, on avait un cours sur les fondamentaux de la start-up, j'écoute, je note tous les mots-clefs pour faire une fiche après. Ce que j'attends ? Y a le réseau également, toutes les personnes qui sont là, elles sont inspirantes… Là, ça fait deux jours, quand je rentre chez moi, je parle de tout le monde, je parle de mes collègues à mes amis, à ma famille. Je suis là où je dois être pour sortir de ma zone de confort. » Dans la promotion de Mariama, les projets sont divers : accès au logement, solutions techniques d'économie d'énergie… Prendre du recul pour changer d'échelle Les participants ont payé 5 000 euros (environ 3 millions de francs CFA) pour bénéficier des conseils de formateurs comme Etienne Krieger. Cet expert de la finance entrepreneuriale veut partager ses « bonnes recettes » avec les participants : « Nous on est là pour leur faire prendre conscience des ingrédients qui vont faire qu'ils vont crédibiliser les projets, identifier des besoins réels, pas ou mal satisfaits par les offres existantes, les vendre, être suffisamment crédibles pour attirer des bonnes fées qui vont se pencher sur leurs berceaux pour passer d'une activité artisanale à quelque chose "d'industriel" ». Parmi les réussites du programme, il y a Leya. La start-up abidjanaise aide les guichets de mobile money à ne jamais manquer d'argent liquide. Son cofondateur Thibaut Cathenoz résume l'apport de la formation : « On a pu prendre énormément de recul, affiner notre pitch, affiner notre proposition de valeur, comprendre comment fonctionne une levée de fonds. Ça nous a beaucoup servi pour la suite parce qu'on a levé des fonds. Et, franchement, ça nous a été d'une grande aide. » En cinq ans, Challenge + Afrique a accompagné près de 120 start-up, à Abidjan et Dakar.
Dans ce nouvel épisode de Mes Légendes Africaines, Avitsara nous présente son inspiration venue d'Afrique : Gisèle Rabesahala, une femme politique malgache.Mes Légendes Africaines, un programme WANAMédias proposé par l'OdioO ! Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Affaire Epstein : des personnalités africaines citées dans les documents
L'affaire Epstein aurat-elle des répercussions sur le continent africain ? Plusieurs personnalités africaines sont citées, comme le Sénégalais Karim Wade et les deux anciens présidents Robert Mugabe et Jacob Zuma. Dans quel contexte leurs noms apparaîssent-ils ? On fera le point dans ce journal.
Les frontières africaines existaient avant la colonisation
durée : 00:03:44 - Le Fil histoire - On dit souvent que les frontières africaines seraient artificielles parce qu'elles auraient été tracées par les colonisateurs. Mais, toutes les frontières du monde sont artificielles. Les frontières sont des artefacts, des constructions humaines. - réalisation : Margot Page - invités : Camille Lefebvre historienne, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS, PI de l'ERC Langarchiv et membre de l'Institut des mondes africains.
«Happy People» de Siân Pottok, sur les traces de ses racines africaines
Avec son nouvel album Happy people, Siân Pottok nous emmène vers la lumière sub-saharienne où jaillit la source de ses racines africaines. Siân Pottok est une musicienne voyageuse, qui a passé une partie de sa vie à arpenter le monde et quoi de plus normal quand on est né d'une mère congolaise et indienne, qu'on a des racines paternelles en Slovaquie et qu'on a grandi entre la Belgique et les États-Unis. Siân Pottok a fait de cette identité plurielle sa marque de fabrique musicale. On l'avait déjà vue à l'œuvre dans son précédent album Deep Waters. « Happy People », son nouvel EP met encore plus en avant ses racines africaines. Siân Pottok y célèbre les échos des ancêtres, à travers le Kamélé Ngoni, cet instrument pour lequel elle a eu une sorte de coup de foudre après y avoir été initié par le bluesman Abou Diarra. ► Titres joués en live : Je danse sur toi et Happy people. ► Chronique : Dans Café Polar, Catherine Fruchon-Toussaint nous parle de Geneviève Roux et son premier roman « Même pas morte » (Stock). En 2018, l'autrice québécoise a survécu à une tentative de féminicide et s'est inspirée de sa propre histoire pour raconter les faits et l'après avec la reconstruction et la quête de justice pour retrouver son agresseur. ► Playlist du jour : - Siân Pottok - Echoes of the ancestors - Siân Pottok - Shine a light.
«Happy People» de Siân Pottok, sur les traces de ses racines africaines
Avec son nouvel album Happy people, Siân Pottok nous emmène vers la lumière sub-saharienne où jaillit la source de ses racines africaines. Siân Pottok est une musicienne voyageuse, qui a passé une partie de sa vie à arpenter le monde et quoi de plus normal quand on est né d'une mère congolaise et indienne, qu'on a des racines paternelles en Slovaquie et qu'on a grandi entre la Belgique et les États-Unis. Siân Pottok a fait de cette identité plurielle sa marque de fabrique musicale. On l'avait déjà vue à l'œuvre dans son précédent album Deep Waters. « Happy People », son nouvel EP met encore plus en avant ses racines africaines. Siân Pottok y célèbre les échos des ancêtres, à travers le Kamélé Ngoni, cet instrument pour lequel elle a eu une sorte de coup de foudre après y avoir été initié par le bluesman Abou Diarra. ► Titres joués en live : Je danse sur toi et Happy people. ► Chronique : Dans Café Polar, Catherine Fruchon-Toussaint nous parle de Geneviève Roux et son premier roman « Même pas morte » (Stock). En 2018, l'autrice québécoise a survécu à une tentative de féminicide et s'est inspirée de sa propre histoire pour raconter les faits et l'après avec la reconstruction et la quête de justice pour retrouver son agresseur. ► Playlist du jour : - Siân Pottok - Echoes of the ancestors - Siân Pottok - Shine a light.
Sapiens, une révolution préhistorique 1 : Les origines africaines d'Homo sapiens
durée : 00:39:00 - La Terre au carré - par : Mathieu Vidard - 773 000 ans. Voici l'âge que l'on a réussi à attribuer à des fossiles hominines trouvés en 2008 et 2009 près de Casablanca au Maroc. Ce résultat d'une étude publiée dans la revue Nature dévoile une nouvelle pièce manquante du puzzle de nos origines et des proches ancêtres d'Homo sapiens en Afrique. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
À l'origine omniprésente dans les cultures amérindiennes et africaines, la plume a fait son chemin jusqu'aux chapeaux des dames, bibis, panaches militaires et autres créations de mode... pour devenir un élément incontournable dans l'habillement occidental jusqu'au milieu du XXème siècle. La plume comme élément millénaire qui témoigne du rapport si particulier entre l'Homme et l'animal, dont on explorera les symboliques et l'usage à travers les époques. sujets traités : plume, cultures, amérindiennes ,africaines, modes, animal, symbolique Merci pour votre écoute Un Jour dans l'Histoire, c'est également en direct tous les jours de la semaine de 13h15 à 14h30 sur www.rtbf.be/lapremiere Retrouvez tous les épisodes d'Un Jour dans l'Histoire sur notre plateforme Auvio.be :https://auvio.rtbf.be/emission/5936 Intéressés par l'histoire ? Vous pourriez également aimer nos autres podcasts : L'Histoire Continue: https://audmns.com/kSbpELwL'heure H : https://audmns.com/YagLLiKEt sa version à écouter en famille : La Mini Heure H https://audmns.com/YagLLiKAinsi que nos séries historiques :Chili, le Pays de mes Histoires : https://audmns.com/XHbnevhD-Day : https://audmns.com/JWRdPYIJoséphine Baker : https://audmns.com/wCfhoEwLa folle histoire de l'aviation : https://audmns.com/xAWjyWCLes Jeux Olympiques, l'étonnant miroir de notre Histoire : https://audmns.com/ZEIihzZMarguerite, la Voix d'une Résistante : https://audmns.com/zFDehnENapoléon, le crépuscule de l'Aigle : https://audmns.com/DcdnIUnUn Jour dans le Sport : https://audmns.com/xXlkHMHSous le sable des Pyramides : https://audmns.com/rXfVppvN'oubliez pas de vous y abonner pour ne rien manquer.Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous donner des étoiles ou des commentaires, cela nous aide à le faire connaître plus largement. Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Pour Stephen, pour que la CAN du Maroc soit réussie, la victoire finale est obligatoire ! Nicolas Jamain explique que cette CAN a permis d'installer le Maroc parmi les meilleures nations africaines. - 18/01
"C'est la libre-antenne du dimanche midi ! Attablez-vous et venez débattre avec la joyeuse bande de Stephen Brun tous les dimanches entre 13h00 et 15h00. Durant deux heures, les auditeurs sont au cœur de l'émission pour échanger avec Stephen Brun, Alexandre Biggerstaff, Maxime Pauty, Erwan Abautret et tous leurs invités."
Exercices navals des BRICS dans les eaux sud-africaines : la classe politique divisée
L'Afrique du Sud accueille à partir de ce vendredi, des navires militaires chinois, iraniens et russes pour des exercices navals du BRICS+. Cet évènement survient alors que les tensions géopolitiques sont élevées suite aux attaques militaires Américaines sur Caracas. La décision de Pretoria d'accueillir les navires russes et iraniens, deux pays sous sanctions de Washington, a été critiquée parmi les membres du gouvernement qui craignent une recrudescence de tensions avec les Etats-Unis.
Jean Rouch : "Nous voudrions créer de véritables archives sonores africaines"
durée : 00:19:53 - Les Nuits de France Culture - par : Philippe Garbit - En 1959, Jean Rouch était à Dakar il expliquait son projet d'archives sonores de l'Afrique (1ère diffusion : 01/01/1959 Radio Dakar). - réalisation : Virginie Mourthé - invités : Jean Rouch
Comment promouvoir l'agriculture urbaine pour nourrir les villes africaines?
Le continent africain connaît les taux d'urbanisation les plus rapides au monde. À l'horizon 2050, ses zones urbaines devraient accueillir 950 millions d'habitants supplémentaires, selon Africapolis, une base de données recensant les dynamiques d'urbanisation du continent. [Rediffusion de l'émission du 17 mars 2025] Une progression et des enjeux en conséquence avec, en premier lieu, celui de l'alimentation. À mesure que le besoin en habitations et infrastructures grandit, la pression sur le foncier s'accélère au détriment des jardins partagés et des potagers qui jouent pourtant un rôle essentiel pour les villes et leurs périphéries. À la fois source de nourriture, d'emploi, de lien social et d'îlot de fraîcheur, l'agriculture urbaine est pourtant délaissée des politiques publiques. Comment valoriser le maraichage au coeur des villes ? Quelles sont les innovations innovantes sur lesquelles s'appuyer ? Avec : • Christine Aubry, directrice de la Chaire agriculture urbaine à Agro Paris Tech, et co-directrice des ouvrages Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar (Presses universitaires du Midi, 2023) et Agriculture urbaine et biodiversités - Vers une ville verte et agroécologique (Apogée, 2025) • Moctar Diouf, géographe, chercheur associé au Laboratoire Pléiade. Chargé d'enseignement à l'Université Sorbonne Paris Nord et membre de AgriTakhh, (Takhh est un terme wolof qui signifie ville) une communauté qui regroupe l'ensemble des acteurs.trices de l'agriculture urbaine et péri-urbaine dans les Suds • Jean-François Kacou Aka, spécialiste de la bioéconomie circulaire. Point focal du programme «Villes Vertes» de l'Institut de l'Économie circulaire d'Abidjan (IECA). En fin d'émission, la chronique Voisins connectés d'Estelle Ndjandjo, sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, les réseaux sociaux et la technologie. Elle revient sur le cyberharcèlement dont a été victime la chanteuse sud-africaine Tyla. Programmation musicale : ► Burna Boy – Update ► Naza – Baby Lova
Comment promouvoir l'agriculture urbaine pour nourrir les villes africaines?
Le continent africain connaît les taux d'urbanisation les plus rapides au monde. À l'horizon 2050, ses zones urbaines devraient accueillir 950 millions d'habitants supplémentaires, selon Africapolis, une base de données recensant les dynamiques d'urbanisation du continent. [Rediffusion de l'émission du 17 mars 2025] Une progression et des enjeux en conséquence avec, en premier lieu, celui de l'alimentation. À mesure que le besoin en habitations et infrastructures grandit, la pression sur le foncier s'accélère au détriment des jardins partagés et des potagers qui jouent pourtant un rôle essentiel pour les villes et leurs périphéries. À la fois source de nourriture, d'emploi, de lien social et d'îlot de fraîcheur, l'agriculture urbaine est pourtant délaissée des politiques publiques. Comment valoriser le maraichage au coeur des villes ? Quelles sont les innovations innovantes sur lesquelles s'appuyer ? Avec : • Christine Aubry, directrice de la Chaire agriculture urbaine à Agro Paris Tech, et co-directrice des ouvrages Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar (Presses universitaires du Midi, 2023) et Agriculture urbaine et biodiversités - Vers une ville verte et agroécologique (Apogée, 2025) • Moctar Diouf, géographe, chercheur associé au Laboratoire Pléiade. Chargé d'enseignement à l'Université Sorbonne Paris Nord et membre de AgriTakhh, (Takhh est un terme wolof qui signifie ville) une communauté qui regroupe l'ensemble des acteurs.trices de l'agriculture urbaine et péri-urbaine dans les Suds • Jean-François Kacou Aka, spécialiste de la bioéconomie circulaire. Point focal du programme «Villes Vertes» de l'Institut de l'Économie circulaire d'Abidjan (IECA). En fin d'émission, la chronique Voisins connectés d'Estelle Ndjandjo, sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, les réseaux sociaux et la technologie. Elle revient sur le cyberharcèlement dont a été victime la chanteuse sud-africaine Tyla. Programmation musicale : ► Burna Boy – Update ► Naza – Baby Lova
Diasporas africaines en France: Chantal Pichon, chercheuse et pionnière dans l'ARN messager [4/5]
Cette scientifique d'origine malgache, reconnue mondialement pour son travail, veut développer de nouvelles thérapies pour le plus grand nombre. (Rediffusion du 21/08/2025) Chantal Pichon est née et a grandi à Madagascar. À 17 ans, cette bachelière brillante quitte le nid familial pour poursuivre ses études dans l'Hexagone, à Marseille. Ses parents sont tous les deux médecins, et elle devait suivre leurs traces, mais une autre voie s'ouvre à elle. « Au départ, je voulais être chirurgienne, raconte Chantal Pichon en souriant, C'était mon rêve. À vrai dire, celui de mon père. Et puis, après, je me suis dit que si je ne suis pas médecin, je peux devenir chercheur en biologie, comme ça je me rapproche de la médecine. Je ne soignerai pas, mais je développerai des nouvelles thérapies. » L'ARN messager n'a plus aucun secret pour elle Son nom et son visage sont associés depuis peu de temps à l'ARN messager, découvert par le grand public lors de la pandémie du Covid-19 et ensuite lors de la vaccination. Elle est en la matière une véritable pionnière : cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille pour plusieurs laboratoires sur cette technologie. Titulaire d'une chaire d'innovation à l'Institut universitaire de France, cette chercheuse est reconnue mondialement. Pourtant, on ne sait presque rien d'elle. Dans le cadre de la stratégie d'accélération France mise en place par le président Emmanuel Macron, elle dirige un gros projet sur la mise au point de nouveaux vaccins. « J'ai des projets européens pour essayer de trouver des moyens pour réduire le coût des ARN messagers, explique-t-elle, comme je viens de Madagascar, un pays pauvre, ce qui me guide, c'est d'arriver à placer une petite brique à mon niveau pour justement développer de nouvelles thérapies pour le plus grand nombre. Car c'est très bien de développer des nouvelles thérapies, mais si c'est juste pour des pays développés, et si c'est réservé à des personnes qui ont de l'argent, eh bien, je trouve cela un peu dommage ». Un parcours pas toujours simple Chantal Pichon a déjà été confrontée au racisme en France. « J'étais candidate pour piloter une école, le profil me correspondait. La directrice était présente, elle m'a regardée et m'a dit : « Êtes-vous sûr que vous pouvez vraiment représenter cette école comme vous êtes là ? Cette phrase m'a véritablement blessée. Je pense que si on ne réussit pas, tout le monde vous accepte et quelque part, vous êtes à votre place. Mais lorsqu'on commence à réussir, cela agace. Il y a de la jalousie, mais je pense que cela concerne tout le monde ». Pantalon fluide couleur kaki ou noir, agrémenté d'un pendentif. Chantal Pichon, élégante et souriante, déambule dans ce laboratoire flambant neuf implanté par l'Inserm, organisme de recherche public français. « Je suis excessivement fière et reconnaissante vis-à-vis de l'Inserm, je veux rendre à la société ce que j'ai eu. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que quand on veut réussir, on peut. En fait, quand les gens vous font confiance, ils vous proposent des moyens humains, des moyens financiers, des équipements. Et puis quand plusieurs collègues vous font confiance pour mener des projets avec eux, eh bien cela vous donne aussi énormément de responsabilités. J'ai beaucoup de pression, j'espère vraiment réussir. » À 60 ans, cette femme passionnée et impatiente a un rêve. Avec sa jeune équipe d'une quarantaine de personnes, qui regroupe plusieurs nationalités, elle met en place les vaccins et les thérapies innovantes à partir de l'ARN messager, une technologie qui pourrait être utilisée notamment dans le traitement de certains cancers. À lire aussiDiasporas africaines en France: Khalid Tamer, le nomade culturel [3/5]
Diasporas africaines en France: Khalid Tamer, le nomade culturel [3/5]
Rien n'arrête Khalid Tamer, metteur en scène d'origine marocaine, premier président africain de la Commission internationale du théâtre francophone et directeur du théâtre le Lavoir Moderne Parisien. (Rediffusion du 20/08/2025) Khalid Tamer est un homme du terroir : « J'ai grandi en Corrèze, puis je suis monté à l'âge de 18 ans à Paris pour faire du théâtre ». Une passion qui ne l'a plus quitté. Il crée au cœur du quartier multiculturel de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement parisien un lieu unique, la compagnie Graines de Soleil - Lavoir Moderne Parisien. Un espace de création atypique : il s'agit tout simplement d'un ancien lavoir transformé en un lieu unique et expérimental où de jeunes troupes ont carte blanche. « On dit qu'Émile Zola en parle dans son roman L'Assommoir. Voyez, il y a encore là les traces qui sont présentes des bassines où les femmes lavaient leur linge. C'est un lieu qui a une belle histoire, ce sont des murs qui ont une âme. En 1986, cet espace est devenu un théâtre, où artistes, auteurs, et des militantes comme les Femen, un groupe de protestation féministe fondé en Ukraine en 2008, célèbres pour avoir organisé des manifestations seins nus, sont venues. Vous voyez le symbole ! Puis j'ai eu mon propre combat pendant six ans avec un des propriétaires qui voulait détruire ce lieu, donc on s'est battu pour le garder tel qu'il est avec tout son charme. » Et c'est toujours au Lavoir Moderne Parisien qu'il vient d'achever la 4ᵉ édition d'Africapitales, avec le Sénégal comme invité d'honneur. Faire venir l'Afrique et ses cultures à Paris, c'est l'un des défis de cet homme passionné de cultures. « Il y a quelque chose de très africain en moi, j'ai l'impression que je suis un nomade et partout où je suis, je porte ma maison », explique-t-il. Première rencontre Dans ce cocon artistique, Virginie Chevalier, Québécoise, l'a rejoint. Cette scénographe a travaillé sur de nombreux projets et pièces de théâtre montés par la compagnie Graines de Soleil aux côtés de Khalid, fascinée par cet homme qui partage sa vie. « Pour moi, Khalid est vraiment au service de la culture. On lui donne un billet d'avion, il te crée un festival dans le monde. Pour lui, l'art est au-dessus de tout. » Au Maroc où il est né, il a des projets. Et à Tanger, ses rêves deviennent réalité. Il vient d'acquérir l'emblématique librairie des Colonnes, c'est aussi dans cette ville, carrefour des cultures entre l'Europe et l'Afrique, qu'il a organisé la première édition des rencontres méditerranéennes de Tanger. Un événement culturel rendu possible avec Marc Bitton de la Fondation Founoun Al Boughaz - Arts du Détroit. Ensemble, ils ont imaginé ce projet. Au menu : des concerts, des expositions et des débats au cœur de la kasbah… où le Liban et sa littérature étaient aussi à l'honneur. Funambule artistique « J'avais très envie qu'on soit présent parce que je pense qu'on a ce défaut dans notre partie du monde de vouloir toujours dialoguer à travers la France », souligne l'écrivaine Georgia Makhlouf. « Je dirais que c'est en France qu'on rencontre les écrivains venus du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie… Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir enfin des liens directs afin d'apprendre à se connaître, je pense qu'on a beaucoup à partager, qu'on a beaucoup à apprendre pour arriver à faire des choses ensemble ». Khalid Tamer tisse des liens : « J'aime rencontrer l'autre que je ne connais pas et j'aime prendre des risques, c'est ma manière de vivre, je suis comme un funambule. » Un véritable funambule artistique qui avance d'un pas délicat et sûr, sans jamais s'arrêter de créer. À lire aussiDiasporas africaines en France: Dieudonné Mbeleg, un «Africain» à la tête de la prison de Nantes [2/5]
Diasporas africaines en France: Dieudonné Mbeleg, un «Africain» à la tête de la prison de Nantes [2/5]
Ce Franco-Camerounais de 56 ans dirige avec fermeté et humilité ce centre pénitentiaire de l'ouest de la France. (Rediffusion du 19/08/2025) Il s'appelle Dieudonné Mbeleg. Ce père de quatre enfants est né au Cameroun. À 56 ans, il pilote avec humanité et fermeté le centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) : quatre établissements répartis sur 11 hectares, 1 800 prisonniers et 600 personnels pénitentiaires. Une ville dans la ville. La maison d'arrêt, comme de nombreuses prisons en France, est surpeuplée. « Ils sont à quatre en cellule, les matelas à terre. Pour moi, c'est un véritable casse-tête, car avec 508 places pour près de 1 000 détenus, le taux d'occupation dépasse les 200 %, et ça devient intenable », explique le directeur. Au cœur de la maison d'arrêt D'un pas décidé, il traverse la cour centrale. « Ils ne nous ont pas encore repérés, lance-t-il en levant les yeux en direction des bâtiments, sinon ils auraient commencé à crier. » Au loin dans les bâtiments, les cellules des détenus. Derrière les barreaux, leurs silhouettes se dessinent. « Il faut bien l'accepter parce que lorsqu'on enferme des personnes dans un endroit comme celui-ci, on sait qu'ils vont réagir », poursuit Dieudonné Mbeleg. « Le matin, lorsque vous venez au travail, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, vous devez être joignable 24 heures sur 24 et être capable de décider dans l'urgence. Vous pouvez être conseillé, épaulé, soutenu… Mais c'est à vous de rassurer vos collaborateurs et de leur faire confiance », déclare le directeur. Issu d'une famille modeste « Mon parcours est à l'image de cette diaspora africaine : une fois arrivée en France, elle aspire tout simplement à réussir », explique-t-il dans un large sourire. Dieudonné Mbeleg va commencer son parcours universitaire au Cameroun. Ses études scientifiques l'amènent ensuite en France, où sa vie va connaître un nouveau départ. Après le concours à l'École nationale d'administration pénitentiaire, il va gravir progressivement tous les échelons : « J'ai pu accéder à de très hautes responsabilités sans jamais me dire : ''Est-ce que je pourrais y arriver ?''. Non, je ne me suis jamais posé ce type de question. J'ai eu des responsables qui m'ont fait confiance. Et moi, j'ai su saisir ces opportunités grâce au travail acharné, grâce aussi à la capacité de cette administration à pouvoir me donner ma chance. » Il démarre sa carrière au centre pénitentiaire de Borgo, en Corse, puis à Avignon-Le Pontet, dans le Vaucluse, où il va diriger un établissement carcéral de très haute sécurité. « Je n'étais pas prédestiné à pouvoir diriger de tels établissements », affirme Dieudonné Mbeleg. Et pourtant, depuis un an, c'est le cas, avec le centre pénitentiaire de Nantes. Extrêmement complexe puisque, éclaté, ce lieu nécessite en termes de pilotage « une véritable stratégie pour accomplir cette mission extrêmement noble », comme il aime à le dire. Et d'ajouter : « Je me sens aujourd'hui légitime. Comme je le dis toujours, je pense être à ma place, à ma juste place. » Toujours souriant, Dieudonné Mbeleg assume avec humilité et fierté le chemin qu'il a parcouru. À lire aussiDiasporas africaines en France: Mahi Traoré, Madame la proviseure [1/5]
Diasporas africaines en France: Mahi Traoré, Madame la proviseure [1/5]
Originaire du Mali, elle dirige depuis cinq ans un lycée professionnel où se perpétue un art séculaire : celui du verre et du vitrail. (Rediffusion du 18/08/2025) En septembre 2020, elle prend la direction du lycée Lucas de Nehou, une école professionnelle et publique du verre et du vitrail en Île-de-France. Elle, c'est Maïmouna N'Daw Traoré, une femme au caractère bien trempé qui sait d'où elle vient et où elle va. Cette Française née au Mali a fait ses études universitaires à la Sorbonne, et quelques années plus tard, c'est dans ce quartier latin qu'elle est de retour pour devenir proviseure. Un poste qu'elle occupe avec fierté. « J'ai toujours su que je serais un jour proviseure », affirme-t-elle. Maïmouna N'Daw, ou Mahi Traoré, son nom d'écrivaine, a un rire franc. Je suis noire mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme est son tout premier roman autobiographique. Et il en dit long aussi sur sa personnalité. « Si on veut savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on vient, et c'est pour cela que j'ai toujours voulu être aux commandes. Je suis exactement à la place que je voulais avoir et je suis à la bonne place », avoue-t-elle sans complexe. Enracinée à Paris depuis les années 1990, Mahi Traoré est donc aux commandes du lycée Lucas de Néhou, un établissement professionnel très particulier. Dans ces murs où se perpétue un art séculaire, celui du verre et du vitrail, on ne s'attendrait pas à y voir une Française d'origine malienne : « Moi, je m'attendais à tout de toute façon, parce que j'ai toujours voulu être proviseure, et j'ai toujours travaillé durement, ardemment pour pouvoir le devenir, explique Mahi Traoré. J'ai passé le concours de chef d'établissement trois fois. Je l'ai raté deux fois, mais ça a été deux échecs constructifs. Mais oui, j'ai toujours su que je serais un jour proviseure et à Paris, parce que c'était mon souhait, mon envie. C'est une nomination, on est beaucoup à candidater, et il faut être en capacité d'administrer à la fois une institution scolaire, publique, et républicaine. » À lire aussiLe Journal d'une proviseure de Lycée atypique Rien ne l'arrête. Alors, une Française d'origine malienne, proviseure, c'est donc possible ? Absolument. « Je suis Noire, donc il y a certaines choses que je ne m'autorise pas, qui ne sont pas possibles. Eh bien, moi, je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver », lance Maïmouna N'Daw Traoré. Et elle est prête à tout pour défendre cette école et ce patrimoine : « Je suis extrêmement opiniâtre. Je ne renonce jamais. Si on me dit non par la porte, je passe par la cave. Si on me dit non par la cave, je passe par la fenêtre. Si on me dit non par la fenêtre, je ferai un trou dans un mur. Je ne lâche jamais rien quand je suis convaincue de ce que je défends. Et moi, je me bats pour mon école, pour mes professeurs, pour mes parents d'élèves, mais encore une fois pour mes élèves, parce que c'est vraiment eux qui me donnent l'énergie. » Un état d'esprit qui a conquis les élèves prêts à s'engager comme elle. Rien n'arrête Madame la proviseure. Elle milite pour revaloriser l'enseignement professionnel en France. Au Mali, elle veut bâtir une école destinée aux jeunes filles – orphelines ou victimes de violences – pour les encourager à concrétiser leurs rêves. À lire aussiCrises multiples: quels impacts sur le bien être des filles et des femmes du Sahel?
Voyage musical dans les Amériques noires 5/5 : Le Brésil et ses racines africaines
durée : 00:10:42 - Les Nuits de France Culture - par : Antoine Dhulster - Suite et fin du voyage musical au cœur des Amériques noires. Pour sa dernière étape, Caroline Bourgine nous emmène au Brésil. Quel autre pays pourrait mieux représenter la vitalité, l'originalité de cultures en constante invention et réinvention depuis le traumatisme originel de l'esclavage ? - réalisation : Rafik Zénine
[Vos réactions] Coupe du monde 2026 : bon ou mauvais tirage pour les sélections africaines ?
Les groupes de la Coupe du monde sont connus. Le décor est planté pour les équipes africaines. Tirage clément ou mission compliquée ? Auditeurs et supporters africains, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous confiants ou inquiets ? On attend vos réactions au standard. Appelez-nous, exprimez-vous et décortiquons ensemble les poules de la prochaine Coupe du monde : +33 9 693 693 70. Réagissez dans les commentaires ou sur WhatsApp : +33 6 89 28 53 64.
Elle lit Lacan, mais pas seulement. Elle a fait Sciences Po et moult paniers de basket. Aby Gaye, c'est son nom. Belle, grande, basketteuse professionnelle : double-championne d'Europe jeune et vice-championne du monde avec l'équipe de France. Les médailles d'or, d'argent et de bronze, ça la connaît. Hey, Aby Gaye, ça va les chevilles ? Ben justement… les chevilles, c'est le point faible de celle qui ne fait pas que lire, qui ne fait pas que des podcasts («Être et athlète», c'est le titre) non. Aby Gaye est non seulement un corps, mais c'est aussi une conscience tournée vers la terre mère : heureuse fondatrice de l'association Terang'Aby, l'estime de soi des jeunes Africaines en général & Sénégalaises en particulier (qui forcent un peu sur la dépigmentation) ça l'intéresse. Bref, Mademoiselle Gaye, c'est une tête bien faite, sur un corps d'athlète. À consulter Terang'Aby. Programmation de l'invitée : • 113 - Les princes de la ville • Kokoroko - Ewa inu.
Elle lit Lacan, mais pas seulement. Elle a fait Sciences Po et moult paniers de basket. Aby Gaye, c'est son nom. Belle, grande, basketteuse professionnelle : double-championne d'Europe jeune et vice-championne du monde avec l'équipe de France. Les médailles d'or, d'argent et de bronze, ça la connaît. Hey, Aby Gaye, ça va les chevilles ? Ben justement… les chevilles, c'est le point faible de celle qui ne fait pas que lire, qui ne fait pas que des podcasts («Être et athlète», c'est le titre) non. Aby Gaye est non seulement un corps, mais c'est aussi une conscience tournée vers la terre mère : heureuse fondatrice de l'association Terang'Aby, l'estime de soi des jeunes Africaines en général & Sénégalaises en particulier (qui forcent un peu sur la dépigmentation) ça l'intéresse. Bref, Mademoiselle Gaye, c'est une tête bien faite, sur un corps d'athlète. À consulter Terang'Aby. Programmation de l'invitée : • 113 - Les princes de la ville • Kokoroko - Ewa inu.
Matches amicaux : deux nations africaines pour le Brésil
Au sommaire de Radio Foot internationale à 16h10-21h10 T.U. : - Après des nations asiatiques en octobre (et une défaite face au Japon), le Brésil affronte 2 sélections africaines. ; - Du pain et des jeux. L'Angola accueille les champions du monde argentins dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'indépendance. ; - Ils sont quatre, il n'en restera qu'un ! Nigeria/Gabon et RDC/Cameroun, 2 matches délocalisés à Rabat. - Veille de match pour la France (contre l'Ukraine) dans un contexte pesant. - Après des nations asiatiques en octobre (et une défaite face au Japon), le Brésil affronte 2 sélections africaines. Le Sénégal à Londres samedi, la Tunisie à Lille mardi. L'occasion de se régler, entre sélections déjà qualifiées, à quelques mois du tournoi mondial. Le dernier affrontement entre Seleção et Lions de la Teranga avait été remporté par ces derniers à Lisbonne (4-2). Que valent les Auriverdes d'Ancelotti ? Des 26 appelés, quels seront les 18 retenus au final, Neymar en fera-t-il partie ? Le «Ney» s'agaçe avec Santos, qui lutte pour le maintien. A-t-il passé son apogée ? - Du pain et des jeux. L'Angola accueille les champions du monde argentins dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'indépendance. Une affiche de gala plutôt onéreuse ! La presse évoque 12 millions d'euros dépensés par la fédération alors que le pays traverse une crise sociale. Messi sera du voyage mais temporise pour ce qui est du Mondial. Ils ne seront pas tous à Luanda pour affronter les Palancas Negras de Patrice Beaumelle. Molina, Montiel, G.Simeone, Mastantuono, Alvarez, Dibu Martinez ou encore Paredes forfaits. L'ex du PSG et de la Roma s'est adjugé le Superclásico avec Boca Juniors (2-0), dans une Bombonera bouillante où les Millonarios n'ont pas été inspirés. - Ils sont quatre, il n'en restera qu'un ! Nigeria/Gabon et RDC/Cameroun, 2 matches délocalisés à Rabat. Les 2 qualifiés se retrouveront dimanche, le vainqueur prendra un ticket pour... un autre barrage (intercontinental) en mars prochain. Quels favoris ? Les Super Eagles ont effectué une campagne de qualification poussive, le Cameroun a sous-performé dans le groupe D. Léopards et Panthères ont-ils les griffes plus acérées ? - Veille de match pour la France (contre l'Ukraine) dans un contexte pesant. Antoine grognet a rencontré Arnaud. Ce supporteur des Bleus se dit «impacté», pas victime. Jusqu'alors, son seul traumatisme s'appelait Séville 82. Présent au Stade de France avec ses 2 fils et des amis lors de France-Allemagne il y a 10 ans, il a vu l'allégresse du match basculer, lorsque Paris est devenu le théâtre des premiers attentats jihadistes. Avec Annie Gasnier, Éric Frosio (en direct du Brésil), Dominique Sévérac et Hervé Penot. -- Technique/réalisation : Laurent Salerno - David Fintzel/Pierre Guérin.
Matches amicaux : deux nations africaines pour le Brésil
Au sommaire de Radio Foot internationale à 16h10-21h10 T.U. : - Après des nations asiatiques en octobre (et une défaite face au Japon), le Brésil affronte 2 sélections africaines. ; - Du pain et des jeux. L'Angola accueille les champions du monde argentins dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'indépendance. ; - Ils sont quatre, il n'en restera qu'un ! Nigeria/Gabon et RDC/Cameroun, 2 matches délocalisés à Rabat. - Veille de match pour la France (contre l'Ukraine) dans un contexte pesant. - Après des nations asiatiques en octobre (et une défaite face au Japon), le Brésil affronte 2 sélections africaines. Le Sénégal à Londres samedi, la Tunisie à Lille mardi. L'occasion de se régler, entre sélections déjà qualifiées, à quelques mois du tournoi mondial. Le dernier affrontement entre Seleção et Lions de la Teranga avait été remporté par ces derniers à Lisbonne (4-2). Que valent les Auriverdes d'Ancelotti ? Des 26 appelés, quels seront les 18 retenus au final, Neymar en fera-t-il partie ? Le «Ney» s'agaçe avec Santos, qui lutte pour le maintien. A-t-il passé son apogée ? - Du pain et des jeux. L'Angola accueille les champions du monde argentins dans le cadre des festivités du cinquantenaire de l'indépendance. Une affiche de gala plutôt onéreuse ! La presse évoque 12 millions d'euros dépensés par la fédération alors que le pays traverse une crise sociale. Messi sera du voyage mais temporise pour ce qui est du Mondial. Ils ne seront pas tous à Luanda pour affronter les Palancas Negras de Patrice Beaumelle. Molina, Montiel, G.Simeone, Mastantuono, Alvarez, Dibu Martinez ou encore Paredes forfaits. L'ex du PSG et de la Roma s'est adjugé le Superclásico avec Boca Juniors (2-0), dans une Bombonera bouillante où les Millonarios n'ont pas été inspirés. - Ils sont quatre, il n'en restera qu'un ! Nigeria/Gabon et RDC/Cameroun, 2 matches délocalisés à Rabat. Les 2 qualifiés se retrouveront dimanche, le vainqueur prendra un ticket pour... un autre barrage (intercontinental) en mars prochain. Quels favoris ? Les Super Eagles ont effectué une campagne de qualification poussive, le Cameroun a sous-performé dans le groupe D. Léopards et Panthères ont-ils les griffes plus acérées ? - Veille de match pour la France (contre l'Ukraine) dans un contexte pesant. Antoine grognet a rencontré Arnaud. Ce supporteur des Bleus se dit «impacté», pas victime. Jusqu'alors, son seul traumatisme s'appelait Séville 82. Présent au Stade de France avec ses 2 fils et des amis lors de France-Allemagne il y a 10 ans, il a vu l'allégresse du match basculer, lorsque Paris est devenu le théâtre des premiers attentats jihadistes. Avec Annie Gasnier, Éric Frosio (en direct du Brésil), Dominique Sévérac et Hervé Penot. -- Technique/réalisation : Laurent Salerno - David Fintzel/Pierre Guérin.
Les racines africaines du maire de New York selon l'ancien ministre sénégalais Abdoulaye Bathily
Le nouveau maire de New-York, le démocrate anti-Trump Zohran Mamdani, n'est pas seulement de nationalité américaine. Il est aussi de nationalité ougandaise, car c'est à Kampala qu'il est né, il y a 34 ans. Et sa solidarité avec le peuple palestinien tient beaucoup à l'engagement de ses parents à la fois contre l'apartheid et pour la Palestine. Quel rôle ont joué son père et sa mère, Mahmood Mamdani et Mira Naïr, dans ses choix politiques d'aujourd'hui ? Abdoulaye Bathily est l'envoyé spécial du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour les affaires internationales. Il est ami avec la famille Mamdani depuis quarante ans. En ligne de Dakar, il témoigne au micro de Christophe Boisbouvier. RFI : Vous êtes un vieil ami de Mahmood Mamdani, le père de Zohran Mamdani, qui vient d'être élu à New York. Vous l'avez rencontré où, Mahmood Mamdani ? Abdoulaye Bathily : J'ai rencontré Mahmood Mamdani à Dar es Salam en 1979. Il était professeur au département de sciences politiques de l'Université de Dar es Salam, et il était à l'époque, comme beaucoup d'intellectuels ougandais, réfugié à Dar es Salam pour fuir la dictature de Idi Amin Dada qui, avec son slogan xénophobe, avait chassé tous les Asiatiques de l'Ouganda. Mais il avait aussi chassé tous les intellectuels, tous les opposants, militaires comme civils. Donc toute l'élite ougandaise s'est retrouvée à Dar es Salam. Il y avait également Yoweri Museveni, qui était étudiant là-bas, qui va par la suite former le Mouvement national de résistance contre la dictature de Idi Amin et qui va recruter des jeunes réfugiés rwandais comme Paul Kagame. Alors nous nous retrouvions souvent dans des espaces publics après les cours, après les conférences, pour discuter de l'avenir du continent, de la lutte contre l'apartheid, de la lutte contre le colonialisme. Et vous étiez tous des freedom fighters, contre l'apartheid ? Contre l'apartheid qui était soutenu à l'époque, il faut le rappeler, par Israël. Et on verra comment, en fait, le jeune Zohran, par la suite, suivra les traces de son père dans cette lutte pour le soutien à Gaza, le soutien à la Palestine. Alors, après la chute de Idi Amin Dada en 1979, Mahmood Mamdani peut rentrer en Ouganda. Et quand Mahmood Mamdani et Mira Naïr se marient et quand nait leur enfant, Zohran en 1991, la petite famille est toujours en Ouganda. Et le deuxième prénom que choisissent les parents pour leur enfant, c'est le prénom Kwame. Est-ce que c'est tout un symbole ? Mahmood Mamdani est un militant de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui un panafricaniste. Et pendant qu'il enseignait en Ouganda, il était régulièrement au Sénégal parce qu'il était membre actif du Conseil pour le développement de la recherche économique et sociale en Afrique, le Codesria. Il venait souvent à Dakar et d'ailleurs, en 2007, il est venu ici avec sa famille, avec le petit Zohran. Je me rappelle, ils sont venus ici à la maison. Et Zohran lui-même, il a vécu dans cette ambiance militante. Comme son prénom l'indique, puisque Kwame, c'est Kwame Nkrumah. Mais aussi Zohran a fait sa thèse sur Frantz Fanon et sur Jean-Jacques Rousseau. Donc vraiment, c'est le fils de son père. Quand Zohran nait à Kampala en 1991, sa maman, Mira Naïr, est déjà une personnalité très connue puisqu'elle a sorti « Salaam Bombay ! », un film à succès qui sera primé partout. Est-ce que Mira Naïr est aussi une femme aux convictions politiques ? Oui, elle a des convictions politiques affirmées. Je l'ai rencontrée plusieurs fois à Kampala, mais également à New York et ils sont venus ici à Dakar. Ils ont visité l'île de Gorée avec leur fils Zohran, et ils sont vraiment engagés à la fois pour les causes de l'Afrique, pour les causes de l'Asie, pour les causes de la Palestine et du monde progressiste en général. En 2018, Zohran Mamdani a été naturalisé citoyen américain et pour autant, il n'a pas abandonné sa nationalité ougandaise. Comment interprétez-vous cela ? Mahmood Mamdani, son père, est profondément attaché à l'Ouganda et à l'Afrique. Donc, cet attachement à l'Afrique, ce n'est pas quelque chose d'artificiel chez eux. Et puis leur foi musulmane également, c'est une donnée importante. C'est un couple de militants qui a donné naissance à un militant engagé pour les causes justes. Et aujourd'hui, est-ce que Mahmood Mamdani continue d'entretenir des relations avec des hommes politiques africains en dehors de vous-même ? Oui, Mahmood continue de parcourir le continent. Il est en contact avec tous nos amis d'il y a 50 ans. Donc c'est un internationaliste, Mahmood Mamdani. Et Zohran est né dans cette ambiance-là. Et est-ce que Mahmood Mamdani est toujours en contact avec Yoweri Museveni ? Oui je pense qu'ils sont en contact, mais peut-être leur chemin, en tout cas du point de vue des idées, ont divergé. Parce que malheureusement, nous avons vu que notre ancien camarade et ami Museveni aujourd'hui est au pouvoir depuis 1986, et ce n'est pas de notre goût.
Quel habitat durable dans les villes africaines face au réchauffement climatique ?
L'Afrique connaît une augmentation sans précédent de sa population urbaine. D'ici 2050, les villes du continent accueilleront 700 millions d'urbains supplémentaires pour atteindre 1,4 milliard d'habitants. Des populations qui auront donc besoin de logements et de services et des villes qui devront s'efforcer de développer leurs infrastructures. Dans le même temps, les conséquences du réchauffement climatique : inondations, sécheresse, pics de chaleur, érosion côtière sont déjà palpables sur le continent africain. L'enjeu de construire des villes aménagées en fonction des risques et un habitat durable adapté au climat, est d'autant plus crucial. Alors que l'urbanisation se fait de manière anarchique, que les populations manquent de moyens, que le secteur de la construction est dominé par le béton, matériau pas toujours adapté, quelles solutions pour les villes africaines ? Quels progrès ont déjà été accomplis par les municipalités ? Et comment appuyer les innovations en matière de construction ? Émission à l'occasion du Sommet Climate Chance Afrique 2025 qui se déroule du 27 au 29 octobre 2025 à Cotonou au Bénin. Avec : • Luc Setondji Atrokpo, maire de Cotonou et président de l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) • Luc Gnacadja, ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Bénin. Fondateur et président de GPS-Dev (Governance & Policies for Sustainable Development), un think tank dont la mission est de rendre les systèmes de gouvernance plus propices au développement durable, notamment en Afrique. Vice-président de l'association Climate Chance • Ahouefa Madiana Pognon, ingénieur conseil construction bioclimatique, associée au cabinet d'architecte Ko • Anne Attane, anthropologue à l'IRD (Institut de recherche pour le développement), spécialiste des dynamiques familiales et des économies domestiques tant en milieu rural qu'urbain ouest-africains, au sein du Laboratoire Environnement et Développement (LPED) à Marseille. En accueil au Bénin au sein du Laboratoire de recherches Socio-Anthropologiques sur les Systèmes Organisés et les Mobilités (LASMO) Programmation musicale : ► Je Gère - Ami Yerewolo ► Mom'lo siwaju - Star Feminine Band.
Quel habitat durable dans les villes africaines face au réchauffement climatique ?
L'Afrique connaît une augmentation sans précédent de sa population urbaine. D'ici 2050, les villes du continent accueilleront 700 millions d'urbains supplémentaires pour atteindre 1,4 milliard d'habitants. Des populations qui auront donc besoin de logements et de services et des villes qui devront s'efforcer de développer leurs infrastructures. Dans le même temps, les conséquences du réchauffement climatique : inondations, sécheresse, pics de chaleur, érosion côtière sont déjà palpables sur le continent africain. L'enjeu de construire des villes aménagées en fonction des risques et un habitat durable adapté au climat, est d'autant plus crucial. Alors que l'urbanisation se fait de manière anarchique, que les populations manquent de moyens, que le secteur de la construction est dominé par le béton, matériau pas toujours adapté, quelles solutions pour les villes africaines ? Quels progrès ont déjà été accomplis par les municipalités ? Et comment appuyer les innovations en matière de construction ? Émission à l'occasion du Sommet Climate Chance Afrique 2025 qui se déroule du 27 au 29 octobre 2025 à Cotonou au Bénin. Avec : • Luc Setondji Atrokpo, maire de Cotonou et président de l'Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) • Luc Gnacadja, ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme du Bénin. Fondateur et président de GPS-Dev (Governance & Policies for Sustainable Development), un think tank dont la mission est de rendre les systèmes de gouvernance plus propices au développement durable, notamment en Afrique. Vice-président de l'association Climate Chance • Ahouefa Madiana Pognon, ingénieur conseil construction bioclimatique, associée au cabinet d'architecte Ko • Anne Attane, anthropologue à l'IRD (Institut de recherche pour le développement), spécialiste des dynamiques familiales et des économies domestiques tant en milieu rural qu'urbain ouest-africains, au sein du Laboratoire Environnement et Développement (LPED) à Marseille. En accueil au Bénin au sein du Laboratoire de recherches Socio-Anthropologiques sur les Systèmes Organisés et les Mobilités (LASMO) Programmation musicale : ► Je Gère - Ami Yerewolo ► Mom'lo siwaju - Star Feminine Band.
Majagira Bulangalire, pasteur de l'Église pentecôtiste postcoloniale, entre la RDC et la France
Nous partons à la rencontre de Majagira Bulangalire, pasteur pentecôtiste de la République Démocratique du Congo, qui a passé une quarantaine d'années en France, en tissant des liens entre les communautés et les églises d'expression africaine dont il a créé la fédération en 1990. Il se définit lui-même comme un «Africain malgré tout et par-dessus tout». Intellectuel engagé sur le terrain, il a aussi contribué à établir des ponts entre la RDC et la France et à poser la question de la réappropriation africaine du christianisme, dans une lecture postcoloniale. En RDC, il est très engagé auprès des églises locales et dans l'éducation, où il a fondé l'Université évangélique à Bukavu et où il dirige l'Institut Supérieur Pédagogique. Nous l'avons rencontré à Paris alors qu'il repartait en RDC à Kiliba où se trouve l'église dont il est le pasteur, dans le Sud-Kivu, malgré le conflit armé dans l'est du pays qui frappe durement les populations de la région, alors qu'il a lui-même été victime d'un enlèvement avec sa femme en avril 2024. Invité : Le pasteur Espoir Majagira Bulangalire, professeur universitaire, directeur de l'Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu en République Démocratique du Congo, député honoraire du Sud-Kivu, ancien recteur et fondateur de l'Université Évangélique en Afrique, co-fondateur de la CEAF – Communauté des Églises d'expressions Africaines francophones -, pasteur de l'Église pentecôtiste de Kiliba (Sud-Kivu), auteur de plusieurs ouvrages dont les essais «Ai-je une place auprès de Toi ? Le cri désespéré d'un nègre converti» (2024) et «Du quotidien à l'extra-ordinaire, l'histoire mouvementée d'une vie protégée» (autobiographie) – Espoir Éditions.
5 pays africains : l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et São Tomé et Principe, commémorent cette année les 50 ans de leur indépendance. Les guerres coloniales se sont arrêtées avec la chute du régime autoritaire de Salazar en 74, et la révolution démocratique du 25 avril. Les guerres civiles et les soubresauts politiques des anciennes colonies poussent toujours hommes et femmes vers l'ancien pays colonisateur. (Rediffusion) Certains sont arrivés dans les années 70, d'autres bien plus tard, et d'autres encore sont nés au Portugal. Ils y vivent entre indépendance, intégration, nostalgie et conviction. «Portugal : les déracinés des indépendances africaines», un Grand reportage de Marie-Line Darcy.
Guewel : au croisement des cultures africaines et australiennes selon Lamine et Awa Sonko
À la veille de la première de « Guewel » à Melbourne, Lamine et Awa Sonko, frère et sœur complices, nous livrent les clés de ce spectacle-rite qui puise dans la mémoire ancestrale des griots pour relier le passé au présent et tisser des liens culturels entre le Sénégal et l'Australie.
Quelle participation des habitants dans la gestion des problématiques des villes africaines ?
Gestion des déchets, manque d'infrastructures d'assainissement, d'accès à l'eau, inondations récurrentes, îlot de chaleur... Les villes du continent africain sont confrontées à des problèmes récurrents qui sont amenés à se multiplier alors que le rythme de l'urbanisation en Afrique est le plus rapide au monde. Selon les prévisions, le nombre d'urbains devrait doubler d'ici 2050 en Afrique pour passer à 1,4 milliard. À cette hausse de population difficile à absorber pour les villes, s'ajoutent la prise en compte des pratiques informelles, des spécificités locales, ou encore le manque de moyens. Dans ces conditions, la mise en place de projets d'infrastructures et d'aménagements pour répondre aux besoins de la population peut relever du casse-tête pour les pouvoirs publics. Les habitants ont parfois l'impression de ne pas être écoutés et considérés. Comment mettre en œuvre de nouveaux équipements qui prennent en compte les vrais besoins et les modes de vie des usagers ? Sous quelle forme intégrer les habitants aux projets de leur ville ? Avec : • Audrey Guiral Naepels, urbaniste, responsable de la division Développement urbain, Aménagement et Logement de l'AFD (Agence Française de Développement) • Charlemagne Yankoty, maire de la commune de Porto Novo au Bénin • Rina Andriambololomanana , cheffe de projet «pépinière urbaine» d'Antananarivo, au Gret (ONG internationale de développement social et solidaire) à Madagascar. En fin d'émission, un reportage au Tchad de Raphaëlle Constant. L'Académie de basket ball «Dreams Comes True» («le rêve devient réalité» en français) à Ndjamena a été fondée en 2020, c'est une école mixte et moderne qui forme les enfants à partir de 5 ans et où l'accent est mis sur la réussite scolaire en parallèle de la formation sportive. Ils sont aujourd'hui 178 pensionnaires, dont 51% de filles, encadrés par 12 coachs. Notre reporter Raphaëlle Constant a assisté à un entraînement et a rencontré les fondateurs Issa Nakoye, président exécutif et Alain Assnale, directeur technique, tous deux anciens joueurs de l'équipe nationale. Direction le Lycée Sacré-cœur dans le quartier Moursal où, ce jour-là, une quarantaine d'enfants de la catégorie minime traversent le terrain sous les consignes du coach Alladoum Klamong. Programmation musicale : ► Magique – Oxmo Puccino ► Robocop – Article15.
Quelle participation des habitants dans la gestion des problématiques des villes africaines ?
Gestion des déchets, manque d'infrastructures d'assainissement, d'accès à l'eau, inondations récurrentes, îlot de chaleur... Les villes du continent africain sont confrontées à des problèmes récurrents qui sont amenés à se multiplier alors que le rythme de l'urbanisation en Afrique est le plus rapide au monde. Selon les prévisions, le nombre d'urbains devrait doubler d'ici 2050 en Afrique pour passer à 1,4 milliard. À cette hausse de population difficile à absorber pour les villes, s'ajoutent la prise en compte des pratiques informelles, des spécificités locales, ou encore le manque de moyens. Dans ces conditions, la mise en place de projets d'infrastructures et d'aménagements pour répondre aux besoins de la population peut relever du casse-tête pour les pouvoirs publics. Les habitants ont parfois l'impression de ne pas être écoutés et considérés. Comment mettre en œuvre de nouveaux équipements qui prennent en compte les vrais besoins et les modes de vie des usagers ? Sous quelle forme intégrer les habitants aux projets de leur ville ? Avec : • Audrey Guiral Naepels, urbaniste, responsable de la division Développement urbain, Aménagement et Logement de l'AFD (Agence Française de Développement) • Charlemagne Yankoty, maire de la commune de Porto Novo au Bénin • Rina Andriambololomanana , cheffe de projet «pépinière urbaine» d'Antananarivo, au Gret (ONG internationale de développement social et solidaire) à Madagascar. En fin d'émission, un reportage au Tchad de Raphaëlle Constant. L'Académie de basket ball «Dreams Comes True» («le rêve devient réalité» en français) à Ndjamena a été fondée en 2020, c'est une école mixte et moderne qui forme les enfants à partir de 5 ans et où l'accent est mis sur la réussite scolaire en parallèle de la formation sportive. Ils sont aujourd'hui 178 pensionnaires, dont 51% de filles, encadrés par 12 coachs. Notre reporter Raphaëlle Constant a assisté à un entraînement et a rencontré les fondateurs Issa Nakoye, président exécutif et Alain Assnale, directeur technique, tous deux anciens joueurs de l'équipe nationale. Direction le Lycée Sacré-cœur dans le quartier Moursal où, ce jour-là, une quarantaine d'enfants de la catégorie minime traversent le terrain sous les consignes du coach Alladoum Klamong. Programmation musicale : ► Magique – Oxmo Puccino ► Robocop – Article15.
5 pays africains : l'Angola, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Mozambique et São Tomé et Principe, commémorent cette année les 50 ans de leur indépendance. Les guerres coloniales se sont arrêtées avec la chute du régime autoritaire de Salazar en 74, et la révolution démocratique du 25 avril. Les guerres civiles et les soubresauts politiques des anciennes colonies poussent toujours hommes et femmes vers l'ancien pays colonisateur. Certains sont arrivés dans les années 70, d'autres bien plus tard, et d'autres encore sont nés au Portugal. Ils y vivent entre indépendance, intégration, nostalgie et conviction. «Portugal : les déracinés des indépendances africaines», un Grand reportage de Marie-Line Darcy.
La Russie recrute des jeunes femmes africaines pour fabriquer des drones kamikazes
Ecoutez RTL Matin avec Thomas Sotto du 28 août 2025.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Comment promouvoir l'agriculture urbaine pour nourrir les villes africaines ?
Le continent africain connaît les taux d'urbanisation les plus rapides au monde. À l'horizon 2050, ses zones urbaines devraient accueillir 950 millions d'habitants supplémentaires, selon Africapolis, une base de données recensant les dynamiques d'urbanisation du continent. (Rediffusion) Une progression et des enjeux en conséquence avec, en premier lieu, celui de l'alimentation. À mesure que le besoin en habitations et infrastructures grandit, la pression sur le foncier s'accélère au détriment des jardins partagés et des potagers qui jouent pourtant un rôle essentiel pour les villes et leurs périphéries. À la fois source de nourriture, d'emploi, de lien social et d'îlot de fraîcheur, l'agriculture urbaine est pourtant délaissée des politiques publiques. Comment valoriser le maraichage au coeur des villes ? Quelles sont les innovations innovantes sur lesquelles s'appuyer ? Avec : • Christine Aubry, directrice de la Chaire agriculture urbaine à Agro Paris Tech, et co-directrice des ouvrages Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar (Presses universitaires du Midi, 2023) et Agriculture urbaine et biodiversités - Vers une ville verte et agroécologique (Apogée, 2025) • Moctar Diouf, géographe, chercheur associé au Laboratoire Pléiade. Chargé d'enseignement à l'Université Sorbonne Paris Nord et membre de AgriTakhh, (Takhh est un terme wolof qui signifie ville) une communauté qui regroupe l'ensemble des acteurs.trices de l'agriculture urbaine et péri-urbaine dans les Suds • Jean-François Kacou Aka, spécialiste de la bioéconomie circulaire. Point focal du programme «Villes Vertes» de l'Institut de l'Économie circulaire d'Abidjan (IECA). En fin d'émission, la chronique Voisins connectés d'Estelle Ndjandjo, sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, les réseaux sociaux et la technologie. Elle revient sur le cyberharcèlement dont a été victime la chanteuse sud-africaine Tyla. Cette émission est une rediffusion du 17 mars 2025 Programmation musicale : ► Update – Burna Boy ► Baby Lova – Naza.
Comment promouvoir l'agriculture urbaine pour nourrir les villes africaines ?
Le continent africain connaît les taux d'urbanisation les plus rapides au monde. À l'horizon 2050, ses zones urbaines devraient accueillir 950 millions d'habitants supplémentaires, selon Africapolis, une base de données recensant les dynamiques d'urbanisation du continent. (Rediffusion) Une progression et des enjeux en conséquence avec, en premier lieu, celui de l'alimentation. À mesure que le besoin en habitations et infrastructures grandit, la pression sur le foncier s'accélère au détriment des jardins partagés et des potagers qui jouent pourtant un rôle essentiel pour les villes et leurs périphéries. À la fois source de nourriture, d'emploi, de lien social et d'îlot de fraîcheur, l'agriculture urbaine est pourtant délaissée des politiques publiques. Comment valoriser le maraichage au coeur des villes ? Quelles sont les innovations innovantes sur lesquelles s'appuyer ? Avec : • Christine Aubry, directrice de la Chaire agriculture urbaine à Agro Paris Tech, et co-directrice des ouvrages Agricultures urbaines en Afrique subsaharienne francophone et à Madagascar (Presses universitaires du Midi, 2023) et Agriculture urbaine et biodiversités - Vers une ville verte et agroécologique (Apogée, 2025) • Moctar Diouf, géographe, chercheur associé au Laboratoire Pléiade. Chargé d'enseignement à l'Université Sorbonne Paris Nord et membre de AgriTakhh, (Takhh est un terme wolof qui signifie ville) une communauté qui regroupe l'ensemble des acteurs.trices de l'agriculture urbaine et péri-urbaine dans les Suds • Jean-François Kacou Aka, spécialiste de la bioéconomie circulaire. Point focal du programme «Villes Vertes» de l'Institut de l'Économie circulaire d'Abidjan (IECA). En fin d'émission, la chronique Voisins connectés d'Estelle Ndjandjo, sur l'évolution des sociétés africaines mondialisées à travers les écrans, les réseaux sociaux et la technologie. Elle revient sur le cyberharcèlement dont a été victime la chanteuse sud-africaine Tyla. Cette émission est une rediffusion du 17 mars 2025 Programmation musicale : ► Update – Burna Boy ► Baby Lova – Naza.
Les accords qui ont changé le monde : La fin des accords de défense entre la France et ses ex-colonies africaines
durée : 00:58:45 - Ils ont changé le monde - par : Isabelle Lasserre - Depuis 2022, l'essentiel des anciennes colonies françaises en Afrique ont rompu les accords de défense qui les liaient encore à la France, entraînant le retrait des forces armées du continent. Comment expliquer ce désaveu, et quelles en sont les conséquences pour la région comme pour l'Europe ? - réalisation : Laure-Hélène Planchet - invités : Antoine Glaser Journaliste, écrivain, fondateur de La Lettre du Continent, spécialiste de l'Afrique; Olivier de Bavinchove Général, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'Otan
Les accords qui ont changé le monde : La fin des accords de défense entre la France et ses ex-colonies africaines
durée : 00:58:45 - Ils ont changé le monde - par : Isabelle Lasserre - Depuis 2022, l'essentiel des anciennes colonies françaises en Afrique ont rompu les accords de défense qui les liaient encore à la France, entraînant le retrait des forces armées du continent. Comment expliquer ce désaveu, et quelles en sont les conséquences pour la région comme pour l'Europe ? - réalisation : Laure-Hélène Planchet - invités : Antoine Glaser Journaliste, écrivain, fondateur de La Lettre du Continent, spécialiste de l'Afrique; Olivier de Bavinchove Général, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'Otan
Les accords qui ont changé le monde : La fin des accords de défense entre la France et ses ex-colonies africaines
durée : 00:58:45 - Ils ont changé le monde - par : Isabelle Lasserre - Depuis 2022, l'essentiel des anciennes colonies françaises en Afrique ont rompu les accords de défense qui les liaient encore à la France, entraînant le retrait des forces armées du continent. Comment expliquer ce désaveu, et quelles en sont les conséquences pour la région comme pour l'Europe ? - réalisation : Laure-Hélène Planchet - invités : Antoine Glaser Journaliste, écrivain, fondateur de La Lettre du Continent, spécialiste de l'Afrique; Olivier de Bavinchove Général, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'Otan
"Acquis selon des modalités inconnues" : les musées français face à l'histoire coloniale de leurs collections africaines
durée : 00:04:41 - Le Zoom de France Inter - L'Assemblée a adopté lundi à l'unanimité une loi permettant la restitution à la Côte d'Ivoire d'un instrument sacré, le tambour parleur Djidji Ayôkwé, un objet volé par la France il y a plus d'un siècle et réclamé par Abidjan depuis six ans. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Si l'essor du numérique sur le continent africain a permis à de nombreuses personnes de s'exprimer, de partager leurs idées, de débattre, il a aussi ouvert un nouvel espace virtuel bien moins positif. Moqueries sur le physique, images diffusées sans consentement, commentaires haineux qui tournent à l'insulte voire aux menaces. Le harcèlement en ligne peut prendre différentes formes et transformer la vie virtuelle et réelle de la personne qui le subit, en cauchemar. Confrontées aux injonctions sociales, aux traditions, aux stéréotypes de genre auxquels, elles font face, les femmes sont particulièrement vulnérables en ligne. Selon une enquête de 2020 menée par l'Unesco sur la violence en ligne à l'encontre des femmes dans 15 pays du continent africain, 73% des femmes journalistes ayant participé à l'enquête avaient subi des violences sur internet. Comment assurer un espace d'expression sûr en ligne ? Quelle responsabilité des plateformes et quelles sanctions pour les harceleurs du net ? Avec : • Ache Ahmat Moustapha, sociologue, réalisatrice du documentaire Harcèlement 2.0 : résilience des Africaines connectées • Aisha Dabo, coordinatrice de projets chez AfricTivistes, organisation panafricaine de la société civile, basée à Dakar au Sénégal, qui œuvre à la promotion et à la défense des valeurs démocratiques, des droits humains et de la bonne gouvernance par le biais du numérique. Programmation musicale : ► Carnet secret - Pi Ja Ma ► Dâmba Kéle - Siraba.
Selon la Plateforme Africaine des Villes Propres, 90% des déchets produits en Afrique sont déversés dans des décharges non contrôlées à ciel ouvert et souvent brûlés. 19 des 50 plus grandes décharges du monde se situent en Afrique subsaharienne qui pourrait devenir la région la plus productrice de déchets. En cause : la forte croissance démographique, l'urbanisation galopante et l'évolution des habitudes de consommation avec l'importation de produits plastiques. Alors que la gestion des déchets ménagers est un enjeu sanitaire, économique et environnemental majeur pour les villes africaines, comment renforcer le traitement des déchets, notamment dans les zones où les services sont encore peu structurés, voire inexistants ? Quel rôle pour les pouvoirs publics, les entreprises et le secteur informel ? Avec :• Matthieu Le Corre, responsable du département Services essentiels et ressources naturelles du GRET, ONG internationale de développement social et solidaire• Jean-Claude Muissa, directeur général de la Régie de Gestion des déchets de Kinshasa (REGEDEK).Le portrait de Mariam Keita, fondatrice de Binedou, transforme les déchets plastiques en pavés et en briques. Raphaëlle Constant l'a rencontrée à Conakry. Portrait d'une entrepreneure guinéenne, lauréate de l'édition 2019 de la compétition « Women In Africa Initiative » : Mariam Mohamed Keita, 32 ans et mère de 4 enfants, est la fondatrice de BGS Recyplast, une entreprise spécialisée dans la récupération et le recyclage des déchets plastiques. Avec son équipe de 10 personnes, elle s'attèle à transformer les déchets de sa ville en pavés dans son entrepôt basé à Coyah. Programmation musicale :► Parioca - Seu Jorge, M (11"-2'49) ► Wa Wa Wa - ADB x Yujio.
Communautés de pêcheurs ouest-africaines, menace sur la ressource
Toute cette semaine, la ville de Nice dans le sud de la France accueille la troisième conférence des Nations unies sur l'océan. L'océan, qui occupe 70 % de notre planète, est sous pression du changement climatique et malmené par l'activité humaine. Au point, parfois, de ne plus offrir aux populations des littoraux les ressources nécessaires. C'est le cas en Afrique de l'Ouest, où les communautés de pêcheurs ont été très fragilisées ces dernières années. Plusieurs reporters de RFI sont allés à leur rencontre en Guinée, en Sierra Leone, au Ghana et au Sénégal. La lourde embarcation, poussée, tirée, glisse sur cette plage. Les cris des pêcheurs en plein effort percent le grondement des vagues. Les pirogues qui partent et reviennent ont cousu ensemble, au fil des siècles, l'histoire de la communauté Lébou et l'océan. L'océan est tellement au cœur de la vie Lébou qu'une confrérie soufie, tournée vers les flots, est née ici : les Layènes.Yoff. Une commune de Dakar, Sénégal. Le vendredi, un haut-parleur diffuse dans les rues, à 100 mètres de la plage, la prière du vendredi. Face à l'océan, Seydina Diop, un érudit layène, évoque l'histoire du fondateur de la confrérie, Seydina Limamou Laye (1843-1909). Et son lien avec la mer. « C'est, explique-t-il, comme si l'océan avait signé un pacte avec Seydina Limamou Laye et sa famille. Tôt après la prière du matin, il s'est dirigé vers la mer en compagnie de ceux qui priaient derrière lui. Arrivé à la mer, il lui intime l'ordre de reculer. Et la mer recule comme une natte sur plusieurs dizaines de mètres. Il a dit, "j'espère que ça suffit ici pour installer ma maison ici". Et s'adressant à ses compagnons : "Vous, vous ne me connaissez pas, mais la mer me connaît, connaît ma dimension et respectera mes ordres". » Depuis l'époque du fondateur, les vagues ont épargné le sanctuaire Layène. Mais Seydina Diop en convient, ailleurs dans le pays, l'océan n'est plus tout à fait le même. « C'est comme si effectivement la mer était en colère. Cette côte va passer par le village de Kayar, une zone poissonneuse, et les gens sont très inquiets. Vous continuez à Thiaroye c'est la même situation, vous continuez à Mbao c'est la même situation. Donc pourquoi ? »De plus en plus loin pour trouver du poissonKayar, aux eaux réputées poissonneuses… Le quai de pêche est bondé de monde, mais la localité, située à une soixantaine de kilomètres de Dakar, se nourrit de plus en plus difficilement de l'océan. Les sécheuses de poisson se plaignent d'attendre de plus en plus longtemps l'arrivée de la matière première : « Comme vous le voyez, nous sommes assises ici à discuter, explique l'une d'elles, Khoudia Touré, installée sous un parasol. Cela veut dire qu'il n'y a pas de poissons ; il arrive parfois que nous passons des journées entières sans aucune activité parce qu'il n'y a pas de poisson, alors que c'est notre matière première et qu'on a des commandes à honorer. Quand les pêcheurs partent en mer, ils restent plusieurs jours d'affilée, car il n'y plus rien. »À lire aussiDix choses à savoir sur la surpêche, fléau des océans au fil des sièclesLes conséquences se font également sentir au Ghana, à Tema, le plus gros marché de pêche artisanale du pays. Une femme, vendeuse depuis 28 ans, regrette les bacs de poisson qu'elle vendait par le passé : « Quand j'ai commencé à travailler, dit-elle, les revenus étaient bons, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. On ne reçoit plus beaucoup de poissons. Quand on recevait beaucoup de poissons, nous avions de l'argent pour mettre nos enfants à l'école. Maintenant, vu que les pêcheurs n'en ramènent plus, nous n'avons plus grand-chose à vendre. Nous n'avons plus d'argent, nous sommes fatigués. »Même chose en Sierra Leone. Tombo, à une cinquantaine de la capitale, Freetown, était autrefois un port de pêche prospère. La ville est aujourd'hui en déclin. Les pêcheurs y sont de plus en plus nombreux, les poissons de plus en plus rares, et les conditions de travail de plus en plus difficiles. « Nous avons beaucoup de soucis aujourd'hui, confie Chernor Bah, le capitaine du port de Tombo. Mais surtout, il n'y a plus de poisson et nous avons du mal à survivre. Maintenant, pour trouver du poisson, on est obligé de brûler beaucoup d'essence. On part tôt le matin, mais ce n'est pas avant 10 heures ou 11 heures qu'on arrive à trouver un endroit avec du poisson... Autrefois, on dépensait peut-être 20 litres, 30 litres d'essence pour aller attraper du poisson... C'était possible de faire des affaires. Mais aujourd'hui, il faut peut-être utiliser 100 litres... 150 litres de carburant pour arriver au même résultat. » La raréfaction du poisson menace, selon certaines études, la sécurité alimentaire de la Sierra Leone. Les produits de la mer représentent en effet 80 % des apports en protéines dans le pays.Toute la région est concernée par l'épuisement de la ressource. Boulbinet est l'un des principaux ports de pêche artisanale de Conakry, la capitale guinéenne. Les prises sont versées à même le sol, sur des bâches tendues sur la digue. Les pêcheurs guinéens doivent, eux aussi, aller de plus en plus loin. Prendre de plus en plus de risques pour trouver le poisson. « Vous savez que cette pêche-là, ça représente un danger, indique Abdoulaye Camara, membre de l'Union des pêcheurs artisanaux, parce que, vous savez, la mer a sa façon de faire. Même le temps où il n'y a pas de pluie, la mer peut s'agiter elle-même. Au fur et à mesure que l'embarcation va très loin, c'est là qu'elle se retrouve en danger. Parce que la mer, c'est la mer. Cette méthode d'aller pêcher loin, c'est pas parce qu'ils veulent aller loin, mais le poisson est un peu éloigné maintenant. »Soumah Seny, alias « Tozo », a une cinquantaine d'années. Il est responsable de l'association des doradiers de Boulbinet. Avec la chute des prises, il explique que de nombreux pêcheurs connaissent une situation financière difficile : « Si vous sortez faire quatre à cinq, six jours, sixième jour vous rentrez. Si vous enlevez la dépense, tu peux te retrouver avec 50 000 dans ta main. Ça permet difficilement de pourvoir aux dépenses de la maison ! Les pêcheurs ne gagnent pas beaucoup d'argent. On peut faire un an sans acheter de viande, parce qu'on n'a pas d'argent pour en acheter. Le prix d'un sac de riz, quand tu reviens de la mer, des fois, tu ne peux même pas gagner ça. » À lire aussiConférence de l'ONU sur l'océan 2025 : l'Afrique particulièrement concernée par ses enjeuxEffondrement de la ressourceCette raréfaction de la ressource, constatée en mer par les pêcheurs, a été documentée par des recherches de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. « On a étudié un peu les quantités débarquées dans chaque pays au fil des années, explique Timothée Brochiet, chercheur à l'IRD. On s'est rendus compte que pour le Sénégal, les quantités maximales qui ont été débarquées étaient tombées en 2011. Et on s'est rendus compte qu'à partir de 2019, on tombe en dessous de 10 % de cette quantité-là. Et selon une définition qui a été donnée en halieutique, on peut parler d'un stock "écroulé" quand, après quatre années d'affilée, les quantités débarquées sont inférieures à 10 % du maximum. » La situation est à ce point alarmante qu'une mobilisation se met en place pour propager la voix des communautés menacées.Ce jour-là, à Ngor au Sénégal, il s'agit de faire entendre le cœur de l'océan aux jeunes générations, grâce à un enregistrement sous-marin, réalisé avec un hydrophone. Fabrice Monteiro, photographe engagé, participe ce jour-là à l'animation. « Ça m'évoque le pouls de la planète, qu'on partage tous un monde commun et que même sous l'eau, il y a toute une vie, il y a des échanges, il y a des tas de choses auxquelles on pense pas parce qu'on nous a expliqué qu'on pouvait disposer de tout et que finalement la vie comptait pour très peu si ce n'est la nôtre. » Pour cet artiste, l'humanité doit « changer de logiciel ». Et le photographe dit vouloir utiliser ses images pour participer à cette conversation.Comment expliquer ces difficultés croissantes à trouver du poisson ? Les pêcheurs artisanaux mettent régulièrement en cause la pêche industrielle. Une critique partagée par le chercheur sierra-léonais Salieu Kabba Sankho : « Quand nous avons commencé la lutte contre la pêche illégale, de nombreux navires sont venus s'enregistrer. Mais cela a fait augmenter de manière conséquente le nombre de bateaux de pêche industriels. Ces navires achètent un permis qui correspond à la taille du bateau, pas au nombre de poissons qu'ils pêchent. Cela va peut-être couter 15 ou 20 000 euros par an, pour un permis qui permet de pêcher 365 jours sur une année et autant de poissons que vous pouvez en attraper. C'est comme un chèque en blanc pour les industriels. Il y a un gros risque de surpêche et d'effondrement des réserves de poissons. »À lire aussiConférence sur l'Océan : « L'Afrique s'attend à » avoir « plus de poids dans la discussion », dit Foga AgbetossouTrop de bateaux de pêche ?Mais le problème semble aller au-delà de la pêche industrielle : trop de bateaux cherchent désormais à puiser les ressources de l'océan. Cette surexploitation a conduit à une véritable bataille du poisson entre pêcheurs industriels et artisanaux, mais aussi entre pêcheurs artisanaux de nationalités différentes. « Les pêcheurs industriels, comme les pêcheurs artisanaux, sont coresponsables de la baisse des réserves de poissons, indique Thomas Turay, le président d'un syndicat de pêcheurs sierra-léonais qui essaie de promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'océan. Il y a vingt ans, ici même, dans ce bureau, on avait 75 000 pêcheurs enregistrés et maintenant, on compte 150 000 personnes qui dépendent de la pêche... Il y a beaucoup de chômage, donc les gens viennent ici pour devenir pêcheurs. La fermeture des mines a aussi joué un rôle. Avant, on voyait des "mango fish", c'est-à-dire des espèces de poissons qui apparaissaient au début de la saison des mangues, qui précède la saison des pluies. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est quand il pleut seulement qu'on comprend que c'est le début de la saison des pluies. »Dans ce contexte de compétition, les règles sont de moins en moins respectées. « Il y a le problème des chalutiers, poursuit Thomas Turay, qui viennent pêcher jusque dans la Zone d'exclusion côtière, qui nous est réservée, plutôt que d'aller au large, dans la Zone économique exclusive où ils sont autorisés à pêcher. Et puis, il y a des braconniers ! Et notre marine n'est pas équipée pour surveiller la mer pendant toute une journée. Donc, dès que la marine s'en va, les braconniers viennent depuis la Guinée ou le Sénégal. À cela s'ajoute la corruption. Des étrangers viennent et enregistrent leurs bateaux comme s'ils étaient des Sierra-Léonais. Ils paient une commission, c'est tout. »À cette compétition pour la ressource s'ajoute le dérèglement climatique, qui provoque le réchauffement des océans. Ces changements de températures provoquent la migration de certaines espèces vers des eaux plus froides. Le chercheur ghanéen John Kusimi, professeur associé de géographie physique au département de géographie et développement des ressources à l'Université du Ghana, a travaillé sur le phénomène. « Au cours des dernières décennies, indique-t-il, la température à la surface de la mer dans le golfe de Guinée a augmenté de 0,2 à 0,4 degré Celsius. Cette augmentation de la température a poussé les petits poissons pélagiques, ceux que pêchent les pêcheurs artisanaux, à migrer des eaux tropicales vers des mers plus tempérées, où l'eau est plus froide. Cela a également eu pour effet de pousser ces poissons, qui ont le sang-froid, à plonger dans les profondeurs des mers tropicales pour réguler leur chaleur corporelle, les rendant souvent inaccessibles aux pêcheurs traditionnels. Donc tout cela, en ajoutant d'autres facteurs humains, a provoqué un déclin de 60 à 80 % de la population de poissons pélagiques depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. »Un phénomène chimique menace également la biodiversité de l'océan : son acidification, le fait que sa composition chimique devienne de plus en plus acide. Les premières mesures ont été faites au large des côtes californiennes, mais le professeur Malick Diouf, de biologie animale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, craint que le phénomène n'en vienne à se répandre : « S'il y a acidité, ça veut dire que tous ceux qui ont une coquille calcaire ont leur vie qui va être hypothéquée, parce que le calcaire est attaqué par l'acide. Et si on regarde les animaux qui ont un test calcaire, aussi bien unicellulaires que pluricellulaires, il y en a des masses. On va vers une perte drastique de la biodiversité. »À écouter aussiSommet des océans à Nice : l'acidification de l'eau menace la biodiversité marineMieux contrôler qui pêche quoiQue faire face à l'effondrement en cours et aux menaces futures ? Depuis ses bureaux de Dakar, l'ONG Greenpeace appelle les autorités à mieux contrôler qui pêche quoi… Le Dr Aliou Ba est responsable de la campagne « Océans » pour Greenpeace Afrique. « La majeure partie de nos pêcheries sont en situation d'accès libre. L'accès libre conduit à la surpêche, à la surexploitation des ressources. Donc, pour parer à cela, il faudrait que l'on contrôle la capacité de pêche dans ces pêcheries, mais aussi accentuer la surveillance pour baisser vraiment ce qu'on appelle la pêche INLA. » Greenpeace essaie aussi d'obtenir une régulation des usines de farine de poisson qui sont à terre et qui sont en concurrence avec le marché local.Reprendre le contrôle ? Les gouvernements de la région disent qu'ils ne cherchent pas autre chose. Le ministère des Ressources maritimes et de la Pêche sierra-léonais est installé au Youyi building, le grand immeuble gouvernemental de la capitale, Freetown. Sheku Sei reçoit à la sortie d'un entretien avec la ministre. Il est responsable de l'aquaculture et de la pêche artisanale au ministère : « Nous avons en tant que pays commencé à mettre en place un système de "saison fermée", durant laquelle les pêcheurs artisanaux ne peuvent plus aller en mer – et au mois d'avril, nous faisons la même chose pour la pêche industrielle. L'idée, c'est qu'il y ait une période de repos biologique pour que les poissons puissent grossir et que la population cesse de décliner, comme ça, on aura plus de poissons dans nos eaux et on pourra produire plus de nourriture. Car un des objectifs, c'est de garantir la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc, la fermeture saisonnière de la pêche, les aires marines protégées, mais aussi, nous aimerions avoir plus de fonds pour opérer des patrouilles de surveillance de nos côtes. Donc, nous allons prendre des contacts pendant la conférence de Nice. Nous allons aussi voir si l'on peut améliorer notre système de surveillance à distance, le moderniser, pour pouvoir suivre les opérations des navires en mer, sans avoir à nous déplacer. »À écouter aussiPourquoi les forêts de mangrove sont importantes pour la biodiversité ? Certaines solutions dorment également aux portes de l'océan, dans ces zones charnière que constituent les mangroves. Malmenées par les exploitants miniers, surexploitées par les communautés locales, elles sont pourtant essentielles. En Guinée, des associations s'activent pour les défendre, comme Guinée écologie. Aboubacar Soumah, l'un de ses cadres, guide le visiteur sur un débarcadère de Dubreka. Ici, les communautés pratiquent la pêche artisanale, mais également la riziculture, et elles mènent des activités de reboisement de la mangrove.Aboubacar Soumah longe la digue d'une aire de riziculture abandonnée. À gauche, des terres en friche. À droite, les terres en cours de restauration. Les jeunes pousses de mangrove pointent déjà vers le ciel et le militant écologiste espère que, d'ici à quelques années, cet espace redeviendra propice pour la reproduction des poissons. À marée basse, l'eau s'engouffre dans un petit chenal. Quand la marée monte, l'océan inonde la mangrove et emmène avec lui les poissons, qui y trouvent un milieu favorable pour se reproduire. « Restaurer la mangrove, dit Aboubacar Soumah, ça a beaucoup d'avantages. C'est un espace vital pour les poissons juvéniles. C'est dans ces milieux, dans les zones de mangrove, les zones ombragées, que les gros poissons viennent pondre les œufs. C'est dans cet espace aussi que les juvéniles grandissent jusqu'à atteindre un certain stade de maturité avant de migrer en mer. »Les mangroves grouillent encore de vie, de crabes et d'insectes, dans des sols riches de nutriments et de minéraux charriés depuis l'amont, un écosystème fixé par les racines des palétuviers. Les mangroves sont de véritables incubateurs de vie marine. Leur restauration, explique Aboubacar Soumah, est indispensable pour protéger l'avenir des communautés de pêcheurs.À écouter aussiEn Gambie, des pêcheurs dans une mauvaise passe
Musiques africaines, une histoire parisienne 1/4 : Barbes Cafés, Princes du Raï et sons du bled
durée : 00:53:34 - LSD, la série documentaire - par : Elodie Maillot - Bien avant l'explosion du raï et les violences en Algérie, il y avait un Orient-sur-Seine à Paris. - réalisation : Manoushak Fashahi
La scène parisienne des musiques africaines 2/4
durée : 00:53:50 - La scène parisienne des musiques africaines 2/4
La scène parisienne des musiques africaines 3/4
durée : 00:53:47 - La scène parisienne des musiques africaines 3/4
La scène parisienne des musiques africaines 4/4
durée : 00:53:51 - La scène parisienne des musiques africaines 4/4
Le plaisir des cuisines levantines et nord-africaines
durée : 00:52:27 - Grand bien vous fasse ! - par : Ali Rebeihi - Partez à la découverte des saveurs envoûtantes des cuisines levantines et nord-africaines. Entre épices, herbes fraîches et traditions culinaires, cette émission vous invite à un voyage gustatif riche en couleurs et en histoires.
“Décolonisations africaines” : entretien avec Pierre Haski
durée : 00:15:36 - L'invité d'un jour dans le monde - Le journaliste Pierre Haski est l'invité d'“Un jour dans le monde”. Journaliste et chroniqueur géopolitique à France Inter, il publie “Décolonisations africaines”. Adapté du podcast du même nom, le livre retrace l'histoire de 13 figures qui ont guidé les pays africains vers l'indépendance.
Restitution d'œuvres d'arts africaines: un fond franco-allemand pour rechercher l'origine des œuvres
La coopération franco-allemande passe un nouveau cap. Désormais, le deux pays coopèrent sur la question de l'origine des objets culturels d'Afrique subsaharienne détenus dans les musées des deux pays. Il y a un an, un fond a été lancé et trois projets sélectionnés. Les diverses équipes de chercheurs se sont réunies pour la première fois la semaine dernière à Berlin. De notre correspondante,Une conférence ouverte au public en plein centre de Berlin, puis deux journées de travail entre chercheurs, ont officiellement lancé le fond franco-allemand de recherche sur la provenance des objets culturels d'Afrique subsaharienne. Au total, plusieurs dizaines de chercheurs vont travailler pendant trois ans. Ils viennent de France, d'Allemagne, mais aussi du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, du Mali ou encore de Tanzanie, des pays qui ont été colonisés par ces deux puissances au XIXe et au XXe siècle. Julie Sissia est responsable scientifique de ce fond. Elle nous en explique le concept :« Les gouvernements français et allemands ont fait le constat qu'il était nécessaire pour ces deux pays, qui renferment les collections d'objets d'Afrique subsaharienne parmi les plus importantes en Europe, de mettre en commun les ressources des chercheurs de provenance et aussi les ressources dans les universités et dans les musées, pour faire la lumière sur les circulations des objets qui participent d'un phénomène de colonisation qui est, on le sait, un phénomène européen. Les histoires ne sont pas exclusivement nationales, quand bien même la France et l'Allemagne ont des histoires coloniales qui sont très différentes. La colonisation allemande s'est arrêtée plus tôt, elle a commencé plus tard que celle de la France. »À lire aussiRestitution des œuvres d'art africaines: la France et l'Allemagne lancent un fonds de recherche« L'effet Macron » propulse trois projets de rechercheCe projet de recherche franco-allemand n'aurait pas vu le jour sans l'impulsion donnée par le président Emmanuel Macron sur la question de la restitution des biens culturels aux pays africains. Après son discours de Ouagadougou, en 2017, le président français a restitué 26 biens au Bénin. Pour Hamady Bocoum, ancien directeur du musée des Civilisations noires de Dakar, cette étape a été cruciale :« Il faut reconnaître que finalement, c'est la parole du prince qui a le plus porté. Je veux parler de ''l'effet Macron'', quand il a déclaré ne pas pouvoir accepter qu'une large part du patrimoine culturel des pays d'Afrique soit en France. Il a projeté de les restituer dans les cinq ans, ce qui n'a pas pu être fait, mais il a quand même ouvert les vannes. J'ai la naïveté de penser que les lignes vont bouger malgré de réelles résistances. »Désormais, c'est une nouvelle étape scientifique qui commence. Le fond franco-allemand a sélectionné trois projets de recherche. L'un d'entre eux se concentre sur plus d'une centaine de restes humains, des crânes, des os, des squelettes pillés par les colons dans les actuels Cameroun, Tanzanie et Namibie. Des restes humains conservés dans les collections de l'université de Strasbourg. Sylvain Djache Nzefa coordonne la route des chefferies au Cameroun, et il participe à ce projet de recherche :« Ils viennent de la Tanzanie, du Cameroun, mais il y a un travail encore beaucoup plus poussé que les historiens sont en train de faire sur leur origine exacte. Ces restes humains font partie de quelle communauté ? On parle de 1902, 1905, pour le Cameroun. Comment était le territoire ? Comment étaient organisées les chefferies traditionnelles ? Voilà de quoi il s'agit. »À lire aussiLa restitution des œuvres d'art africainDes objets culturels et objets du quotidien seront analysésUn autre projet vient de débuter. Il concerne les objets culturels issus de la communauté banama et spoliés dans ce qui était le Soudan français au tournant du XXe siècle. Une partie de ces objets se trouvent au musée du Quai Branly à Paris. Une autre, encore plus importante, à Hambourg, en Allemagne. La plupart ont été « rapportés » par l'ethnologue allemand Leo Frobenius, dont il faut désormais analyser les archives. C'est l'une des taches du chercheur allemand Richard Kuba :« On a énormément de matériel visuel, des photographies, des croquis, des aquarelles. Un but de ce projet, c'est d'utiliser ces images, mais aussi les archives écrites, les journaux de voyages qu'on a, qui sont extrêmement difficiles à déchiffrer parce que c'est un monsieur qui a une écriture à la main compliquée. De ramener ça, de le mettre en contexte avec les objets qu'il a collectés au Mali en 1907 et 1908 de la région des Banamas. »Le troisième projet se concentre sur des objets du quotidien, des instruments de musique, des objets cultuels, des ustensiles de cuisine, familiers, mais souvent méconnus dans leurs sociétés d'origine et dans les lieux où ils sont conservés. Les chercheurs souhaitent les relier de nouveau à leurs communautés, et notamment aux femmes, et donner la parole à celles et ceux qui ont été exclus dans l'histoire coloniale.Au final, ces différents projets de recherche donneront lieu à des publications, à des expositions. Mais le but est aussi de créer une dynamique scientifique, avec d'autres pays qui, comme la France et l'Allemagne, possèdent des collections issues d'Afrique subsaharienne.
Henri Texier, voix libre du jazz français 3/5 : "Il n'y a pas de jazz s'il n'y a pas de résonances africaines"
durée : 00:27:11 - Henri Texier, contrebassiste (3/5) - par : Nathalie Piolé - Lorsque Henri Texier rencontre Don Cherry, le trompettiste lui donne les clefs pour ouvrir de nombreuses portes musicales. Toujours à la recherche d'équilibre de cette musique qui doit se fabriquer toute seule, les musiciens de jazz sont avant tout des passeurs, des sculpteurs de temps qui passe... - réalisé par : Gilles Blanchard