Podcasts about tanzanie
Country in East Africa
- 286PODCASTS
- 659EPISODES
- 25mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Jan 26, 2026LATEST
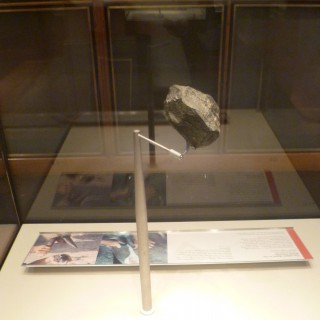
POPULARITY
Best podcasts about tanzanie
Latest news about tanzanie
- Le paradoxe sénégalais Africa Is a Country - Dec 27, 2025
- Les lacs "qui explosent" au Cameroun: un expert en catastrophes met en garde contre les rejets de gaz mortels English – The Conversation - Sep 22, 2022
- African developers: creating opportunities and building for the future Official Google Africa Blog - Feb 21, 2022
Latest podcast episodes about tanzanie
Un an après la prise de Goma: «Les ressources naturelles sont le carburant de cette guerre»
Un an après la bataille de Goma, quelle est la réalité du contrôle exercé sur la ville par l'AFC/M23, soutenu par Kigali ? Comment le groupe AFC/M23 se finance-t-il ? Et quelles perspectives de paix, alors que les initiatives diplomatiques — qui se multiplient — n'ont que peu d'effet sur le terrain ? Zobel Behalal, expert senior à l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational et ancien membre du panel d'experts des Nations unies sur la RDC, répond aux questions de Florence Morice. RFI : Il y a un an, lors de la chute de Goma, beaucoup d'analystes affirmaient que le M23 n'avait pas les moyens de gouverner la ville. Un an plus tard, peut-on dire que l'on s'était trompé ? Zobel Behalal : Oui, évidemment, on s'était trompé il y a un an. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement non seulement contrôle la ville, mais il a étendu son pouvoir sur d'autres territoires, et notamment sur la province du Sud-Kivu. De quelle manière est-ce qu'il contrôle la ville, concrètement ? Le M23, toujours soutenu massivement par le Rwanda, a installé une administration parallèle avec des gouverneurs qui ont été nommés dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu, des administrateurs du territoire. Il a installé un système de taxation assez bien huilé. Le M23 contrôle également des territoires stratégiques de production minière, qui sont une source d'enrichissement assez considérable pour lui. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que le M23 contrôle cinq postes frontaliers stratégiques, notamment avec le Rwanda et l'Ouganda. Comment le M23 finance-t-il cette administration parallèle ? Essentiellement par ces taxes et le contrôle des ressources minières ? On a vu une nomenclature des taxes assez bien élaborée par le mouvement, qui concerne aussi bien le mariage, le transfert d'un corps, que la traversée d'une frontière, l'exploitation d'un site minier. Donc ça couvre vraiment toute l'activité économique et sociale des territoires sous son contrôle et cela rapporte énormément d'argent au mouvement. Il faut aussi comprendre que le M23 ne dépense pas beaucoup d'argent pour ses troupes. Les soldats, pour la plupart, sont très peu payés, ils reçoivent un entretien journalier pour leur nutrition, donc ceux-ci se sucrent sur le dos de la population et l'essentiel de l'argent collecté par le M23 va dans les poches de ses cadres politiques et militaires. Avant la chute de Goma, le M23 contrôlait déjà d'importants sites miniers. C'était le cas, par exemple, de Rubaya. Qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Est-ce qu'ils ont mis la main sur de nouveaux sites stratégiques ? Depuis la chute de Goma, le M23 a étendu son contrôle sur des sites miniers, notamment dans la province du Sud-Kivu, des sites miniers de production d'or et de ce qu'on appelle la wolframite, ce qui constitue des sources de revenus importantes pour le mouvement. Il a continué à maintenir son contrôle sur les routes d'exportation des minerais de coltan exploités à Rubaya vers le Rwanda. Donc tout cet argent rentre dans les caisses du mouvement, mais profite surtout aux cadres politiques, aux cadres militaires et évidemment aux pays qui soutiennent le M23. Quels sont les pays qui bénéficient de ces ressources ? On a suffisamment d'informations et de preuves pour attester du soutien massif du Rwanda vis-à-vis du M23 et on sait que ce soutien rapporte énormément d'argent au Rwanda. Les statistiques du Rwanda d'exportation du coltan sur la période de janvier à juin 2025 sont 200 % supérieures à ce que c'était à la même période en 2024. Et on sait aussi qu'il y a des pays qui profitent de manière passive de la présence du M23, notamment les flux commerciaux et économiques entre le M23 et le Congo et l'Ouganda. Il y a également des pays un peu plus lointains, comme le Kenya et la Tanzanie. Prenons un exemple, celui du commerce du carburant. Aujourd'hui, à Goma, le carburant est sous le contrôle des proches du général Makenga, qui est le chef militaire du M23, et ses proches ont un monopole sur l'importation du carburant qui vient de pays comme le Kenya. Donc ça enrichit des réseaux qui, de manière passive ou indirecte, contribuent à financer le mouvement et profitent également de cette économie illicite. Depuis un an, les initiatives diplomatiques se multiplient, mais on a le sentiment qu'elles ont peu d'effet sur le terrain. Pour quelle raison, selon vous ? Il y a eu une forte mobilisation diplomatique qui est appréciable. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un élément qui structure cette guerre, il y a un élément qui constitue son carburant, c'est l'exploitation des ressources naturelles. Donc l'angle mort des principaux processus de paix, c'est qu'ils ne prennent pas suffisamment en compte cet aspect qui pourtant représente un moyen de pression sur les différents acteurs pour les obliger à se mettre autour de la table pour discuter. Mais le processus de Washington et l'accord-cadre qui a été signé en fin d'année dernière aux États-Unis prétend justement placer cette dimension économique et l'organisation économique régionale au cœur des discussions. Autant on se félicite du fait que les Américains aient mis sur la table cette dimension économique, autant on reste encore sur notre faim sur les mesures concrètes qui vont véritablement résoudre le problème dans sa profondeur. On a plutôt l'impression que ce processus pourrait représenter une prime à l'ambition expansionniste de certaines parties. Il pourrait représenter une source d'enrichissement des réseaux criminels préexistants. Donc il faut commencer par créer des conditions pour que ces personnes n'accèdent plus à ces ressources naturelles. Et c'est l'angle mort, comme je le disais, de ces processus de paix. Donc le M23, et ? Le M23, les pays voisins comme le Rwanda… Et il faut reconnaître aussi que, aujourd'hui, dans l'exploitation illicite des ressources naturelles, les réseaux criminels se recrutent au sein de l'élite politique, sécuritaire de tous les pays, y compris du Congo. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui que ces élites au Congo, au Rwanda et dans les autres pays, ne continueront pas à tirer les ficelles lorsque ces contrats seront appliqués. Tout récemment, l'Angola, qui semblait sorti des processus de négociation, a relancé des consultations et plaide pour un dialogue national. Est-ce que cette nouvelle initiative de Luanda est porteuse d'espoir selon vous ? L'initiative angolaise est potentiellement une évolution positive, car si la crise du M23 s'inscrit dans une dynamique géo-criminelle, où des États instrumentalisent le crime transnational organisé à des fins économiques et financières, il faut reconnaître que cette crise prospère aussi parce qu'elle s'ancre dans des faiblesses structurelles profondes que seuls les Congolais eux-mêmes ont la capacité et le devoir de traiter. Donc un dialogue intercongolais, qui va discuter du partage des richesses, de la forme de l'État, de comment faire nation, de la lutte contre l'impunité, me semble bienvenu. À lire aussiRDC: à Rubaya, des mines stratégiques au cœur de la guerre, toujours contrôlées par le M23
À la Une: élection présidentielle tendue en Ouganda
« Des élections tendues, considérées comme un test de la force de Musévéni » : c'est ainsi que le Monitor titre son article sur la journée d'hier. Le journal ougandais en ligne, considéré comme indépendant du pouvoir, ne se fait pas l'écho des problèmes techniques survenus hier pendant la journée de vote, mais précise toutefois que « le scrutin s'est déroulé sous haute surveillance policière et militaire. Les autorités ont coupé l'accès à Internet dans tout le pays, mardi, afin de lutter contre ce qu'elles qualifient de désinformation concernant l'élection ». Quant aux enjeux de l'élection, le journal ougandais estime « qu'elle est largement perçue comme un test de la force politique de Museveni, 81 ans, et de sa capacité à éviter le genre de troubles qui ont secoué ses voisins, la Tanzanie et le Kenya, alors que les spéculations vont bon train quant à sa succession éventuelle ». Le résultat du scrutin ne fait toutefois aucun doute, comme le rappelle Africanews : « Le président Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis plus de quarante ans, est donné largement vainqueur pour un septième mandat, bénéficiant d'un contrôle quasi-total de l'Etat et des forces de sécurité ». Un scrutin émaillé d'incident techniques, ajoute Africanews : « De nombreux bureaux de vote ont enregistré plusieurs heures de retard en raison de la lenteur de l'arrivée des urnes et du dysfonctionnement des machines biométriques … » L'attente continue Au Bénin, les résultats des élections de dimanche se font toujours attendre. « Le suspens continue », titre la Nouvelle Tribune. « A ce jour, précise le quotidien béninois, même si les délais légaux ne sont pas encore échus, ni les grandes tendances du vote ni les résultats officiels n'ont été rendus publics par les autorités compétentes ». Ce qui ne contribue pas à un climat serein : « Dans l'espace politique, explique la Nouvelle Tribune, l'absence de chiffres officiels alimente toute sorte de spéculations et de calculs d'avant-bureaux. Certains états-majors de partis affirment disposer de "leurs propres estimations" basées sur des remontées locales, tandis que d'autres appellent à la patience et au respect du processus légal avant toute proclamation ». En attendant les résultats, certains médias béninois ont choisi de faire de la pédagogie. Ainsi la Nation, qui titre « Non à la désinformation électorale », et publie à l'intention de ses électeurs, une série de recommandations indiquant « les bons réflexes à avoir face à une information douteuse ». Le journal béninois conseille d'abord « de prendre du recul et de ne pas réagir immédiatement, face à une information, quelle que soit sa nature ». Autre conseil : « Identifiez la source de votre information, c'est-à-dire recherchez qui parle et dans quel but, car une information n'a de valeur que si l'on sait clairement d'où elle vient. » Suivent d'autres conseils judicieux, à lire dans la Nation. Visas pour la Coupe du monde de football Au Nigeria, le journal le Guardian revient sur la décision prise par Donald Trump d'interdire de visas 75 pays étrangers. L'inquiétude est à l'ordre du jour. « L'interdiction de voyager imposée par Donald Trump laisse les Nigérians dans l'incertitude quant à la Coupe du Monde » explique ainsi le Guardian. « Les fans de football nigérians qui prévoyaient de se rendre aux Etats-Unis pour assister à la Coupe du Monde, pourraient ne pas concrétiser leur projet, suite à l'interdiction de voyager imposée par l'administration de Donald Trump à certains pays africains », ajoute le quotidien nigérian indépendant, qui remarque toutefois « que cette interdiction ne concernerait qu'un nombre limité de fans ». En effet, ajoute-t-il, « le coût du voyage pour la Coupe du Monde, notamment le prix des billets, fait que seuls les plus riches peuvent se permettre de se rendre en Amérique du Nord, pendant la compétition ». Et il leur faudrait encore fournir de multiples assurances, dont celle-ci : « Prouver des liens solides avec le Nigéria, et une intention claire de retourner au pays ».
Le bouyon fait le lien entre les Caraïbes et le continent africain
Dans la première partie, programmation consacrée aux nouveautés musicales avec, entre autres, Holly G et Théodora, VJ feat Sidiki Diabaté, Chily ou encore Creol. La chronique de James Woka qui décortique le bouyon, des Caraïbes au continent africain. Et dans la seconde partie, émission spéciale en compagnie de notre correspondant au Mali Mory Touré. En ce jour, Mory propose une programmation musicale consacrée à l'actualité du pays des hommes intègres : Le Burkina Faso. Playlist du 8 janvier (1ère partie) HollyG X Théodora - Coller la petite Franco - Coller la petite VJ feat Sidiki Diabaté - Toi et moi Chily - 2love Shan'L - Mytho Creol - Y'a pas le time Dans sa chronique, James Woka fait le lien entre l'Afrique et les Caraïbes à travers le bouyon, genre musical venu de la Dominique, dans les Caraïbes. Depuis quelques temps, le bouyon rythme le continent africain, notamment en Tanzanie, au Nigéria et plus récemment en Côte d'Ivoire avec Allons là-bas de Fior 2 Bior et Meiway. James Woka en vidéos sur Instagram Playlist du 8 janvier (2ème partie) Le Burkina Faso voit émerger de nombreux talents. Mory Touré propose de découvrir certains d'entre eux. Donsharp x Élue 111 x Nabalum x Young Ced x Barack la voix d'or x Mc Bigaf - Ça vient de nous Reman - Ropero Audray - Tonton Tanya, Zoung Nanzaguemda et Nana Bibata - Rakiré Kanazoe Orkestra - Dabara Pour visionner les clips, cliquez sur les titres des chansons Retrouvez la playlist officielle de RFI Musique.
Aide à l'Eglise en détresse 2026-01-02 Nouvelles de Tanzanie
Avec Thomas Oswald https://aed-france.org/
EXCLU Podcast - Christophe Dugarry donne son avis sur le niveau du Maroc dans cette CAN
Grâce à l'inévitable Brahim Diaz, absolument énorme dans cette CAN, le Maroc a battu sur la plus petite des marges la Tanzanie et sera au rendez-vous des quarts de finale de la CAN. Il retrouvera le Cameroun qui a été plutôt séduisant depuis le début de la compétition. Il faudra nécessairement monter en puissance pour des Lions de l'Atlas décevants dans le jeu. Du moins, c'est l'avis de Christophe Dugarry.
Présidentielle en Ouganda: «La répression est toujours très claire»
Voilà presque quarante ans jour pour jour que Yoweri Museveni préside aux destinées de l'Ouganda. Et à la présidentielle de ce 15 janvier 2026, il va briguer un septième mandat à la tête du pays. Face à lui, il y a l'ex-chanteur populaire Bobi Wine, qui avait réussi à obtenir officiellement 35% des voix en 2021. À l'âge de 81 ans, Yoweri Museveni s'engage-t-il pour un dernier tour de piste ? Une alternance est-elle possible ? Kristof Titeca est professeur à l'université d'Anvers, en Belgique, où il enseigne à l'Institut de gouvernance et de développement. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier. RFI : De nombreux opposants et défenseurs des droits de l'homme sont en prison. Est-ce que la répression est aussi forte que lors de la campagne électorale de 2021 ? Kristof Titeca : En fait, au début de la campagne électorale pour ces élections, c'était plutôt calme et ça a surpris pas mal de monde. Mais donc, dès que Bobi Wine et le NUP, son parti politique, ont vraiment commencé à faire campagne, là, la répression est montée. Donc en effet, il y a eu pas mal d'arrestations. Le NUP, ils disent qu'il y a entre 300 et 400 personnes qui ont été arrêtées. Des analystes disent que c'est plutôt autour de 200. Mais donc on a vraiment essayé d'empêcher Bobi Wine et le NUP de faire campagne, d'organiser des meetings, tout simplement. Donc la répression est toujours très claire. Et l'on vient d'apprendre l'arrestation d'une grande avocate, Sarah Bireete... Oui, tout à fait. Donc il y a quelques jours, il y a Sarah Bireete qui a été arrêtée, ça ne s'est pas passé les élections précédentes. Donc c'est la première fois qu'une figure comme Sarah Bireete a été arrêtée sur des accusations qui étaient un peu floues. Et dans cette répression, quel rôle joue le fils du président, le général Muhoozi Kainerugaba, qui est le chef de l'armée ougandaise ? La seule consigne vraiment claire qui a été donnée par lui, mais aussi par des autres responsables, c'est que les électeurs doivent rentrer directement chez eux après avoir voté. Et ça, ça veut dire deux choses. Donc, d'une part, évidemment, c'est un message du type « ne créez pas de troubles », mais d'autre part, pour beaucoup de gens, cela suscite des inquiétudes sur un possible bourrage des urnes ou des manipulations du vote, parce que d'habitude, il y a des observateurs civils qui restent sur place pour surveiller le dépouillement, et là, ce ne sera plus possible. Alors, dans le pays voisin, la Tanzanie, la présidentielle du 29 octobre dernier a été marquée par des manifestations violemment réprimées. Plus de 2 000 morts selon l'opposition. Est-ce que le même scénario pourrait se reproduire en Ouganda ? D'abord, il faut toutefois dire que la répression en Tanzanie a été extrêmement brutale, donc plus que 2000 morts. Donc, c'était une échelle qui est différente de ce qu'il se passe en Ouganda pour le moment. Cela dit, on observe un rapprochement entre l'Ouganda et la Tanzanie et dans une certaine mesure aussi avec le Kenya sur ces questions. On parle d'une sorte d'externalisation de la répression entre ces différents gouvernements. Par exemple, il y a eu un cas de torture visant quelqu'un qui est ougandais, donc c'est la militante des droits humains qui est la plus connue en Ouganda, Agather Atuhaire. Elle s'est rendue en Tanzanie, c'était une supporter des militants des droits humains en Tanzanie. Là-bas, elle a été arrêtée, elle a été brutalement torturée et puis elle a été abandonnée par les services de sécurité tanzanienne à la frontière ougandaise. Donc, on voit clairement apparaître ces dynamiques transfrontalières de répression. En Tanzanie, en octobre dernier, les principaux adversaires de la présidente sortante, Samia Suluhu Hassan, étaient exclus du scrutin. Alors qu'en Ouganda, certes, Kizza Besigye est en prison, mais Bobi Wine peut se présenter. Est-ce que ce n'est pas une différence ? Oui, il y a cette différence qualitative entre les deux pays en fait. Donc l'Ouganda a toujours été considéré comme un régime hybride, c'est-à-dire il y a des tendances autoritaires, mais il y a aussi des tendances démocratiques. Ça veut dire que le gouvernement et le président Museveni, ils ont toujours besoin du soutien de la communauté internationale, c'est-à-dire de l'Union européenne, des États-Unis, c'est-à-dire du support financier et politique de ces acteurs internationaux. Voilà exactement 40 ans que Yoweri Museveni est au pouvoir. Il a aujourd'hui 81 ans. Est-ce que c'est sa dernière élection ? En fait, oui, c'est ça la question qui est la plus importante pour les Ougandais, c'est qu'est-ce qu'il va se passer après le président Museveni ? Et donc il y a son fils Muhoozi Kainerugaba, qui est un peu vu comme son successeur. Mais en tout cas, le clan Museveni va tout faire pour empêcher Bobi Wine ou Kizza Besigye d'être élu président ? Oui, tout à fait. Et c'est ça la grande difficulté ou le grand danger pour le pays. Comment cette transition va se dérouler ? Est-ce que l'armée, est-ce que la population vont accepter que de nouveau il y ait quelqu'un du clan de Museveni qui va rester au pouvoir ?
Vainqueur de la Tanzanie (1-0), le Maroc retrouvera en 1/4 de finale le Cameroun, qui a battu l'Afrique du Sud (2-1). Mon analyse.
Une émission consacrée essentiellement aux huitièmes de finale de la CAN 2025, avec des projections sur les affiches du week-end et la présentation des rencontres clés : samedi, Sénégal vs Soudan, Mali vs Tunisie et dimanche : Maroc vs Tanzanie et Afrique du Sud vs Cameroun. Des chocs et des favoris, faut-il déjà se méfier des surprises dans cette première phase à élimination directe ? Va t-on voir des pépites briller ? ► FIFA – Arbitrage : une petite révolution en vue ? La règle du hors-jeu est-elle sur le point d'évoluer ? La règle « Wenger » appliquée dès la prochaine saison ? Quelles conséquences concrètes pour le jeu, les arbitres… et le spectacle ? ► Ligue 1 – Derby parisien entre « clubs frères » Ce dimanche 4 janvier, le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC. Retour sur une histoire commune avant la rivalité : deux clubs, une origine partagée, et aujourd'hui un choc qui pourrait devenir un grand classique de la Ligue 1 ? ► Les Cartons Vidéo de la semaine Vos images, vos coups de cœur ou coups de gueule, sans oublier les cartons de nos consultants. CAN 2025 : le tableau de la phase finale Autour d'Annie GasnierConsultants : Rémy Ngono, Xavier Barret, Youssouf Mulumbu, François DavidChef d'édition : David FintzelRéalisation : Laurent SalernoRéalisation vidéo : Souheil Khedir et Robin Cussenot À écouter aussi :CAN 2025: les moments forts du premier tour décryptés par Joseph-Antoine Bell
Une émission consacrée essentiellement aux huitièmes de finale de la CAN 2025, avec des projections sur les affiches du week-end et la présentation des rencontres clés : samedi, Sénégal vs Soudan, Mali vs Tunisie et dimanche : Maroc vs Tanzanie et Afrique du Sud vs Cameroun. Des chocs et des favoris, faut-il déjà se méfier des surprises dans cette première phase à élimination directe ? Va t-on voir des pépites briller ? ► FIFA – Arbitrage : une petite révolution en vue ? La règle du hors-jeu est-elle sur le point d'évoluer ? La règle « Wenger » appliquée dès la prochaine saison ? Quelles conséquences concrètes pour le jeu, les arbitres… et le spectacle ? ► Ligue 1 – Derby parisien entre « clubs frères » Ce dimanche 4 janvier, le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC. Retour sur une histoire commune avant la rivalité : deux clubs, une origine partagée, et aujourd'hui un choc qui pourrait devenir un grand classique de la Ligue 1 ? ► Les Cartons Vidéo de la semaine Vos images, vos coups de cœur ou coups de gueule, sans oublier les cartons de nos consultants. CAN 2025 : le tableau de la phase finale Autour d'Annie GasnierConsultants : Rémy Ngono, Xavier Barret, Youssouf Mulumbu, François DavidChef d'édition : David FintzelRéalisation : Laurent SalernoRéalisation vidéo : Souheil Khedir et Robin Cussenot À écouter aussi :CAN 2025: les moments forts du premier tour décryptés par Joseph-Antoine Bell
CAN 2025: Tempête politico-sportive au Gabon après l'élimination des Panthères
Toute l'équipe de Radio Foot vous souhaite une bonne année 2026 ! Au programme aujourd'hui : la crise au Gabon après son échec à la CAN 2025... ► Gabon : Suspension de la sélection annoncée en direct à la télévision par le ministre des Sports, mise en cause de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, dissolution du staff évoquée… avant un rétropédalage et un communiqué retiré. L'élimination prématurée des Panthères ne passe pas : retour sur un imbroglio aux allures « d'affaire d'État ». ► CAN 2025 : Fin de la phase de poules. Focus sur la Tanzanie , qualification historique pour les huitièmes ! Et le Soudan qui franchit les poules… sans avoir inscrit le moindre but (un contre son camp adverse), une première dans l'histoire de la CAN. ► Projection sur les huitièmes de finale. Des chocs très attendus, des affiches plus déséquilibrées, deux parties de tableaux inégales ? Forces en présence, pièges potentiels et sélections capables de créer la surprise... À lire aussiDissolution du staff, cas Aubameyang: le Gabon en crise après son échec Pour en débattre autour d'Annie Gasnier : Éric Rabesandratana, Yoro Mangara, Nabil Djellit Édition : David Fintzel Réalisation : Laurent Salerno
CAN 2025: Tempête politico-sportive au Gabon après l'élimination des Panthères
Toute l'équipe de Radio Foot vous souhaite une bonne année 2026 ! Au programme aujourd'hui : la crise au Gabon après son échec à la CAN 2025... ► Gabon : Suspension de la sélection annoncée en direct à la télévision par le ministre des Sports, mise en cause de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ecuele Manga, dissolution du staff évoquée… avant un rétropédalage et un communiqué retiré. L'élimination prématurée des Panthères ne passe pas : retour sur un imbroglio aux allures « d'affaire d'État ». ► CAN 2025 : Fin de la phase de poules. Focus sur la Tanzanie , qualification historique pour les huitièmes ! Et le Soudan qui franchit les poules… sans avoir inscrit le moindre but (un contre son camp adverse), une première dans l'histoire de la CAN. ► Projection sur les huitièmes de finale. Des chocs très attendus, des affiches plus déséquilibrées, deux parties de tableaux inégales ? Forces en présence, pièges potentiels et sélections capables de créer la surprise... À lire aussiDissolution du staff, cas Aubameyang: le Gabon en crise après son échec Pour en débattre autour d'Annie Gasnier : Éric Rabesandratana, Yoro Mangara, Nabil Djellit Édition : David Fintzel Réalisation : Laurent Salerno
CAN 2025: lutte à distance entre Ivoiriens et Camerounais pour la première place du groupe F
Radio Foot, encore deux émissions en direct 16h10 et 21h10 T.U ce mercredi ! ► CAN 2025, au tour des groupes E et F de livrer leur verdict. Gabon / Côte d'Ivoire : des retrouvailles après les éliminatoires Mondial 2026. Les Panthères, déjà éliminées, mais le vestiaire gabonais veut rester mobilisé face aux champions sortants. Côté Éléphants, Émerse Faé veut oublier que ses joueurs sont déjà qualifiés. Un collectif solide, mais pour l'instant, un seul buteur. L'attaque orange, va-t-elle se distinguer ? À moins d'un sursaut d'orgueil des Panthères ? Le duel à distance avec le Cameroun pour la première place. Lions indomptables contre Mambas, les Mozambicains sur leur lancée ? Les signaux positifs côté Cameroun. David Pagou satisfait de ses jeunes Lions. À lire aussiCAN 2025: au Cameroun, le risque d'une Mbeumo-dépendance ? ► CAN 2025, la belle surprise soudanaise. Malgré la guerre, un championnat à l'arrêt et des clubs en exil, les Faucons de Jediane disputeront les huitièmes de finale. 3 points au compteur, c'est un de plus que la Tanzanie, qualifiée malgré sa différence de buts négative, mais un but de plus que l'Angola. Les Taifa Stars affronteront le pays-hôte marocain, avant de co-organiser la prochaine édition. Avec notamment l'Ouganda. Les Cranes n'iront pas plus loin, mais resteront dans la rubrique insolite, après avoir utilisé trois gardiens en un quart d'heure contre le Nigeria ! Avec Annie Gasnier, François David, Yoro Mangara et Salim Baungally. Technique/réalisation : Matthieu Degueldre / David Fintzel / Pierre Guérin. Calendrier CAN 2025 : programme complet, dates et horaires des matchs Radio Foot sera de retour ce soir à 21h10 TU pour une deuxième émission
CAN 2025: lutte à distance entre Ivoiriens et Camerounais pour la première place du groupe F
Radio Foot, encore deux émissions en direct 16h10 et 21h10 T.U ce mercredi ! ► CAN 2025, au tour des groupes E et F de livrer leur verdict. Gabon / Côte d'Ivoire : des retrouvailles après les éliminatoires Mondial 2026. Les Panthères, déjà éliminées, mais le vestiaire gabonais veut rester mobilisé face aux champions sortants. Côté Éléphants, Émerse Faé veut oublier que ses joueurs sont déjà qualifiés. Un collectif solide, mais pour l'instant, un seul buteur. L'attaque orange, va-t-elle se distinguer ? À moins d'un sursaut d'orgueil des Panthères ? Le duel à distance avec le Cameroun pour la première place. Lions indomptables contre Mambas, les Mozambicains sur leur lancée ? Les signaux positifs côté Cameroun. David Pagou satisfait de ses jeunes Lions. À lire aussiCAN 2025: au Cameroun, le risque d'une Mbeumo-dépendance ? ► CAN 2025, la belle surprise soudanaise. Malgré la guerre, un championnat à l'arrêt et des clubs en exil, les Faucons de Jediane disputeront les huitièmes de finale. 3 points au compteur, c'est un de plus que la Tanzanie, qualifiée malgré sa différence de buts négative, mais un but de plus que l'Angola. Les Taifa Stars affronteront le pays-hôte marocain, avant de co-organiser la prochaine édition. Avec notamment l'Ouganda. Les Cranes n'iront pas plus loin, mais resteront dans la rubrique insolite, après avoir utilisé trois gardiens en un quart d'heure contre le Nigeria ! Avec Annie Gasnier, François David, Yoro Mangara et Salim Baungally. Technique/réalisation : Matthieu Degueldre / David Fintzel / Pierre Guérin. Calendrier CAN 2025 : programme complet, dates et horaires des matchs Radio Foot sera de retour ce soir à 21h10 TU pour une deuxième émission
En cette veille de Nouvel an, nombre de médias du continent s'attardent sur l'année écoulée et se lancent dans le traditionnel exercice du bilan. Bilan politique tout d'abord avec ce constat établi par Le Pays au Burkina Faso : « Dans la plupart des élections qui se sont tenues cette année, il y avait, de Yaoundé à Bissau en passant, entre autres, par Bangui et Dodoma, comme une constante qui consistait pour les tenants du pouvoir à écarter (…) les candidatures de poids de l'opposition, susceptibles de gêner les plans d'élection ou de réélection du prince régnant, pour ne laisser passer que des candidatures de seconde zone (…). C'est à peine si certains chefs d'Etat, candidats à leur propre succession, n'ont pas eux-mêmes choisi leurs challengers. Et des coups de force, le continent noir en a connu aussi en 2025, pointe encore Le Pays. Notamment à Madagascar et en Guinée-Bissau où le pouvoir a changé de main. (…) Ce sont autant de faits qui constituent autant d'alertes pour la démocratie sur le continent noir. Lequel continent a aussi connu la survivance de certaines crises en 2025, notamment en RDC, au Soudan et dans les pays du Sahel. » Croissance et… dette ! WalfQuotidien à Dakar fait le point pour sa part sur l'économie du continent. « L'année 2025 se termine comme elle a commencé pour l'Afrique. Sans leadership affirmé, affirme le quotidien sénégalais. Sans réelles perspectives stratégiques pour conforter l'Agenda 2063 adopté en 2013 afin d'inscrire l'Afrique dans la voie de l'unité et du progrès. L'accélération de la croissance économique africaine autour de 4 % environ est une réalité encourageante. En revanche, la moitié des États de la région sont déjà surendettés. Le rythme de la croissance est insuffisant pour réduire l'extrême pauvreté et créer des emplois. L'année 2025 se termine donc comme elle a commencé pour le continent, insiste WalfQuotidien. Les mêmes défis politiques, les mêmes enjeux sociétaux devant un monde où sa faiblesse structurelle lui donne peu de marges de manœuvre (…). » Mali : « ne pas offrir le même scénario… » Le Pouce, à Bamako, s'attarde sur la situation nationale : « L'année 2025 a été particulièrement difficile au Mali avec, pointe le journal, en plus du problème sécuritaire, la crise du carburant (…), le chômage, l'accès à la santé, à l'éducation et au logement… Il est clair que le Malien ne souhaite pas vivre les mêmes problèmes qu'il a déjà vécus en 2025. Il appartient aux autorités de la transition de créer la surprise à hauteur des attentes, des rêves, affirme Le Pouce. Ne pas offrir le même scénario même si c'est difficile. (…) La guerre contre le terrorisme ne doit pas priver les Maliens du bonheur auquel ils ont droit ; elle ne doit surtout pas empêcher un État de mettre en œuvre ses projets de développement. » La CAN, bouquet final de 2025 En cette fin d'année et à l'aube de la nouvelle, un moment de bonheur pour des millions d'africains : le foot avec la Coupe d'Afrique des nations. On entre dans le dur avec les 16è de finale et donc les matches à élimination directe à partir de samedi. « Tout peut arriver maintenant !, s'exclame WakatSéra. Les Pharaons d'Égypte tenteront de se démomifier pour remonter sur le toit de l'Afrique pour la huitième fois. Les Lions indomptables vont sortir les crocs pour aller à l'assaut de leur sixième trophée. Les Super Eagles du Nigeria essaieront de planer plus haut dans le ciel marocain, afin d'y décrocher leur quatrième titre. Les Fennecs algériens et les Léopards de RDC vont lutter pour une troisième étoile, tandis que les Aigles de Carthage, les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, et les Lions de la Teranga, iront, eux, à la conquête du graal pour la deuxième fois de leur histoire. » Toutefois, relève encore WakatSéra, « la partie est loin d'être gagnée pour les ténors, car le ballon sera rond pour les 16 équipes qui se mettent désormais dans la peau du vainqueur. Le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Tanzanie, le Mozambique et le Soudan ne comptent pas faire de la figuration. Loin de là. »
WFC CAN 2025 - Nigeria : la plus grosse impression en phase de poules ?
Le Nigeria a réalisé un parcours sans faute avec trois victoires dont la dernière hier face à l'Ouganda. Est-ce l'équipe qui vous a le plus impressionné pendant cette phase de poules ? Avancent ils masqués pour la phase finale ? Sentez-vous Osimhen en mission ? Attendiez-vous qu'il puisse aider en ne marquant pas ? La Tunisie a elle concédé le nul face à la Tanzanie, un match seulement en gestion ? Est-ce le retour de la mentalité des "Italiens d'Afrique" ? Le match face au Mali est-il un piège ?
En cette veille de Nouvel an, nombre de médias du continent s'attardent sur l'année écoulée et se lancent dans le traditionnel exercice du bilan. Bilan politique tout d'abord avec ce constat établi par Le Pays au Burkina Faso : « Dans la plupart des élections qui se sont tenues cette année, il y avait, de Yaoundé à Bissau en passant, entre autres, par Bangui et Dodoma, comme une constante qui consistait pour les tenants du pouvoir à écarter (…) les candidatures de poids de l'opposition, susceptibles de gêner les plans d'élection ou de réélection du prince régnant, pour ne laisser passer que des candidatures de seconde zone (…). C'est à peine si certains chefs d'Etat, candidats à leur propre succession, n'ont pas eux-mêmes choisi leurs challengers. Et des coups de force, le continent noir en a connu aussi en 2025, pointe encore Le Pays. Notamment à Madagascar et en Guinée-Bissau où le pouvoir a changé de main. (…) Ce sont autant de faits qui constituent autant d'alertes pour la démocratie sur le continent noir. Lequel continent a aussi connu la survivance de certaines crises en 2025, notamment en RDC, au Soudan et dans les pays du Sahel. » Croissance et… dette ! WalfQuotidien à Dakar fait le point pour sa part sur l'économie du continent. « L'année 2025 se termine comme elle a commencé pour l'Afrique. Sans leadership affirmé, affirme le quotidien sénégalais. Sans réelles perspectives stratégiques pour conforter l'Agenda 2063 adopté en 2013 afin d'inscrire l'Afrique dans la voie de l'unité et du progrès. L'accélération de la croissance économique africaine autour de 4 % environ est une réalité encourageante. En revanche, la moitié des États de la région sont déjà surendettés. Le rythme de la croissance est insuffisant pour réduire l'extrême pauvreté et créer des emplois. L'année 2025 se termine donc comme elle a commencé pour le continent, insiste WalfQuotidien. Les mêmes défis politiques, les mêmes enjeux sociétaux devant un monde où sa faiblesse structurelle lui donne peu de marges de manœuvre (…). » Mali : « ne pas offrir le même scénario… » Le Pouce, à Bamako, s'attarde sur la situation nationale : « L'année 2025 a été particulièrement difficile au Mali avec, pointe le journal, en plus du problème sécuritaire, la crise du carburant (…), le chômage, l'accès à la santé, à l'éducation et au logement… Il est clair que le Malien ne souhaite pas vivre les mêmes problèmes qu'il a déjà vécus en 2025. Il appartient aux autorités de la transition de créer la surprise à hauteur des attentes, des rêves, affirme Le Pouce. Ne pas offrir le même scénario même si c'est difficile. (…) La guerre contre le terrorisme ne doit pas priver les Maliens du bonheur auquel ils ont droit ; elle ne doit surtout pas empêcher un État de mettre en œuvre ses projets de développement. » La CAN, bouquet final de 2025 En cette fin d'année et à l'aube de la nouvelle, un moment de bonheur pour des millions d'africains : le foot avec la Coupe d'Afrique des nations. On entre dans le dur avec les 16è de finale et donc les matches à élimination directe à partir de samedi. « Tout peut arriver maintenant !, s'exclame WakatSéra. Les Pharaons d'Égypte tenteront de se démomifier pour remonter sur le toit de l'Afrique pour la huitième fois. Les Lions indomptables vont sortir les crocs pour aller à l'assaut de leur sixième trophée. Les Super Eagles du Nigeria essaieront de planer plus haut dans le ciel marocain, afin d'y décrocher leur quatrième titre. Les Fennecs algériens et les Léopards de RDC vont lutter pour une troisième étoile, tandis que les Aigles de Carthage, les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, et les Lions de la Teranga, iront, eux, à la conquête du graal pour la deuxième fois de leur histoire. » Toutefois, relève encore WakatSéra, « la partie est loin d'être gagnée pour les ténors, car le ballon sera rond pour les 16 équipes qui se mettent désormais dans la peau du vainqueur. Le Burkina Faso, le Mali, le Bénin, la Tanzanie, le Mozambique et le Soudan ne comptent pas faire de la figuration. Loin de là. »
WFC CAN 2025 - Bénin vs Sénégal : attention au piège ?
La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans une phase décisive ! Alors que l'on connait l'identité de 14 des 16 sélections déjà qualifiées pour le huitièmes de finale, et que les 2 derniers billets devraient se jouer dans le Groupe C entre la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda, le Sénégal en termine avec son parcours de poule face au Bénin. Arrivés avec de grandes ambitions au Maroc, le Lions de la Téranga qui comptent 4 points sont quasi assurés de leur qualifications en 8ème et de faire partie au moins des meilleurs troisièmes de cette premières phase mais devront battre le Benin à Tanger pour s'assurer la 1ère place du groupe D. Un duel qui peut paraitre déséquilibré sur le papier, mais gare aux écureuils de Gernot Rohr qui peut s'appuyer sur une solidité défensive qui n'est plus à prouver et un renouveau offensif incarné par son capitaine Steve Mounié.
WFC CAN 2025 - Égypte : le retour des grands Pharaons ?
Les matchs de la 2e journée de la phase de groupes de cette CAN ont débuté et l'Egypte empoche une 2e victoire ! Les Pharaons ont battu l'Afrique du Sud (1-0) grâce à un but de Mohamed Salah et valident leur ticket pour les 8e de finale. Sont-ils à nouveau l'équipe à redouter dans cette CAN ? Forte de ses deux succès, l'Egypte s'est-elle positionnée comme l'un des grands favoris à la compétition ? Ensuite, il sera question du Sénégal, vainqueur de son premier match face au Botswana et qui enchaine face à la RDC. Les Léopards peuvent-ils réussir la perf de dominer les Lions de la Teranga et ainsi prendre une option sur la première place du groupe ?
Le nouveau podcast football du FC Copains
Safari: Zažil průvodce Marián Vágner kempování v africké přírodě jako jeho slavný dědeček Josef Vágner?
Teď se vypravíme do Tanzanie, do země s přívlastkem Perla Afriky. Tentokrát nebudou přímým prostředníkem naší cesty zvířata chovaná v Safari Parku Dvůr Králové, ale průvodce Marián Vágner. Redaktorku Danu Voňkovou zajímalo, zda zažil kempování v africké přírodě jako jeho dědeček Josef Vágner.
Zažil průvodce Marián Vágner kempování v africké přírodě jako jeho slavný dědeček Josef Vágner?
Teď se vypravíme do Tanzanie, do země s přívlastkem Perla Afriky. Tentokrát nebudou přímým prostředníkem naší cesty zvířata chovaná v Safari Parku Dvůr Králové, ale průvodce Marián Vágner. Redaktorku Danu Voňkovou zajímalo, zda zažil kempování v africké přírodě jako jeho dědeček Josef Vágner.Všechny díly podcastu Safari můžete pohodlně poslouchat v mobilní aplikaci mujRozhlas pro Android a iOS nebo na webu mujRozhlas.cz.
Zprávy z Vysočiny: Betlémy z Karibiku nebo ve stylu Star Wars. Přes 100 kusů vystavují ve výlohách v Měříně
O komentovaných prohlídkách informuje majitelka na webu Betlémské stezky. Svatou rodinu z Tanzanie, Bolívie, nebo Slovinska můžou vidět lidé až do svátku Tří králů.
CAN 2025 - Les groupes E et F lancent leur parcours
Dans votre émission 100% CAN 2025 : - L'entrée en lice de la Cote d'Ivoire ; - Le Burkina Faso ambitieux pour cette édition marocaine ; - L'Algérie et Mahrez en quête de renouveau après plusieurs désillusions ? ; - Focus sur les débuts réussis de la Tunisie face à l'Ouganda. Au sommaire de votre émission : - Les groupes E et F dans les starting blocks ! Ils tenteront de conserver leur couronne. Les Éléphants vont-ils réussir leur entame à Marrakech ? Dans un groupe F très relevé, déjà un test majeur pour les Oranges face aux Mozambicains de Chiquinho Conde. Pépé, Adingra et Haller ne sont pas du voyage marocain. Une certitude, la bonne assise défensive de la formation d'Emerse Faé. Les Mambas, qui n'ont jamais passé le 1er tour en 5 participations, n'ont pas la même profondeur de banc que leurs adversaires, mais joueront sans pression. - 1er tour de piste pour les Étalons. Et 1er match de la journée. Les Burkinabè vont-ils lâcher les chevaux ? Ils comptent faire mieux que les 8es de finale lors du tournoi ivoirien. Attention aux Équato-Guinéens, les coéquipiers d'Emilio Nsue nagent souvent à contre-courant des pronostics ! - Un bon départ est crucial dans un groupe où l'Algérie va se lancer face au Soudan. Les Fennecs de l'éternel Riyad Mahrez en quête de renouveau après plusieurs désillusions. Les Faucons de Jediane, coachés par le Ghanéen James Appiah, pourront-ils les contrarier sur la pelouse de Rabat ? - Les Tunisiens bien lancés par Ellyes et Elias ! Skhiri et Achouri (doublé), les Aigles se sont imposés contre l'Ouganda, et prennent la tête de la poule C devant le Nigeria, autre vainqueur (de la Tanzanie) hier. Les joueurs de Sami Trabelsi retrouveront les Super Eagles samedi soir à Fès. Cédric De Oliveira, Martin Guez et Joseph-Antoine Bell aux commentaires des intégrales, Éric Mamruth à Casablanca, et aussi dans Radio Foot. Pour débattre avec Annie Gasnier : Yoro Mangara, Philippe Doucet et Nicolas Vilas Technique/Réalisation : Laurent Salerno, David Fintzel et Pierre Guérin
CAN 2025 - Les groupes E et F lancent leur parcours
Dans votre émission 100% CAN 2025 : - L'entrée en lice de la Cote d'Ivoire ; - Le Burkina Faso ambitieux pour cette édition marocaine ; - L'Algérie et Mahrez en quête de renouveau après plusieurs désillusions ? ; - Focus sur les débuts réussis de la Tunisie face à l'Ouganda. Au sommaire de votre émission : - Les groupes E et F dans les starting blocks ! Ils tenteront de conserver leur couronne. Les Éléphants vont-ils réussir leur entame à Marrakech ? Dans un groupe F très relevé, déjà un test majeur pour les Oranges face aux Mozambicains de Chiquinho Conde. Pépé, Adingra et Haller ne sont pas du voyage marocain. Une certitude, la bonne assise défensive de la formation d'Emerse Faé. Les Mambas, qui n'ont jamais passé le 1er tour en 5 participations, n'ont pas la même profondeur de banc que leurs adversaires, mais joueront sans pression. - 1er tour de piste pour les Étalons. Et 1er match de la journée. Les Burkinabè vont-ils lâcher les chevaux ? Ils comptent faire mieux que les 8es de finale lors du tournoi ivoirien. Attention aux Équato-Guinéens, les coéquipiers d'Emilio Nsue nagent souvent à contre-courant des pronostics ! - Un bon départ est crucial dans un groupe où l'Algérie va se lancer face au Soudan. Les Fennecs de l'éternel Riyad Mahrez en quête de renouveau après plusieurs désillusions. Les Faucons de Jediane, coachés par le Ghanéen James Appiah, pourront-ils les contrarier sur la pelouse de Rabat ? - Les Tunisiens bien lancés par Ellyes et Elias ! Skhiri et Achouri (doublé), les Aigles se sont imposés contre l'Ouganda, et prennent la tête de la poule C devant le Nigeria, autre vainqueur (de la Tanzanie) hier. Les joueurs de Sami Trabelsi retrouveront les Super Eagles samedi soir à Fès. Cédric De Oliveira, Martin Guez et Joseph-Antoine Bell aux commentaires des intégrales, Éric Mamruth à Casablanca, et aussi dans Radio Foot. Pour débattre avec Annie Gasnier : Yoro Mangara, Philippe Doucet et Nicolas Vilas Technique/Réalisation : Laurent Salerno, David Fintzel et Pierre Guérin
Guinée-Bissau: la Cédéao rejette le chronogramme de transition, «la meilleure posture qu'elle pouvait avoir»
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest « rejette catégoriquement le chronogramme de transition » en Guinée-Bissau. Lundi, l'organisation régionale a confirmé son désaccord avec la durée de la période d'exception proposée par les putschistes. La semaine dernière, la junte au pouvoir a adopté une charte de transition de 12 mois, jugée trop longue par la Cédéao. Dans son compte-rendu final, l'organisation a rappelé son intransigeance face au coup d'État militaire à répétition dans la zone, et s'est félicitée de la riposte régionale immédiate face à la tentative de putsch au Bénin. Le politologue béninois Mathias Hounkpe, membre de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, livre son analyse. Il répond aux questions de Sidy Yansané. RFI : Dans son communiqué final, après la clôture du sommet, la Cédéao condamne fermement le coup d'État en Guinée-Bissau. Mais surtout, elle rejette catégoriquement le chronogramme de transition de douze mois, annoncé par la junte. Comment vous analysez cette position ? Mathias Hounkpe : Etant donné que personne n'avait rien à reprocher au processus électoral, ça veut dire que si on le veut aujourd'hui, même dans un délai de trois mois, au plus six mois, on peut organiser les élections. Et donc je pense que cette posture de la Cédéao est plutôt, de mon point de vue, la meilleure posture qu'elle pouvait avoir. C'est une posture qui diffère par rapport aux multiples coups d'État qu'on a pu constater dans la dernière décennie ? Pour les autres coups d'État, la Cédéao était plutôt dans la posture non seulement de condamnation, mais de négociation avec les auteurs des coups pour décider de la durée. Cette fois-ci, même si la durée fixée par ceux qui ont fait le coup d'État est relativement courte, la Cédéao estime quand même qu'il faut organiser les élections dans un délai encore plus court. Dimanche, à l'ouverture du sommet, le président de la Commission, Omar Alieu Touray, a affirmé que le coup d'État empêché au Bénin a montré concrètement l'importance de la solidarité régionale. Et pourtant, quelques jours avant, il concédait que la Cédéao était « en état d'urgence », notamment à cause des putschs à répétition… Ce qui s'est passé au Bénin, ça a été une surprise pour quasiment tout le monde. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de réaction de la part de la Cédéao en cas de tentative de coup d'État. Donc le président de la Commission Omar Touray a été lui aussi obligé de reconnaître qu'il ne s'attendait pas à ce genre de réaction. Même s'il se contredit, les faits étaient si inattendus qu'il a dû en tenir compte dans son analyse lors du Sommet. Vous considérez que cette intervention militaire régionale illustre un nouveau paradigme de la Cédéao ? Ou alors c'est une exception, du fait de la proximité avérée du dirigeant béninois avec ses homologues nigérian, ivoirien et français, ce dernier ayant d'ailleurs reconnu avoir apporté un appui logistique ? Quand vous lisez le compte-rendu de cette session, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement charge la Commission de la Cédéao de proposer un cadre permettant une intervention rapide en cas de coup d'État. Ça veut dire que même si le 7 décembre 2025 était une exception, désormais la Cédéao est consciente qu'il est possible, si on est préparé, d'intervenir rapidement pour empêcher les coups d'État d'aller à leur terme. En revanche, aucune mention des changements constitutionnels en série ou des opposants écartés lors des élections, comme en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin, pour ne citer qu'eux. Ce sont pourtant les principaux arguments qui sont utilisés par les militaires pour justifier leurs coups de force ? Quand je lis correctement le compte-rendu, je vois de manière implicite la reconnaissance par les chefs d'État et de gouvernement des problèmes dans la sous-région en matière de respect des droits humains et d'organisation d'élections inclusives et compétitives. Rappelez-vous des événements récents en Tanzanie. Ce n'était pas un coup d'État. On a parlé de plus de 700 morts dans les manifestations parce qu'une bonne partie de la classe politique a été exclue du jeu électoral et démocratique. Si l'on veut la paix et la stabilité de la sous-région, il faut non seulement condamner les coups d'État et prévoir des mécanismes pour les empêcher, mais il faut également éviter les situations où on pourra jouer avec les libertés et droits fondamentaux des citoyens et créer des conditions d'élections non inclusives et non compétitives. Pourtant, de manière explicite, la Cédéao prend note des élections passées en Côte d'Ivoire, celles à venir au Bénin et salue la présidentielle prévue à la fin du mois en Guinée, alors même que dans ces trois pays, des opposants d'importance ont été écartés, emprisonnés ou exilés. N'est-ce pas là une contradiction majeure ? Je dirais que la Cédéao cherche par des voies diplomatiques à dire les choses sans vraiment les dire. C'est très important d'avoir mentionné dans ce même compte-rendu le rejet des récents coups de force et la nécessité d'organiser des processus électoraux inclusifs et compétitifs. Je suis resté un peu sur ma faim, justement, car de la même manière que les dirigeants chargent la Commission de créer un cadre permettant une intervention rapide en cas de coup d'État, je me serais attendu à ce qu'ils la chargent également de prévoir des mécanismes permettant d'interpeller les pays dans lesquels on pratique l'exclusion en matière électorale et où on réprime les libertés et droits fondamentaux des citoyens.
À quoi servent encore les élections en Afrique ?
Faut-il continuer à dépenser des milliards de francs CFA dans des élections qui débouchent le plus souvent sur des violences avec mort d'hommes et dont les résultats sont toujours contestés ?
Tour d'Afrique à vélo: le parcours fou de la Marocaine Meryem Belkihel pour «Donner de l'espoir aux femmes»
C'est une « sortie » à vélo qui aura duré trois ans. À bord de son Gravel – un vélo mi-route mi-VTT, Meryem Belkihel 30 ans, a réussi le pari un peu fou de faire un tour d'Afrique, seule. 34 000 km parcourus, 33 pays traversés, la jeune Marocaine a finalement achevé son aventure début novembre 2025, à Madagascar. Elle voulait « découvrir l'Afrique », comprendre les pressions exercées sur l'écologie, rencontrer ses voisines et voisins de continent, montrer à qui la croisait sur son passage qu'on peut vivre ses rêves, en étant une femme, seule. Meryem Belkihel raconte son périple militant. De notre correspondante à Antananarivo, Sourire vissé au visage, Meryem Belkihel savoure ses premières journées depuis trois ans sans pédaler. À ses poignets, plusieurs dizaines de bracelets, souvenirs peu encombrants qui lui ont été offerts au fil de ses rencontres.« Celui-là, je l'ai eu en Éthiopie. Celui-ci, c'est, ici, Madagascar. Ça, c'est la Tanzanie, lui, le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Burundi, le Zimbabwe, celui-là l'Eswatini et ça, c'est Mozambique. » Son périple à vélo, elle l'a documenté. Caméra embarquée, drone, elle a filmé ses traversées solitaires et ses découvertes, parfois choquantes. « Le changement climatique, je voulais voir ça de près. L'impact sur notre continent, sur l'Afrique. Et partager aussi parce qu'on voit ça beaucoup, mais parfois, on se dit " Mais non ! Ce n'est pas réel ! », on trouve des excuses. « Là par exemple, c'est une vidéo que j'ai prise à l'est du Cameroun. Ces tronçonneuses que vous entendez, ce sont celles de gens qui travaillent pour une grande société qui coupe les arbres de plus que 100 ans pour les envoyer à l'étranger, en Europe et en Chine. Et là ça m'a choqué parce que pour couper un arbre, il faut en abattre 20 autres. Et ça, c'est tous les jours dans cette forêt du Cameroun. Même chose pour la République centrafricaine. » La jeune femme, informaticienne à Casablanca, avoue avoir semé la gêne dans son entourage : « Les gens ne me comprenaient pas. Ce que j'ai fait, ce n'est pas dans notre culture. On me trouvait bizarre. Mon désir de partir seule, ça a choqué ma famille, mes amis. On me demandait de rester, d'acheter une maison, une voiture, me marier, avoir des enfants. Non ! Moi, je voulais donner de l'espoir aux femmes et aussi donner l'exemple d'une femme marocaine, africaine ! » Un mental renforcé par les épreuves Meryem nous montre sur son téléphone un échange animé, qu'elle a filmé durant son périple : « Là, c'est une vidéo que j'ai tournée quand je suis arrivée au Ghana. J'étais en train de parler avec un vendeur dans un magasin de vélo, pour essayer de réparer mon dérailleur et là, il y a quelqu'un qui était juste à côté. Il a commencé à dire : " Non non non, ce que tu racontes n'est pas vrai, arrête de mentir ! Ce n'est pas possible de venir du Maroc et parcourir plus que 6 000 km à vélo ! " Bah, je lui ai dit, « Je suis Marocaine. Si toi, tu n'es pas fort, moi, je le suis et je peux le faire ! » Les galères, raconte-t-elle, elle en a vécu. Partout. Crevaisons. Casse. Pépins de santé. Chaque épreuve a contribué à renforcer un peu plus son mental d'acier : « J'ai eu quatre fois le palu, j'ai eu la typhoïde, j'ai eu beaucoup d'infections dentaires. Mon visage a été gonflé comme si j'avais pris du botox » rit-elle. « J'étais au milieu de la jungle, au Cameroun. Il y avait un centre de soin, sans eau ni électricité. C'était fou. Mais je n'ai jamais eu l'idée de dire "j'arrête, je n'en peux plus". J'ai appris durant ce voyage que si quelque chose arrive, "it is what it is". Ça m'a appris à rester toujours positive, à apprendre que chaque problème a une solution et que tout est possible. » Marquée, elle le restera. Par l'hospitalité des Guinéens, par la solidarité et la bienveillance des Malgaches, la beauté des paysages de Namibie, du Nigeria, de l'Angola. De retour au Maroc, elle a déjà prévu la suite : écrire un livre, monter le documentaire de son aventure avec les centaines d'heures de rush, et qui sait, reprendre un jour son vélo pour se rendre au point le plus au nord de la planète.
durée : 00:03:39 - Sous les radars - par : Sébastien LAUGENIE - Selon l'opposition en exile au Kenya, le gouvernement de Samia Suhulu Hassan tue ses citoyens en pleine rue, et notamment à Dodoma, la capitale du pays Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
durée : 00:03:39 - Sous les radars - par : Sébastien LAUGENIE - Selon l'opposition en exile au Kenya, le gouvernement de Samia Suhulu Hassan tue ses citoyens en pleine rue, et notamment à Dodoma, la capitale du pays Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Longtemps considérée comme un pays calme, la Tanzanie a basculé dans la violence fin octobre 2025. Des élections sans opposition, sans beaucoup d'électeurs avec malgré tout des scores de participation et des résultats dignes d'une dictature. Contestation dans la rue, répression d'une violence inouïe qui a fait des centaines, voire des milliers de morts. Comment savoir puisque tout a été fait pour que des enquêtes ne soient pas menées ? Les communications sont rétablies, mais la présidente Samia Suluhu Hassan règne par la terreur. Jusqu'où peut-elle aller ? Y a-t-il un risque de fracture ? Avec nos invités : - Marie-Aude Fouéré, anthropologue à l'EHESS - Alexis Deswaef, président de la Fédération Internationale des droits humains (FIDH).
Baybridge: un projet d'influence chinoise, aussi ambitieux que défaillant
Des centaines de sites internet composant un vaste réseau de dissémination d'articles de propagande pro-russe et chinoise est mis à jour dans l'étude Baybridge que publient l'IRSEM et Tadaweb. Les chercheurs qui ont documenté cette opération d'influence, à la fois complexe et sophistiquée, décrivent toutefois un écosystème de qualité médiocre, avec de nombreuses incohérences du point de vue informationnel. La cartographie de ce réseau s'avère riche d'enseignements. Le rapport Baybridge dévoile un ambitieux projet d'influence visant à disséminer des récits de propagande pro-russe et chinoise, à travers des centaines de faux sites internet provenant d'un écosystème chinois composé de plusieurs agences de marketing digital, dont deux principales Haixun et Haimai, situées à Shenzhen et Shanghaï. Ou comment une opération hypersophistiquée échoue à trouver sa cible. Un loupé riche d'enseignements, que nous dévoilent Paul Charon de l'IRSEM et Côme Allard de Tadaweb, grâce à l'exploitation de données en sources ouvertes. L'enquête permet de révéler les divers strates du réseau, les agences et les sites sources qui permettent de stocker des milliers d'articles, avant qu'ils ne se propagent à travers des sites internet permettant de masquer la provenance des contenus. Les recherches en sources ouvertes révèlent également l'identité des responsables de ces entreprises, les liens avec des organes de propagande du PCC, le Parti communiste chinois, à l'échelon local. L'analyse de ces données relativise enfin la portée de ce projet ambitieux, de facture médiocre, qui ne semble pas rattaché aux plus hautes sphères du pouvoir. Paul Charon explique néanmoins l'intérêt de cette cartographie, à titre préventif. Il s'agit de mieux connaître les modes opératoires de la désinformation afin d'être en mesure d'évaluer la menace et d'adapter la riposte. La chronique de Grégory Genevrier de la cellule info vérif de RFI : Guerre en Ukraine : comment la propagande pro-russe exploite les générateurs de vidéos par IA pour désinformer. La chronique de Charlotte Durand de l'AFP factuel : Images décontextualisées sur les manifestations en Tanzanie.
Tanzanie : l'opposition évoque "au moins 800 morts" dans les violences post-électorales
En Tanzanie, le principal parti d'opposition, Chadema, a avancé le chiffre d'au moins 800 morts dans des violences post-électorales qui ont duré trois jours. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers, de personnes ont été tuées en marge des scrutins organisés la semaine dernière.
[Vos questions] Tanzanie : comment le pays a basculé dans le chaos ?
Les journalistes et experts de RFI répondent également à vos questions sur une opération anti-drogue meurtrière au Brésil, une résolution du RN votée pour la première fois et les essais nucléaires américains. Tanzanie : comment le pays a basculé dans le chaos ? Selon le principal parti d'opposition Chadema, au moins 800 personnes ont été tuées lors des violences qui ont suivi l'élection présidentielle de mercredi dernier (29 octobre 2025). Pourquoi ce scrutin est-il autant contesté ? Comment les autorités justifient-elles une telle répression ? Avec Elodie Goulesque, correspondante de RFI à Dar es Salam. Brésil : l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire du pays Au moins 121 personnes ont été tuées lors d'une vaste opération anti-drogue menée par plus de 2 500 policiers dans deux favelas de Rio de Janeiro. Comment expliquer ce bilan humain si élevé ? Pourquoi le gouverneur de l'État de Rio a-t-il ordonné une telle opération ? Avec Elcio Ramalho, chef du service en langue brésilienne de RFI. France : les députés votent une résolution de l'extrême-droite Pour la première fois, l'Assemblée nationale a adopté un texte porté par le Rassemblement national. Cette résolution dénonçant l'accord franco-algérien de 1968 est passée à une voix près (185 pour, 184 contre). Pourquoi la droite traditionnelle s'est-elle rangée du côté de l'extrême-droite sur ce texte ? Avec Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de RFI. États-Unis : comment comprendre la reprise des essais nucléaires ? Donald Trump a créé la surprise en annonçant avoir ordonné la relance immédiate des tests d'armes nucléaires, pourtant suspendus depuis plus de trente ans. Cette décision est-elle le signe d'une reprise de la course nucléaire ou une réponse provocatrice aux derniers essais nucléaires de la Russie ? Avec Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheuse en sciences et technologies nucléaires au Cnam.
Benoit Chervalier, regarder l'Afrique au delà des crises et des guerres
durée : 00:59:04 - Le 13/14 - par : Bruno Duvic - De la Tanzanie au Soudan en passant par le Cameroun et le Maroc, les crises africaines dominent l'actualité ces dernières semaines mais nous allons essayer dans les prochaines minutes de dresser un tableau plus complexe d'un contient qu'on présente encore trop souvent comme uniforme Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Samia Hassan élue avec 97,66 % des voix, "une parodie de démocratie" pour l'opposition tanzanienne
En Tanzanie, Samia Suluhu Hassan est élue présidente avec près de 98 % des voix, a annoncé samedi la commission électorale. Une victoire qualifiée de "parodie de démocratie" par l'opposition, après plusieurs jours de violences qui ont fait plusieurs centaines de morts.
À la Une: la situation en Tanzanie, «un chaos post-électoral et un silence d'État»
En Tanzanie, des heurts en marge des élections législatives et présidentielle, dont l'opposition a été évincée, ont débuté mercredi. Alors que la population était appelée à respecter un couvre-feu jeudi, de nouvelles manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Une situation commentée par la presse africaine. Si la coupure du réseau internet rend l'accès aux informations compliqué, le média Afrik.com souligne « un chaos post-électoral et un silence d'État ». « Rendez-nous notre pays ! » scandent d'un côté les manifestants, de l'autre, on constate une absence de communication de la part du gouvernement, dirigé par la présidente Samia Suluhu Hassan, « tandis que les mesures de sécurité sont renforcées et que les craintes de victimes augmentent », peut-on lire. Selon Afrik.com « L'absence de communication gouvernementale est d'autant plus inquiétante que le scrutin a été précédé d'une vague de répression sévère. L'organisation Amnesty International a dénoncé une véritable "vague de terreur" marquée par des disparitions forcées, des arrestations arbitraires et des actes de torture ». Le média précise : « Le principal parti d'opposition, le Chadema, dont le chef Tundu Lissu est jugé pour trahison, a été disqualifié pour avoir refusé de signer un code électoral jugé insuffisant ». Pas d'observateurs crédibles Au Kenya, The Daily Nation scrute également de près la situation chez son voisin Tanzanien. Le journal rappelle que des militants, depuis le Kenya, ont dénoncé « une mascarade », juste « après que les autorités ont interdit à deux des principaux partis d'opposition de présenter des candidats ». Par ailleurs, le KHRC « la Commission kenyane des droits de l'homme (une ONG) a tiré la sonnette d'alarme face à l'absence de groupes d'observation électorale crédibles lors des élections. "Aucune mission d'observation crédible n'est présente en Tanzanie. La Belgique, la Suède, l'Allemagne et l'Irlande se sont retirées des élections. Les États-Unis surveillent, mais sans y déployer d'observateurs officiels" explique notamment un membre du KHRC ». Cependant, rappelle The Daily Nation « l'Union Africaine, la Communauté de développement de l'Afrique Australe, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont déployé des missions d'observation, ce qui a suscité des critiques pour avoir légitimé un processus défectueux ». Au Burkina Faso, WakatSéra commente aussi la situation en Tanzanie, dans ces colonnes édito : « Après les élections, la tension ! (...) c'est le condensé en peu de mots, de la situation volcanique que vit le pays », peut-on lire. « La présidente sortante en quête d'un deuxième mandat, (...) n'a pas résisté à la tentation d'organiser des scrutins interdits à l'opposition, la vraie ». Ainsi, les manifestants « n'ont que leurs voix pour crier leur ras-le-bol d'un régime incapable de répondre aux attentes d'un peuple trop longtemps muselé ». En Algérie, des réactions et des commentaires sur la politique française Jeudi, le parti d'extrême droite français, le Rassemblement national, a obtenu une « victoire » à l'Assemblée nationale, en faisant adopter à une voix près une résolution qui vise à « dénoncer » l'accord franco-algérien de 1968, qui crée un régime d'immigration favorable pour les Algériens. « La France vote contre elle-même », c'est le titre d'un édito dans Algerie patriotique. « Derrière les apparences d'un débat diplomatique, c'est une fracture politique, morale et historique qui s'ouvre : celle qui annonce l'arrivée de l'extrême-droite au pouvoir en 2027. (…) Le fameux accord de 68, que les nostalgiques de l'Algérie française décrivent à tort comme un privilège offert aux ressortissants algériens, n'est en réalité qu'une coquille vide ». Et pour Algérie Patriotique, « le vrai scandale n'est pas dans le vote, mais dans la complaisance du pouvoir en place », car « l'exécutif a préféré jouer la partition du populisme. En reprenant à son compte les thèmes de l'extrême droite, il espérait la contenir, mais il n'a fait que la légitimer. C'est ainsi que, sous couvert de "fermeté", la France se déshonore et prépare son propre suicide politique ». Algérie 360, rappelle que l'idée de mettre en cause l'accord de 1968 n'est pas nouvelle. « Déjà en février, un rapport du Sénat suggérait d'envisager sa dénonciation. De plus, l'ancien ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait exprimé à plusieurs reprises son souhait de remettre en question cet accord, notamment lors d'une période de crise diplomatique ». Par ailleurs, le média observalgérie souligne que les accords de 1968 « ne sont pas liés aux obligations de quitter le territoire français non exécutées, argument souvent évoqué par le Rassemblement national ». Ces accords encadrent uniquement les droits de résidence et d'établissement des ressortissants algériens en France. Enfin, le texte voté ne modifie en rien ces dispositions... Puisqu'une résolution parlementaire ne peut pas imposer d'action à l'exécutif. Elle exprime seulement la position de l'Assemblée nationale.
L'ONU tire la sonnette d'alarme sur les atrocités au Soudan
Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa "profonde inquiétude" sur "l'escalade" au Soudan, le chef des opérations humanitaires onusiennes parlant d'"informations crédibles d'exécutions de masse". Il a aussi affirmé que la ville d'El-Facher au Darfour a "plongé dans un enfer encore plus noir" : "l'horreur se poursuit. Des femmes et des filles sont violées, des gens mutilés et tués, en toute impunité".
durée : 00:03:31 - Sous les radars - par : Sébastien LAUGENIE - En Tanzanie depuis hier, jour de scrutin présidentiel, de violentes manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes du pays, malgré la mise en place d'un couvre-feu. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
durée : 00:03:31 - Sous les radars - par : Sébastien LAUGENIE - En Tanzanie depuis hier, jour de scrutin présidentiel, de violentes manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes du pays, malgré la mise en place d'un couvre-feu. Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
Des élections sans opposition : en Tanzanie, Amnesty dénonce une "vague de terreur"
durée : 00:15:11 - Journal de 8 h - L'ONG Amnesty dénonce en Tanzanie "des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des actes de torture" alors que les électeurs votent ce mercredi dans le pays pour la présidentielle et les législatives.
Tanzanie : des élections sans opposition, couvre-feu à Dar es Salam
La police a décrété un couvre-feu mercredi dans la capitale économique de Tanzanie où des centaines de personnes ont violemment manifesté, hurlant leur opposition au régime le jour d'élections présidentielle et législatives dont l'opposition était largement écartée. Première présidente de Tanzanie, promue à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassa, qui aspire à être élue, est accusée de mener une répression sévère contre les voix critiques.
En Afrique subsaharienne, 600 millions de personnes vivent encore sans électricité, selon la Banque mondiale. Une réalité qui affecte principalement les zones rurales et obligent les populations à recourir au bois de chauffage, au charbon de bois ou à des générateurs pour cuisiner, s'éclairer ou travailler. Des solutions peu sûres et coûteuses. Lors du dernier sommet africain de l'Énergie en Tanzanie, 30 chefs d'État et de gouvernements africains ont approuvé un plan de plus de 50 milliards de dollars qui devrait permettre de fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Un programme colossal qui montre bien l'urgence de la situation. Car au-delà du confort essentiel, l'accès à l'énergie est aussi déterminant pour le développement économique des pays. Alors que le continent africain concentre 60% du potentiel solaire mondial, selon Global solar Council (GSC), miser sur les énergies renouvelables pourrait également lui permettre de combler son retard en matière d'électrification de manière propre. Ce serait également une opportunité de créer des emplois et développer l'économie locale des zones rurales. Comment associer les populations et les petites entreprises au développement du secteur solaire ? Smart grids, mini-réseaux solaires : quelles solutions simples et peu coûteuses à mettre en place ? Émission à l'occasion du Sommet Climate Chance Afrique 2025 qui se déroule du 27 au 29 octobre 2025 à Cotonou au Bénin. Avec : • Faridath Assouma, directrice technique de la Société Béninoise de production d'Énergie Électrique (SBEE) • Delali Adedje, fondatrice et gérante de Yokoumi, une entreprise coopérative de production de beurre de karité. Lauréate 2022 du Prix Solutions Genre et climat décerné par la Constituante Femmes et Genre (WGC) • Roland Fangnon, directeur général de Clean Energy 4 Africa, entreprise spécialisée dans l'accès aux énergies renouvelables, propres et durables, au Bénin et plus largement en Afrique. Consultant en énergie et développement durable • Abdou Ndour, coordinateur de programmes énergies renouvelables et efficacité énergétique chez ENDA énergie, ONG basée au Sénégal, membre du réseau international d'Enda Tiers Monde. Programmation musicale : ► Hustler - Bobo Wê ► Wetin U Go Choose - James BKS.
Des élections sans opposition : en Tanzanie, Amnesty dénonce une "vague de terreur"
durée : 00:15:11 - Journal de 8 h - L'ONG Amnesty dénonce en Tanzanie "des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des actes de torture" alors que les électeurs votent ce mercredi dans le pays pour la présidentielle et les législatives.
Des élections sans opposition : en Tanzanie, Amnesty dénonce une "vague de terreur"
durée : 00:15:11 - Journal de 8 h - L'ONG Amnesty dénonce en Tanzanie "des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des actes de torture" alors que les électeurs votent ce mercredi dans le pays pour la présidentielle et les législatives.
En Afrique subsaharienne, 600 millions de personnes vivent encore sans électricité, selon la Banque mondiale. Une réalité qui affecte principalement les zones rurales et obligent les populations à recourir au bois de chauffage, au charbon de bois ou à des générateurs pour cuisiner, s'éclairer ou travailler. Des solutions peu sûres et coûteuses. Lors du dernier sommet africain de l'Énergie en Tanzanie, 30 chefs d'État et de gouvernements africains ont approuvé un plan de plus de 50 milliards de dollars qui devrait permettre de fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Un programme colossal qui montre bien l'urgence de la situation. Car au-delà du confort essentiel, l'accès à l'énergie est aussi déterminant pour le développement économique des pays. Alors que le continent africain concentre 60% du potentiel solaire mondial, selon Global solar Council (GSC), miser sur les énergies renouvelables pourrait également lui permettre de combler son retard en matière d'électrification de manière propre. Ce serait également une opportunité de créer des emplois et développer l'économie locale des zones rurales. Comment associer les populations et les petites entreprises au développement du secteur solaire ? Smart grids, mini-réseaux solaires : quelles solutions simples et peu coûteuses à mettre en place ? Émission à l'occasion du Sommet Climate Chance Afrique 2025 qui se déroule du 27 au 29 octobre 2025 à Cotonou au Bénin. Avec : • Faridath Assouma, directrice technique de la Société Béninoise de production d'Énergie Électrique (SBEE) • Delali Adedje, fondatrice et gérante de Yokoumi, une entreprise coopérative de production de beurre de karité. Lauréate 2022 du Prix Solutions Genre et climat décerné par la Constituante Femmes et Genre (WGC) • Roland Fangnon, directeur général de Clean Energy 4 Africa, entreprise spécialisée dans l'accès aux énergies renouvelables, propres et durables, au Bénin et plus largement en Afrique. Consultant en énergie et développement durable • Abdou Ndour, coordinateur de programmes énergies renouvelables et efficacité énergétique chez ENDA énergie, ONG basée au Sénégal, membre du réseau international d'Enda Tiers Monde. Programmation musicale : ► Hustler - Bobo Wê ► Wetin U Go Choose - James BKS.
Tanzanie: M-Mama, un programme qui réduit la mortalité maternelle
En Tanzanie, la santé est l'un des secteurs le plus en difficulté. Problèmes d'accès aux soins, d'infrastructures ou manque de personnels qualifiés, les défis sont nombreux. Mais grâce à la Fondation Vodafone et l'implication du gouvernement tanzanien, un programme nommé M-Mama a permis de réduire la mortalité maternelle de près de 40%. De notre correspondante à Dar es Salaam, Cette sonnerie, Sophia Miraji l'entend jusqu'à 40 fois par jour dans son bureau de l'hôpital Mwananyamala à Dar es Salaam. Au bout du fil en général, un dispensaire ou une structure de santé ayant une urgence obstétrique. « On a une urgence, on a besoin d'un véhicule. » Francesca Konyani est infirmière. Avec sa collègue, elle traite cet appel aujourd'hui : « La mère est en plein travail, mais sa tension est élevée, c'est de la pré-éclampsie, donc on doit la transporter du centre de santé de Kigogo à l'hôpital de Mwananyamala. » Un trajet d'environ 10-20 minutes s'il n'y a pas de trafic et qui sera effectué ce jour-là par une ambulance. Si aucune n'est disponible, c'est un chauffeur privé qui fera le trajet. Grâce au numéro gratuit 115 de M-Mama, depuis 2023, toutes les femmes enceintes ou nouveau-nés en état d'urgence en Tanzanie peuvent être pris en charge et transportés dans un établissement pouvant leur fournir les soins appropriés. Rahma est la responsable du projet M-Mama en Tanzanie : « Nous avons déjà transporté plus de 170 000 personnes dans le pays, c'est énorme. Nous avons des chauffeurs issus des communautés de presque tous les villages dans ce pays. C'est surtout grâce à la volonté politique. » Élargir le programme à d'autres urgences médicales La présidente Samia Suluhu Hassan a fait de la santé des femmes et des nouveau-nés une priorité. Mais avec quasiment 60% du système de santé national financé par des dons extérieurs ou le paiement des particuliers, l'efficacité de M-Mama est loin de refléter la réalité du pays. Faraji Bakari est l'un des chauffeurs du programme : « On espère que ça ne va pas s'arrêter aux femmes enceintes, mais que le gouvernement va étendre ça à ceux qui ont d'autres besoins médicaux dans la communauté. » La Tanzanie ne dispose pas de service de transport d'urgence, c'est donc pour ça que la fondation Vodafone s'est focalisée sur ce problème. Le programme est financé par l'État et désormais aussi géré par différents ministères. Juwairia Hamad tient son bébé de quatre mois en pleine forme dans ses bras : « Sans eux, je ne serais pas là. Quand une mère est en situation d'urgence et qu'il n'y a pas de services, c'est très difficile. C'est une super initiative et je suis très heureuse. » Si le gouvernement tanzanien a augmenté son budget lié aux infrastructures de santé ces dernières années, le manque de personnel qualifié et le coût des soins restent un véritable problème dans le pays. À lire aussiNeoNest, un couffin pour sauver les bébés prématurés en Ouganda rural
Style de musique iconique de la Tanzanie, le Bongo Flava se fait de plus en plus connaître à l'international. Avec ses notes de hip hop, rap, zouk, le tout en swahili, le style est né dans les années 1990 et continue de faire danser les Tanzaniens. Même si quelques décennies plus tard, les messages de revendications se sont estompés. De notre correspondante en Dar es Salaam, C'était « le » tube l'an dernier en Tanzanie, Diamond PlatnumZ, star du Bongo Flava lançait sa chanson Komasava pour « comment ça va ? ». Le titre a tourné à travers le monde. À coup de voitures clinquantes, femmes légèrement vêtues et de Masai réalisant la chorégraphie de la chanson, le tube parle vaguement de romance… Des thèmes pourtant bien loin des origines du style Bongo Flava, selon Kwame Eli, en charge de la communication pour l'Association de la musique urbaine tanzanienne : « Ça a beaucoup changé, à l'origine c'était quelque chose qui aidait les jeunes à s'exprimer sur différents problèmes dans le voisinage, dans la communauté, mais maintenant c'est juste du divertissement. » À lire aussiLa « success story » du Tanzanien Diamond Platnumz Une musique autrefois engagée Né dans les années 1990, le Bongo Flava est un mélange de genres pour, à l'époque, parler de politique, d'économie et parfois même critiquer le gouvernement. Le titre Ndio Mzee, traduisez « oui chef », de l'artiste Professor Jay, fait partie des classiques. « Nous t'avons donné nos voix ; Tu nous as fait tant de promesses ; Mais aujourd'hui, nous restons affamés », chantait Professor Jay à l'époque. Aujourd'hui, il a préféré ne pas répondre à nos questions. À quelques jours à peine des élections présidentielles, exprimer quelconque critique est très risqué en Tanzanie. Pour Kwame Eli, « Les choses ne vont pas bien. La plupart des musiciens maintenant ne soutiennent qu'une partie. "Parce qu'ils ont peur, vous pensez ?" 100% ! Ils ont peur ! [rires] » Alors, certains chantent les louanges de la présidente au pouvoir Samia Suluhu Hassan. C'était le cas en 2021 de Frida Amani : « J'utilise la musique pour parler des femmes, c'est pour ça que j'ai une chanson comme Madam President. Ça n'était pas du tout politique, c'était pour inspirer les filles. » La chanteuse estime qu'aujourd'hui le public ne veut plus entendre parler des problèmes du quotidien : « Ils pensent : "C'est notre vie, c'est ce qu'il se passe maintenant, s'il vous plaît, laissez-nous avoir du bon temps". ». Une querelle des anciens et des modernes. Quelles qu'en soient les paroles, une chose est certaine, le rythme du Bongo Flava continue de faire danser la Tanzanie.
Tanzanie: l'éducation en manque de moyens face à l'explosion démographique
La Tanzanie fait partie des dix pays africains où la population augmente le plus vite. Parmi les défis que cela implique : l'éducation. Un secteur encore sous-financé et aux nombreux problèmes. Illustration à Dar es Salaam à l'école islamique d'Ubungo. De notre correspondante à Dar es Salam, « Ici, ce sont certaines des classes et des laboratoires. » Ramadhan Mbwana est le directeur de l'école privée islamique d'Ubungo, à l'ouest de Dar es Salaam. Sous son aile, ils sont 250 élèves âgés de 13 ans et plus. Et depuis l'an dernier, il doit s'adapter au nouveau programme scolaire mis en place par le gouvernement. « Parmi les défis qu'on rencontre, c'est le manque d'outils pour la formation professionnelle, par exemple, notre gouvernement a fait imprimer des livres, mais il n'y en a pas assez pour tous les étudiants. Il y a aussi le problème de la formation, ajoute Ramadhan Mbwana, notre gouvernement a essayé de former les enseignants, mais ils ne l'ont pas tous été. » À l'école islamique d'Ubungo, sur 29 professeurs, seuls douze ont été formés au nouveau programme. Malgré ces manquements, l'établissement est privé et donc plutôt privilégié. Financé uniquement par les frais de scolarité qui s'élève à environ 900€ par an pour les internes, il dispose d'équipement informatique notamment et l'éducation s'y fait en anglais. Hemedi est élève ici depuis deux ans, il étudiait auparavant dans une école publique et note la différence : « L'école d'Ubungo est mieux parce que les infrastructures sont bonnes et les professeurs aussi. » Des classes surchargées dans les écoles publiques Le nombre d'élèves par exemple va du simple à plus du double, comme l'explique Said Sumuni, 29 ans, professeur d'anglais : « Dans les écoles publiques, il y a beaucoup, trop d'élèves. Par exemple, dans une classe, vous pouvez avoir pas moins de 100 élèves. » L'école publique, c'est pourtant là où étudie la majorité des enfants tanzaniens. Si l'éducation est obligatoire à partir de sept ans, beaucoup abandonnent après le primaire. En cause, des longs trajets, un manque de moyens pour payer l'uniforme par exemple ou parce que certaines jeunes filles tombent enceintes très tôt. L'autre problème, c'est l'apprentissage par cœur avec très peu de pratique, selon Rajabu James, volontaire à l'association IBET qui vise à améliorer l'éducation en Tanzanie : « Ils ne font pas de lien entre l'apprentissage et la situation dans la vraie vie. On est trop basé sur la théorie au lieu de la pratique. » Un défaut que le nouveau programme tente de palier. L'an dernier, 12,5% du budget du gouvernement était alloué à l'éducation. Dans un monde idéal, le chiffre devrait se rapprocher des 20%. À lire aussiLa bataille contre l'absentéisme des adolescentes à l'école en Tanzanie
Luthando Dziba espère «inspirer une génération de scientifiques africains» à la tête de l'Ipbes
Après des années d'expérience sur le terrain dans la conservation des grands mammifères africains, le scientifique sud-africain Luthando Dziba a pris le 1er octobre 2025 les rênes de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes). Souvent surnommé le « Giec de la biodiversité », cette instance scientifique et politique mondiale – près de 150 pays en sont membres - fait référence pour guider les politiques de préservation de la nature à partir des travaux de milliers de chercheurs. Pour la première fois, un scientifique africain en prend la tête. Pour sa première interview depuis sa prise de fonction, il est au micro de Lucile Gimberg, du service environnement de RFI. RFI : Vous êtes le premier scientifique africain à diriger la plateforme scientifique et intergouvernementale sur la biodiversité, l'Ipbes. C'est l'équivalent du Giec pour la biodiversité. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour le continent ? Quels sujets allez-vous portez ? Luthando Dziba : L'Ipbes est vraiment LA plateforme de politique scientifique la plus fiable pour fournir des informations sur la biodiversité aux décideurs. C'est donc un immense privilège pour moi d'avoir été invité à diriger l'Ipbes. Ce que j'apporte, je pense, ce sont de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la conservation de la nature en Afrique. Une expérience très pratique, de gestion des défis sociaux et écologiques sur le continent. Et je pense que cette perspective africaine unique sera extrêmement bénéfique. Je crois aussi que ma contribution et ma présence à ce poste aideront à inspirer une génération de scientifiques africains à contribuer non seulement à la politique scientifique de leurs pays, mais aussi à se penser et à se voir comme des contributeurs au niveau mondial. Les scientifiques africains sont-ils aujourd'hui bien représentés au sein de la communauté internationale en matière de biodiversité ? Donne-t-on assez d'importance aux savoirs africains aujourd'hui ? On a beaucoup œuvré pour améliorer la représentation des scientifiques des régions sous-représentées à l'Ipbes… comme l'Afrique, l'Europe de l'Est et parfois l'Amérique latine qui sont sous-représentées dans la communauté scientifique. Je pense que le point de départ pour l'Ipbes c'est vraiment de servir de plateforme à des voix très diverses, aux savoirs locaux et autochtones notamment, et à d'autres systèmes de connaissances. À lire aussiL'ONU donne son feu vert pour un Giec de la biodiversité Et puis nous ne voulons pas seulement nous concentrer sur la science de la biodiversité, nous voulons faire de la place aux sciences sociales pour avoir une vision beaucoup plus complète dans notre travail. Quelles sont les spécificités de la biodiversité africaine ? On pense souvent aux grands mammifères du continent comme les éléphants, les lions ou encore les rhinocéros, mais la nature africaine est riche de bien plus que cela, non ? Tout à fait, et notre rapport sur la biodiversité en Afrique en 2018 a montré le caractère unique de cet assemblage de grands mammifères. Ce qui est parfois moins connu ou valorisé, c'est le fait que la biodiversité africaine a co-évolué avec les humains. Il y a beaucoup d'exemples sur le continent, mais je pense aux savanes boisées du Miombo. Ces forêts tropicales sèches traversent tout le continent, de l'Angola, sur la côte ouest, jusqu'à la Tanzanie, le Mozambique sur la côte est, et l'Afrique australe. Les arbres Miombo se sont adaptés et quand on les exploite, ils repoussent. Ils peuvent survivre à des années d'exploitation de la part des populations tant qu'elles en font un usage durable… c'est-à-dire tant qu'elles ne détruisent pas des arbres entiers ou des groupes d'arbres entiers. C'est assez unique ! Un peu partout dans le monde, les peuples autochtones et traditionnels sont montrés en exemple pour leur capacité à préserver la nature, les animaux, les sols, les arbres… Auriez-vous en tête des exemples en Afrique de ces pratiques bénéfiques pour la biodiversité ? Je pense à la façon dont les communautés ont répondu à la bilharziose dans les zones rurales du Sénégal. Au lieu de juste traiter cette maladie parasitaire, ils ont mis en place des actions qui avaient un effet combiné sur la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et leur santé. Concrètement, en retirant des espèces invasives des cours d'eau où proliféraient les parasites et les mollusques qui transmettent cette maladie, ces communautés ont réduit les taux d'infection des jeunes jusqu'à 32 %, ils ont amélioré la qualité de l'eau, mais aussi les revenus des familles rurales. Il existe des façons d'agir que nous apprenons en nous appuyant sur les communautés autochtones et locales, des façons de gérer les systèmes naturels pour qu'ils perdurent. Nous experts, nous pouvons apprendre de ces années, parfois millions d'années, où les gens ont su comment vivre avec la nature. À lire aussiL'IPBES, «Giec de la biodiversité», prône des réponses globales et décloisonnées aux crises
Anne de Vandière voyage depuis 30 ans pour rencontrer les savoir-faire des peuples premiers. Son travail passionnel l'a menée au Sénégal, au Népal, en Inde, en Tanzanie, en Australie, en Thaïlande, au Groenland ou en Equateur... Chaque fois, c'est par les mains qu'elle entre dans l'âme de ses sujets. En s'intéressant aux origines, elle propose un chemin vers l'intelligence du corps qui est celle qui réunit les artisans au delà des langues, des cultures et des frontières.















































