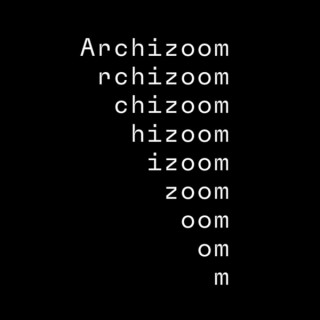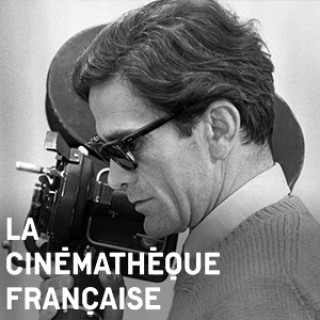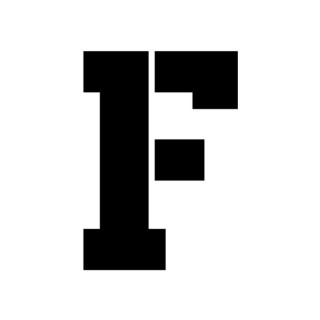Podcasts about georges didi huberman
- 46PODCASTS
- 95EPISODES
- 58mAVG DURATION
- ?INFREQUENT EPISODES
- Sep 16, 2025LATEST
POPULARITY
Best podcasts about georges didi huberman
Latest podcast episodes about georges didi huberman
Exposição na França revela dinamismo e resistência da cultura das periferias do Rio e de Paris
Os versos “Pode crê! Mas só pra te lembrar: Periferia é periferia em qualquer lugar”, da música Periferia Brasília, do rapper GOG, abrem a exposição Les Lucioles (“Os vaga-lumes”, em português): arte, cultura e esperança nas periferias urbanas do Rio de Janeiro e de Paris. A mostra, resultado de uma pesquisa acadêmica conjunta entre França e Brasil, está em cartaz na Maison de Sciences de l'Homme, em Saint-Denis, na periferia norte de Paris. A exposição revela a prática e a produção de coletivos culturais das periferias do norte e oeste do Rio de Janeiro e de Paris, especialmente de Saint-Denis e Stains. Ela é fruto de uma pesquisa codirigida pelas professoras Silvia Capanema, da Universidade Sorbonne Paris Nord, e Adriana Facina, do Museu Nacional da UFRJ. Durante mais de dois anos, os pesquisadores observaram as formas de criação e resistência de 30 coletivos periféricos cariocas e parisienses. Com fotos, textos e vídeos acessíveis por QR Codes, a exposição destaca a produção de 14 desses grupos — metade brasileiros, metade franceses — evidenciando o caráter comparativo e dialógico da pesquisa. “Uma teoria pensada no Brasil pode ajudar a refletir sobre as periferias francesas hoje (e vice-versa). Então, mostramos essa transferência de experiências práticas e de formas de pensar as periferias”, explica Silvia Capanema. O estudo revelou uma dinâmica intensa e uma diversidade cultural “impressionante” nas periferias, que vai muito além do hip hop. “Quando se pensa em periferia, muitas vezes se associa apenas ao movimento hip hop. Mas há muito mais: samba, coletivos de artistas, música clássica, teatro, choro... A cultura popular é muito rica”, afirma a professora da Sorbonne Paris Nord. Outro ponto relevante observado foi a presença do “Sul global no Norte global”, especialmente na Europa. “Vimos isso na França, nas periferias, com forte presença de imigrantes e do Caribe francês. O Carnaval chega à França por meio do Caribe francês e das periferias”, destaca Silvia Capanema. Carnaval como metáfora O Carnaval, representado na exposição por três coletivos — os brasileiros Loucura Suburbana e Barracão da Mangueira, e o francês Action Créole — aparece como uma metáfora poderosa dessa dinâmica. A antropóloga Patricia Birman, da UERJ, participou da jornada de estudos que inaugurou a exposição em 12 de setembro, falando sobre o Carnaval no Brasil e na França. Segundo ela, “o que une é a festa. Qualquer festa pode ter um sentido carnavalesco. E a música — a potência da música nos grupos é essencial”. Adriana Facina, que estuda há anos o coletivo Loucura Suburbana, destaca que os coletivos não fazem apenas cultura: “Para eles, cultura é trabalho”. Um bom exemplo é o Carnaval carioca. Sthefanye Paz, que defendeu uma tese de doutorado sobre a Mangueira, lembra que a importância do Carnaval para a comunidade vai muito além dos quatro dias de festa. “O Carnaval funciona com uma base de trabalho de cerca de dez meses por ano, não é só aquela única semana. São muitas pessoas envolvidas, correndo atrás dos seus sonhos para que o Carnaval aconteça nas ruas. Minha pesquisa faz essa relação entre a festa e o trabalho das pessoas que a constroem”, relata a pesquisadora, que também participa da cadeia produtiva da escola de samba desenvolvendo enredos. Formas contemporâneas de movimentos sociais A precariedade de sobrevivência e a luta por reconhecimento e estabilidade são semelhanças estruturais entre as periferias dos dois países. Os coletivos culturais têm papel central na vida das comunidades e atuam como formas contemporâneas de movimentos sociais. Adriana Facina explica que o nome da exposição se inspira no conceito de “vaga-lumes” do filósofo francês Georges Didi-Huberman, que reflete sobre o papel dessas “luzes frágeis e intermitentes, que apontam caminhos alternativos em períodos muito sombrios”, como o fascismo. “Para nós, hoje, os movimentos culturais das periferias urbanas — especialmente em Paris e no Rio de Janeiro — são esses vaga-lumes. Eles enfrentam o racismo, a xenofobia, a extrema direita e o capitalismo em sua fase mais selvagem, marcada pela precarização e pela perda de direitos”, detalha a pesquisadora do Museu Nacional. “O que esses coletivos propõem em seus territórios aponta caminhos para transformar o mundo em outra direção”, completa. Orgulho suburbano A cultura periférica vem ganhando espaço e se tornando o centro da inovação cultural. Sandra Sá Carneiro, da UERJ, que estuda o coletivo 100% Suburbano, destaca a valorização atual da cultura suburbana. “Esses coletivos atuam justamente valorizando essa identidade e a cultura suburbana. Há várias manifestações culturais. O grupo que estudo trabalha com o choro, como forma de resgatar a identidade e a sociabilidade carioca. Outros coletivos atuam com cinema, teatro, Carnaval, samba... É uma grande aposta em repensar essas regiões, marcadas por forte territorialização e desigualdade social”, afirma Sandra Sá Carneiro. Lição brasileira de democracia A exposição Les Lucioles foi inaugurada no dia seguinte à condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pela trama golpista. A coincidência foi considerada simbólica pelas codiretoras da pesquisa. Segundo Silvia Capanema, que além de professora é deputada regional de Saint-Denis, “a França está interessada em entender que lição de democracia o Brasil está dando. Esses coletivos culturais também são frutos de processos democráticos. Sem democracia, não há cultura, não há diversidade. Eles também defendem a democracia, pois são fortemente contrários ao fascismo”. Adriana Facina retoma uma ideia do filósofo Paulo Arantes e fala da “brasilianização” do mundo, como a ampliação da precarização do trabalho. “Mas também há uma ‘brasilianização' positiva, que é a potência das periferias.” Para ela, com a condenação de Bolsonaro, surge uma terceira comparação: “Hoje, podemos falar de uma ‘brasilianização' do mundo no sentido de uma defesa radical da democracia. O Brasil está dando uma lição ao mundo. Espero que isso inspire outras democracias, às vezes consideradas mais fortes que a nossa”, diz. Democratização da ciência Em vez de encerrar a pesquisa com os tradicionais artigos e livros acadêmicos, as organizadoras optaram por uma exposição para ampliar o alcance e democratizar a ciência. “Sabemos que livros e artigos são muito importantes, mas não atingem um público amplo, especialmente o não especializado. Nossa ideia foi fazer da exposição um resultado acessível da pesquisa, voltado ao maior número de pessoas possível — sobretudo aos próprios participantes da pesquisa: os coletivos culturais que abriram suas portas, responderam às nossas perguntas e atuaram como cocuradores, enviando fotos e participando ativamente do processo”, compartilha Adriana Facina. A exposição Les Lucioles: arte, cultura e esperança nas periferias urbanas do Rio e de Paris fica em cartaz na Maison de Sciences de l'Homme, em Saint-Denis, periferia norte de Paris, até 30 de janeiro de 2026.
Ömer Lekesiz-Kan uyumaz, şiiri unutulur ama destanı unutulmaz
Georges Didi-Huberman, dünyanın hali hazırdaki durumuna (işgal, zulüm, kölelik, ufuksuzluk, umutsuzluk, bakışların bozulması, yarın endişesi… vb.) denk düşen yanlarıyla kıyamet vizyonunu reddetmemekle birlikte, “var kalma siyaseti”nin “tanımı gereği ve zorunlu olarak” kıyamet gününe ihtiyaç duymadığını belirterek onu aşmaya çalışır.
Archivos Visuales: Metodología e Historia - Quito 1981
Viaja con nosotros al corazón de la metodología histórica visual. En este episodio experimental, realizamos un viaje inmersivo al Quito de 1981 para presenciar una manifestación indígena y descubrir cómo las imágenes - pancartas, carteles, símbolos - nos permiten leer la historia de maneras que los documentos escritos jamás podrían.A través de una narrativa envolvente, exploramos los archivos visuales como fuentes históricas fundamentales, analizando cómo las imágenes no solo documentan el pasado, sino que lo construyen. Desde las pancartas escritas en quichua hasta la transformación simbólica del espacio colonial, este episodio revela el poder de la metodología visual en la investigación histórica.Basado en las investigaciones de Isabel Paredes sobre la "Geografía de la protesta 1971-1983" y fundamentado en los trabajos de Peter Burke, Sarah Barber, Corinna Peniston-Bird y Georges Didi-Huberman.[Astry Chavez - Cynthia Montaño - José Navarro - Cristian Torres]Métodos Históricos y Documentales - FLACSO Ecuador
Idag berättar Karin Brygger utifrån sin judiska tro om högtiden Chanukka, där ljuset spelar en symboliskt viktig roll. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. Ur andakten:I judiska berättelser, särskilt de mystiska, måste vi öppna oss för ljuset för att kunna se det. Det hänger alltså på oss, förmågan att ta emot ljuset, inte på ljuset i sig. För mig öppnar den uppfattningen för att jag ska kunna ägna mig åt religion: tanken på att tro inte bara är att sitta på rumpan och vänta. När vi tror på att vi kan förbinda oss till ljus kan vi också bereda plats för mirakel i framtiden. Bara med den drömmen formulerad kommer ljuset att bli verklighet. Ser man på det judiska folkets långa historia, präglad av död och fördrivning, så är det traditionens förmåga att installera i oss en envishet och en tro på framtiden som gett oss vår framtid.Text:Översättningen av dikten Vetekorn av Abraham Sutzkever är hämtad ur Natt och Aska, Daniel Pedersen, Bokförlaget Faehton, 2024.Boken om Oyneg Shabes heter Förspridda av Georges Didi-Huberman, Bokförlaget Faethon. Producent:Susanna Némethliv@sverigesradio.se
#herkesesanat #çağdaşsanat Bir pisuar sanat tarihini nasıl değiştirdi? Öncüsü Beuys'a göre her insan bir sanatçı! Yüksek ve alçak kültür arasındaki sınırı bulanıklaştıran sanat biçimi! Anlamak çok zor! ... Bilgi Üniversitesi'nden Esra Yıldız rehberliğinde çağdaş sanatla tanışıyoruz. Çağdaş sanatın ne olduğunu, önemli sanatçı ve eserleri öğreniyoruz. ... Çağdaş sanat, yüksek kültürle alçak kültür arasındaki sınırı bulanıklaştıran, salt estetikten uzak, toplumsal kaygılarla üretilen sanat biçimi. Öncülerinden Joseph Beuys'a göre, her insan bir sanatçı. Belki bu yüzden çağdaş sanatı anlamak zor! Tarihsel aralık açısından sanat tarihçileri iki döneme işaret ediyor: İlki, 2. Dünya Savaşı sonrası dönem. Milyonlarca insanın toplama kamplarında öldürülmesi ve bundan sonra artık nasıl devam edileceği sorusu. Frankfurt Okulu'nun temsilcisi Adorno'nun, “Auschwitz'ten sonra şiir yazılamaz” sözünün ardından sanatçıların yapıtlarına dikkat çekti. İkinci dönem, 1960'dan günümüze kadar devam eden dönem. Feminizm, çevre hareketlerinin yükselişi, siyah haklar hareketi, 1968'de gençlerin ve işçilerin hareketi açısından önemli dönem. Sanatçıların bunlara karşılık gelen üretimlerini görüyoruz... ... Esra Yıldız'ın çağdaş sanata örnek olarak anlattığı sanatçılar ve eserleri: “Hazır yapıt” terimini literatüre kazandıran Fransız sanatçı Marcel Duchamp - 1917'de Bağımsız Sanatçılar Sergisi'ne gönderdiği ancak reddedilen eseri “çeşme / pisuvar”, modern sanat döneminde olsa bile, çağdaş sanatın kırılma noktası kabul ediliyor. Çağdaş sanatta önemli bir yeri olan, toplumu sanat aracılığıyla şekillendirmede önemli rolü olan Alman sanatçı Joseph Beuys. Ona göre her insan bir sanatçı. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda tahrip edilen ve ekolojik yapısı bozulan Kassel kentini canlandırma amacıyla yaptığı “7 bin meşe” çalışması, örnek eserlerden. Bu bölüm için seçtiği müzikler: John Cage'ten “Music for Marcel Duchamp” ve “Fontana Mix” Joseph Beuys - Sonne statt Reagan 1982 Türkiye'den örnek verdiği sanatçılar: Ayşe Erkmen - Berlin'de bir evin dış cephesindeki “mış'lı” yerleştirmesi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin Tünel tarafındaki bir heykeli var. Nur Koçak, Nil Yalter ve Sarkis'in de 70'lerden itibaren öncü isimler. Filmlerin, çağdaş sanatı anlamak açısından önemini vurguladı. Agnes Varda'nın “Les Glaneurs et la glaneuse” / “Toplayıcılar ve Ben” adlı belgeselinin izlenmesini önerdi, neden önemli olduğunu anlattı. Çağdaş sanat ve felsefe ilişkisine dikkat çekti, Fransız felsefeci Jean Francois Lyotard'ın 1985'te Paris Pompidou Kültür Merkezi'ndeki sergisinin önemli olduğunu belirtti. Bu sergi için: https://www.centrepompidou.fr/en/collection/film-and-new-media/les-immateriaux-1985 Ve günümüz filozoflarından Fransız sanatçı Georges Didi-Huberman'ın halen Madrid'de devam eden sergisini işaret etti. Bu sergiyle ilgili için: https://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/in-the-troubled-air NEDEN ESRA YILDIZ? İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi. Lisans derecesini Çevre Mühendisliği (İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ) ve Sosyoloji (İÜ), yüksek lisans (İTÜ) ve doktora derecelerini (İTÜ) Sanat Tarihi bölümünden aldı. Doktora çalışmaları sırasında Technische Universität Berlin'de bulundu. Doktora sonrası çalışmalarını Berlin Humboldt Üniversitesi ve Paris EHESS'te sürdürdü. Critical Arts, African Arts, International Journal of Arts Management gibi dergilerde, Routledge, Intellect, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları gibi yayınevlerinden çıkan kitaplarda akademik çalışmaları, makaleleri yayınlanıyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra, Sayfalar Arasında Bir Gölge: Sahaf Vahan (2010) ve Vatansız (2021) belgesel filmlerinin yönetmeni.
Köşedeki Kitapçı - Neil Oliver & Serdar Uslu & Georges Didi-Huberman
#KöşedekiKitapçı'da bugün
El ojo crítico - Eléctrico 28, Premio El Ojo Crítico de Teatro 2024
Vamos a hablaros del teatro de calle, porque, por primera vez en la historia de los Premios El Ojo Crítico, que están cumpliendo 35 años, hoy el galardón de Teatro ha premiado a una compañía de teatro de calle. Es la compañía Eléctrico 28, como el tranvía Lisboeta, solo que este colectivo interdisciplinar está radicado en Barcelona. Han recibido alguna nominación a los Max, pero este es su primer premio. Lo reciben por ser un referente internacional en el teatro de calle y hacer participe a los propios espectadores. Felicitamos a dos de sus integrantes, ideólogas y creadoras, Alina Stockinger y Daniela Poch. Valencia no se acaba nunca, como canta Julio Bustamante, tampoco la literatura se acaba, pero una DANA se puede llevar por delante muchos libros, destruir librerías, editoriales, distribuidoras... Hoy nos fijamos en los daños que han sufrido y en las muestras de apoyo que han llegado y están por llegar.'En el aire conmovido', de ese verso de Federico García Lorca, de su Romancero gitano, toma su nombre la nueva exposición del Museo Reina Sofía. Una muestra comisariada por el pensador francés Georges Didi-Huberman que reflexiona sobre la emoción y donde nos encontramos obra de Dalí, Miró, Pasolini, Goya... O de supervivientes del bombardeo de Hiroshima.Nos vamos ahora a Barcelona, porque en el Teatre Lliure se ha presentado hoy 'Caramel', una colaboración inédita entre Ariadna y Clara Peya, Las Impuxibles, y Pablo Messiez. Todos reflexionan sobre el consumo en la sociedad actual... ¿Por qué consumimos? ¿Puede ser a la vez liberación y cárcel?Seguimos con FIFTY-FIFTY, uno de los festivales más originales de nuestro país que se celebra desde mañana y hasta el domingo en Avilés, en Asturias. Y con Martín Llade el nuevo disco del contratenor Philippe Jaroussky, 'Schubert lieder'.Escuchar audio
921. Doświadczanie wojny poprzez obrazy. Kriegskartothek Aby'ego Warburga - Hanna Doroszuk
Wykład Hanny Doroszuk zorganizowany w ramach wystawy „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”. Muzeum Narodowe w Warszawie, 6 grudnia 2018 [0h45min]https://wszechnica.org.pl/wyklad/doswiadczanie-wojny-poprzez-obrazy/Wielka Wojna to pierwszy konflikt zbrojny, który pozostawił po sobie tak obszerną dokumentację fotograficzną. Przebieg wydarzeń relacjonowano w prasie, uwieczniano na kartkach pocztowych, plakatach i ulotkach propagandowych. Zalewające Europę obrazy wojny posłużyły m.in. Aby'emu Warburgowi do stworzenia Kriegskartothek, swoistego atlasu ikonografii wojennej. Aby Warburg – a kto to taki? Niemiecki historyk sztuki. Ale również: prorok, wizjoner, pacjent szpitala psychiatrycznego. Autor nigdy nieukończonego projektu, który miał wstrząsnąć podstawami naszej wiedzy o obrazach. Psychohistoryk, który (jak sam pisał) badał schizofreniczne rozdarcie wewnątrz naszej kultury. Mimo że zmarł ponad osiemdziesiąt lat temu, a jego życie bardziej niż do późnej nowoczesności przynależy do czasów środkowoeuropejskiego fin de siécle'u, niewiele jest w dzisiejszej humanistyce postaci równie fascynujących. Za życia niedoceniony, po śmierci szybko zapomniany, a z pewnością zrozumiany tylko częściowo – dziś powraca triumfalnie, by uwiarygodnić niektóre snute przez nas narracje. Ślady jego widmowych obecności, a także ślady naszych równie widmowych ich poszukiwań, odnaleźć można w wielu miejscach: to właśnie dziś, myśląc o nowoczesności, o historii kultury, historii obrazów i ich meandrach, coraz częściej „myślimy Warburgiem”. A może raczej jest tak, jak pisał Georges Didi-Huberman: niepostrzeżenie Warburg stał się naszą obsesją; widmem, dybukiem, który nawiedza nas bezustannie. Ten utajony, senny wpływ ujawnia się również, coraz mocniej, w świecie dzisiejszej sztuki. Już nie tylko wśród akademickich badaczy, ale także kuratorów i artystów (źródło: https://www.dwutygodnik.com/artykul/3120-aby-warburg-i-jego-przybrane-dzieci.html) *** Wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie "Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918" zorganizowana została na cześć 100-lecia odzyskania Niepodległości. Jej głównym założeniem jest skonfrontowanie przedstawień wydarzeń historycznych i politycznych z przemianami polskiej sztuki na progu Niepodległości. Wystawę zwiedzać można do 17 marca 2019 roku. Wystawie towarzyszą wykłady, oprowadzania kuratorskie i warsztaty. Więcej na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie. Znajdź nas: https://www.youtube.com/c/WszechnicaFWW/ https://www.facebook.com/WszechnicaFWW1/ https://anchor.fm/wszechnicaorgpl---historia https://anchor.fm/wszechnica-fww-nauka https://wszechnica.org.pl/ #niepodległość #żeromski #piłsudski #1918 #muzeumnarodowe
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/new-books-network
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/history
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/genocide-studies
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/intellectual-history
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/european-studies
Georges Didi-Huberman - Faits d'affects. Vol. 2. La fabrique des émotions disjointes
"Faits d'affects. Vol. 2. La fabrique des émotions disjointes" aux éditions de Minuit. Entretien avec Jérémy Gadras.Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Maria Nadotti "Per che obbedire? Georges Didi-Huberman
Maria Nadotti"Per che obbedire?"Georges Didi-HubermanLuca Sossella Editorewww.lucasossellaeditore.itUn insieme di piccole conferenze che si rivolgono ai ragazzi (dai dieci ai quindici anni) e a coloro che li accompagnano.“Bambini o adulti, poco importa, ci viene costantemente chiesto di obbedire. E per cosa, in vista di cosa, perché? Quando obbedire ci protegge e quando invece ci intrappola? Quando obbedire ci salva dal peggio o ci priva del meglio? Obbedire ci dà spazio o ci immobilizza? Come avviene il passaggio tra l'essere costretti a obbedire (negli spazi disciplinari veri e propri) e l'essere liberi di obbedire (negli spazi che sono nostri, gli spazi “normali” del commercio e della comunicazione)?Obbedire ciecamente. Disobbedire gratuitamente. Due modi di mettere a dormire il pensiero, di tacitare la coscienza, di non scegliere. Due automatismi deresponsabilizzanti. Partendo da qui, Didi-Huberman ri-percorre alcune tappe della storia recente. Chi era il Male assoluto all'epoca della sua infanzia? Senza alcun dubbio, Adolf Hitler. Eppure il dubbio si insinua istantaneamente, con la logica stringente e la serafica perplessità che sono proprie dei bambini: possibile che quel capo di stato abbia fatto tutto da solo? — Maria Nadotti"Per che obbedire?" Cura e traduzione di Maria Nadotti. Georges Didi-Huberman (1953) è un filosofo e storico dell'arte francese. Si è occupato in particolare della storiografia d'arte, elaborando un'interpretazione della pittura rinascimentale incisiva e originale. Ha insegnato in diverse università straniere (Johns Hopkins, Berkeley, Univ. di Berlino) e diretto varie esposizioni. Ha vissuto alcuni anni a Roma, pensionante dell'Accademia di Francia di Villa Medici e a Firenze, ospite della Fondazione Bernard Berenson di Villa I Tatti. Insegna all'Ehess – √âcole des hautes études en sciences sociales.Maria Nadotti (Torino, 1949) è giornalista, saggista, consulente editoriale e traduttrice e collabora con testate cartacee e online italiane e internazionali. Di recente ha curato e tradotto il saggio di Georges Didi-Huberman, Per che obbedire? (Luca Sossella editore, 2023).IL POSTO DELLE PAROLEascoltare fa pensarewww.ilpostodelleparole.itDiventa un supporter di questo podcast: https://www.spreaker.com/podcast/il-posto-delle-parole--1487855/support.
De klassiska muserna har fallit. Ner i det mänskliga. Ner mot gatan och köket. Rebecka Kärde reflekterar över ett skifte som berättar om konstens förändrade roll i kulturen. Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play. ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Minnet är konstens moder. I alla fall om man ska tro den grekiske poeten Hesiodos. Enligt honom resulterade en nio dagar lång förbindelse mellan Zeus och minnets gudinna Mnemosyne i att den senare födde lika många döttrar. De fick namnen Kleio, Euterpe, Erato, Polyhymnia, Melpomene, Ourania, Therpsichore, Thaleia och Kalliope. Tillsammans kallas de för muserna. Från dessa nio systrar flödar den poetiska inspirationen, och den som vill dansa, dikta, sjunga eller ägna sig åt någon av de andra musiska konstarterna måste göra det med deras välsignelse.Hur får man kontakt med muserna? I Hesiodos fall kommer uppvaktningen oväntat. En dag, då han som vanligt vallar sina får på berget Helikon, dyker systrarna plötsligt upp från ingenstans. De börjar förolämpa den blivande poeten. Du lantliga fä, ropar de, i Ingvar Björkesons översättning – du som ”bara tänker på buken!” Sedan säger de att mycket av det de berättar i själva verket är lögn. Men när de så har lust, kan de också tala sanning. Hesiodos förses med en stav och en lagergren. Hans bröst fylls av en ”gudomlig röst för att sjunga om svunnen tid och kommande”. I ett slag är herden redo att dikta. Muserna har gjort honom till poet.Episoden återges i den episka lärodikten ”Theogonin”, som Hesiodos komponerade omkring år 700 före Kristus, och som därmed är den äldsta bevarade källan till myten om muserna. Frågan är vad som hänt med dem sedan dess. När man talar om systrarna idag är det ju oftast i en rätt så annorlunda bemärkelse. För det första uppträder de i singularis, som musan. För det andra är denna musa mänsklig. Kanske var hon gift med en berömd manlig 1900-talskonstnär, i vars bilder eller dikter hon återfinns, och som hon gav upp sitt eget konstnärskap för att vårda. Att vara någons musa – nej, det är för de flesta ingen lockande roll. Som den amerikanska poeten Louise Glück skriver i en dikt: ”Ingen vill vara musan. När allt kommer omkring, vill alla vara Orfeus”.Hur blev det så här? När förvandlades musan från generativ kraft till stum sköterska? Kanske kan man närma sig ett svar genom den franske konsthistorikern Georges Didi-Huberman. I boken ”Ninfa moderna” diskuterar han en besläktad figur, nymfen, och hur hon har gestaltats genom århundradena. Didi-Huberman utgår från det bildmaterial som i början av 1900-talet samlades ihop av den tyska kulturhistorikern Aby Warburg. Denne ägnade sina sista år i livet åt ett ofullbordat jätteprojekt som han (med hänvisning till musernas moder) kallade för Bilderatlas Mnemosyne. Warburg var intresserad av hur former och motiv från antiken lever kvar i senare tiders europeisk bildkonst. Atlasen, som består av ett sextiotal stora planscher med fastnålade fotografier och konstreproduktioner, är hans försök att i collageform kartlägga släktbanden. Till exempel kan en renässansmålning placeras bredvid en romersk skulptur. Det som förbinder konstverken är en gemensam detalj: ett plagg som faller snarlikt över en skuldra, en hand som gör en identisk gest. Det är som om antiken hemsöker moderniteten.Didi-Hubermans undersökning, som sträcker sig från antiken till den florentinska renässansen, bygger alltså på Warburgs atlas. Och när han betraktar nymferna upptäcker han något märkvärdigt. Nymfen har fallit. Ju längre bort från antiken vi kommer, desto tydligare närmar hon sig marken. Hon sjunker från gudinnans höjder längst upp i bilden till dess nedre kant. Där förblir hon liggande. Samma öde drabbar hennes kläder. De tidiga, grekiska nymferna är draperade i långa, mantelliknande klädesplagg. Men med tiden blir nymfen mer och mer avklädd. Axlarna blottas, under renässansen brösten. Tizian porträtterar henne som i princip naken. I hans målning ”Nymf och herde” ligger hon med ryggen och baken vänd mot betraktaren, med ett ynka tygstycke kring midjan. I en annan, ”Backanal på Andros”, återfinns hon med bakåtböjt huvud i bildens högra hörn. Brösten och könet är blottade, liksom strupen. Draperingen ligger slängd som en eftertanke över armen. Nymfen är redo att intas.Didi-Hubermans och Warburgs nymfer är nu inte identiska med vare sig muserna eller nymfen som vi känner henne från den grekiska mytologin. Snarare syftar de på en arketyp i form av en gudinnelik kvinnogestalt – ung, vacker, lekfull, med svallande hår och suggestiv blick. Ungefär så brukar också muserna avbildas. Och man skulle kunna hävda att något liknande hänt med dem. Muserna har sjunkit från Helikon, ner till jorden, till köket och gatan. Kanske börjar fallet redan efter Hesiodos. Hos många senare antika författare är muserna några man åberopar, snarare än uppsöks av. Samtidigt betvivlas deras existens. Den romerska poeten Horatius ber i ett av sina oden musan Kalliope att stiga ner till honom från himlen, men säger sig vara osäker på om rösten han sedan hör verkligen är hennes, eller om han drabbats av ett ”ljuvligt vansinne”. Propertius, en annan romersk diktare, talar ofta om sin musa, som om en av dem stod redo just för honom. Så skulle Hesiodos knappast formulera sig. Muserna är inte hans – det är ju han som är deras!Långt efter antiken fortsätter muserna dyka upp i konsten. Dante åkallar dem i ”Den gudomliga komedin”, till exempel i Skärselden, då han ber dem om hjälp med att besjunga ting ”som knappt tanken fattar”. Men när man säger ordet ”musa” i samband med Dante tänker de flesta på Beatrice. Hon uppträder som en guide genom paradiset i den sista delen av ”Den gudomliga komedin”, och var med viss sannolikhet en sublimering av Dantes ungdomskärlek med samma namn. Inspirationen härrör alltså från en levande, högst verklig person – som, till skillnad från de antika muserna, knappast delat med sig av den medvetet. Samma gäller Laura i den något yngre Petrarcas sonetter. Ännu senare, hos Baudelaire, har musan blivit prostituerad. I dikten ”La muse vénale” – ungefär ”den köpbara musan” – förtjänar diktens du sitt uppehälle genom att gå på gatan.Mycket kan sägas om kvinnosynen i de nämnda dikterna. Men det är knappast så enkelt som att musans nya skepnad motsvarar en parallell omvandling av könsordningen. Snarare speglar den konstens förändrade betydelse, från kollektiv praktik till uttryck för individualitet. Det säger ju sig självt att den diktare som själv är gudomlig inte kan vara underställd en skara bråkiga systrar.Fast vore det verkligen så illa? Finns det inte något frigörande i att tänka på dikten så som Hesiodos: som något som kommer utifrån, ovanifrån, snarare än från den rädda lilla själ man bär inom sig? Litteraturen är ju trots allt inte ens egen. Den föds ur de texter som föregått den. Dess moder är minnets gudinna – och minnet är något gemensamt.Rebecka Kärde, litteraturkritiker och grecistLitteraturGeorges Didi-Huberman: Ninfa moderna – essä över fallen drapering. Översättare: Jakob Svedberg. Bokförlaget Faethon, 2023.Hesiodos: Theogonin och Verk och dagar. Översättning: Ingvar Björkeson. Natur och kultur, 2003.
Penser les images 1/5 : Georges Didi-Huberman : "Penser les images, c'est penser un recommencement"
durée : 00:43:52 - Par les temps qui courent - par : Marie Richeux - Nous recevons le philosophe et historien de l'art Georges Didi-Huberman pour nous parler de son exposition "Tables de montage" visible à L'Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC) -l'Abbaye d'Ardenne jusqu'au 22 octobre 2023. - invités : Georges Didi-Huberman Historien de l'art et philosophe, maître de conférences à l'EHESS
Djamel Klouche et Caroline Poulin sont architectes et co-fondent l'AUC, bureau d'architecture et d'urbanisme à Paris en 1996 avec François Decoster. l'AUC vient du latin Ab Urbe Condita qui signifie “depuis la fondation de la ville”. Avec une casquette d'urbaniste, leurs projets croisent des échelles de temps et de dimensions variées, allant du dessin de la chaussée à “la fabrique du territoire par le non-plan”. Une discussion sur l'origine de leur travail et aussi sur celle de la ville, avec toute l'intensité des situations qui la caractérisent. Les conseils lecture de Djamel et Caroline : Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images, Patrick Boucheron, 2013. Léonard et Machiavel, Patrick Boucheron, 2008. L'Image survivante, Georges Didi-Huberman, 2002. Entendre la Terre: À l'écoute des milieux humains. Entretiens avec Damien Deville Augustin Berque, 2022. — Propos recueillis par Solène Hoffmann et Cyril Veillon. Production: Archizoom / Direction artistique et montage: Marie Geiser / Jingle et musique: Cédric Liardet
Georges Didi-Huberman : Faits d'affects. Vol. 1. Brouillards de peines et de désirs
"Faits d'affects. Vol. 1. Brouillards de peines et de désirs" aux éditions de Minuit.
durée : 00:53:49 - L'Heure bleue - Georges Didi-Huberman est l'invité de l'Heure bleue à l'occasion des parutions de son dernier livre "Brouillards de peines et de désirs. Faits d'affects, 1" (Minuit) et du numéro de la revue Critique (Minuit) consacré à son œuvre.
Francesco Fogliotti "Sentire il grisou" Georges Didi-Huberman
Francesco Fogliotti"Sentire il grisou"Georges Didi-HubermanOrthotes Editricehttps://www.orthotes.com/La domanda che Georges Didi-Huberman pone all'inizio di Sentire il grisou è vertiginosa: come veder venire la catastrofe? Come percepire il livello di grisou nell'aria, questo gas inodore e incolore altamente infiammabile che saturando i pozzi minerari rischia di provocare un'esplosione? Era uso corrente, presso i minatori di un tempo, discendere nel ventre della terra con un pulcino in gabbia: brutto segno quando le ali iniziavano a fremere… Secondo Didi-Huberman le immagini hanno la stessa funzione, al contempo divinatoria e alare: se iniziano a fremere, ad agitarsi, a smarcarsi dalla quieta “normalità” che le rende quasi invisibili (e di conseguenza illeggibili e inconoscibili), qualcosa sta per spiccare il volo. Può trattarsi di una lotta comune, come mostrano le pagine dedicate all'occupazione spagnola della miniera di Santa Cruz del Sil, che la cantaora Rocío Márquez trasporrà in canto e Carlos Caracas in immagini “militanti”, oppure di uno scenario “deprimente”: quello a cui assistette Pier Paolo Pasolini di fronte alle immagini del cinegiornale Mondo libero dopo aver firmato il contratto per ricavarne un film. Eppure, attraverso un'operazione di montaggio in cui “rime di voci” e “rime di immagini” innescano un potente movimento dialettico, è sorto (o si è sollevato) La rabbia, film “lirico-documentaristico” che Didi-Huberman non esita a definire «un atlante in movimento dell'ingiustizia contemporanea» e di cui offre, in queste pagine, una lettura nuova e penetrante.Sentire il grisou, com'è difficile. Il grisou è un gas inodore e incolore. Come sentirlo o vederlo allora, malgrado tutto? Detto altrimenti: come veder venire la catastrofe? E quali sarebbero gli organi sensoriali di un simile veder-venire, di un simile sguardo-tempo? L'infinita crudeltà delle catastrofi è che diventano visibili troppo tardi, quando ormai hanno avuto luogo. Le più visibili – le più evidenti, le più studiate, le più universali – le catastrofi insomma alle quali si fa spontaneamente ricorso per intendere che cos'è una catastrofe, sono catastrofi che furono, catastrofi del passato; quelle che qualcun altro, prima di noi, non ha saputo o voluto veder venire, quelle che qualcun altro non è riuscito a impedire. Le riconosciamo tanto più facilmente perché oggi non ne siamo affatto – o più – i responsabili.Una catastrofe si annuncia raramente come tale. È facile dire, nell'assoluto del passato: “Fu una catastrofe”, quando tutto è esploso, quando ormai a morire sono stati in molti. È altrettanto facile dire, nell'assoluto del futuro: “Sarà una catastrofe” per tutti e tutto, dato che tutti e tutto, è evidente, un giorno spariranno per lenta o rapida distruzione. Ma è ben più difficile poter affermare: “Eccola che arriva, proprio adesso, qui, la catastrofe”, eccola arrivare in una configurazione che eravamo lungi dall'immaginare così fragile, così esposta al fuoco della storia. Vedere una catastrofe è vederla venire nella sua singolarità mascherata, nella particolare “incrinatura silenziosa”…IL POSTO DELLE PAROLEAscoltare fa Pensarehttps://ilpostodelleparole.it/
« HISTOIRE DU SENSIBLE, HISTOIRE SENSIBLE » : GEORGES DIDI-HUBERMAN
En conversation avec Hervé Mazurel, Quentin Deluermoz & Anouche Kunth Rencontre proposée par la revue Sensibilités « Il n'y pas d'histoire qui ne soit sensible de part en part ». Georges Didi-Huberman La revue Sensibilités s'emploie à mieux saisir les ressorts sensibles de la vie collective. Elle s'efforce de décrire l'infinie variété des modes de présence au monde. Ou, dit autrement, des façons de sentir et de ressentir d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Ce faisant, elle explore la vie affective dans toutes ses dimensions : pulsions et désirs, perceptions et émotions, sentiments, passions et autres fantasmes… Pour fêter la parution de son 10e numéro, la revue et son comité de rédaction, en partenariat avec les éditions Anamosa, ont souhaité inviter le philosophe et historien d'art Georges Didi-Huberman pour discuter de son approche de la vie sensible et de ce qu'il appelle les « faits d'affects ». Les historiens Quentin Deluermoz, Anouche Kunth et Hervé Mazurel se relaieront pour évoquer avec lui la vie longue de l'image survivante, les métamorphoses du pathos et de ses représentations, la contagiosité des émotions politiques et, avec elle, des gestes de révolte et de soulèvement. Pour l'anniversaire de la revue Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales (Anamosa), Quentin Deluermoz, Anouche Kunth et Hervé Mazurel, trois de ses animateurs, discuteront avec Georges Didi-Huberman de ses derniers livres autour de la vie sensible et des faits d'affects. À lire – La revue Sensibilités n°10, « La guerre transmise », éd. Anamosa, 2021. – Georges Didi-Huberman, Le Témoin jusqu'au bout. Une lecture de Victor Klemperer, Les éditions de Minuit, 2022.
Criação Ep#89 - 03/05/2022 - Larissa Lacerda e a criação da luz para a peça "Vermelho Melodrama"
Larissa Lacerda é Multiartista, pesquisadora, desenvolve uma trajetória entre a música, as letras e a cena, com experiências fluidas e integradas. Atua como iluminadora, cantora, atriz, diretora e criadora audiovisual, consequência de sua busca por um percurso múltiplo. É Mestre em Artes Cênicas (PPGAC/UFBA), bacharel em Direção Teatral (UFBA), licenciada em Letras Vernáculas (UFBA). E é integrante da Dimenti, que é uma produtora cultural e um ambiente de criação e difusão artística. Junto com a Dimenti, tem sido coordenadora técnica e curadora do festival IC - Encontro de Artes; é idealizadora e coordenadora da ILUMINA! projeto de formação na área de iluminação voltado para mulheres. É diretora geral e diretora de fotografia do TOCA! na Mão, braço audiovisual do projeto TOCA! Entre suas realizações como iluminadora estão os festivais Afropunk Bahia (2021) e Concha Negra (2019/2020); a comemoração dos 40 anos da Noite da Beleza Negra do Ilê (2019), a peça premiada como Melhor Espetáculo (Prêmio Braskem de Teatro 2019) Vermelho Melodrama (2019). @larissalacerda Release: Um melodrama sobre uma carta que não foi entregue. A história de três órfãos que foram criados como irmãos e cujas vidas foram atravessadas por amores inconfessos, segredos do passado e grandes reviravoltas. “Vermelho Melodrama” mergulha no gênero melodramático, falando ao coração com desmedimento e passionalidade, articulando a dramaturgia do autor baiano Gildon Oliveira com escritoras/escritores como Angela Davis, Linn da Quebrada, Clarice Lispector e Georges Didi-Huberman. Em meio a tempestades de emoções, algumas perguntas vêm à tona: você acredita no destino? Como ativar emoções revolucionárias? Quem tem direito a melodrama por amor? Até quando vai o melodrama da vida política no Brasil? Ficha técnica: Obra original: Gildon Oliveira (Título original: “Vermelho rubro amoroso… profundo, insistente e definitivo!”) Direção e Adaptação: Jorge Alencar Criação e elenco: Eduardo Gomes, Fábio Osório Monteiro, Lia Lordelo, Neto Machado e Véu Pessoa Canções: Leo Fressato Direção Musical e Trilha Sonora Original: Luciano Salvador Bahia Direção de arte e identidade visual: Tanto - criações compartilhadas (Daniel Sabóia, Fábio Steque e Patrícia Almeida) Figurino, adereços e máscaras: Luiz Santana Assistência de Direção: Larissa Lacerda e Marina Martinelli Luz light design: Larissa Lacerda Colaboração artística: Ellen Mello e Jacyan Castilho Supervisão vocal: Manuela Rodrigues Operação de som e assistência de luz: Felipe Viguini Operação de luz: Larissa Lacerda e Mariana Passos Técnico de som: Igor Pimenta Oficina de Melodrama: Paulo Merísio Direção de Produção: Ellen Mello Equipe de Produção: Marina Martinelli, Natália Valério, Priscila Santos, Marília Pereira e Fábio Osório Monteiro Financeiro: Marília Pereira e Priscila Santos Comunicação: Marcatexto
Dans le cadre du cycle « Dans la bibliothèque de », conçu en partenariat avec AOC et animé par Sylvain Bourmeau, la Fondation Pernod Ricard reçoit le philosophe et historien de l'art prolifique Georges Didi-Huberman. Lors de cette rencontre, Sylvain Bourmeau invitera Georges Didi-Huberman à nous ouvrir les portes de sa bibliothèque. Directeur d'études de l'EHESS, Georges Didi-Huberman est l'auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages qui interrogent les articulations entre iconographie, histoire et mémoires. Depuis la Renaissance jusqu'aux travaux d'artistes contemporain·es, la pensée de Didi-Huberman se met également à l'œuvre en tant que commissaire d'expositions marquées par une lecture politique des contextes d'apparition des images : « Nouvelles histoires de fantômes » avec Arno Gisinger au Palais de Tokyo en 2014 et « SOULÈVEMENTS » au Jeu de Paume en 2017. Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Aby Warburg, le prix Max Weber, le prix Alexander von Humboldt, le prix Theodor W. Adorno et, le 26 septembre 2021, le prix spécial Walter Benjamin pour l'ensemble de son œuvre, pour l'apport essentiel qu'elle constitue à l'actualisation de la pensée de Walter Benjamin au XXIe siècle.
durée : 00:54:29 - L'Heure bleue - par : Laure Adler, Céline Villegas - L'Heure Bleue s'interroge sur la guerre et les images avec deux grands connaisseurs en la matière, Georges Didi-Huberman, historien de l'art, et Marie-José Mondzain, spécialiste de l'art et des images.
aux éditions Minuit.
No 44º episódio do podcast, a minha conversa é com a Maria Homem. Ela é psicanalista, professora da FAAP, colunista da Folha de São Paulo e autora de Lupa da Alma e Coisa de Menina, entre muitos outros textos. Além disso, a Maria dá vários cursos (que você pode encontrar no site dela, tem o link aí embaixo). Nosso papo foi muito importante, bem focado em como entendemos diálogos entre as pessoas num momento tão polarizado como este que estamos vivendo. Também falamos sobre maternidade e outros temas fantásticos de uma pessoa que sabe tanto sobre tudo! Você pode encontrar a Maria Homem em: Instagram: https://www.instagram.com/maria.homem/ Twitter: https://twitter.com/mariahomem Youtube: https://www.youtube.com/c/MariaHomem Site: https://mariahomem.com/ Eu sou a Gabi Oliveira, antropóloga, mãe de dois e professora, e este é o meu podcast, “Uma estrangeira”. Você também pode me encontrar no meu instagram @gabi_instaaberto. Para contar o que você está achando do podcast, mandar sugestões, perguntas e acompanhar os episódios, é só seguir o instagram @umaestrangeira_podcast ou escrever para o email umaestrangeirapodcast@gmail.com. Este podcast é produzido e editado por Fabio Uehara (@fauehara) e revisado por Tatiana Yoshizumi. Neste episódio foram citados: Coisa de Menina?: Uma Conversa sobre Gênero, Sexualidade, Maternidade e Feminismo, de Maria Homem: https://amzn.to/3oli8GG Lupa da Alma: Quarentena-Revelação, de Maria Homem: https://amzn.to/3GhiV1q Que emoção! Que emoção?, de Georges Didi-Huberman: https://amzn.to/3AVQJAk --- Send in a voice message: https://anchor.fm/uma-estrangeira/message
Bras ouverts jusque dans le feu | Conférence « Aimer ne consiste qu'à désirer une chose pour elle-même ». Ces paroles de Saint-Augustin ont incité Hannah Arendt à écrire son premier livre (sa thèse de philosophie) sur Le Concept d'amour. Décision frappante par contraste avec l'absence remarquable du thème de l'amour chez Heidegger. On interrogera la dimension existentielle et poétique de ce geste, ouvrir les bras à l'autre, en relisant la correspondance entre Marina Tsvétaïeva et Rainer Maria Rilke. Georges Didi-Huberman, philosophe et historien de l'art, enseigne à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris). Il a enseigné dans de nombreuses universités étrangères et a reçu de nombreuses distinctions. Il a dirigé plusieurs expositions internationales et a publié une soixantaine d'ouvrages sur l'histoire et la théorie des images. Parmi les plus récents : Désirer désobéir (Ed. Minuit, 2019), Pour commencer encore (Ed. Argol, 2019) et Éparses (Ed. Minuit, 2020). En partenariat avec le Centre de culture ABC et le TPR dans le cadre de BIG BOUNCE : des rebonds pour penser et pour se réapproprier le présent. Enregistrée au Club 44 le 20 octobre 2021
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/genocide-studies
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/european-studies
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/intellectual-history
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/history
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/german-studies
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/new-books-network
Dora Osborne, "What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture" (Camden House, 2020)
With the passing of those who witnessed National Socialism and the Holocaust, the archive matters as never before. However, the material that remains for the work of remembering and commemorating this period of history is determined by both the bureaucratic excesses of the Nazi regime and the attempt to eradicate its victims without trace. Dora Osborne's book What Remains: The Post-Holocaust Archive in German Memory Culture (Camden House, 2020) argues that memory culture in the Berlin Republic is marked by an archival turn that reflects this shift from embodied to externalized, material memory and responds to the particular status of the archive "after Auschwitz." What remains in this late phase of memory culture is the post-Holocaust archive, which at once ensures and haunts the future of Holocaust memory. Drawing on the thinking of Freud, Derrida, and Georges Didi-Huberman, this book traces the political, ethical, and aesthetic implications of the archival turn in contemporary German memory culture across different media and genres. In its discussion of recent memorials, documentary film and theater, as well as prose narratives, all of which engage with the material legacy of the Nazi past, it argues that the performance of “archive work” is not only crucial to contemporary memory work but also fundamentally challenges it. Lea Greenberg is a scholar of German studies with a particular focus on German Jewish and Yiddish literature and culture; critical gender studies; multilingualism; and literature of the post-Yugoslav diaspora. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/book-of-the-day
#30 - “Conservarei, guardarei, esquecerei?”: Reflexões sobre Cascas, de Georges Didi-Huberman [por Elcio Cornelsen]
Georges Didi-Huberman - I mostri dell'immaginazione - Festival della Mente 2010
In un'acquaforte molto celebre del pittore spagnolo Francisco Goya (il foglio numero 43 dei Capricci) vi è un'iscrizione che recita “il sogno (o il sonno) della ragione genera mostri”. Georges Didi – Huberman cercherà di spiegare ed analizzare quest'opera di Goya, come “un'immagine dialettica”. L'indagine e l'analisi di quella che può essere considerata una politica dell'immaginazione, realizzata da uno dei più originali e attenti studiosi di estetica.
Une table ronde vue de haut regarde les spectateurs comme un œil. C’est là, à l’aide de quelques cartes postales, des reproductions d’œuvres, que dix figures du monde de l’art évoquent, à tour de rôle, le parcours d’Hubert Damisch, philosophe, théoricien et historien de l’art, né en 1928, mort en 2017.Avec des analyses, ou des anecdotes, les spectateurs entrent dans le monde d'Hubert Damisch et découvrent une histoire de l’art décloisonnée qui va de Piero della Francesca à Frank Sinatra, de Signorelli à Fritz Lang.Entrer dans le regard d’un grand historien de l’art : c’est ce que propose ce film, dernier de la série Un œil, une histoire. Une immense personnalité, racontée pour une fois « in absentia », par d’autres que lui. Les archives de Teri Wehn Damisch, réalisatrice et femme de l’historien de l’art, complètent le portrait et apportent une proximité hors du commun avec le grand intellectuel. Avec la participation de Jean-Claude Bonne, Giovanni Careri, Jean-Louis Cohen, Jean-Pierre Criqui, Georges Didi-Huberman, Rosalind Krauss, Angela Mengoni, Dominique Païni, Daniel Soutif et Gérard Wajcman.
Podcast « L’Œil écoute » #14 : Sophie Zénon (1er volet)
Sophie Zénon sait que l’histoire est une « matière vivante ». Historienne de formation, inspirée par les travaux de Georges Didi-Huberman, elle a développé une démarche holistique qui s’intéresse plutôt aux petites histoires anonymes qu’à l’épopée des grands bouleversements, et qui donne, en plus d’un solide socle théorique, une vraie place à l’instinct de la chercheuse, l’attirant vers des dimensions oniriques, voire chamaniques. Ses thèmes de prédilection, depuis qu’elle a commencé à utiliser la photographie comme outil de recherche en 1996 jusqu’à en faire une pratique artistique à part entière à partir de 2001, tirent leur source d’un voyage initiatique en Mongolie, qu’elle qualifie volontiers d’« expérience de vie » fondatrice... La suite sur hemeria.com
04 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noireRésuméEntre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d'une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d'un récit épidémique.SommaireFestival d'Avignon, cour d'honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent)« Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud,« Le théâtre et la peste », 1938)Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ?Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordéeVoir l'histoire à travers « l'imagination de la vérité du réel » (Goethe)Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l'imaginaire« Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983)Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d'une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu,il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman)La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978Une « rupture inhumaine » dans l'ordre ordinaire des joursLa persistance historiographique de « l'âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L'odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd'hui, 2019)Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l'homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960)Les traits anthropologiques fondamentaux d'une « société de peste »« Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu'il s'agisse d'un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d'anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau)« l'homérique bataille de l'explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l'acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984)Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault« Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975)Visible dans l'archive et rendant l'archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplaritéA Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux)De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l'ombre du paradigmeLa fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale« Evidemment que c'est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n'est jamais trop prudent. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux)Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéroCharles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l'épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
04 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noireRésuméEntre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d'une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d'un récit épidémique.SommaireFestival d'Avignon, cour d'honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent)« Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud,« Le théâtre et la peste », 1938)Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ?Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordéeVoir l'histoire à travers « l'imagination de la vérité du réel » (Goethe)Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l'imaginaire« Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983)Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d'une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu,il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman)La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978Une « rupture inhumaine » dans l'ordre ordinaire des joursLa persistance historiographique de « l'âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L'odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd'hui, 2019)Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l'homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960)Les traits anthropologiques fondamentaux d'une « société de peste »« Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu'il s'agisse d'un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d'anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau)« l'homérique bataille de l'explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l'acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984)Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault« Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975)Visible dans l'archive et rendant l'archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplaritéA Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux)De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l'ombre du paradigmeLa fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale« Evidemment que c'est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n'est jamais trop prudent. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux)Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéroCharles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l'épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
03 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice BoucheronCollège de FranceAnnée 2020-2021La peste noireRésuméEntre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d'une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d'un récit épidémique.SommaireFestival d'Avignon, cour d'honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent)« Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud,« Le théâtre et la peste », 1938)Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ?Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordéeVoir l'histoire à travers « l'imagination de la vérité du réel » (Goethe)Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l'imaginaire« Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983)Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d'une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu,il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu'il n'arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman)La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978Une « rupture inhumaine » dans l'ordre ordinaire des joursLa persistance historiographique de « l'âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L'odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd'hui, 2019)Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l'homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960)Les traits anthropologiques fondamentaux d'une « société de peste »« Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu'il s'agisse d'un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d'anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau)« l'homérique bataille de l'explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l'acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984)Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault« Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975)Visible dans l'archive et rendant l'archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplaritéA Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux)De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l'ombre du paradigmeLa fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale« Evidemment que c'est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n'est jamais trop prudent. La peste donc, mais d'abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux)Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéroCharles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l'épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
02 - La peste noire - VIDEO
Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Patrice Boucheron Collège de France Année 2020-2021 La peste noire Résumé Entre fiction littéraire de la fête collective chez Jean Delumeau et fiction politique de la société de peste chez Michel Foucault, la séance interroge la constitution des savoirs historiens sur les épidémies de peste dans les années 1975-1985. Elle pose comme hypothèse que celle-ci est indissociable d’une certaine hantise contemporaine, ramenant le théâtre de la contagion aux structures narratives d’un récit épidémique. Sommaire Festival d’Avignon, cour d’honneur, 9 juillet 1983 : « dans ce palais, il y a eu la peste et la papauté, ensemble, en 1348 » (Jean-Pierre Vincent) « Il y a dans le théâtre comme dans la peste quelque chose à la fois de victorieux et de vengeur (Antonin Artaud, « Le théâtre et la peste », 1938) Comment une société organise-t-elle son indestructibilité ? Microbiologie, environnement, world history : une histoire triplement débordée Voir l’histoire à travers « l’imagination de la vérité du réel » (Goethe) Retour sur la « terrible puanteur des morts » à Marseille en 1347 : mémoire et inflammation de l’imaginaire « Les gestes de la peste, comme ceux de la peur et de la douleur en général, délivrent une mémoire dont nous avons perdu le souvenir » (Georges Didi-Huberman, Memorandum de la peste, 1983) Ecrire dans un théâtre dépeuplé : récit d’une coïncidence différée Une survivance chorale : « Mais à la peste il faut bien un narrateur, un qui puisse, qui ose dire mes yeux ont tout vu, il faut bien, tâche lourde ou non, un arpenteur du désastre, un mélancolique, un dont la maladie différait un peu des autres, maladie à la mort, non maladie mortelle, encore. Un qui pressent qu’il n’arrive pas à mourir » (Georges Didi-Huberman) La peste comme fête collective et comme cité assiégée : Jean Delumeau, La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles), 1978 Une « rupture inhumaine » dans l’ordre ordinaire des jours La persistance historiographique de « l’âpre saveur de la vie » (Elodie Lecuppre-Desjardins dir., L’odeur du sang et des roses. Relire Johan Huizinga aujourd’hui, 2019) Histoire des mentalités, médecine et psychologie des foules : la « dissolution de l’homme moyen » (Paul Fréour, « Réactions des populations atteintes par une grande épidémie », Revue de psychologie des peuples, 1960) Les traits anthropologiques fondamentaux d’une « société de peste » « Le Journal de la peste de Daniel Defoe — notre meilleur document sur une peste bien qu’il s’agisse d’un roman — est rempli de scènes hallucinantes et d’anecdotes bouleversantes » (Jean Delumeau) « l’homérique bataille de l’explosion et du colmatage, de la déliquescence et du durcissement, du désordre fou et de l’acharnée volonté de mise en ordre » (Bernard Chartreux, Dernières nouvelles de la Peste, 1984) Fiction littéraire de la fête chez Jean Delumeau, fiction politique de la peste chez Michel Foucault « Voici, selon un règlement de la peste de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu’il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville » (Surveiller et punir, 1975) Visible dans l’archive et rendant l’archive lisible : le paradigme foucaldien, entre singularité et exemplarité A Marseille en 1720, société de surveillance et « expériences ordinaires de la peste » (Fleur Beauvieux) De 1347 à 1722, la deuxième pandémie de peste : à l’ombre du paradigme La fondation paradoxale des années 1975-1985 : savoirs historiens, indistinction chronologique et hantise théâtrale « Evidemment que c’est la peste. En voici les dernières nouvelles, on n’est jamais trop prudent. La peste donc, mais d’abord une peste, peu importe laquelle… » (Bernard Chartreux) Théâtre de la contagion et récit épidémique : trois actes et un patient zéro Charles Rosenberg, « What Is an Epidemic ? AIDS in Historical Perspective », Daedalus, 1989 Le troisième acte ouvre seulement la possibilité de la fin de l’épidémie : ça finit quand, vraiment ?
Pierandrea Amato"La rivolta"con un intervento di Georges Didi-HubermanEdizioni Cronopiohttp://www.cronopio.it/edizioni/“La destituzione ha un rapporto con l'esistenza – riprendo qui il tema delle primissime righe de La rivolta – solo se si temporalizza, se si prolunga in un futuro che non prende certamente le forme di un ‘programma', ma di un desiderio. Se con un gesto della mano spazzo via tutti gli oggetti posati sul tavolo davanti a me, quel che destituisco mandandolo all'aria trova comunque una ‘risposta', un prolungamento che è frutto del mio stesso gesto: la mia mano, una volta gettati gli oggetti per terra, continua da sola il suo movimento in una certa direzione, anche se mi è sconosciuta. Essa distrugge, ma si lancia contemporaneamente verso uno spazio altro, che essa designa al di là del mio progetto e che, dunque, in una certa maniera, desidera. […] Può darsi che il gesto di rivolta segni forse la ‘fine dell'età del progetto politico', come scrivi all'inizio de La rivolta. Ma questo non implica la fine di ogni speranza politica” (dalla Lettera/postfazione di Georges Didi-Huberman, traduzione di Andrea Inzerillo). Pierandrea Amato (Napoli, 1973) è professore associato di Estetica all'Università di Messina. Ha concentrato i suoi studi prevalentemente sulla filosofia del Novecento, approfondendo però anche alcuni aspetti del pensiero antico. A partire dal pensiero di Nietzsche, si è occupato delle questioni legate al nichilismo e alla tecnica moderna. In questo senso, si è impegnato, nell'analisi dell'opera di alcuni pensatori post-metafisici del XX secolo, in particolare tedeschi (Heidegger, Jünger, Benjamin, Schmitt) e francesi (Deleuze, Foucault). Ha dedicato una parte consistente della propria ricerca al vaglio della relazione tra la vita e il potere nella filosofia contemporanea e, più nello specifico, alla nozione di bio-politica. Inoltre, è interessato alla nuova figura dell'umano (il post-umano). Ha prestato particolare attenzione al tema dello spazio e dell'abitare contemporaneo e, più recentemente, alle questioni estetiche che derivano dall'implicazione tra l'arte e la tecnica con una specifica attenzione al medium fotografico.IL POSTO DELLE PAROLEascoltare fa pensarehttps://ilpostodelleparole.it/
Georges Didi-Huberman : "Le mélancolique est en deuil de lui-même"
durée : 00:48:33 - Remède à la mélancolie - par : Eva Bester - "La rage" de Pasolini, l'admiration, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Henri Michaux, Georges Perec, Boby Lapointe, Janis Joplin, Goya, les tracts clandestins de la Résistance... Retrouvez tous les remèdes de notre invité !
Pour cette dixième et dernière émission, Scanners se penche sur la question de l’imagerie scientifique avec Thierry Lefebvre, maître de conférence à l’Université Paris-Diderot et auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux œuvres cinématographiques d’Étienne Jules-Marey, d’Eugène Doyen ou de Jean Comandon. Programme 01:13 – Reconfigurer le rapport à la maladie, de la clinique à l’endoscopie (Sylvain Blandy) 05:10 – La monstruosité lovecraftienne à l’heure digitale, dans The Thing et Prometheus (Corentin Lê) 10:53 – Science, cinéma, scanners : le corps de la machine et la machine du corps (Sylvain Blandy) 13:42 – Entretien avec Thierry Lefebvre, maître de conférence à l’Université Paris-Diderot. Ressources – Michel Foucault, Naissance de la clinique : une archéologie du regard médical, 1963 – Georges Didi-Huberman, L’invention de l’hystérie : Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière, 2008 – Howard Philips Lovecraft, Les Montagnes hallucinées, 1931 – Jean Epstein, Écrits sur le cinéma, Cinéma Club / Seghers, 1974 – Thierry Lefebvre, Jacques Malthête, Laurent Mannoni (dir.), Sur les pas de Marey, Science(s) et cinéma, Paris, L’Harmattan, 2004 – Thierry Lefebvre, La Chair et le Celluloïd : le cinéma chirurgical du docteur Doyen, Paris, Jean Doyen éditeur, 2004 – Béatrice de Pastre (dir.), Thierry Lefebvre (coll.), Filmer la science, comprendre la vie : le cinéma de Jean Comandon, Paris, CNC, 2012 – Edwin Catmull, A System for Computer Generated Movies, University of Utah, 1972, https://ohiostate.pressbooks.pub/app/uploads/sites/45/2017/09/catmull-movies.pdf Générique Mathieu Bonnafous : https://soundcloud.com/catartsis Une émission animée et réalisée par Corentin Lê.
Où va la philosophie française? // Georges Didi-Huberman : Où va la pensée française?
Au sein de la grande tradition de la philosophie, celle-ci s’est toujours pensée comme la possibilité inhérente à l’être humain de se départir de son discours national en vue de le faire accéder à l’universalité de la raison. En même temps, la philosophie n’aura jamais cessé de s’inspirer de langues singulières. C’est ainsi que nous parlons, par exemple, de « philosophie allemande », « américaine » ou « anglo-saxonne », « grecque », et, aussi, « française ». En effet, toute l’histoire de la philosophie témoigne de cette tension à tel point qu’elle n’a jamais su se fixer dans l’une ou dans l’autre de ces deux tendances.Notre dessein sera de penser le rapport entre la langue française et la pensée philosophique dans chacune de ces modalités en avançant les questions suivantes : comment l’universalité de la pensée philosophique se voit-elle interrogée, voire réorientée par la singularité de la langue française ? Quel avenir se tient encore en réserve au cœur de cette rencontre exceptionnelle entre ces deux langues, philosophique et française ? Comment cette rencontre, si prolifique et subtile, peut-elle encore aujourd’hui, créer et inventer ? Quelles sont les préoccupations majeures de ce que l’on entend par « philosophie française » aujourd’hui ?Afin d’avoir quelque chance de comprendre les enjeux actuels à l’œuvre dans les multiples transformations de la philosophie française contemporaine, il nous faudra repenser non pas uniquement son rapport aux autres traditions philosophiques, mais aussi aux autres disciplines du savoir. Nous tenons à déployer la multiplication impressionnante des « gestes » à l’œuvre en philosophie française et en misant sur le débat entre ses différents courants, nous chercherons à présenter les questions les plus pressantes pour celle-ci tout en suggérant, sinon des passerelles entre ses multiples tendances au moins des mises au jour de leurs principaux motifs. Ainsi, nous rouvrirons au cœur de la philosophie française un dialogue soutenu entre ses différentes composantes et ses courants divergents en proposant à la fois des intersections entre philosophie française et les autres régimes de connaissance, tout en requérant les courants aujourd’hui majeurs de la philosophie française à confronter leurs approches : phénoménologique, herméneutique, théorie critique, déconstruction, épistémologie, philosophie analytique, néo-réalisme ou réalisme spéculatif, etc. Nous verrons se construire depuis ces vecteurs multiples, une reprise capable de mettre en question le statut du politique, de l’éthique, du sociétal ainsi que les différents domaines du savoir scientifique.Ce colloque, coordonné par Isabelle Alfandary, Sandra Laugier, Astrid von Busekist, Raphael Zagury-Orly et Joseph Cohen, interrogera la « philosophie française » telle qu’elle s’énonce au présent et face à notre monde contemporain. En somme : « où va la philosophie française ? » Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Conférences // Georges Didi-Huberman : Allons-nous donc renoncer à être romantiques?
L’assassinat de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht, le 15 janvier 1919, fut comme un prélude déjà cruel aux « sombres temps » à venir du nazisme. Une question se posait déjà à certains penseurs de ce temps, au premier rang desquels Walter Benjamin et Ernst Bloch : comment construire une espérance politique à partir d’une telle barbarie en marche ? On s’aperçoit que les « testaments » des deux spartakistes assassinés avaient fait appel à un lyrisme poétique quelque peu surprenant au premier abord. Or ce lyrisme doit se comprendre à partir d’une position philosophique issue du premier romantisme allemand, ainsi que du romantisme républicain des Français des années 1830-1848. Les textes de jeunesse de Walter Benjamin en donnent, non seulement un témoignage, mais encore une raison d’être philosophique.La conférence sera suivie d’un dialogue avec les membres fondateurs philosophes Joseph Cohen, professeur au University College Dublin, Robert Maggiori, critique littéraire (Libération) et Raphael Zagury-Orly, professeur à Sciences po.La conférence se fait dans le cadre du Prix de la Principauté 2019 qui a été décerné à Georges Didi-Huberman conjointement par la Fondation Prince Pierre et les Rencontres Philosophiques de Monaco pour l’ensemble de son oeuvre. Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Georges Didi-Huberman et Keren Ann : le pouvoir des images
durée : 00:54:26 - Livres & vous, le podcast - Convertir, transformer, déplacer le regard… Le théoricien Georges Didi-Huberman et l'artiste Keren Ann stimulent notre imaginaire dans ce nouvel épisode de l'émission littéraire de Public Sénat présentée par Adèle Van Reeth.
On aura beaucoup dit et écrit sur Pasolini : Sa joie ou sa tristesse. Nous prendrons et sa joie et sa tristesse. Sa joie et sa tristesse tiennent à ceci, qu'il ne se sera jamais consolé de rien. Pasolini aura aimé son époque. Il l'aura aimée au point que de son amour nous reste une rage. Et c'est aussi parce qu'il l'aura aimée comme peu l'auront aimée, comme personne, qu'il aura aussi pleuré sa fin, qu'il l'aura pleurée au point que tout désormais devait disparaître une fois entendu que la beauté avait disparu. Que d'elle ne resta plus que son simulacre. De ce monde aimé ne pouvait rester qu'un cadavre meurtri, défiguré, échoué. Comme s'il avait fallu au monde le monde pour le défaire. Une nuit radiophonique diffusée sur Radio Grenouille et s'appuyant sur ces deux conférences de Georges Didi–Huberman, Réalisation à l'occasion de la rétrospective intégrale (films, lectures, conférences et documents d'archives), Pasolini, la force scandaleuse du passé. Un temps fort de Marseille Provence 2013 qui s'est tenu du 14 mai au 8 juillet. Durée : 213mn Réalisation : Emmanuel Moreira & Céline Laurens avec la complicité de Romain Mattio. Une proposition en partenariat avec l'INA Pasolini à travers les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel Production : Radio Grenouille
Jeudi 30 août 2018 Plus on est de fous, plus on lit!
Le texte de la semaine avec Aurélie Lanctôt et Vanessa Destiné. Le questionnaire du 1er roman; les réponses de Clara Dupuis-Morency pour Mère d’invention, chez Nota bene. Analyse d’un objet culturel avec Hélène Laurendeau et Jean-Pierre Lemasson; le guide Michelin. On appelle D-Track. Une entrevue avec Georges Didi-Huberman, commissaire de l’exposition Soulèvements. Nantali Indongo et Sarahmée Ouellet; 20 ans après, pourquoi The Miseducation of Lauryn Hill est toujours considéré comme un chef-d’oeuvre?
En dialogue avec Marianne Alphant Le 9 avril 2018 à la Maison de la Poésie - Scène littéraire
Yolocast #3 - "Je pensais qu'il avait une physique plus mesurée"
Yolocast une émission mensuelle de DeezPodcasts.Un concept simple : un.e ou plusieurs invité.e,s. Ami.e.s ou personnes de passage. Le point commun ? Une émission sans fil rouge en impro totale!===== Au programme de ce Yolocast #3====Troisième numéro de cette émission de Yolocast. Une émission en compagnie d'Antonin qui revient déjà avec ce troisième numéro. Ce n'est pas moi qui vais me plaindreLe sujet ?Pop culture au hasard ? Mais là on est parti d'un troll gratuit que j'avais lancé autour du film Neon Demon. Devant la surprise en 140 caractères d'Antonin je me disais qu'un Yolocast était un bon moyen d'en parler et de fil(ms) en aiguille de discuter jeu vidéo, Kickstarter.C'est qui l'invité ?Antonin is back. Toujours enclin à la critique et de bonne compagnie on a remis le couvert. Si vous voulez faire les choses dans l'ordre écoutez le premier Yolocast ! ;)Pourquoi ?Finalement pour changer de position, chacun, de manière constructive. C'est pas mal surtout quand on part d'un troll. Et le fil rouge a finalement un peu été le manque de liberté qu'on peut ressentir face à certaines oeuvres.Au final ?Comme les cocktails un bon équilibre : rigueur et déconne entre amis.Et on a mis en avant un traumatisme vidéoludique d'Antonin en avant...:pAu menu de ce podcast avec Jérôme :Timeline00:00:00 – 00:25:00 : Intro et on se "clashe" autour du (non)film "The Neon Demon" de Nicolas Winding Refn (avec un cours d'ortophonie d'Antonin pour moi^^'). Le tout autour d'une partie en simultané d'Uncharted 4 !Interlude musicalCliff Martinez - Get Her Out of Me (BO de The Neon Demon)00:26:19 – 00:55:25 :On continue et termine (?) sur Neon Demon. On enchaine avec Djokovic, la pub invasive et les jeux vidéo qui nous forcent trop à faire des trucs. Ou comment on a créer la fin "Pacifiste" d'Undertale. :pOn parle aussi en vrac de GTA IV, du Royaume-Uni, la police du bon goût, de la série des Yakuza (c'est contractuel avec Antonin), Manhunt et enfin de sociopathie et psychopathie. Tout un programme !Interlude Musical Ennio Morricone - Salo ou les 120 jours de Sodome00:57:53 – 01:10:33 :Dernière ligne droite avec Mighty N°9, Shen Mue III et bien sûr Kickstarter. On fait aussi une analogie entre le meurtre virtuel et le fait de saloper son jean.A la prochaine...Et faites gaffe à pas trop énerver Antonin en lui disant comment jouer...A moins que ce ne soit Niko Bellic ! ;)Autres ressources audio/vidéo évoquées dans l'émission :Indochine – L'aventurier (Bob Morane)Sega Rally – Game Over themeGTA IV Niko Bellic speechExtrait « Les tutos de Camille » La saint ValentinL'ouvrage "La survivance des lucioles de Georges Didi-Huberman (autour de la métaphore des lucioles évoquée par Pasolini dans ses écrits et poèmes).Pour Alain Badiou on peut aller du côté de l'ouvrage "L'être et l'événement" (faut s'accrocher). Ou une petite entrée en matière ici :http://danielbensaid.org/Badiou-ou-le-miracle-de-lCrédits musiques/extraits sonoresTous les thèmes et éventuels visuels sont la propriété de leurs compositeurs et/ou sociétés respectives.Whaaaat!!?? Bojack Horseman (Netflix)I don't understand what's goin' on here (Jet Set Radio Future Soundtrack/Sega)La cité de la peur réalisé par Alain Berberian (AMLF)Le morceau "Inside of me" est composé par Lukash dont vous pouvez consulter en libre tous ses albums : lukhash.com/ET SURTOUT TOUT COMME MOI EVENTUELLEMENT LUI FAIRE UN DON SI VOUS APPRECIEZ SON TRAVAIL ! ;)
Codruta Morari reads from Images in Spite of All: Four Photographs from Auschwitz by Georges Didi-Huberman, published by The University of Chicago Press. "...The very notion of image...is intermingled with the incessant urge to show what we cannot see. We cannot 'see desire' as such, yet painters have played with crimson tones to show it..."
Cinéma de poésie : Godard face à Pasolini. Conférence de Georges Didi-Huberman
Cinéma de poésie : Godard face à Pasolini. Conférence de Georges Didi-Huberman
Programme de FRANK SMITH pour webSYNradio : avec des interventions, des sons et des paroles de Georges Didi-Huberman, Jean Luc Godard, Julius Eastman, Laurie Anderson, Pier Paolo Pasolini
Programme de FRANK SMITH pour webSYNradio : avec des interventions, des sons et des paroles de Georges Didi-Huberman, Jean Luc Godard, Julius Eastman, Laurie Anderson, Pier Paolo Pasolini
Georges Didi-Huberman discusses André Malraux’s Musée Imaginaire
Interview mit Georges Didi-Huberman
ATLAS. How to Carry the World on One's Back? | Interview Interview mit Georges Didi-Huberman Released May 04, 2011 Interview with the curator of the exhibition Georges Didi-Huberman 07.05.–07.08.2011, ZKM | Museum of Contemporary Art /// Interview mit dem Kurator der Ausstellung Georges Didi-Huberman 07.05.–07.08.2011, ZKM | Museum für Neue Kunst