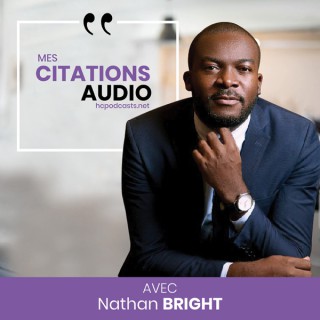Podcasts about lorsque
- 1,919PODCASTS
- 6,410EPISODES
- 21mAVG DURATION
- 5WEEKLY NEW EPISODES
- Feb 6, 2026LATEST
POPULARITY
Categories
Best podcasts about lorsque
Latest news about lorsque
- Eleven Theses on Socialist Revolution libcom.org - Dec 25, 2025
- Bertrand Denzler & Frantz Loriot - Musique Improvisée et Questions Politiques (Self-Released, 2025) The Free Jazz Collective - Sep 22, 2025
- La course à la finalité : comment Kaspa change les règles Blockchain on Medium - Aug 1, 2025
- Créer une application ReactJS moderne étape par étape (sans se perdre) avec Vite + Tailwindcss JavaScript on Medium - Jul 20, 2025
- Porte-clé coeur en 2 morceaux style Lego Thingiverse - Newest Things - Jan 11, 2025
- Cette université sacrifiée par une élection Africa Is a Country - Feb 19, 2024
Latest podcast episodes about lorsque
BONUS : L'insurrection du 6 février 1934 : une journée sans nom qui a pourtant réussi, un instant, à faire trembler la République.
Le 6 février 1934 restera à jamais gravé dans l'histoire de la Troisième République française. Franck Ferrand vous plonge au cœur de cette journée tumultueuse qui a failli faire basculer le régime.Tout commence avec le scandale Stavisky, une affaire d'escroquerie financière qui éclabousse les plus hautes sphères du pouvoir. La colère gronde dans la population, exaspérée par l'instabilité chronique des gouvernements et la corruption qui gangrène la République. Lorsque le préfet de police de Paris, figure controversée mais populaire auprès de la droite, est limogé, c'en est trop. Les ligues nationalistes et les anciens combattants appellent à manifester le 6 février sur la place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale.
L'insurrection du 6 février 1934 : une journée sans nom qui a pourtant réussi, un instant, à faire trembler la République.
Le 6 février 1934 restera à jamais gravé dans l'histoire de la Troisième République française. Franck Ferrand vous plonge au cœur de cette journée tumultueuse qui a failli faire basculer le régime.Tout commence avec le scandale Stavisky, une affaire d'escroquerie financière qui éclabousse les plus hautes sphères du pouvoir. La colère gronde dans la population, exaspérée par l'instabilité chronique des gouvernements et la corruption qui gangrène la République. Lorsque le préfet de police de Paris, figure controversée mais populaire auprès de la droite, est limogé, c'en est trop. Les ligues nationalistes et les anciens combattants appellent à manifester le 6 février sur la place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale.
C dans l'air l'invité du 26 janvier 2026 avec Justin Vaïsse, historien spécialiste des relations transatlantiques, directeur général du Forum de Paris sur la Paix.La président américain Donald Trump a présenté son "Conseil de la paix", un nouvel organisme né à Davos, et qui vient concurrencer l'ONU. Lorsque le Hamas et Israël ont signé leur accord de cessez-le-feu en octobre 2025, il prévoyait plusieurs étapes. La première était la libération des otages contre le retrait partiel d'Israël de Gaza, la seconde la création d'un "Conseil de la Paix" à l'initiative des Etats-Unis. Ce "Board of Peace" vient donc de voir le jour.Donald Trump est le premier président de ce Conseil. Il est le seul à pouvoir inviter d'autres chefs d'Etat et de gouvernement à l'intégrer, et il peut décider d'en exclure un membre s'il le souhaite. Chaque Etat membre exerce un mandat d'une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la charte, et pour rester dans ce club il faudra débourser un milliard de dollars. La mission de ce Conseil de la Paix est un copier-coller de la mission des Nations Unies. Dans le préambule de la charte signée à Davos, il est écrit que "Le Conseil de paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits" quand la charte de l'ONU, elle, parle de "préserver les générations futures du fléau de la guerre, de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice, d'instaurer de meilleures conditions de vie et de défendre les droits de l'Homme." Quelles conséquences pour le multilatéralisme, et pour la paix dans le monde ?Ce week-end, le président américain s'en est pris à ses alliés de l'Otan. Il a affirmé que les alliés étaient «restés un peu loin des lignes de front» lors de l'intervention en Afghanistan et que les États-Unis n'ont «jamais eu besoin d'eux». Dès vendredi, le Premier ministre britannique Keir Starmer, à l'unisson de toute la classe politique, avait qualifié d'«insultants» et «franchement consternants» les déclarations du président américain. «Ces déclarations inacceptables n'appellent aucun commentaire. C'est aux familles de soldats tombés que le chef de l'État souhaite apporter du réconfort et redire la reconnaissance et la mémoire respectueuse de la nation», a dit l'entourage du Français Emmanuel Macron. Justin Vaïsse, historien spécialiste des relations transatlantiques, et directeur général du Forum de Paris sur la Paix, est notre invité. Il analysera avec nous la situation des relations transatlantiques, et les menaces qui pèsent contre la paix.
Occuper l'enfant lors des trajets - Pause éducative - Sylvie d'Esclaibes
Un trajet en voiture, en train ou en avion avec des enfants… et si cela devenait un moment joyeux, serein et même porteur d'apprentissages ?Comment éviter l'ennui, l'agitation ou les écrans, pour transformer les déplacements en véritables temps de vie partagés ?Dans cet épisode, Sylvie d'Esclaibes, spécialiste de l'éducation depuis plus de 30 ans, nous partage ses meilleurs conseils pour occuper les enfants pendant les déplacements, en s'inspirant des principes Montessori : des activités simples, ludiques et adaptées qui rendent le voyage aussi enrichissant pour l'enfant… que plaisant pour les parents !Lorsque l'enfant est respecté dans ses besoins pendant le voyage, le trajet devient plus doux et agréable, aussi bien pour lui que pour les adultes qui l'entourent.Quelques enseignements clés :
Un an après la prise de Goma par l'AFC/M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, retour sur les combats
En janvier 2025, la Monusco est confrontée à une double mission : protéger les civils tout en assurant la sécurité de son propre personnel, pris dans cinq jours d'affrontements intenses. Vivian van de Perre est la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies pour la protection et les opérations de la Monusco et en est la cheffe par intérim. Elle se trouvait à Goma au moment des combats. Un an après, comment a-t-elle personnellement vécu cette bataille ? Elle répond aux questions de Patient Ligodi. RFI : Un an après la prise de la ville par l'AFC/M23, comment avez-vous personnellement vécu cette bataille et ces moments de bascule pour la Monusco ? Vivian van de Perre : Merci beaucoup pour la question. La bataille de Goma, en janvier 2025, nous ne l'oublierons jamais, qu'il s'agisse de la population, des combattants des deux camps ou des Casques bleus eux-mêmes. C'est la bataille la plus intense que nous ayons connue dans l'est du pays, de par son ampleur. Elle n'a absolument rien de comparable avec la prise de Goma en 2012. Cette fois-ci, il s'agissait d'une bataille urbaine intense et prolongée. Ces journées ont été un choc par leur intensité et par ce qu'elles ont signifié pour la population de Goma et pour la mission de la Monusco, dont le mandat est de protéger les civils. Dans la ville, le sentiment immédiat n'était pas celui de considérations géopolitiques abstraites, mais celui de l'urgence. Le bruit et l'impact continus des armes légères et lourdes, la pression exercée par l'arrivée massive de civils et de personnels en uniforme venus chercher refuge dans les bases de la Monusco et la responsabilité, au milieu de tout cela, de maintenir nos Casques bleus opérationnels et concentrés malgré les risques auxquels ils étaient eux-mêmes exposés, ont constitué un véritable défi. Le 28 janvier, vous vous en souvenez peut-être, je faisais un briefing devant le Conseil de sécurité. La bataille de Goma n'était pas encore terminée. Mais la nuit, l'intensité diminuait en raison de l'obscurité. J'ai donc pu informer le Conseil depuis Goma et leur dire que la violence devait cesser immédiatement, car la situation échappait à tout contrôle d'une manière susceptible d'entraîner l'ensemble de la région dans un conflit encore plus profond. On avait vraiment le sentiment qu'il s'agissait d'un moment ou tout pouvait basculer et c'est la crainte qu'on avait. Nos bases — les bases de la Monusco — étaient touchées, tout comme les résidences de notre personnel. Et bien sûr, l'ensemble de la population civile de Goma et de ses environs était également affectée. Nous avons été pris dans des tirs croisés. Il ne s'agissait pas d'une attaque directe contre l'ONU, mais nous étions pris dans les tirs croisés. Dans le même temps, nous recevions des civils et des personnels de sécurité qui avaient besoin de protection, dans toutes nos bases — dans nos bases militaires autour de Goma, comme dans nos bases civiles. Il y avait donc un véritable sentiment d'urgence et une intensité sans précédent. Mais un an plus tard, dispose-t-on aujourd'hui d'un rapport consolidé du nombre de civils tués à Goma lors de cette bataille de janvier 2025 ? Et quelles sont les principales difficultés pour documenter ces chiffres aujourd'hui ? On n'a pas véritablement de chiffres précis. Le brouillard de la guerre est tel qu'il est très difficile d'établir un bilan civil pleinement consolidé et vérifié de manière indépendante, car les combats actifs ont tout perturbé — l'accès aux sites, aux dossiers médicaux, les hôpitaux étaient débordés, les communications coupées, et les conditions nécessaires pour mener des vérifications en toute sécurité n'étaient pas réunies. En outre, les gens avaient peur. Ils craignaient d'être ciblés. L'intimidation des survivants et des témoins représentait un risque réel. Il y a ensuite eu des déplacements de population, à la fois volontaires et fortement encouragés, voire forcés, ce qui compliquait les recherches. Les familles se déplaçaient. Par ailleurs, pour des raisons sanitaires, les corps étaient très rapidement collectés et mis en terre afin d'éviter la propagation de maladies transmissibles. À cela s'ajoute le fait que, puisque nous combattions aux côtés du gouvernement de la RDC pendant la bataille de Goma, nous étions à ce moment-là considérés comme une partie au conflit. Nous n'avions donc pas la liberté de mouvement et ne pouvions pas circuler librement. Il est donc difficile de se prononcer avec précision. Les estimations varient largement. C'est pourquoi nous souhaitons soutenir l'intervention d'un organe indépendant, comme la commission d'enquête récemment créée par le Conseil des droits de l'Homme, afin qu'elle devienne opérationnelle avec des ressources adéquates et, surtout, qu'elle bénéficie d'un accès sans restriction. La Monusco est prête à les soutenir, ainsi que d'autres mécanismes nationaux, pour enquêter sur ces incidents graves, prévenir les récidives et rendre justice aux victimes, le moment venu. Qu'est-ce qui a été, selon vous, déterminant dans la chute de Goma ? Au-delà des faiblesses connues des forces congolaises, quel a été concrètement le rôle de la Monusco face à l'avancée de l'AFC/M23 appuyé par l'armée rwandaise ? Qu'est-ce qui a fait que très rapidement, Goma s'est retrouvé dans une situation où l'AFC/M23 n'a pas trouvé de résistance armée, alors qu'il y avait la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), la Monusco, les FARDC, les Wazalendo… Oui, nous nous étions préparés à l'éventualité que Goma soit attaquée. Mais je tiens à réaffirmer que ce M23 n'est pas le même que celui de 2012. Le qualifier simplement de groupe armé ou de groupe rebelle ne rend pas compte du niveau d'équipement et d'organisation qu'il a atteint. Et comme nous le savons tous, il bénéficie du soutien de pays voisins, ce qui a été largement établi par différents rapports. Il ne s'agissait donc pas tant d'un combat contre un groupe rebelle que d'un affrontement qui ressemblait presque à un conflit entre deux armées conventionnelles. L'ampleur des combats était sans précédent. Nous étions désavantagés dans l'utilisation de nos technologies en raison du brouillage très actif des signaux GPS pendant la bataille — et, soit dit en passant, cela se poursuit encore aujourd'hui —, ce qui nous empêchait d'utiliser nos hélicoptères et nos drones. Nous ne pouvions pas utiliser nos équipements technologiques. Et l'ampleur de l'attaque était considérable. J'ai également vu autour de l'aéroport des combats extrêmement violents. Ce n'est pas comme si le M23 était simplement entré et avait pris le contrôle, comme en 2012. C'était une bataille extrêmement intense. J'ai vu les forces gouvernementales se battre très violemment à l'aéroport et subir de lourdes pertes. Cela nous amène à réfléchir aux leçons à tirer. Tout d'abord, il y a eu un mépris répété des décisions prises par le Conseil de sécurité, par l'Union africaine, par la Communauté d'Afrique de l'Est et par la SADC, pour n'en citer que quelques-unes. Tous ont cherché à empêcher une escalade du conflit. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773 après la chute de Goma. Cependant, cela n'a pas empêché l'extension du conflit, qui s'est poursuivi jusqu'à Bukavu, qui est également tombée — même si ce ne fut pas à l'issue d'une bataille aussi intense que celle de Goma. De même, la signature récente de l'accord de Washington n'a pas empêché la prise d'Uvira. Deuxièmement, tout processus de paix qui n'est pas ancré dans les droits humains et dans la protection des civils est fragile dès le départ. Il faut considérer la protection des droits humains comme une mesure de confiance. Sans s'attaquer, au moins en partie, aux causes profondes du conflit et si l'on cherche à régler les différends sur le champ de bataille, ce conflit se poursuivra. Et il est évidemment impératif de l'empêcher. La primauté de la médiation et des accords négociés est donc absolument centrale. La solution à la situation dans l'est du pays ne réside pas dans une nouvelle guerre, ni sur le champ de bataille. Protéger les civils et votre propre personnel : qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer ? La partie la plus difficile a été de gérer deux urgences simultanément : protéger les civils dans une ville en proie à de violents combats et assurer la sécurité ainsi que la continuité de nos opérations. Heureusement, nous avions évacué la plupart du personnel non-essentiel hors de Goma. Lorsque j'ai informé le Conseil depuis Goma, j'ai été très claire : certains de nos sites étaient affectés et nous accueillions un grand nombre de personnes venues y chercher refuge. Sur le plan opérationnel, cela implique des décisions complexes, prises minute par minute : où renforcer les dispositifs, comment sécuriser les emprises, comment maintenir la coordination humanitaire et appuyer les partenaires, sans accroître les risques pour les civils autour de nos sites. Un exemple concret de ce que signifie notre mandat de protection dans la pratique est ce qui s'est passé après la chute de Goma. Entre 2 000 et 3 000 militaires désarmés des FARDC et de la Police nationale congolaise, ainsi que plusieurs civils de haut profil, ont trouvé refuge dans les bases de la Monusco à Goma en janvier et y sont restés pendant quatre mois. À partir du 30 avril 2025, nous avons mené une opération visant à relocaliser en toute sécurité 1 359 d'entre eux vers Kinshasa, en étroite coordination avec le CICR en tant qu'intermédiaire neutre, et en étroite concertation avec le gouvernement de la RDC, en veillant au respect de la sécurité, de la dignité et de la neutralité tout au long du processus. Cette opération a été conduite avec le consentement éclairé des personnes concernées et dans le strict respect des Conventions de Genève. Pendant plus de trois mois, nous avons assuré une protection physique, un hébergement, des soins médicaux et une alimentation à ces personnes placées sous notre responsabilité, alors même que nous n'étions pas équipés pour accueillir un nombre aussi élevé de personnes et que des maladies transmissibles se sont déclarées en raison de la surpopulation. Nous nous souvenons que les 23 et 24 janvier 2025, les positions de la Monusco et de la SAMI-DRC, la force de la SADC, ont été prises pour cibles. Deux Casques bleus sud-africains, ainsi qu'un Casque bleu uruguayen, ont été tués. Un an plus tard, quel est le bilan au niveau des Nations unies ? Dans ces incidents, comme dans tant d'autres où des Congolais et d'autres personnes ont perdu la vie – et ils étaient très majoritairement congolais – des biens ont été détruits et de nombreuses personnes ont été blessées. Nous continuons à appeler et soutenir les efforts afin de déterminer les responsabilités dans ce qu'il s'est passé. Ces pertes humaines et matérielles ont été rapportées au Conseil de sécurité, et la position générale des Nations unies est claire : l'ONU ne peut jamais être attaquée directement. Nous étions impliqués dans le conflit au début de l'offensive du M23. Mais les attaques délibérées contre les Casques bleus sont inacceptables et peuvent constituer de graves violations du droit international. Nous continuons donc à soutenir la documentation et la préservation des informations, dans la mesure du possible. Mais établir les responsabilités dépend très largement de l'accès, de la coopération et de la capacité des autorités compétentes à enquêter sur ces incidents de manière crédible et en toute sécurité. Nous continuons à plaider pour que ces conditions soient réunies. Nous avons également renforcé – et continuons de renforcer – les mesures de protection pour les Casques bleus et les civils, car notre devoir immédiat est d'empêcher de nouvelles pertes en vies humaines, qu'il s'agisse de nos propres personnels ou des civils pris dans les tirs croisés. Normalement, la justice met du temps à être rendue. Elle est lente, mais elle finit par rattraper les responsables. Nous l'avons vu dans d'autres contextes. Mais pourquoi a-t-on l'impression que la région des Grands Lacs est la seule où des Casques bleus peuvent être attaqués, où des hélicoptères de la Monusco peuvent être détruits, sans clarification, sans explication, sans suivi judiciaire, sans sanctions ? Pourquoi ? La première étape est d'arrêter les combats dans l'est. Après cela, il y aura le temps d'examiner toutes ces questions. Car il est bien sûr inacceptable qu'une mission de maintien de la paix, décidée à l'unanimité par 193 États membres et financée par ces mêmes États, soit empêchée de faire correctement son travail. Je tiens également à souligner que la Monusco est la seule à être encore présente sur le terrain. De nombreux autres acteurs armés et divers groupes ont quitté l'est, qui est aujourd'hui toujours sous contrôle du M23. Mais nous, nous sommes toujours là et nous avons toujours un rôle important à jouer. Nous tenons bon et nous remplissons ce rôle du mieux que nous le pouvons, malgré les restrictions de mouvement. Mais Il viendra un moment où il faudra établir les responsabilités. Eh bien sûr, nous avons documenté tout cela, et le moment viendra. Mais notre priorité immédiate est de mettre fin aux combats et de créer les conditions pour que des solutions négociées puissent être instaurées, afin que l'on trouve une solution à cette situation persistante dans l'est, qui dure depuis trente ans et qui, au moment même où nous parlons, semble encore s'aggraver. Voilà notre priorité absolue. La justice et la responsabilité viendront après. Avec le nouveau mandat de la Monusco, que fait concrètement la mission aujourd'hui sur le terrain, différemment de ce qu'elle faisait dans les semaines et les mois ayant suivi la prise de Goma, et par rapport à l'ancien mandat ? Dans les zones contrôlées par le M23, la situation est évidemment différente, car nous n'avons jamais pu y retrouver notre liberté de mouvement. Nous pouvons faire entrer et sortir des troupes et du personnel, mais sans aéroport, cela se fait par voie terrestre, ce qui prend plus de temps. Mais les troupes ne peuvent pas patrouiller librement. Le Conseil de sécurité le sait parfaitement. Des pressions sont exercées sur le M23 pour qu'il nous accorde la liberté de mouvement, mais ce groupe pose des conditions que nous ne pouvons pas accepter, car nous ne pouvons pas coopérer avec un groupe armé ayant pris le contrôle d'un territoire souverain de la RDC. Malgré cela, nous avons établi un modus operandi qui nous permet de rester présents dans l'est. Cette présence est précieuse, car elle donne un certain espoir à la population : l'ONU est toujours là, la communauté internationale ne les a pas oubliés. Nous utilisons nos réseaux pour surveiller la situation et en rendre compte. Mais les opérations classiques de maintien de la paix que nous menons en Ituri et dans le grand nord ne sont pas possibles dans les zones contrôlées par le M23. Un nouvel élément figure toutefois dans la résolution : lorsqu'un cessez-le-feu est en place – et nous devrions en avoir un – nous sommes mandatés pour le soutenir. Cela a été négocié à Doha, avec un rôle pour la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), et la Monusco fait partie intégrante de ce mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, y compris sur le plan logistique. Ce mécanisme est prêt, il n'est pas encore visible parce que le cessez-le-feu ne tient pas pleinement. Mais nous sommes prêts. Nous nous préparons activement, mais certaines conditions doivent être en place : l'accès aux aéroports, l'utilisation de nos hélicoptères. En mars, nous retournerons devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il nous a demandé des propositions concrètes sur la mise en œuvre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, et nous serons prêts à les présenter, afin qu'il puisse prendre une décision.
"Parlons Encore" : Pourquoi peut-on se sentir seul même lorsque l'on est entouré ?
REDIFF - Paul Delair et Caroline Dublanche explorent une question d'une auditrice : pourquoi peut-on se sentir seul même entouré ? À travers une discussion riche et introspective, ils abordent la nature complexe de la solitude, ses racines psychologiques et son impact sur nos vies sociales. Ce podcast invite les auditeurs à réfléchir sur leur propre rapport à la solitude. Chaque soir, en direct, Caroline Dublanche accueille les auditeurs pour 2h30 d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local) ou sur parlonsnous@rtl.frHébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Lorsque l'on parle de « brûler » des graisses, l'image qui nous vient souvent en tête est celle d'un glaçon qui fond. En réalité, la biologie raconte une histoire bien plus surprenante : lorsque nous perdons de la graisse après un effort physique, la majorité de cette graisse quitte notre corps… par la respiration.Tout commence dans nos cellules. Lorsqu'elles ont besoin d'énergie — pendant une séance de sport, une marche rapide ou même une simple montée d'escaliers — elles vont puiser dans leurs réserves : les triglycérides. Ces molécules sont stockées dans les adipocytes, nos cellules graisseuses. Leur rôle est d'emmagasiner de l'énergie sous une forme compacte et stable, en attendant un moment de besoin. Quand l'organisme réclame du carburant, ces triglycérides sont démontés en acides gras et en glycérol.C'est dans les mitochondries que la véritable « combustion » a lieu. Grâce à l'oxygène que nous respirons, ces acides gras sont métabolisés. Et c'est là que survient la révélation : la graisse ne disparaît pas, elle se transforme. Son produit final n'est pas de la chaleur ni de la sueur, mais principalement du dioxyde de carbone (CO₂) et de l'eau.Pour donner une idée concrète : si vous perdez 100 g de graisse, environ 84 g seront transformés en CO₂. À un rythme respiratoire normal, cela représente plusieurs dizaines de litres de CO₂ expirés au fil des heures. La dépense énergétique d'une séance de sport d'intensité modérée peut mobiliser 50 à 150 g de graisse, ce qui signifie que l'on expire littéralement des dizaines de grammes de graisse sous forme de CO₂ après un seul entraînement.Les 16 % restants de la masse initiale sont transformés en eau, éliminée par la sueur, l'urine et même la vapeur d'eau expirée. Contrairement aux idées reçues, la transpiration n'est pas la preuve que nous « brûlons » de la graisse : elle sert surtout à refroidir le corps.Cette découverte — popularisée après une étude publiée en 2014 dans BMJ — a renversé nombre d'idées que l'on croyait acquises : maigrir est avant tout un processus respiratoire. Chaque mouvement accélère la transformation des triglycérides en CO₂, et c'est en expirant que nous perdons réellement du poids.En résumé : pour perdre de la graisse, il faut bouger… et respirer. L'oxygène que nous inspirons, et surtout le CO₂ que nous expirons, portent la signature chimique de notre perte de poids. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Lorsque l'empereur latin de Constantinople propose à Louis IX de lui confier la Sainte Couronne, s'organise le voyage de la plus grande relique de la Chrétienté.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Régulièrement, l'équipe de Folie Douce partage avec vous les extraits les plus marquants des épisodes du podcast. Aujourd'hui, on vous propose de réécouter l'auteur Edouard Louis.Dans cet extrait, Edouard Louis raconte son rapport au pardon, la haine qui ne permet de pas se confronter aux personnes, et l'écriture de son livre sur son frère.« Le devoir d'être convoqué par le monde », ainsi Édouard Louis décrit-il sa manière d'écrire. Lorsque son frère est décédé à 38 ans des suites d'alcoolisme, il s'est dit qu'il ne pouvait pas écrire sur autre chose, « convoqué par cette réalité de la mort », et a terminé son livre, L'effondrement, paru en octobre. Il y entrecroise les prismes sociologiques et psychologiques d'une manière inédite.Au micro de Lauren Bastide, dans cet épisode de Folie Douce que - peut-être - vous attendiez, l'auteur qui se penche sur sa famille depuis de nombreuses années raconte qu'il se libère ainsi d'une forme de honte. Édouard Louis évoque aussi son livre précédent, Monique s'évade, sa mère et son enfance. Si « le pardon n'apaise pas les blessures », et qu'écrire c'est « creuser la douleur », Édouard Louis renie le rôle cathartique de l'écriture. Il raconte enfin le rôle de l'amitié dans sa vie, et le fait de re-parenter avec ses ami·es, en faisant de l'amitié un mode de vie.Retrouvez juste ici un formulaire pour m'aider à mieux vous connaître, communauté de Folie Douce !
La rate : un organe qui protège notre santé des virus et des bactéries
Organe méconnu, la rate à un rôle important puisqu'elle protège la santé de l'individu et en particulier son organisme des virus et des bactéries. Elle ne pèse que 200 grammes et se situe dans la partie supérieure gauche de la cavité abdominale, juste sous le diaphragme. Lorsque la rate augmente de volume, on parle alors de splénomégalie, décelable à la palpation ou à l'échographie. En augmentant de volume, la rate peut provoquer une anémie sévère. Pour les patients drépanocytaires et en particulier les enfants, ce symptôme constitue une urgence absolue. Comment la rate nous protège-t-elle ? Quelles sont les différentes pathologies pouvant l'affecter ? La rate est un organe du système lymphatique, localisé dans l'appareil digestif et situé à gauche de l'abdomen, sous le diaphragme. Pesant environ 200 g et dont la forme peut rappeler celle d'un haricot, il reste assez méconnu, en dépit de ses multiples fonctions pour notre santé, puisque la rate joue un rôle important pour l'immunité, et assure également un rôle clé dans le filtrage et le nettoyage du sang. Système immunitaire Si vivre sans rate est possible, c'est un facteur de fragilité, notamment pour se défendre contre les risques d'infections. La plupart des affections qui la concernent avancent à bas bruit et le dysfonctionnement de la rate est le plus souvent secondaire d'une autre maladie : atteintes du foie, de l'hémoglobine, des infections bactériennes, parasitaires, virales… Hypertrophie de la rate En contexte tropical, un dysfonctionnement ou une hypertrophie de la rate (ou splénomégalie) peuvent être particulièrement associées à des maladies comme la drépanocytose, le paludisme ou les hépatites. Dans certains cas, l'atteinte nécessite une opération chirurgicale totale ou partielle, appelée splénectomie. Avec : Pr Marika Rudler, hépato-gastroentérologue à l'Institut du Foie et responsable de l'Unité de soins intensifs d'hépato-gastroentérologie de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris Pr Alexis Elira Dokekias, professeur titulaire d'hématologie, Chef du service Hématologie du CHU de Brazzaville au Congo, directeur général du Centre National de Référence de la Drépanocytose et des Maladies rares « Antoinette SASSOU NGUESSO ». Président émérite de la Société Africaine d'hématologie. Programmation musicale : ► TML Vibez, Ruger - Body Tuff ► Bopol Mansiamina, Lucas Silva, Rafael Cassiani – Esta tierra no es mia.
La rate : un organe qui protège notre santé des virus et des bactéries
Organe méconnu, la rate à un rôle important puisqu'elle protège la santé de l'individu et en particulier son organisme des virus et des bactéries. Elle ne pèse que 200 grammes et se situe dans la partie supérieure gauche de la cavité abdominale, juste sous le diaphragme. Lorsque la rate augmente de volume, on parle alors de splénomégalie, décelable à la palpation ou à l'échographie. En augmentant de volume, la rate peut provoquer une anémie sévère. Pour les patients drépanocytaires et en particulier les enfants, ce symptôme constitue une urgence absolue. Comment la rate nous protège-t-elle ? Quelles sont les différentes pathologies pouvant l'affecter ? La rate est un organe du système lymphatique, localisé dans l'appareil digestif et situé à gauche de l'abdomen, sous le diaphragme. Pesant environ 200 g et dont la forme peut rappeler celle d'un haricot, il reste assez méconnu, en dépit de ses multiples fonctions pour notre santé, puisque la rate joue un rôle important pour l'immunité, et assure également un rôle clé dans le filtrage et le nettoyage du sang. Système immunitaire Si vivre sans rate est possible, c'est un facteur de fragilité, notamment pour se défendre contre les risques d'infections. La plupart des affections qui la concernent avancent à bas bruit et le dysfonctionnement de la rate est le plus souvent secondaire d'une autre maladie : atteintes du foie, de l'hémoglobine, des infections bactériennes, parasitaires, virales… Hypertrophie de la rate En contexte tropical, un dysfonctionnement ou une hypertrophie de la rate (ou splénomégalie) peuvent être particulièrement associées à des maladies comme la drépanocytose, le paludisme ou les hépatites. Dans certains cas, l'atteinte nécessite une opération chirurgicale totale ou partielle, appelée splénectomie. Avec : Pr Marika Rudler, hépato-gastroentérologue à l'Institut du Foie et responsable de l'Unité de soins intensifs d'hépato-gastroentérologie de l'Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris Pr Alexis Elira Dokekias, professeur titulaire d'hématologie, Chef du service Hématologie du CHU de Brazzaville au Congo, directeur général du Centre National de Référence de la Drépanocytose et des Maladies rares « Antoinette SASSOU NGUESSO ». Président émérite de la Société Africaine d'hématologie. Programmation musicale : ► TML Vibez, Ruger - Body Tuff ► Bopol Mansiamina, Lucas Silva, Rafael Cassiani – Esta tierra no es mia.
Pourquoi des scientifiques ont-ils préféré mourir de faim plutôt que de manger des graines ?
Pendant le siège de Leningrad, l'un des plus longs et des plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale, une poignée de scientifiques a accompli un acte de courage presque inimaginable. Alors que la ville était encerclée par les troupes allemandes, coupée de ses ravitaillements et plongée dans une famine extrême, des chercheurs de l'Institut Vavilov ont fait un choix radical : protéger à tout prix une collection de graines, quitte à en mourir.Fondé par le généticien Nikolaï Vavilov, l'institut était à l'époque l'une des plus grandes banques de semences du monde. On y conservait des variétés rares de céréales, de légumineuses, de tubercules et de plantes alimentaires venues des quatre coins du globe. Ces graines n'étaient pas de simples échantillons : elles représentaient des décennies de recherche et, surtout, une réserve génétique essentielle pour l'avenir de l'agriculture mondiale.Lorsque le siège commence en 1941, la situation devient rapidement désespérée. Les rations diminuent, l'hiver est glacial, et la faim tue des centaines de milliers de civils. À l'intérieur de l'institut, les chercheurs vivent entourés de sacs de riz, de blé, de pommes de terre séchées ou de graines oléagineuses. De quoi survivre, au moins temporairement. Pourtant, ils n'y touchent pas.Pour ces scientifiques, consommer la collection aurait été une trahison de leur mission. Ils savaient que ces graines pourraient un jour sauver des populations entières de la famine, bien au-delà de Leningrad et de la guerre. Les manger aurait signifié anéantir un patrimoine irremplaçable, fruit de voyages, d'expéditions et de sacrifices humains considérables.Malgré la faim, le froid, les bombardements et la menace constante des pillages, ils organisent la protection de la collection. Ils déplacent des échantillons, les dissimulent, les surveillent jour et nuit. Certains meurent assis à leur bureau, affaiblis par la malnutrition, entourés de graines intactes. Sur les douze scientifiques restés sur place pendant les pires mois du siège, seuls trois survivent.Leur sacrifice n'a pas été vain. La collection de l'Institut Vavilov a traversé la guerre et existe encore aujourd'hui. Elle contient des centaines de milliers de variétés végétales, dont certaines ont disparu à l'état naturel. Grâce à elles, des chercheurs modernes travaillent sur la résistance aux maladies, au changement climatique et aux famines futures.Cet épisode rappelle que, même au cœur de la barbarie et du désespoir, certains ont choisi de penser à l'humanité de demain. En protégeant ces graines au prix de leur vie, ces scientifiques ont semé bien plus que des plantes : ils ont laissé un héritage moral et scientifique unique dans l'histoire. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi la fonte des glaces n'élève pas le niveau de la mer partout au même rythme ?
La fonte des glaces liée au réchauffement climatique n'entraîne pas une montée uniforme du niveau des mers à l'échelle mondiale. Contrairement à une idée reçue, le niveau de la mer n'augmente pas partout au même rythme, et certaines régions peuvent même connaître, temporairement, une hausse plus faible que la moyenne, voire une baisse relative. Ce phénomène complexe s'explique par des mécanismes physiques bien identifiés, mis en lumière notamment par les travaux de Shaina Sadai, du Five College Consortium, et Ambarish Karmalkar, de l'université de Rhode Island.Le premier facteur clé est la gravité. Les grandes masses de glace, comme celles du Groenland ou de l'Antarctique, exercent une attraction gravitationnelle sur l'océan. Cette force attire l'eau vers les calottes glaciaires, créant un niveau de la mer plus élevé à proximité des glaces. Lorsque ces masses fondent, leur attraction diminue : l'eau est alors « libérée » et migre vers d'autres régions du globe. Résultat paradoxal : près des pôles, la fonte peut entraîner une hausse plus faible du niveau marin, tandis que des régions éloignées, notamment les zones tropicales, subissent une augmentation plus marquée.Deuxième mécanisme majeur : la déformation de la croûte terrestre, appelée ajustement isostatique. Sous le poids des glaciers, la croûte terrestre s'enfonce. Quand la glace disparaît, le sol remonte lentement, parfois sur des siècles. Ce rebond post-glaciaire peut compenser en partie la montée des eaux localement, comme c'est le cas dans certaines régions du nord de l'Europe ou du Canada. À l'inverse, dans des zones où le sol s'affaisse naturellement, la montée du niveau marin est amplifiée.Les chercheurs Sadai et Karmalkar ont cartographié ces effets combinés en montrant que la fonte des glaces redistribue l'eau de manière très inégale. Leurs travaux soulignent que certaines régions côtières densément peuplées — notamment en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique ou sur la côte est des États-Unis — sont exposées à une élévation du niveau de la mer supérieure à la moyenne mondiale. À l'échelle globale, la montée moyenne est aujourd'hui d'environ 3 à 4 millimètres par an, mais localement, elle peut être bien plus rapide.Enfin, les courants océaniques et la dilatation thermique jouent aussi un rôle. Le réchauffement de l'eau modifie la circulation des océans, accumulant davantage d'eau dans certaines zones. Ces dynamiques renforcent encore les disparités régionales.En résumé, la montée des mers n'est pas un phénomène uniforme mais une mosaïque de situations locales, façonnée par la gravité, la géologie et la dynamique océanique. Comprendre ces différences est crucial pour anticiper les risques côtiers et adapter les politiques de protection face au changement climatique. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Gavin Bryars, l'art de l'imprévu 5/5 : “Lorsque je joue avec mon ensemble, c'est comme jouer avec ma famille”
durée : 00:25:07 - Gavin Bryars, compositeur et contrebassiste (5/5) - par : Thomas Vergracht - À 82 ans, Gavin Bryars continue de réinventer la musique. Invité du festival Musica à Strasbourg, le compositeur revient, en cinq épisodes, sur un parcours éclectique croisant jazz, minimalisme et expérimentations avant-gardistes. - réalisé par : Béatrice Trichet Vous aimez ce podcast ? Pour écouter tous les autres épisodes sans limite, rendez-vous sur Radio France.
REDIFFUSION : ALEXIA BARRIER : A la conquête du Trophée Jules Verne
Pour démarrer l'année, on pense à Alexia Barrier et son équipage du "Famous Project" qui sont parties à la conquête du Trophée Jules Verne ! Malgré des mésaventures, les filles tiennent le cap et gardent le sourire. Il y a quelque jours, les huit navigatrices sont entrées dans le Pacifique avec le cap Horn en ligne de mire. Avant de retrouver un numéro inédit la semaine prochaine, je vous propose donc de nous replonger avant le départ afin d'écouter l'énergie et la détermination de cette navigatrice hors pair qui tente de faire bouger les lignes dans le milieu de la voile, tout en éveillant les consciences à la protection de la planète. Lorsque nous l'avons reçue, elle nous a raconté comment elle s'est préparée avec son équipage pour franchir la ligne de départ du Trophée Jules Verne. Un équipage 100% féminin qu'elle venait de présenter à la presse. 7 femmes, 6 nationalités afin d'essayer pour la première fois d'inscrire un temps féminin sur cette course au large sans assistance et sans escale. Alexia nous raconte cette aventure et comment elle compte, une fois de plus, collecter des données précieuses pour les scientifiques avec de mieux protéger l'Océan. Bonne écoute avec Impact Positif.Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
2 clés spirituelles pour une vie pleine d'assurance | Joseph Prince | New Creation TV Français
Lorsque la vie devient difficile et que vous êtes confronté à un dilemme, demandez-vous à Dieu un miracle ou cherchez-vous la sagesse nécessaire pour prendre la bonne décision ? Dans ce message, le pasteur Prince révèle comment, en Christ, nous pouvons marcher chaque jour dans la puissance et la sagesse...
Anna Karénine revisitée: «Une chanson, c'est comme une équation»
Fille de est le nouvel album / spectacle de Claire Diterzi. Pour cette nouvelle création, c'est Anny Karénine, fille adultérine de Anne Karénine qui est à l'honneur. Mais qui est donc Anny Karénine ? Elle n'est pas uniquement la fille adultérine d'Anna Karénine: c'est aussi le titre du nouvel album et spectacle à venir de l'artiste Claire Diterzi. Pour rappel, Anna Karénine est un roman de l'auteur russe Léon Tolstoï paru en 1877 en feuilleton dans Le Messager russe qui raconte les amours contrariés entre Anna Karénine, femme de la haute société russe, mariée à Alexis Karénine, fidèle et mère d'un jeune garçon. Lors d'un voyage, elle croise la route du comte Vronski, un officier brillant, mais frivole. Elle tombe amoureuse. Elle tombera enceinte et accouchera d'une fille qu'elle appellera Anny. Mais prise de culpabilité d'avoir abandonné mari et enfant, elle finira par se suicider en se jetant sous un train. « J'ai trouvé le livre un peu ennuyeux, mais pourtant j'ai aimé ce portrait de femme malheureuse » C'est lors d'un voyage sur le Transsibérien en 2019 que l'artiste Claire Diterzi découvre ce classique de la littérature russe qui l'inspire pour ce nouvel album et spectacle Fille de... Son spectacle musical commence donc par la fin du livre : elle imagine la vie d'Anny et analyse la relation mère/fille. On découvre Anny, devenue jeune femme avec ses désirs d'émancipation. Lorsque j'écris des chansons, j'ai l'impression de faire des maths. Une chanson, c'est comme une équation : on passe son temps à rentrer des carrés dans des ronds. Invitée : Claire Diterzi, autrice, compositrice et metteuse en scène, née en 1970, son parcours musical débute avec le collectif punk-rock Forguette Mi-Not. Elle débute ensuite une carrière solo. Depuis 2014, elle gère sa propre structure, Je Garde le Chien : label, édition et compagnie théâtrale musicale. Fille de est sorti le 19 septembre 2025. Son spectacle Anny Karénine sera joué au Théâtre du Rond-Point du 26 au 29 novembre 2025. Programmation musicale : Les titres diffusés sont tous extraits de Fille de Fille de, Pom pom girl, La mèche qui dépasse, I lego you.
Anna Karénine revisitée: «Une chanson, c'est comme une équation»
Fille de est le nouvel album / spectacle de Claire Diterzi. Pour cette nouvelle création, c'est Anny Karénine, fille adultérine de Anne Karénine qui est à l'honneur. Mais qui est donc Anny Karénine ? Elle n'est pas uniquement la fille adultérine d'Anna Karénine: c'est aussi le titre du nouvel album et spectacle à venir de l'artiste Claire Diterzi. Pour rappel, Anna Karénine est un roman de l'auteur russe Léon Tolstoï paru en 1877 en feuilleton dans Le Messager russe qui raconte les amours contrariés entre Anna Karénine, femme de la haute société russe, mariée à Alexis Karénine, fidèle et mère d'un jeune garçon. Lors d'un voyage, elle croise la route du comte Vronski, un officier brillant, mais frivole. Elle tombe amoureuse. Elle tombera enceinte et accouchera d'une fille qu'elle appellera Anny. Mais prise de culpabilité d'avoir abandonné mari et enfant, elle finira par se suicider en se jetant sous un train. « J'ai trouvé le livre un peu ennuyeux, mais pourtant j'ai aimé ce portrait de femme malheureuse » C'est lors d'un voyage sur le Transsibérien en 2019 que l'artiste Claire Diterzi découvre ce classique de la littérature russe qui l'inspire pour ce nouvel album et spectacle Fille de... Son spectacle musical commence donc par la fin du livre : elle imagine la vie d'Anny et analyse la relation mère/fille. On découvre Anny, devenue jeune femme avec ses désirs d'émancipation. Lorsque j'écris des chansons, j'ai l'impression de faire des maths. Une chanson, c'est comme une équation : on passe son temps à rentrer des carrés dans des ronds. Invitée : Claire Diterzi, autrice, compositrice et metteuse en scène, née en 1970, son parcours musical débute avec le collectif punk-rock Forguette Mi-Not. Elle débute ensuite une carrière solo. Depuis 2014, elle gère sa propre structure, Je Garde le Chien : label, édition et compagnie théâtrale musicale. Fille de est sorti le 19 septembre 2025. Son spectacle Anny Karénine sera joué au Théâtre du Rond-Point du 26 au 29 novembre 2025. Programmation musicale : Les titres diffusés sont tous extraits de Fille de Fille de, Pom pom girl, La mèche qui dépasse, I lego you.
L'économie mondiale retient son souffle : rétrospective de l'année 2025
L'année 2025 restera comme une année charnière pour l'économie mondiale, marquée par le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses décisions commerciales radicales. Cette émission spéciale d'Éco d'ici, éco d'ailleurs revisite, avec les experts qui sont intervenus à notre micro, les moments clés d'une année économique tumultueuse, entre guerres commerciales, crises géopolitiques, révolution de l'intelligence artificielle et urgence climatique.
L'économie mondiale retient son souffle : rétrospective de l'année 2025
L'année 2025 restera comme une année charnière pour l'économie mondiale, marquée par le retour tonitruant de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses décisions commerciales radicales. Cette émission spéciale d'Éco d'ici, éco d'ailleurs revisite, avec les experts qui sont intervenus à notre micro, les moments clés d'une année économique tumultueuse, entre guerres commerciales, crises géopolitiques, révolution de l'intelligence artificielle et urgence climatique.
Pour Noël, l'archevêque catholique de Douala invite à «créer vraiment un monde de paix»
Au Cameroun, l'archevêque de Douala saisit l'occasion de la fête de Noël pour appeler le pouvoir à libérer les centaines de personnes arrêtées après la présidentielle du 12 octobre. Et, pour joindre le geste à la parole, Monseigneur Samuel Kleda est allé, mercredi 24 décembre, célébrer une première messe de Noël à la prison de New Bell, à Douala. La mort en détention de l'opposant Anicet Ekane, la réélection de Paul Biya pour un huitième mandat… L'archevêque catholique de Douala s'exprime sans détours sur tous les récents événements au micro de Christophe Boisbouvier. RFI : Quel est votre message en ce jour de Noël ? Monseigneur Samuel Kleda : Le message est très simple parce que nous célébrons la fête de Noël, la naissance du Fils de Dieu parmi les hommes. Dieu nous aime et il a choisi de nous envoyer son Fils qui s'est fait l'un d'entre nous. Ça veut dire que Dieu nous rencontre par son Fils, et le Fils de Dieu vient nous donner la paix et surtout dans ce monde. En ce moment, beaucoup de pays, beaucoup de peuples sont en crise. Et alors maintenant, nous avons à redécouvrir que tous, nous pouvons nous accepter les uns les autres et vivre ensemble en paix. Alors vous appelez à la paix, mais le sang a coulé au Cameroun lors des violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants après la présidentielle du 12 octobre. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est d'abord de condamner cela. Lorsque nous organisons des élections, c'est pour mieux construire notre pays. Lorsque cela se transforme en une crise, je condamne totalement cela. Et aussi, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une élection présidentielle au Cameroun, il y a toujours la violence. Maintenant, j'invite tous les Camerounais à profiter de la fête de Noël pour créer vraiment un monde de paix, une société où nous pouvons vivre en paix les uns avec les autres. À l'issue de la répression des manifestations, il y a eu de nombreux morts, mais aussi beaucoup d'arrestations. Selon les autorités, 963 personnes sont toujours en prison. Que souhaitez-vous à leur sujet ? Tout simplement que ces gens-là soient libérés pour amener les gens à une sorte de paix. Parce que les gens sont inquiets. Mais tant de personnes arrêtées, ce n'est pas normal. Étant donné que le Christ est né pour tous les hommes, pour chaque homme. Voilà pourquoi hier, je suis allé célébrer la messe avec les prisonniers, leur dire que le Christ est né pour eux aussi, que le Christ vient les rencontrer dans leurs conditions de vie. Dans quelle prison de Douala êtes-vous allé hier ? La plus grande prison, New Bell, à Douala. Où vous avez célébré la messe avec les prisonniers ? Oui, j'ai vraiment prié avec eux pour leur apporter ce message d'espérance. Parce que c'est à Douala qu'il y a eu le plus d'arrestations, qu'il y a eu aussi beaucoup plus de morts. À Douala, et j'avais même fait une déclaration à ce sujet, invitant déjà les gens au calme, et ce calme demande que tous ceux qui sont arrêtés, qu'ils soient libérés. Alors parmi les personnes arrêtées après la présidentielle du 12 octobre, il y avait l'opposant Anicet Ekane. Le 1er décembre, il est mort dans sa cellule de Yaoundé. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle ? Moi, j'ai prié. Vraiment, j'ai beaucoup prié pour lui. Mais il n'est pas le seul, ses compagnons sont même encore en prison. Mais quelqu'un comme Ekane, mais il est malade. On le sait, mais on devrait mettre en place un système de traitement pour ne pas qu'il meure en prison. Mais je crois que lui, il était en danger de mort, puisqu'il vivait avec un appareil pour la respiration. On devait faire attention en l'interpellant, mais malheureusement ça n'a pas été fait. Voilà le résultat. Monseigneur Samuel Kléda, dans votre message de Noël de l'an dernier, vous aviez dit qu'une nouvelle candidature de Paul Biya n'était pas réaliste et que vous souhaitiez pour votre pays une transition pacifique. Alors, au lendemain de la réélection officielle de Paul Biya pour un huitième mandat, quel est votre sentiment ? Vraiment, je dirais, je suis triste. Je suis triste parce que, selon moi, quand on est une autorité, ça veut dire qu'on doit être capable de gouverner. Mais nous le savons, sur le plan humain, une personne âgée de 92 ans ne peut plus travailler nuit et jour pour gouverner. Mais ça, ça ne dépend pas de nous, c'est notre condition humaine. Justement, voilà pourquoi je dis qu'on devait être réaliste, dire que non, ce n'est pas ça. Essayons de choisir une autre personne qui puisse gouverner le pays. Mais malheureusement, nous sommes là à ce niveau. À lire aussiUne nouvelle candidature du président Biya en 2025 «n'est pas réaliste» selon l'archevêque de Douala
Restaurer quelqu'un, c'est choisir d'aimer malgré les murmures et d'ignorer les jugements. Lorsque l'on pèche, on pèche contre Dieu qui nous a établi. L'amour n'est pas une faiblesse, mais une noblesse.Tout le monde n'est pas capable de le donner, car aimer comme Christ demande du courage et de l'humilité.Un vrai père ne regarde pas à la faute, mais à la restauration. Entrer dans la mission de Dieu, c'est apprendre à aimer comme Christ a aimé. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion ; il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15:20Soutenez-nous sur PayPal !
Aider son enfant : comment utiliser les outils de coaching à la maison (Best of)
Aider son enfant à traverser ses émotions, ses peurs et ses difficultés sans les contrôler ni s'oublier soi-même est l'un des plus grands défis de la parentalité. Dans cet épisode Best of du podcast Sensées, Jenny Chammas, mastercoach certifiée et fondatrice de Coachappy, partage comment aider son enfant en utilisant concrètement les outils du coaching à la maison, avec plus d'écoute, de sérénité et de bienveillance.Être parent, c'est composer chaque jour avec des émotions intenses : colère, anxiété, peur de l'échec, frustration, découragement. Lorsque l'on cherche à aider son enfant, on se sent parfois démunie face à ce qu'il traverse, sans savoir quoi dire ni quoi faire. Cet épisode propose une approche réaliste et incarnée, issue du coaching, pour accompagner les enfants dans leur quotidien émotionnel tout en respectant leur rythme et leurs besoins.Jenny précise qu'il ne s'agit ni de recettes magiques ni de parentalité parfaite. Aider son enfant avec les outils du coaching, c'est avant tout adopter une posture : observer, écouter, poser des questions, accueillir les émotions sans les nier ni les dramatiser. C'est aussi accepter que cela ne fonctionne pas à tous les coups, et que vous êtes, vous aussi, humaine.Ce que vous saurez faire après écoute :– Aider son enfant à accueillir ses émotions intenses sans chercher à les faire disparaître.– Repérer les signaux faibles qui indiquent qu'un enfant traverse une difficulté.– Poser les bonnes questions pour l'aider à formuler son problème.– Transmettre des valeurs comme l'effort, la persévérance et la confiance sans pression.– Lui apprendre ce qui est sous son contrôle et ce qui ne l'est pas.À travers des exemples très concrets de son quotidien de mère, Jenny montre comment aider son enfant à mieux vivre avec ses émotions, à développer sa confiance en lui et à comprendre son fonctionnement interne. Elle rappelle aussi un point fondamental : pour accompagner ses enfants, il est essentiel de se faire accompagner soi-même, car accueillir les émotions de l'autre demande d'abord de savoir accueillir les siennes.Un épisode précieux pour toutes les mères qui souhaitent aider leur enfant avec plus de clarté, de calme et de justesse, tout en préservant leur propre équilibre émotionnel.
Préparez-vous à plonger dans les secrets d'enfance de la princesse Élisabeth Charlotte de Wittelsbach, la célèbre Liselotte (ou princesse palatine), épouse du frère de Louis XIV. Dans ce deuxième épisode, revenons à la Cour d'Heidelberg. Après 3 ans d'une union volcanique, le mariage des parents de Liselotte bat plus que jamais de l'aile : l'électeur Charles se tourne vers une nouvelle beauté, délaissant son épouse Charlotte pour une certaine Louise de Degenfeld. Lorsque la femme trompée découvre le pot aux roses, sa colère se déchaîne. Mais la maîtresse n'est guère plus docile que l'épouse : c'est la bague au doigt, sinon rien. L'électeur se lance alors dans une procédure burlesque et proprement scandaleuse !Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Le mot peut faire sourire, tant le légume semble inoffensif. Et pourtant, dans le langage courant, il est devenu synonyme d'échec artistique, en particulier au cinéma. Cette expression cache une histoire bien plus ancienne que le septième art.À l'origine, le navet est simplement un légume populaire, nourrissant, mais jugé banal et peu raffiné. Dès le XIXᵉ siècle, en français, le mot commence à être utilisé de manière figurée pour désigner une œuvre artistique considérée comme médiocre. On parle alors de « navet » à propos d'une pièce de théâtre ou d'un tableau raté. Le cinéma n'a fait que reprendre une expression déjà bien installée.Pourquoi ce légume en particulier ? Parce qu'il symbolise quelque chose de fade, d'ordinaire, sans saveur. À une époque où l'art est associé à l'élévation de l'esprit, comparer une œuvre à un navet revient à dire qu'elle n'apporte ni plaisir esthétique, ni émotion, ni profondeur. Elle nourrit peut-être… mais sans goût.Une autre hypothèse, souvent citée, vient du milieu de la peinture. Au XIXᵉ siècle, certains artistes académiques représentaient des légumes — notamment des navets — dans des natures mortes jugées sans imagination. Les critiques auraient alors utilisé le mot pour se moquer de ces tableaux sans ambition. Même si cette origine n'est pas totalement certaine, elle illustre bien l'idée d'un art répétitif et sans âme.Lorsque le cinéma apparaît à la fin du XIXᵉ siècle, le terme s'impose rapidement. Le cinéma est un art populaire, accessible à tous, et donc particulièrement exposé à la critique. Un film raté, mal joué, mal écrit ou ennuyeux devient naturellement un navet. L'expression est courte, parlante, et immédiatement compréhensible.Ce qui est intéressant, c'est que le mot « navet » ne renvoie pas forcément à un film techniquement mauvais. Il peut aussi désigner un film prétentieux, creux ou décevant, surtout lorsqu'il promettait beaucoup. Un gros budget, des stars, une grande campagne de promotion… et au final, un navet.Aujourd'hui, le terme est entré dans le langage courant, au point d'être presque affectueux. Certains navets deviennent même cultes, appréciés pour leurs défauts. Preuve que dans la culture populaire, l'échec peut parfois devenir une forme de réussite inattendue.En appelant un mauvais film un navet, nous ne jugeons donc pas seulement sa qualité. Nous exprimons aussi une vieille méfiance culturelle envers ce qui est jugé fade, ordinaire, et indigne de laisser une trace durable. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le bac de la Lobaye, trait d'union historique entre la Centrafrique et la RDC
En Centrafrique, un simple bac est devenu, au fil des décennies, bien plus qu'un moyen de traverser la rivière Lobaye. Depuis 1965, la liaison entre Mongoumba, en Centrafrique, et Betou, en RDC, relie chaque jour deux villes frontalières… et deux peuples. Camions de marchandises, véhicules, motos, passagers : tous empruntent cette traversée qui fait circuler produits, services et espoirs entre les deux pays. Malgré son ancienneté et des moyens modestes, ce bac reste un symbole vivant pour la région. Une activité tenue par les jeunes de la localité qui en ont fait à la fois une source de revenus et un véritable vecteur du désenclavement. De notre correspondant de retour de Mongoumba, À l'aube, lorsque la brume flotte encore au-dessus de la Lobaye, les premiers voyageurs apparaissent sur la rive, silhouettes tranquilles dans la lumière naissante. Ici, pour la traverser, on emprunte le bac : une plateforme en bois et en métal, portée par la force du courant, guidée par des conducteurs comme Sylvestre : « Ce bac c'est toute ma vie. Un métier simple et essentiel. Je transporte des véhicules, des camions et des cargaisons entières. Certains traversent pour aller faire du commerce, d'autres rejoignent leur famille, il y a également ceux qui partent au travail. » Le vacarme du moteur se mêle aux conversations. Femmes, hommes et enfants montent les uns après les autres. Chacun avec sa raison de traverser la rivière, mais le passage est le même pour tous. Bernice est une agricultrice. « Ce bac est comme un vieil ami pour moi. Sans lui, je ne suis rien. Mon champ se trouve de l'autre côté, et le bac est le seul moyen pour m'y rendre. Je monte toujours à bord avec mes paniers. Durant la récolte, c'est grâce à ce bac que j'achemine tous mes produits vers les grandes villes et les marchés. » Cohésion entre les habitants Lorsque le bac s'éloigne de la rive, un silence particulier s'installe. Tout le monde regarde l'eau. L'ombre des arbres se reflète sur la surface fluide. La dépendance à ce bac préoccupe Léopold Kossolo, le chef du village de Bac-Lobé-Yapo. « Ce bac est pratiquement le seul dans la région. S'il tombe en panne, toutes les villes alentour se retrouveront isolées les unes des autres. Ce bac renforce la cohésion entre les habitants, il nous rapproche. Bien sûr, il existe des pirogues, mais leurs capacités sont limitées. Il serait plus simple d'installer deux bacs ici et pourquoi pas de construire un pont sur la rivière. » Soudain, l'autre bord apparaît. Les premiers enfants accourent, et l'agitation reprend. Les passagers débarquent, chacun reprenant sa route, laissant derrière eux la courte traversée qui, pourtant, rythme le quotidien de toute une région. « Le bac a plus de 40 ans. Tout le monde sait que la rivière Lobaye est très profonde. Pour éviter tout drame ou naufrage, il est nécessaire de procéder à sa réhabilitation complète et, si possible, d'installer des équipements de sauvetage en cas d'accident. Chaque jour, des centaines de personnes font des allers-retours à cet endroit », explique Léopold Kossolo. La construction d'un pont sur la rivière Lobaye est en cours. Elle s'inscrit dans le cadre du projet du corridor 13, un programme de construction routière reliant la République du Congo, la RCA et le Tchad, financé par la Banque africaine de développement (BAD). À lire aussiRépublique centrafricaine: la Basse-Lobaye un trésor de biodiversité en péril
Pourquoi la Colombie porte-t-elle le nom de Christophe Colomb ?
La Colombie porte le nom de Christophe Colomb, mais le navigateur génois n'a jamais mis les pieds sur le territoire colombien actuel. Cette apparente contradiction s'explique par l'histoire complexe de la découverte de l'Amérique et par la construction politique des jeunes États du continent au XIXᵉ siècle.Christophe Colomb est avant tout associé à l'arrivée des Européens en Amérique en 1492. En réalité, il n'a jamais atteint le continent nord-américain et n'a exploré que certaines îles des Caraïbes, ainsi que les côtes de l'Amérique centrale. Pourtant, son voyage marque un tournant majeur : il inaugure durablement les échanges entre l'Europe et le continent américain, ce que l'on appelle souvent la « rencontre de deux mondes ».Lorsque les colonies espagnoles d'Amérique du Sud commencent à lutter pour leur indépendance au début du XIXᵉ siècle, leurs dirigeants cherchent des symboles forts capables de fédérer des territoires immenses et très divers. Christophe Colomb s'impose alors comme une figure fondatrice, perçue à l'époque comme l'initiateur de l'histoire moderne du continent américain, même si cette vision est aujourd'hui largement critiquée.En 1819, après plusieurs victoires militaires contre l'Espagne, le général Simón Bolívar proclame la création d'un nouvel État : la Gran Colombia. Cet ensemble politique regroupe alors les territoires de l'actuelle Colombie, du Venezuela, de l'Équateur et du Panama. Le choix du nom « Colombia » est hautement symbolique : il rend hommage à Colomb tout en affirmant une rupture avec la domination espagnole. Il s'agit d'un hommage paradoxal, car Colomb était lui-même un acteur de la conquête européenne, mais son nom est détaché de la couronne espagnole et transformé en mythe fondateur.La Gran Colombia se disloque rapidement, dès 1830, en plusieurs États indépendants. L'un d'eux conserve le nom de Colombie, qui devient officiel en 1886 avec la République de Colombie. Le nom est désormais enraciné dans l'identité nationale.Il faut aussi rappeler qu'au XIXᵉ siècle, l'image de Christophe Colomb est très différente de celle que nous avons aujourd'hui. Il est alors célébré comme un héros visionnaire et un explorateur audacieux, tandis que les violences de la colonisation sont largement passées sous silence. Ce n'est que plus tard que l'historiographie et les débats publics viendront nuancer, voire contester, ce récit.Ainsi, la Colombie porte le nom de Christophe Colomb non pas parce qu'il l'a découverte, mais parce que son nom est devenu un symbole politique et historique, choisi à un moment clé pour construire une nation et lui donner une place dans l'histoire du continent américain. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Ce phénomène étrange, presque comique, mais très courant, porte un nom scientifique : le “pee shiver”, littéralement « frisson de miction ». Beaucoup d'hommes le connaissent, certaines femmes aussi, et les scientifiques ont proposé plusieurs mécanismes complémentaires pour expliquer pourquoi le corps peut soudain se mettre à trembler au moment d'uriner.D'abord, il faut comprendre que la miction provoque une décharge soudaine du système nerveux autonome, celui qui gère les fonctions inconscientes : respiration, digestion, rythme cardiaque… et accès aux toilettes. Lorsque la vessie est pleine, le corps active le système nerveux sympathique, celui qui met l'organisme en état d'alerte. En urinant, on libère cette tension : le système parasympathique reprend le dessus, entraînant une chute de l'adrénaline et une forme de relaxation brutale. Ce basculement nerveux, très rapide, peut déclencher un petit frisson involontaire, comme un court-circuit physiologique.Deuxième mécanisme : la variation de température corporelle. L'urine stockée dans la vessie est plus chaude que l'air ambiant. Lorsque l'on urine, on perd un peu de chaleur interne. Cela ne refroidit pas réellement l'organisme de façon mesurable, mais la sensation de chaleur qui s'échappe peut suffire à activer le réflexe classique de thermorégulation : un frisson destiné à réchauffer le corps. C'est le même type de réflexe que lorsqu'on sort d'un bain ou qu'une brise froide traverse le dos.Troisième piste : la libération de tension musculaire. Une vessie pleine mobilise de nombreux muscles — abdominaux, plancher pelvien, bas du dos. Au moment d'uriner, ces muscles se relâchent en masse, et cette relaxation soudaine peut provoquer une micro-secousse comparable au relâchement d'un spasme. Le corps passe littéralement d'un état de contraction à un état de détente en une fraction de seconde.Enfin, plusieurs chercheurs pensent que ce frisson pourrait être un reste évolutif, un vestige de mécanismes archaïques qui synchronisaient les systèmes nerveux et hormonaux lors de certaines fonctions vitales. Rien de dangereux donc : un simple bug fascinant de notre biologie.En résumé, les frissons au moment de faire pipi sont le résultat d'une combinaison de facteurs : changement brutal d'activité du système nerveux, légère perte de chaleur, relaxation musculaire et réflexes ancestraux. Un phénomène surprenant, mais parfaitement normal — et qui rappelle que même les gestes les plus ordinaires cachent une mécanique biologique étonnamment complexe. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi parle-t-on d'écuries pour désigner les équipes en Formule 1 ?
Le terme peut surprendre à l'ère des moteurs hybrides, des simulateurs et des millions de données analysées en temps réel. Pourtant, son origine est profondément liée à l'histoire du sport automobile.À l'origine, une écurie est tout simplement un lieu où l'on abrite, nourrit et entretient des chevaux. Or, lorsque l'automobile fait ses premiers pas à la fin du XIXᵉ siècle, elle ne remplace pas brutalement le cheval : elle s'inscrit dans sa continuité. Les premières courses automobiles sont organisées par des passionnés issus du monde équestre, et le vocabulaire suit naturellement.Au début du XXᵉ siècle, les voitures de course sont souvent financées, entretenues et engagées par de riches industriels ou aristocrates, à la manière des propriétaires de chevaux de course. Ces mécènes disposent d'ateliers, de mécaniciens et de pilotes, exactement comme un propriétaire possède des chevaux, des palefreniers et des jockeys. On parle alors d'écuries automobiles, par analogie directe avec les écuries hippiques.Le parallèle va encore plus loin. Dans les courses de chevaux, une écurie peut aligner plusieurs chevaux dans une même compétition, tout en poursuivant une stratégie globale. En Formule 1, une écurie engage plusieurs voitures, gère ses pilotes, définit des tactiques de course et cherche à maximiser ses chances de victoire. Le terme s'impose donc naturellement pour désigner une structure organisée, bien plus qu'un simple véhicule.Lorsque la Formule 1 est officiellement créée en 1950, le vocabulaire est déjà bien installé. Des noms mythiques apparaissent : Ferrari, Maserati, Alfa Romeo. Ferrari, d'ailleurs, adopte comme emblème le cheval cabré, directement hérité de l'aviation militaire italienne, mais parfaitement cohérent avec cet imaginaire équestre déjà omniprésent.Avec le temps, les écuries deviennent de véritables entreprises industrielles et technologiques. Elles emploient des centaines, parfois des milliers de personnes, développent leurs propres moteurs, châssis et logiciels. Pourtant, le mot écurie reste. Pourquoi ? Parce qu'il ne désigne plus un lieu physique, mais une identité sportive, un collectif uni autour d'un objectif commun : gagner.Aujourd'hui encore, parler d'écurie permet de rappeler que la Formule 1 n'est pas qu'une affaire de pilotes stars. C'est un sport d'équipe, où la coordination, la stratégie et la préparation sont essentielles — comme dans une écurie de course hippique.En somme, si l'on parle d'écuries en Formule 1, c'est parce que ce sport moderne garde, dans ses mots, la mémoire de ses origines. Une preuve que même à 300 km/h, l'histoire n'est jamais bien loin. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Pourquoi notre sommeil pourrait prédire la démence ?
Le sommeil n'est pas qu'un moment de repos. Une nouvelle étude de l'Université de Californie à San Francisco montre qu'il serait peut-être l'un des meilleurs indicateurs précoces du risque de démence. Les chercheurs ont suivi 733 femmes âgées en moyenne de 82 ans, toutes en bonne santé cognitive au début de l'étude, pour comprendre si leurs habitudes de sommeil pouvaient annoncer l'apparition future d'un déclin mental. Et les résultats sont aussi clairs qu'inquiétants.Pendant cinq ans, chaque participante a été évaluée grâce à des capteurs de sommeil et des questionnaires détaillés. L'objectif était simple : observer comment la durée, la régularité et la qualité du sommeil évoluaient au fil du temps, et déterminer si ces changements étaient liés à un risque accru de développer une démence. Ce suivi longitudinal, rare par sa durée et la précision des mesures, a permis de dresser un portrait très fin du sommeil dans le grand âge.Les chercheurs ont découvert un élément frappant : les femmes dont le sommeil devenait plus irrégulier voyaient leur risque de démence augmenter de manière significative. Il ne s'agissait pas seulement de dormir moins, mais surtout de dormir à des heures différentes d'un jour à l'autre, avec un rythme de veille-sommeil instable. Cette irrégularité perturbe le fonctionnement de l'horloge biologique, ce système interne chargé d'organiser les cycles hormonaux, l'activité cérébrale et le métabolisme. Lorsque cette horloge se dérègle durablement, les neurones deviennent plus vulnérables.Mais ce n'est pas tout. Les participantes qui connaissaient une réduction progressive du temps passé en sommeil profond — la phase qui permet au cerveau de nettoyer les déchets neuronaux accumulés dans la journée — présentaient elles aussi un risque accru de démence. Ce processus d'« auto-nettoyage » du cerveau, rendu possible notamment par le système glymphatique, est essentiel. Quand il fonctionne mal, des protéines comme la bêta-amyloïde peuvent s'accumuler, favorisant les maladies neurodégénératives.L'étude met également en lumière un facteur psychologique : les femmes qui rapportaient une sensation de sommeil non réparateur développaient plus souvent un déclin cognitif. Le ressenti subjectif semble donc aussi important que les données objectives.Ces résultats ouvrent une perspective essentielle : le sommeil pourrait devenir un outil de dépistage précoce. Surveiller l'évolution du rythme de sommeil chez les personnes âgées, en particulier sa régularité, pourrait aider à détecter plus tôt les risques de démence et à mettre en place des mesures préventives.En un mot, cette étude rappelle que le sommeil n'est jamais anodin. Il pourrait bien être l'un des premiers signaux d'alerte de notre cerveau. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
[FORMAT POCHE] Oscar Pistorius, l'athlète sur-homme à la face sombre
Découvrez celui qu'on surnomme “Blade Runner”, le premier sportif amputé à concourir dans un championnat du monde pour les valides. S'il a longtemps été une source d'inspiration pour les autres sportifs handicapés souhaitant se lancer dans des compétitions, aujourd'hui ce n'est plus pour ses prouesses sportives qu'il fait les gros titres, mais pour le crime qu'il a commis. Son nom : Oscar Pistorius. De ses exploits athlétiques à sa condamnation pour homicide volontaire, découvrez son sordide destin Un parcours hors-norme Jeux Olympiques de Londres 2012, 4 août. Lorsque les noms des différents coureurs sont annoncés, c'est le nom d'Oscar qui fait le plus parler. Ce jeune coureur Sud Africain de 25 ans est pourtant loin d'être favori, repêché par le comité Olympique de son pays pour la participation à ces jeux, il arrive deuxième du premier round de cette épreuve avec un temps en deçà de ses adversaires. Non, si Oscar fait parler de lui ce n'est pas pour ses résultats, c'est parce qu'avant le coup d'envoi, alors que les autres athlètes positionnent leurs pieds sur les starting block, Oscar lui, positionne deux lames de carbones qui lui servent de prothèses. Un podcast Bababam Originals Ecriture : Clémence Setti Voix : Andréa Brusque Production : Bababam Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
La Russie resserre encore son contrôle sur le numérique
Après le bannissement en 2022 de Facebook et d'Instagram, réseaux emblématiques du groupe Meta, les autorités russes renforcent leur emprise sur les espaces de l'internet et des applications étrangères. Depuis cet été, les appels via WhatsApp, FaceTime et Telegram sont bloqués, au nom de la lutte contre le fléau des fraudeurs. D'autres coupures et interdictions sont, quant à elles, justifiées au nom de la sécurité nationale, et notamment les attaques de drones. « Désolé de ne pas avoir donné signe de vie, mon téléphone s'est soudainement éteint et l'écran est devenu tout noir. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. » Casquette sur la tête, bouille bienveillante et souriante, Nicolas Maschourov arrive tout essoufflé et un poil en retard au rendez-vous sur une place du centre de Yaroslavl, face à l'un des monastères les plus célèbres de cette ville au riche passé historique. Au fond, ce mystérieux incident du jour n'est pour lui qu'un de ceux qui s'ajoutent à une longue liste, tant la vie quotidienne est déjà bien compliquée localement. Dans cette ville-étape incontournable pour les touristes, cela fait en effet de longs mois que les liaisons téléphoniques et internet sont perturbées. Yaroslavl est en effet aussi une ville industrielle importante, ce qui fait d'elle une cible dans le conflit avec l'Ukraine. « On a ici une raffinerie très importante, elle fournit du pétrole à de nombreuses régions de l'Ouest du pays, explique Nicolas Maschourov. À l'heure actuelle, les règles y sont très strictes à l'intérieur, car il y a un risque de sabotage. Lorsque vous entrez dans l'usine, vous n'êtes même pas autorisé à prendre votre téléphone, vous devez le laisser dans votre voiture. Et si jamais vous avez oublié et qu'il est resté dans votre poche, l'amende que vous encourez atteint 30 000 roubles. Si on vous attrape une deuxième fois avec, vous êtes viré. Tout ça, c'est parce que cette raffinerie est périodiquement attaquée par des drones. Heureusement, jusque-là, les attaques ne se sont produites que vers 5 ou 6 heures du matin, lorsque les travailleurs n'étaient pas là. Mais la situation là-bas est quand même assez tendue. L'Internet mobile y est généralement désactivé. » Ce vendredi 12 décembre, selon les médias locaux, une attaque contre la raffinerie a été à l'origine d'un incendie. Une partie des routes y menant ont été fermées, causant des bouchons de plusieurs kilomètres. Mais le plus fréquent pour parer aux attaques reste de couper le réseau. « L'Internet mobile dans toute la ville est de toute façon souvent en mauvais état désormais, avance le professeur d'histoire et guide touristique. De temps en temps, c'est même totalement coupé ». À lire aussiRussie: le contrôle étatique de l'expression publique sur les réseaux sociaux s'accélère « J'ai envie de hurler tellement je suis furieux et tellement je trouve ça injuste. » Première conséquence : impossible d'utiliser la géolocalisation, très répandue en Russie. Mais d'autres usages sont désormais limités. Dans sa cuisine, avec sa bouilloire qui siffle sur le gaz pour chauffer l'eau du thé, Andrey Akimov explique qu'il aimerait pouvoir publier à sa guise sur les réseaux sociaux. « Je gère plusieurs chaînes Telegram, explique cet avocat et secrétaire d'un petit parti, qui tente d'être officiellement enregistré par les autorités. J'y poste diverses choses, et tout est légal et officiel. Mais parfois c'est impossible à faire. J'essaie une fois, deux fois. Puis je me dis : “Ok, je réessaie dans 10 minutes", et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai un ressenti de 5% d'inconfort. Je réessaie trois- quatre fois. Et si, à la cinquième tentative, une demi-heure plus tard, je ne peux toujours pas publier, je commence à ressentir de l'anxiété et de la colère. À ce moment-là, bien sûr, mon inconfort est à 100%. J'ai envie de hurler tellement je suis furieux et tellement je trouve ça injuste ». Pour lui, les exigences sécuritaires d'un pays en conflit ne sont pas les seuls motifs à ces restrictions de plus en plus importantes. Avec prudence et des mots très pesés, il avance : « Je vais dire les choses de cette façon : je comprends un peu la stratégie des autorités. Il y a une tendance à réduire les libertés, à contrôler les ressources Internet. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire si on procède progressivement, pas à pas, en supprimant une partie des droits et libertés des citoyens petit à petit, de telle sorte que l'indignation soit étalée dans le temps et qu'il n'y ait pas de pic soudain ». Depuis cet été, les autorités ont mis en place une messagerie nationale, Max, et tentent de convaincre les citoyens d'y migrer, la présentant comme plus sûre. Les critiques avancent qu'il s'agit d'une stratégie visant à surveiller les contenus, car Max est présentée comme totalement transparente pour les services de sécurité. Entre blocage des messageries étrangères et coupures de l'internet, de plus en plus de Russes vivent depuis plusieurs mois à l'heure des restrictions de communication. À lire aussiVers un «goulag numérique»: comment la Russie développe le contrôle et la surveillance de ses citoyens Yaroslavl est très loin d'être la seule ville touchée. Aux derniers décomptes effectués mi-décembre, une quarantaine de régions sur les 89 que compte la Russie ont souffert depuis le printemps d'incidents de types variés. Toutes les régions frontalières ou proches de la zone de combat sont plus ou moins touchées, de Rostov à Koursk et Voronej, ainsi que des villes de garnison comme Pskov ou des régions abritant d'importantes usines du complexe militaro-industriel comme celle de Sverdlovsk. D'autres villes et régions à des milliers de kilomètres à l'est ont aussi enregistré des plaintes d'usagers au sujet de très longues coupures : en Sibérie, à Omsk ou en Yakoutie, jusqu'à Khabarovsk, le Kamchatka et Sakhaline dans l'Extrême-Orient. Même Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, a été le théâtre de deux jours consécutifs de perturbations. À Moscou, depuis mai dernier, des pannes régulières mais courtes sont observées. Comme à Yaroslavl, les autorités régionales expliquent en général ces coupures comme des « mesures de sécurité visant à se protéger contre les attaques de drones ». Selon le groupe de travail du kraï de Krasnodar, « un adversaire peut utiliser l'internet mobile à haut débit pour contrôler des drones et perpétrer des attentats terroristes ». Ces restrictions sont imposées dès réception d'un signal de « menace drone » et sont techniquement temporaires. Wikipedia.ru a fait ce décompte : 69 coupures avaient déjà été enregistrées en mai, mais en juin, ce nombre était passé à 655, et en juillet, il a atteint le chiffre record de 2 099 coupures à travers le pays. Ce chiffre a dépassé le total mondial des blocages d'internet pour toute l'année 2024 (296 incidents dans 54 pays), faisant de la Russie le pays le plus touché par les pannes de communications numériques. « Notre pays est en état de guerre, [...] nous ne pouvons pas revendiquer les libertés que nous avions auparavant. » À quelques kilomètres de Moscou, la ville de Balachika est une zone connue pour abriter notamment une importante base de l'armée russe. Une tradition ancienne : sous l'Union soviétique, la ville était d'ailleurs interdite aux étrangers. Zina, 42 ans, m'accueille dans la cour en bas de son immeuble, dans cette ville où elle a déménagé il y a trois ans « pour la nature et la vue sur le canal ». Pour elle, toutes les mesures de restrictions prises pour internet sont justifiées, y compris cette autre, récente, qui bloque l'usage des cartes SIM, russes comme étrangères, pendant 24 heures à tout retour de l'étranger. « Je comprends très bien qu'une carte SIM pourrait soudainement ne plus être entre les mains de son propriétaire officiel. Elle pourrait être volée, avec le téléphone ou pas d'ailleurs. Et cette carte SIM pourrait être utilisée par d'autres personnes à leurs propres fins. Moi, je compare cette décision à la quarantaine temporaire obligatoire pendant le Covid-19 ou à l'usage des masques. On peut quand même trouver le moyen de s'organiser et préparer un retour de vacances. Je comprends que des gens soient très énervés, mais notre pays est en état de guerre, alors pour moi, c'est évident, nous ne pouvons pas revendiquer les libertés que nous avions auparavant », affirme-t-elle. Pour elle, le vrai problème, qui la concerne de près, est ailleurs. « Je vais vous dire qui traverse, à cause de tout ça, de vraies difficultés, avance-t-elle. Ce sont ceux qui ne gagnaient leur vie que grâce au blogging, en vendant des publicités, par exemple, ou en monétisant leurs publications. C'est vrai, il existe des plateformes alternatives à celles qu'on avait avant, mais avec celles-là, on ne peut pas gagner autant d'argent. Elles sont mal conçues. Et cela a un impact sur toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, qui pendant de nombreuses années ont construit un système de diffusion en continu, produisaient du contenu. En fait, chaque blogueur avait en quelque sorte créé sa propre petite agence. C'est un système qui s'est effondré ». Sans Instagram, classé extrémiste en Russie, et avec l'interdiction depuis cet automne d'y faire de la publicité, Internet qui rame est le dernier clou dans le cercueil de son activité professionnelle de bloggeuse-coiffure. Sur un an, Zina chiffre sa perte de revenu à 80%. À lire aussiLa Russie resserre encore son contrôle sur internet
Dans cet épisode glaçant de Dans Le Noir, découvrez l'histoire de Mme Harridan, une vieille femme apparemment inoffensive… jusqu'à ce qu'un agent de police disparaisse mystérieusement après lui avoir rendu visite. Ce récit terrifiant explore les dessous d'une maison où le calme, le thé chaud — et les sourires — cachent en réalité un secret indicible.Lorsque l'agent Dudley vient interroger la vieille dame au sujet d'enfants portés disparus dans le voisinage, il ne se doute pas que la tasse de thé qu'elle lui offre contient un mélange d'herbes et d'épices destiné à envoûter ses invités. Peu à peu, la conversation devient étrange, la tension monte… et l'on découvre ce que Mme Harridan cache dans son sous-sol.Plongée dans :une histoire d'horreur psychologique,un twist macabre,un récit paranormal captivant,une ambiance de sorcellerie moderne,une disparition inquiétante,et un suspense digne des meilleures creepypastas.Un épisode parfait pour ceux qui aiment les histoires effrayantes, les podcasts immersifs, les récits hypnotiques, et les légendes urbaines revisitées.Éteignez les lumières… Servez-vous une tasse… Et écoutez ce que cache vraiment Le Thé de Mme Harridan.
Pourquoi un atoll de Polynésie a sombré dans la folie en 1987 ?
En 1987, un drame aussi absurde qu'effroyable secoue l'atoll de Faaite, dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Ce qui restera dans l'histoire comme « l'Affaire des bûchers de Faaite » est l'un des épisodes les plus sombres de la Polynésie contemporaine : une véritable flambée de fanatisme religieux, ayant conduit des habitants ordinaires à torturer et brûler vives plusieurs personnes accusées… de sorcellerie.L'affaire commence lorsque deux prédicatrices évangéliques venues de Tahiti arrivent sur l'île. Leur discours passionné, mêlant visions apocalyptiques, exorcismes improvisés et dénonciations des “forces démoniaques”, trouve un écho dans une partie de la population. Sur cet atoll isolé, marqué par une forte tradition orale et une vie communautaire très soudée, leurs propos déclenchent une spirale incontrôlée. Les habitants, déjà influencés par des croyances ancestrales autour des esprits, se laissent convaincre de la présence d'un mal invisible parmi eux.Rapidement, un climat d'hystérie collective s'installe. Des habitants sont accusés d'être “possédés”, de jeter des sorts ou d'être à l'origine de malheurs supposés. Les suspects, souvent choisis au hasard ou dénoncés pour des comportements jugés étranges, sont séquestrés, frappés, torturés. Le phénomène prend l'ampleur d'une véritable chasse aux sorcières. Les prédicatrices encouragent les exorcismes, et une partie de la population croit sincèrement agir pour “sauver” l'île du mal.Le 2 septembre 1987, la situation atteint son paroxysme. Six personnes, parmi lesquelles un adolescent, sont enfermées, battues, puis jetées dans des bûchers allumés pour “purifier” le village. Certaines meurent brûlées vives sous les yeux de leurs proches, convaincus d'assister à la libération de leur âme. Ce passage à l'acte marque l'un des rares cas contemporains de sacrifices humains motivés par un délire mystico-religieux dans un territoire français.Lorsque les gendarmes arrivent enfin sur l'île, ils découvrent une communauté sous le choc, incapable d'expliquer rationnellement ce qu'elle vient de vivre. L'affaire fait immédiatement la une des journaux, sidérant l'opinion publique. Les procès qui s'ensuivent mettent en avant un phénomène de psychose collective, influencée par des croyances syncrétiques mêlant christianisme évangélique et traditions polynésiennes.L'Affaire des bûchers de Faaite reste aujourd'hui un exemple tragique de la manière dont l'isolement, la peur et le fanatisme peuvent transformer une communauté paisible en groupe meurtrier. Un rappel brutal du pouvoir destructeur des croyances lorsqu'elles échappent à toute raison. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Audrey Daigneault: complications post-accouchement
Cet épisode est présenté par Solveig qui propose des vêtements qui se portent avant, pendant et après la grossesse. Tous les morceaux sont adaptés pour l'allaitement. La mission de Solveig est de créer des vêtements aussi beaux que confortables pour aider les femmes à se sentir confiantes dans les périodes de grands changements corporels, parce qu'avant d'être des mères, nous restons avant tout des femmes. Pantalons, jupe, hauts, robes, tous les produits Solveig se retrouvent sur le site www.solveigmama.com Merci également à Jadou & Flo : les livres souvenirs qui sont là pour vous aider à préserver sans effort chaque étape de la vie de votre enfant, de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'âge 5 ans. Avec leur design élégant et intemporel, leurs pages simples et intuitives, leurs pochettes intégrées et leur boîte souvenir, ils transforment vos moments importants en un souvenir rempli d'amour et de tendresse. Un magnifique cadeau pour vous, et vos humains! Découvrez les livres sur le https://jadouflo.com La créatrice de contenu Audrey Daigneault vient me raconter son accouchement où tout s'est bien déroulé…ou presque. Elle n'a pas particulièrement aimé être enceinte, elle a fait des cours prénataux sur Zoom via le CLSC : vraiment rien d'extraordinaire. Mais lorsqu'elle perd un peu de liquide, le corps médical réalise qu'il y a du méconium dans ce dernier. Lorsque sa fille vient au monde, elle est immédiatement prise en charge par l'équipe médicale, sous les yeux des nouveaux parents. De son côté, Audrey fera une hémorragie post-accouchement. Sa fille, hospitalisée quelques jours et elle-même sont finalement hors de danger.
États-Unis: pourquoi la Fed s'apprête à baisser encore ses taux directeurs
Réunie à Washington jusqu'à ce mercredi soir, la Réserve fédérale américaine doit rendre une décision très attendue sur sa politique monétaire. Une baisse des taux directeurs apparaît aujourd'hui comme le scénario le plus probable, dans un contexte dans lequel l'inflation recule tandis que le marché du travail montre des signes de fragilité. C'est à Washington que se joue, jusqu'à ce mercredi soir, l'une des décisions économiques les plus importantes du moment. La Réserve fédérale américaine, la Fed, y tient sa réunion de politique monétaire, au terme de deux jours de discussions entre ses membres. À l'issue de cette réunion, la banque centrale la plus puissante au monde pourrait annoncer une nouvelle baisse de ses taux directeurs, un scénario désormais largement anticipé par les acteurs économiques, politiques et financiers américains. La décision est suivie de près, car les taux directeurs de la Fed jouent un rôle central dans l'économie américaine. Ils représentent tout simplement le prix de l'argent. Lorsque ces taux sont élevés, emprunter coûte plus cher: les ménages consomment moins, les entreprises investissent moins et l'activité ralentit. À l'inverse, une baisse des taux rend le crédit plus accessible et soutient la croissance. Inflation maîtrisée, emploi fragilisé : le cœur de l'arbitrage La Fed agit dans le cadre d'un double mandat: contenir l'inflation et garantir le plein emploi. C'est l'équilibre entre ces deux objectifs qui guide ses décisions. Aujourd'hui, l'inflation américaine se situe autour de 3%, un niveau encore supérieur à l'objectif officiel de 2 %. Mais la banque centrale ne se focalise pas uniquement sur le niveau des prix à un instant donné. Elle observe avant tout la tendance et les anticipations. Or, sur ce terrain, les signaux sont jugés rassurants. L'inflation ne semble plus constituer la principale menace pour l'économie américaine, ce qui ouvre la porte à un assouplissement monétaire. En revanche, le marché du travail envoie des signaux beaucoup plus préoccupants. Les créations d'emplois continuent de ralentir, les chiffres ont une nouvelle fois été révisés à la baisse et certaines publications ont été retardées en raison du shutdown. Surtout, les petites et moyennes entreprises, pilier de l'emploi aux États-Unis, sont sous pression. Or, l'économie américaine repose très largement sur la consommation. Lorsque l'emploi se détériore, les ménages consomment moins, la croissance ralentit et le risque de récession augmente. C'est précisément pour éviter ce scénario que la Fed envisage d'agir. Une baisse progressive, sous le regard méfiant des marchés Le scénario le plus probable évoque une baisse des taux directeurs de 0,25 point, ce qui les porterait dans une fourchette comprise de 3,50% à 3,75 %. Une décision qui s'inscrirait dans une stratégie prudente et graduelle. La Fed a déjà entamé ce mouvement lors de sa dernière réunion et avance désormais pas à pas, sans précipitation. Mais cette baisse des taux directeurs intervient dans un contexte paradoxal. Les taux d'intérêt à dix ans, eux, ont fortement augmenté. Cette évolution s'explique par les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant la trajectoire de la dette américaine, mais aussi par les interrogations autour de l'indépendance future de la Fed. Avec le départ annoncé de son président Jerome Powell en mai prochain et le retour de Donald Trump sur la scène politique, certains redoutent une Réserve fédérale plus politisée, et donc moins indépendante. Or, le doute n'est jamais bon pour les marchés: lorsqu'il s'installe, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour prêter à long terme. À court terme, une baisse des taux directeurs devrait néanmoins soutenir l'économie américaine. À moyen terme, tout dépendra de la capacité de la Fed à préserver sa crédibilité. Si celle-ci venait à être remise en cause, le risque serait un retour de l'inflation, une fragilisation du dollar et des taux d'intérêt durablement élevés.
Pourquoi les ventes de slips sont-elles un indicateur économique ?
Parmi les signaux inattendus que les économistes scrutent pour prendre la température d'un pays, il en existe un particulièrement étonnant : la vente de slips et de caleçons masculins. Derrière son apparence anecdotique, cet indicateur repose pourtant sur une logique comportementale simple et révélatrice.L'idée a été popularisée par Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine. Selon lui, la consommation de sous-vêtements masculins évolue très lentement… sauf en période de tension économique. Pourquoi ? Parce que, pour beaucoup d'hommes, l'achat de slips n'est pas une priorité. Contrairement à des produits visibles comme les chaussures ou les vêtements de dessus, personne ne remarque vraiment si vos sous-vêtements sont neufs ou un peu usés. En temps normal, les achats se font à un rythme stable. Mais lorsque l'économie se dégrade, ces dépenses jugées secondaires sont les premières à être repoussées. Autrement dit : si les hommes conservent plus longtemps leurs vieux sous-vêtements, c'est souvent que le portefeuille se serre.Ce comportement fait des ventes de slips une sorte de baromètre discret, un indicateur avancé de ralentissement économique. À la différence d'autres grandeurs macroéconomiques — chômage, PIB, inflation — qui bougent avec inertie, les dépenses du quotidien réagissent immédiatement au moral des ménages. Dès que la confiance baisse, même légèrement, les achats non essentiels sont reportés. Les sous-vêtements masculins, avec leur cycle de renouvellement très régulier, deviennent alors un marqueur sensible de cette prudence accrue.Ce principe s'applique d'ailleurs à d'autres consommations “banalisées”. La fréquentation des restaurants, ou des salons de coiffure, recule souvent avant que les statistiques officielles ne signalent une crise. Et parfois, certains produits deviennent presque des thermomètres économiques traditionnels. À New York, par exemple, le célèbre restaurant Gray's Papaya propose depuis des décennies un menu surnommé sans détour le “Recession Special” : un repas bon marché qui voit ses ventes bondir chaque fois que l'économie vacille. Lorsque les clients affluent vers ces offres à bas prix, c'est généralement que la population commence à ajuster son budget.Ainsi, derrière l'humour apparent de l'“indice du slip”, se cache une observation sérieuse : dans l'économie, les petits arbitrages du quotidien disent souvent plus que les grandes statistiques. Suivre la consommation de biens anodins permet de capter très tôt les changements d'humeur des ménages. Et parfois, un simple slip raconte beaucoup sur l'état d'un pays. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
À la Une: les enseignements de la tentative de putsch au Bénin
48 heures après le coup de force des militaires à Cotonou, « l'heure n'est plus seulement au soulagement, mais à l'autopsie d'une faillite sécuritaire et politique, relève Afrik.com. En effet, au-delà de l'échec opérationnel des mutins, cet événement marque une rupture : le "modèle béninois", cette exception démocratique (déjà écornée) dans une région sahélienne en feu, vient de montrer ses limites structurelles. « Depuis 2016, précise le site panafricain, le président Patrice Talon a opéré un changement radical de paradigme : sacrifier une part des libertés publiques et du pluralisme politique sur l'autel de l'efficacité économique et de la modernisation des infrastructures. Mais ce coup de force, bien que déjoué, suggère que ce pacte ne fait plus l'unanimité, y compris au sein des "corps habillés". La prospérité macroéconomique vantée par le régime ne ruisselle pas assez vite pour apaiser les frustrations sociales, et celles désormais affichées des militaires, affirme encore Afrik.com. En verrouillant le système électoral (à savoir l'exclusion de l'opposition radicale lors des législatives passées et les difficultés pour la présidentielle de l'année prochaine), le pouvoir a involontairement fait de la caserne le seul lieu de contestation possible. Lorsque l'urne est cadenassée, le fusil devient tentant. » Frustrations nombreuses En effet, renchérit Le Pays au Burkina Faso, « la question qui se pose est de savoir si Patrice Talon saura tirer les leçons de ce pronunciamiento avorté qui, après coup, apparaît comme un avertissement sans frais pour lui. La question est d'autant plus importante qu'au-delà des revendications des comploteurs, l'atmosphère sociopolitique reste teintée de souffre dans ce contexte préélectoral où, entre embastillement d'opposants et mise à l'écart du principal parti d'opposition, "Les Démocrates" de l'ancien président Boni Yayi, les frustrations sont nombreuses. Et ce, dans une ambiance où le président Talon est accusé de dérives autoritaires par ses contempteurs. » Le rôle de la France… Jeune Afrique pour sa part nous éclaire sur le rôle de la France lors de cette tentative de coup d'État. « Dès les premières heures dimanche, le président français a été informé de l'évolution de la situation. Emmanuel Macron et Patrice Talon ont échangé par téléphone au cours de la journée. Selon nos informations, poursuit le site panafricain, le chef de l'État français a fait savoir à son homologue béninois qu'il avait prépositionné à Cotonou des membres des forces spéciales de l'armée française, mises en alerte dès le début des événements. Emmanuel Macron a également joint le chef de l'État nigérian, Bola Tinubu, pour appuyer les demandes d'intervention formulées par les autorités béninoises. (…) Dans le même temps, révèle encore Jeune Afrique, les services de renseignements français ont apporté un appui technique aux Forces de défense et de sécurité béninoises, qui combattaient les mutins aux abords de la présidence, puis des studios de la chaîne de télévision nationale. Un avion de surveillance a notamment survolé la capitale béninoise à de nombreuses reprises durant la journée de dimanche. » Et Jeune Afrique de rappeler enfin que « la France et le Bénin sont liés par des accords de coopération militaire depuis 1977, qui sont très régulièrement mis à jour ». Davantage de coups d'États en Afrique ? Enfin, à lire dans Le Monde Afrique, cet entretien avec Achille Mbembe. Pour le philosophe et politologue camerounais, nous assistons à une crise du multipartisme en Afrique : « une "crise du multipartisme" et non une "crise de la démocratie", affirme-t-il, pour la simple raison que la quasi-totalité des pays du continent n'ont jamais rempli les critères élémentaires d'un État de droit. Dans les années 90, suite à la poussée protestataire contre les régimes autocratiques, des arrangements institutionnels découlant des conférences nationales avaient été mis en place, dont l'autorisation de partis d'opposition. Mais, tout cela n'était que de façade. » Et les institutions actuelles, estime encore Achille Mbembe, « ne sont pas prêtes pour traiter politiquement les conflits que génèrent les sociétés. Héritées dans la plupart des cas de l'époque coloniale, elles ont été conçues pour commander au lieu de dialoguer, pour réprimer au lieu de négocier. C'est ce qui explique le recours systématique à la violence. Tant qu'on ne s'attaque pas à ce système, il y a fort à parier que cette dynamique va se poursuivre. Et, conclut le philosophe et politologue camerounais, dans les temps à venir, nous allons à assister à davantage de coups d'État en Afrique ».
Comparer ses galères : ce réflexe (assez humain) qui complique votre rapport à l'alimentation
Pourquoi avons-nous tendance à minimiser ce que nous vivons ?Et comment ce réflexe apparemment anodin peut-il influencer votre rapport à l'alimentation ?Ah ben, ça, c'est important de le savoir ! Dans cet épisode de Dans la poire !, je vous propose d'examiner un mécanisme fréquent mais souvent méconnu : la comparaison de vos galères, de vos fatigues et de vos difficultés. Ce réflexe, très répandu, consiste à penser que “d'autres vivent pire”, que votre fatigue “n'a pas de raison d'être”, ou que vos émotions devraient être plus “raisonnables”.Je décris comment ce réflexe, pourtant très humain, brouille les signaux internes, empêche la reconnaissance de la fatigue réelle et peut encourager des prises alimentaires guidées non par la faim, mais par la nécessité d'apaiser une tension émotionnelle. Lorsque la lassitude, l'ennui ou le manque d'élan ne trouvent pas d'espace pour être exprimés, ils cherchent d'autres voies pour se manifester.Je m'appuie également sur la réflexion d'Audre Lorde, poétesse, essayiste et militante, qui rappelle que prendre soin de soi n'est pas un geste d'indulgence, mais un acte de préservation.Reconnaître la fatigue n'est pas une faiblesse : c'est une manière d'ouvrir un espace où vos besoins peuvent exister sans être comparés ni hiérarchisés.✨ Cet épisode est fait pour vous si :vous vous dites souvent « ce n'est rien » alors que votre corps raconte l'inverse,vous comparez vos difficultés à celles des autres,vous sentez que votre fatigue influence votre rapport à la nourriture,vous avez du mal à demander de l'aide, à poser des limites ou à reconnaître votre vulnérabilité,vous souhaitez comprendre comment vos émotions influencent vos prises alimentaires.Je vous proposerai enfin une question simple mais essentielle pour éclairer votre semaine (enfin, je l'espère!). Cet épisode vous accompagnera pour mieux comprendre ce réflexe, en identifier les coûts invisibles et rétablir une relation plus claire avec vos besoins. Une manière d'alléger à la fois votre charge mentale, votre fatigue… et votre rapport à l'alimentation.
Pour devenir Ambassadeur du bonheur et m'aider à propulser le lancement de mon nouveau livre sur Amazon. Inscrivez-vous !Une remarque blessante peut suffire à ébranler la confiance, même lorsque tout semble aller bien dans les relations au quotidien. Lorsqu'un jugement nous atteint, nous cherchons immédiatement ce que nous aurions fait de travers, comme si la parole de l'autre révélait une vérité sur nous. Pourtant, les mots d'une personne parlent d'abord d'elle-même : de ses peurs, de ses croyances, de ses insécurités.C'est ce que rappelle le deuxième accord toltèque partagé par Don Miguel Ruiz : « Ne faites jamais une affaire personnelle ». Lorsque quelqu'un critique, juge ou dévalorise, il exprime surtout son monde intérieur. Le « poison » émotionnel n'entre qu'à partir du moment où nous acceptons de lui donner du crédit.Prendre du recul permet de déplacer le regard : au lieu de se demander « Qu'est-ce que j'ai fait ? », se demander « De quoi cette personne parle-t-elle en elle ? ». Cette distance ouvre la voie à un meilleur discernement entre deux types de retours : le feedback constructif, qui aide à progresser, et les attaques personnelles, qui sapent inutilement l'estime de soi.Choisir consciemment ce que l'on accueille ou non est une manière de préserver son équilibre émotionnel. Cela renforce la confiance intérieure, diminue la rumination et favorise des relations plus apaisées. En comprenant que chacun parle depuis son propre vécu, il devient plus simple d'écouter sans se blesser et d'avancer avec présence, ancrage et compassion — pour les autres, et pour soi.**********Retrouvez le texte de l'épisode sur notre blog.En vous abonnant sur Itunes pour recevoir les notifications et en nous laissant un avis, vous nous envoyez des bulles de bonheur !En suivant notre actu sur FB @2minutesdebonheur et sur insta @2minutesdebonheur, vous profiterez gratuitement de pleins de trucs, d'astuces et de mises en pratique liés au podcast de la semaine.Inscrivez-vous à la newsletter, vous serez ainsi notifié de nos nouveaux épisodes et vous recevrez un bon de réduction de 5% sur notre site.Et surtout, partagez nos épisodes à tous ceux qui veulent prendre le temps d'être heureux !Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
Assassinats, trafics de drogue, blanchiment d'argent, terrorisme… Lorsque le crime dépasse les frontières d'un pays, une organisation internationale de police criminelle se lance à la poursuite des coupables.Interpol assure la traque de criminels recherchés à travers le monde, et coordonne les différents services de police. Ses 196 pays membres coopèrent, pour rendre le monde plus sûr.Découvrez "Interpol", la nouvelle saison de Criminels, disponible dès le 8 décembre. Hébergé par Audion. Visitez https://www.audion.fm/fr/privacy-policy pour plus d'informations.
Écoutez la suite de la vie de Maria Callas, racontée par Virginie Girod qui mêle sa voix aux archives Europe 1. La chanteuse a décroché un contrat à la prestigieuse Scala de Milan, mais souffre de la concurrence d'une rivale : Renata Tebaldi. Lorsque cette dernière tombe malade, Maria Callas la remplace au pied levé. Elle tient sa chance de se distinguer, mais les critiques du lendemain sont assez mauvaises. Malgré ce début mitigé à la Scala, Maria ne se décourage pas. Elle sait qu'elle est née pour être une prima donna. Pour mieux séduire le public, Maria a une obsession : maigrir. Elle commence un régime drastique et perd 35 kg en deux ans. Avec son physique longiligne, Maria Callas devient une icône. Au début des années 1970, la plus grande diva du XXe siècle transmet son art à des élèves de la prestigieuse Julliard School de New York. En 1973, elle fait une tournée de récitals qui est en réalité une tournée d'adieux, et en 1977, Maria Callas décède peu après un malaise. Les raisons de sa mort sont assez mystérieuses, certains évoquent un suicide. Mais peut-on vraiment mourir quand on est la plus mythique des chanteuses lyriques de tous les temps ? (rediffusion)Au Cœur de l'Histoire est un podcast Europe 1.- Auteure et Présentatrice : Virginie Girod - Production : Camille Bichler- Réalisation : Pierre Cazalot- Direction artistique : Julien Tharaud- Composition de la musique originale : Julien Tharaud et Sébastien Guidis- Edition et Diffusion : Nathan Laporte et Clara Ménard- Visuel : Sidonie ManginHébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
(Deuxième et dernier épisode) 1996, des femmes sont attaquées dans Paris, en pleine rue ou bien dans des parkings. Elles sont frappées avec beaucoup de violence, parfois violées. Certaines en réchappent, d'autres non. L'enquête mène la police sur les traces d'un homme à l'enfance tourmentée. Lorsque celui-ci avoue les premiers faits, les enquêteurs décident de se pencher sur une liste d'affaires non-élucidées ayant eu lieu en région parisienne.Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Clara Grouzis, Anaïs Godard et Clémentine Spiler - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : France 2. Documentation.Cet épisode de Crime story a été préparé en puisant dans les archives du Parisien, avec l'aide de nos documentalistes. Nous avons aussi exploité les ressources suivantes : “Au pays des ombres - Voyage au cœur de la folie” du Dr Laurent Layet ainsi que Le Figaro, L'Express, Libération et Le Monde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
(Premier épisode) 1996, des femmes sont attaquées dans Paris, en pleine rue ou bien dans des parkings. Elles sont frappées avec beaucoup de violence, parfois violées. Certaines en réchappent, d'autres non. L'enquête mène la police sur les traces d'un homme à l'enfance tourmentée. Lorsque celui-ci avoue les premiers faits, les enquêteurs décident de se pencher sur une liste d'affaires non-élucidées ayant eu lieu en région parisienne.Dans Crime story, la journaliste Clawdia Prolongeau raconte cette enquête avec Damien Delseny, chef du service police-justice du Parisien.Crédits. Direction de la rédaction : Pierre Chausse - Rédacteur en chef : Jules Lavie - Ecriture et voix : Clawdia Prolongeau et Damien Delseny - Production : Clara Grouzis, Anaïs Godard et Clémentine Spiler - Réalisation et mixage : Julien Montcouquiol - Musiques : Audio Network - Archives : France 2. Documentation.Cet épisode de Crime story a été préparé en puisant dans les archives du Parisien, avec l'aide de nos documentalistes. Nous avons aussi exploité les ressources suivantes : “Au pays des ombres - Voyage au cœur de la folie” du Dr Laurent Layet ainsi que Le Figaro, L'Express, Libération et Le Monde. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Quatre-vingts ans après sa mort, Adolf Hitler continue de fasciner et d'intriguer. Lorsque le dictateur se suicide dans son bunker de Berlin en avril 1945, ses proches incendient et enterrent à la hâte son corps, suivant ses instructions pour empêcher qu'il ne tombe entre les mains de ses ennemis. Pourtant, malgré ces précautions, des traces biologiques ont survécu. Et aujourd'hui, une unique empreinte génétique semble lever un coin du voile sur l'homme derrière le mythe noir.Un documentaire britannique diffusé en 2025, Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, relate le travail de chercheurs qui, depuis 2018, analysent un fragment de sang retrouvé sur un morceau de tissu provenant du bunker. Grâce à des comparaisons génétiques avec des parents éloignés du Führer, les biologistes confirment que l'échantillon provient bien d'Hitler. Ce matériel exceptionnel leur a permis d'étudier certains traits biologiques entourés de rumeurs depuis des décennies.La première découverte porte sur une anomalie génétique touchant les gènes responsables du développement sexuel. L'absence d'un marqueur spécifique semble compatible avec le syndrome de Kallmann, une affection rare provoquant un retard ou une absence de descente des testicules. Un document médical de 1923, exhumé en 2015, évoquait déjà un testicule non descendu chez Hitler. Cette hypothèse, longtemps prêtée à la simple propagande, se trouve donc confortée par la génétique. Le syndrome est aussi associé à une libido très faible, un trait évoqué dans plusieurs témoignages contemporains.En revanche, une autre rumeur tenace est clairement infirmée : celle d'un prétendu ascendant juif. Les chercheurs n'ont retrouvé aucun marqueur génétique associé aux populations juives ashkénazes ou séfarades. Cette idée, brandie à la fois par la propagande antisémite et par certains biographes, semble donc relever du fantasme.Les scientifiques se sont également aventurés sur un terrain plus délicat : les prédispositions comportementales. L'analyse du génome suggère des marqueurs associés à une tendance aux comportements antisociaux, à l'impulsivité, voire à un trouble de l'attention ou à certains traits autistiques. Mais les spécialistes sont unanimes : la génétique ne suffit pas à expliquer Hitler. Comme le rappelle l'historien Alex J. Kay, ce type d'interprétation doit rester prudent : beaucoup de personnes partagent ces marqueurs sans jamais commettre de violences. De plus, Hitler a grandi dans un environnement familial marqué par les abus et l'autoritarisme, éléments déterminants dans la construction de sa personnalité.Enfin, réduire la naissance du nazisme à un seul génome serait trompeur. Hitler n'a pas agi seul. Il a bénéficié du soutien actif ou passif de millions d'Allemands, dont la grande majorité ne présentait aucun des traits génétiques identifiés par les chercheurs. L'ADN peut éclairer certaines zones d'ombre, mais il ne remplace ni l'histoire, ni la responsabilité collective. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Que révèle vraiment la dernière analyse ADN d'Hitler ?
Quatre-vingts ans après sa mort, Adolf Hitler continue de fasciner et d'intriguer. Lorsque le dictateur se suicide dans son bunker de Berlin en avril 1945, ses proches incendient et enterrent à la hâte son corps, suivant ses instructions pour empêcher qu'il ne tombe entre les mains de ses ennemis. Pourtant, malgré ces précautions, des traces biologiques ont survécu. Et aujourd'hui, une unique empreinte génétique semble lever un coin du voile sur l'homme derrière le mythe noir.Un documentaire britannique diffusé en 2025, Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator, relate le travail de chercheurs qui, depuis 2018, analysent un fragment de sang retrouvé sur un morceau de tissu provenant du bunker. Grâce à des comparaisons génétiques avec des parents éloignés du Führer, les biologistes confirment que l'échantillon provient bien d'Hitler. Ce matériel exceptionnel leur a permis d'étudier certains traits biologiques entourés de rumeurs depuis des décennies.La première découverte porte sur une anomalie génétique touchant les gènes responsables du développement sexuel. L'absence d'un marqueur spécifique semble compatible avec le syndrome de Kallmann, une affection rare provoquant un retard ou une absence de descente des testicules. Un document médical de 1923, exhumé en 2015, évoquait déjà un testicule non descendu chez Hitler. Cette hypothèse, longtemps prêtée à la simple propagande, se trouve donc confortée par la génétique. Le syndrome est aussi associé à une libido très faible, un trait évoqué dans plusieurs témoignages contemporains.En revanche, une autre rumeur tenace est clairement infirmée : celle d'un prétendu ascendant juif. Les chercheurs n'ont retrouvé aucun marqueur génétique associé aux populations juives ashkénazes ou séfarades. Cette idée, brandie à la fois par la propagande antisémite et par certains biographes, semble donc relever du fantasme.Les scientifiques se sont également aventurés sur un terrain plus délicat : les prédispositions comportementales. L'analyse du génome suggère des marqueurs associés à une tendance aux comportements antisociaux, à l'impulsivité, voire à un trouble de l'attention ou à certains traits autistiques. Mais les spécialistes sont unanimes : la génétique ne suffit pas à expliquer Hitler. Comme le rappelle l'historien Alex J. Kay, ce type d'interprétation doit rester prudent : beaucoup de personnes partagent ces marqueurs sans jamais commettre de violences. De plus, Hitler a grandi dans un environnement familial marqué par les abus et l'autoritarisme, éléments déterminants dans la construction de sa personnalité.Enfin, réduire la naissance du nazisme à un seul génome serait trompeur. Hitler n'a pas agi seul. Il a bénéficié du soutien actif ou passif de millions d'Allemands, dont la grande majorité ne présentait aucun des traits génétiques identifiés par les chercheurs. L'ADN peut éclairer certaines zones d'ombre, mais il ne remplace ni l'histoire, ni la responsabilité collective. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Le mot “tong” vient… d'un bruit. Littéralement. Il s'agit d'une onomatopée : le tong évoque le claquement caractéristique de la sandale contre le talon lorsque l'on marche avec ce type de chaussure. Ce son sec, répété à chaque pas, a donné son nom à l'objet.Mais c'est un peu plus compliqué en r'realité. A l'origine, avant d'arriver chez nous et de correspondre à ce bruit, le mot vient de l'anglais “thong”, qui signifie à l'origine “lanière”, “courroie”, et plus précisément la bande qui passe entre les orteils. Dans l'anglais moderne, “thong sandals” désigne les sandales à entre-doigts. En Australie, on parle même simplement de thongs pour désigner les tongs.Lorsque le mot traverse la Manche au début du XXe siècle, il est adapté phonétiquement par les francophones. La prononciation anglaise “thong” (/θɒŋ/) devient rapidement “tong”, plus simple à prononcer et plus cohérent avec le son produit par la sandale. Cette coïncidence phonétique — le bruit et le mot — favorise l'adoption du terme dans la langue française.L'objet, lui, est bien plus ancien que son nom. Les sandales à entre-doigt existent depuis l'Égypte ancienne, où on en fabriquait déjà en papyrus ou en cuir. On en trouve aussi en Inde, au Japon (les geta), ou encore en Grèce antique. Mais le mot “tong”, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, apparaît réellement au moment où ce type de sandale devient populaire en Occident, après la Seconde Guerre mondiale.Le véritable essor vient dans les années 1950 et 1960, avec l'arrivée massive de modèles en caoutchouc importés du Japon. L'entreprise japonaise Shōroku Shōkai — ancêtre de MoonStar — commercialise alors des sandales bon marché, confortables, faciles à produire, qui deviennent vite incontournables sur les plages. Les Américains les appellent “flip-flops”, là encore pour leur bruit. Les Français retiennent plutôt la version anglo-australienne “tong”.Ce mélange entre origine linguistique anglaise (la “lanière”) et ressemblance avec le claquement sonore explique pourquoi ce mot s'est imposé si facilement. Le français adore les onomatopées, et “tong” sonnait à la fois simple, efficace et immédiatement reconnaissable.En résumé :Origine anglaise : thong = lanière entre les orteils.Adaptation française : “tong”, mot qui évoque le bruit de la sandale.Succès mondial : la sandale à entre-doigt devient un symbole estival, et son nom s'impose naturellement. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
En 1999, alors que la plupart des adolescents de 15 ans révisent leurs cours ou jouent à la console, un jeune Américain du nom de Jonathan James pénètre tranquillement dans les systèmes les plus sensibles des États-Unis. Sous le pseudonyme c0mrade, il réalise ce que beaucoup d'adultes, ingénieurs ou spécialistes de cybersécurité, jugent impossible : infiltrer le réseau de la NASA et du Département de la Défense… depuis la chambre de ses parents.Tout commence dans la banlieue de Miami. Jonathan est un autodidacte passionné, un gamin brillant qui démonte des ordinateurs, apprend seul le C et manipule les réseaux comme d'autres collectionnent des cartes Pokémon. Pour lui, Internet n'est pas un outil : c'est un terrain d'aventure, une jungle fascinante dont il veut comprendre chaque recoin.Sa première grande intrusion vise la Defense Threat Reduction Agency, une division du Pentagone chargée de lutter contre les armes chimiques et biologiques. En exploitant une simple faille logicielle, Jonathan réussit à installer une porte dérobée et intercepter plus de 3000 messages internes. Il a accès aux codes d'employés, aux procédures d'urgence, aux données confidentielles. En clair, un adolescent vient d'ouvrir une fenêtre sur le cœur militaire des États-Unis.Mais l'exploit qui le rend célèbre survient quelques semaines plus tard. Jonathan s'introduit dans un serveur de la NASA et télécharge un logiciel de commande destiné à la Station spatiale internationale. Valeur : 1,7 million de dollars. Résultat : la NASA est contrainte de couper son réseau pendant trois semaines, une paralysie totale, pour vérifier l'étendue des dégâts. On parle alors du plus grave piratage jamais attribué à un mineur.Lorsque les autorités remontent finalement jusqu'à lui, Jonathan accepte sa responsabilité. Devant les enquêteurs médusés, il explique posément qu'il ne voulait ni argent ni sabotage, seulement « comprendre comment les choses fonctionnent ». Il devient à 16 ans le premier mineur américain condamné pour cybercriminalité fédérale.Après sa peine, Jonathan tente de reprendre une vie normale. Mais en 2007, son nom est associé — à tort — à une gigantesque affaire de hacking impliquant des vols massifs de données bancaires. Harcelé, perquisitionné, convaincu qu'il ne sortira jamais de cette spirale, le jeune prodige tombe dans une profonde détresse. En 2008, à 24 ans, il met fin à ses jours, laissant une lettre où il clame son innocence.Jonathan James restera l'un des symboles les plus troublants de l'histoire du hacking : un adolescent génial, capable de défier les plus grandes institutions du monde… mais rattrapé trop tôt par un système qui ne savait pas quoi faire de son talent. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Comment se forment les feux follets qui effraient les villages depuis des siècles ?
Depuis le Moyen Âge, les feux follets intriguent et effraient. Ces lueurs vacillantes, observées la nuit dans les marais, les cimetières ou les champs humides, ont longtemps été entourées de légendes. Les paysans d'autrefois pensaient qu'il s'agissait d'âmes perdues, de fantômes ou de démons cherchant à égarer les voyageurs. Dans la tradition européenne, on les appelait aussi « feux de Saint-Elme », « feux du diable » ou « esprits des marais ». Les récits médiévaux décrivent des petites flammes bleues dansant au ras du sol, capables de disparaître dès qu'on s'en approche. Mais la science moderne a fini par lever le mystère.Les feux follets ne sont pas surnaturels : ils sont le fruit d'une réaction chimique bien connue. Ces phénomènes apparaissent dans les zones riches en matière organique en décomposition — comme les marécages ou les cimetières — où se dégagent naturellement des gaz. Lorsque des végétaux ou des animaux morts se décomposent dans un environnement pauvre en oxygène, des bactéries anaérobies produisent du méthane (CH₄), du phosphure d'hydrogène (PH₃) et du diphosphane (P₂H₄).Or, ces deux derniers gaz — les phosphures — sont hautement instables et s'enflamment spontanément au contact de l'air. En brûlant, ils allument le méthane présent autour d'eux, créant ces petites flammes bleutées ou verdâtres que l'on perçoit la nuit. La lumière semble flotter, se déplacer ou s'éteindre brusquement, car la combustion est irrégulière et brève. C'est donc un phénomène chimico-atmosphérique, issu d'une combustion lente et localisée de gaz produits par la décomposition biologique.Dans certains cas, des phénomènes lumineux similaires ont été confondus avec des effets électriques naturels, comme les feux de Saint-Elme — des décharges de plasma apparaissant sur les mats de navires ou les clochers lors d'orages. Mais le feu follet typique, celui des marais, relève bien de la chimie du phosphore et du méthane.Les scientifiques ont tenté de reproduire ces flammes en laboratoire dès le XIXe siècle, notamment avec des expériences de combustion de phosphine. Les résultats ont confirmé l'hypothèse : les gaz issus de la putréfaction pouvaient effectivement s'enflammer spontanément et produire la même couleur bleue fantomatique.Aujourd'hui, les feux follets ne sont plus un mystère. Ce sont des flammes naturelles, nées du mélange entre la chimie du vivant et les conditions particulières des sols humides. Ce qui, finalement, rend le phénomène encore plus fascinant : derrière ce spectacle jadis attribué aux esprits se cache simplement l'expression lumineuse de la chimie de la vie et de la mort. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Chaque nuit, lorsque le ciel s'assombrit, les étoiles se mettent à scintiller comme si elles venaient tout juste de s'allumer. Pourtant, elles brillent en permanence, de jour comme de nuit. Si nous ne les voyons qu'après le coucher du soleil, c'est avant tout à cause de la lumière de notre propre étoile : le Soleil.Pour comprendre pourquoi les étoiles brillent la nuit, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'est une étoile. Une étoile est une gigantesque boule de gaz — principalement d'hydrogène — qui produit de la lumière grâce à un phénomène fondamental : la fusion nucléaire. Au cœur de l'étoile, la pression et la température sont tellement élevées que les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Cette réaction libère une immense quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. C'est ce rayonnement qui voyage ensuite dans l'espace, parfois pendant des milliers d'années, avant d'atteindre nos yeux.Alors pourquoi ne voit-on ces étoiles que la nuit ? Simplement parce que, le jour, la luminosité du Soleil est si intense qu'elle éclipse littéralement la lumière des autres étoiles. La lumière solaire se diffuse dans l'atmosphère, éclaircissant le ciel et rendant impossible l'observation des points lumineux beaucoup plus faibles. Lorsque le Soleil passe sous l'horizon, son éclat ne domine plus et la lumière stellaire redevient visible.Le scintillement que l'on observe est dû à l'atmosphère terrestre. Les couches d'air, toujours en mouvement, dévient légèrement la lumière des étoiles. Comme leur lumière nous parvient en un minuscule faisceau, les variations atmosphériques créent cette impression de clignotement. Les planètes, elles, scintillent beaucoup moins, car leur disque apparent est plus large.Mais si le ciel nocturne nous paraît constellé d'étoiles, ce n'est qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. La plupart des étoiles sont trop lointaines ou trop faibles pour être visibles à l'œil nu. À travers un télescope, on découvre des milliards d'astres supplémentaires, témoins d'un univers en constante évolution.Enfin, l'obscurité de la nuit est essentielle : elle crée le contraste qui permet à nos yeux de percevoir ces lumières lointaines. Sans la nuit, nous serions aveuglés par notre propre étoile et coupés visuellement du reste du cosmos.En résumé, les étoiles brillent la nuit parce qu'elles émettent leur propre lumière grâce à la fusion nucléaire, mais surtout parce que l'absence du Soleil permet enfin à leurs faibles éclats d'atteindre notre regard. Une fenêtre nocturne ouverte sur l'immensité de l'univers. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.