Podcast appearances and mentions of Stanislas Dehaene
French cognitive neuroscientist
- 58PODCASTS
- 94EPISODES
- 43mAVG DURATION
- 1MONTHLY NEW EPISODE
- Oct 3, 2025LATEST

POPULARITY
Best podcasts about Stanislas Dehaene
Latest news about Stanislas Dehaene
- My intellectual journey to (dis)solve the hard problem of consciousness LessWrong - Apr 6, 2024
- The Conscious Turing Machine - a blueprint for conscious machines. Deric's MindBlog - Jun 10, 2022
- Thoughts of Blue Brains and GABA Interneurons The Neurocritic - Jan 29, 2021
Latest podcast episodes about Stanislas Dehaene
Colloque - Stanislas Dehaene : Concluding Remarks
Stanislas DehaeneChaire Psychologie cognitive expérimentaleAnnée 2025-2026Collège de FranceColloque : Seeing the Mind, Educating the BrainConcluding RemarksColloque - Stanislas Dehaene : Concluding RemarksStanislas Dehaene
Colloque - Edward Hubbard : Illuminating Fractions Learning: Neuronal Recycling of Non-Symbolic Ratios for Symbolic Fractions
Stanislas DehaeneChaire Psychologie cognitive expérimentaleAnnée 2025-2026Collège de FranceColloque : Seeing the Mind, Educating the BrainTheme: Numerical and Mathematical DevelopmentIlluminating Fractions Learning: Neuronal Recycling of Non-Symbolic Ratios for Symbolic FractionsColloque - Edward Hubbard : Illuminating Fractions Learning: Neuronal Recycling of Non-Symbolic Ratios for Symbolic FractionsEdward HubbardRésuméWithin mathematics, fractions hold a special place. They present perennial difficulties to students, and yet, mastering fractions is a critical stepping stone towards algebra and higher-order mathematics. More than 20 years ago, Stanislas Dehaene suggested that fractions are difficult because they lack the intuitive perceptual foundation that permits us to readily comprehend whole numbers and instead may depend on formal and symbolic processes. Here, I will present research from my lab showing that fractions may indeed have a perceptual foundation, and that this perceptual foundation may be recycled to allow us to understand symbolic fractions. Behaviorally, we have shown that symbolic fractions do not need to be processed componentially and instead can be represented on a coherent mental number. We show that wholistic fraction comparisons (and translation to decimals) does not require time consuming computations, and that non-symbolic ratio perception in college students and American elementary school children predicts formal fractions skills. Using fMRI, we have further shown that non-symbolic ratio perception reliable recruits right parietal cortex, even before the onset of formal schooling, and these parietal systems become tuned to symbolic fractions after as little as two years of formal education. Despite this evidence that fractions do, indeed, have a perceptual foundation, they still present significant difficulties. I will close by arguing that fractions (and other domains) may be difficult not due to a lack of foundational systems, but rather, due to educational methods that fail to align with these perceptual foundations. Furthermore, I will argue that research in numerical cognition can (and should!) provide new pedagogical approaches that better align with the foundational systems we have discovered to help students better grasp higher-order mathematical concepts.
Colloque - Lucia Melloni : Building a Theory of Consciousness, One Collaboration at a Time
Stanislas DehaeneChaire Psychologie cognitive expérimentaleAnnée 2025-2026Collège de FranceColloque : Seeing the Mind, Educating the BrainTheme: Perception and ConsciousnessBuilding a Theory of Consciousness, One Collaboration at a TimeColloque - Lucia Melloni : Building a Theory of Consciousness, One Collaboration at a TimeLucia MelloniRésuméWhat does it take to transform consciousness from a philosophical puzzle into a scientific theory? Few frameworks have shaped this quest as deeply as Stanislas Dehaene's Global Neuronal Workspace Theory (GNWT). By proposing that conscious access arises through large-scale broadcasting and ignition across fronto-parietal networks, GNWT provided both a conceptual framework and concrete, testable predictions
L'apprentissage, une exposition sonore et la neuroendoscopie
Bonjour! CQFD du dimanche, Ccʹest une sélection de quelques-uns des sujets de CQFD en rediffusion avec, pour commencer, un épisode de la série de Stéphane Délétroz " Une idée dans la tête" autour de lʹapprentissage de la lecture syllabique. Dans un tout autre genre, nous suivrons Huma Khamis à travers une expo intitulée "Tuning in" qui se tient au musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève. Et enfin, nous pénètrerons dans les cerveaux sans ouvrir la boite crânienne grâce à la neuro endoscopie et Sarah Dirren. CQFD en rediffusion cʹest maintenant et jusquʹà 16 heures Bon voyage! 1) Comment faisons-nous pour apprendre? Quʹest-ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous apprenons à parler, à lire, à jouer dʹun instrument? Stanislas Dehaene aborde ces thématiques avec brio et clarté. Le neuroscientifique signe chez Odile Jacob "Une idée dans la tête", quarante pépites réjouissantes sur le cerveau et lʹapprentissage. Une série de Stéphane Délétroz. 2) "Tuning in - acoustique de lʹémotion", une exposition sur l'univers sonore de l'humanitaire L'exposition "Tuning In - acoustique de l'émotion", au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, nous plonge dans l'univers sonore de l'humanitaire. Elle explore les archives audio du CICR, révélant les émotions dans la voix et l'impact des sons en situations de crise. De la musique comme réconfort aux témoignages, l'exposition offre une expérience immersive et émouvante. Elle met en lumière l'importance du son dans l'action humanitaire et notre compréhension des conflits. Avec des installations artistiques et même des chansons humanitaires, "Tuning In" propose un voyage sonore unique à travers l'histoire et les émotions de l'aide humanitaire. Avec Elisa Rusca, Directrice Collections et Expositions au Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Didier Grandjean, Directeur du Centre Inter facultaire en Sciences Affectives (CISA) de l'Université de Genève au micro d'Huma Khamis. 3) La neuroendoscopie, qu'est-ce que c'est? A l'occasion de la semaine du cerveau, l'hôpital du Valais à Sion organise une série de conférences. Aujourd'hui : "Comment opérer le cerveau sans ouvrir le crâne!". Une explication de la neuroendoscopie. Sarah Dirren reçoit Jean-Yves Fournier, médecin-chef au service de Neurochirurgie à l'Hôpital du Valais, spécialiste en neurochirurgie et privat-docent à l'Université de Lausanne et de Liège.
Susie Morgenstern, Daniel Pennac, Zep, Timothée de Fombelle, Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, Clémentine Beauvais, Myriam Meyer et Stanislas Dehaene
Comment faire lire nos enfants ? Cette semaine, dans La Grande Librairie, écrivains, chercheurs et enseignants s'interrogeront justement sur l'apprentissage, la transmission et le plaisir de la lecture : Susie Morgenstern, Daniel Pennac, Zep, Timothée de Fombelle, Marie-Aude Murail et Constance Robert-Murail, Clémentine Beauvais, Myriam Meyer et Stanislas Dehaene.
Exploring Stanislas Dehaene's Groundbreaking Research on Reading Acquisition
The trio dives into the insights and research of renowned neuroscientist Stanislas Dehaene on the cognitive science of reading. Dehaene's work has revolutionized our understanding of how the brain learns to read, from the development of the visual word form area to the neural markers of dyslexia. The hosts unpack Dehaene's explanations of the brain's recycling of pre-existing circuits for reading, the competition and collaboration between reading and facial recognition, and the different subtypes of reading challenges. Throughout the discussion, they highlight Dehaene's practical teaching recommendations grounded in the latest neuroscience, providing educators with a roadmap to foster reading proficiency in all learners.SHOW NOTESLiteracy Leaders:Stanislas DehaeneSally ShaywitzResources:Video—Stanislas Dehaene Summit 2024 Virtual KeynoteHow We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for NowVideo—Eyes on Reading: Dr. Stanislas Dehaene with Emily HanfordTerms:The Matthew Effect: The Matthew effect of accumulated advantage, sometimes called the Matthew principle, is the tendency of individuals to accrue social or economic success in proportion to their initial level of popularity, friends, and wealth. It is sometimes summarized by the adage or platitude "the rich get richer and the poor get poorer".Chat about this episode in The Science of Reading Collective.Explore the Reading Horizons Discovery® Product Suite.Access past show notes.Read the transcripts.
À la Une: une nouvelle page entre la France et le Maroc?
C'est la Tribune Dimanche qui consacre sa Une à la visite de trois jours que le président français Emmanuel Macron entame lundi 28 octobre à Rabat. « France-Maroc : la grande réconciliation », titre le journal. Il s'agit, nous dit-on, « d'enterrer une brouille de six ans. En cause : une succession de couacs, la perte de marchés économiques et un désaccord profond sur la question migratoire. »Mais ce n'est pas tout. Ce voyage devrait aussi être celui « des gros contrats », explique la Tribune Dimanche, qui voit encore plus loin, évoquant la « dimension africaine de la relation franco-marocaine ». « Avec un marché ouest-africain en pleine expansion, assure le journal, Rabat et Paris ont tout intérêt à mettre en place une offre commune pour répondre aux besoins de la région », « alors que le Maroc est le deuxième investisseur sur le continent ».+ 972M, le supplément du Monde, consacre un long article au média numérique + 972, composé de Palestiniens et d'Israéliens. Un nom qui fait allusion à « l'indicatif téléphonique partagé entre Israël et la Palestine », précise le magazine. « Depuis les massacres du 7 octobre et la riposte de l'État-hébreu », explique M, les reporters de ce média en ligne gratuit « font partie des rares journalistes encore présents à Gaza. Leurs enquêtes, sous les bombes, dérangent un état-major israélien de plus en plus enclin à la censure ».Il faut dire qu'Israël interdit l'accès de la bande de Gaza à la presse internationale, alors qu'on estime à « 130 », le nombre de journalistes, pour la plupart palestiniens, tués dans l'enclave palestinienne. « Grâce à notre travail, estime Ruwaida Amer, ancienne enseignante de 30 ans, devenue journaliste, personne ne peut ignorer ce qui se passe dans la bande de Gaza. » Elle-même vit à Khan Younès et, poursuit M, « enchaîne les interviews de blessés et de familles de victimes, malgré les crises de larmes et les moments de découragement qui la traversent ».Trump et les femmes« La dernière trouvaille de Donald Trump : se présenter en sauveur des femmes ». Dans l'Express, l'historienne Françoise Coste détaille sa méthode. « L'ancien président, dit-elle, met en œuvre deux stratégies. La première, peu glorieuse, consiste à éluder le sujet de l'avortement. La seconde est contre-intuitive. Elle consiste à présenter Trump comme le champion des Américaines. » Françoise Coste prend pour exemple la convention de Milwaukee, lors de laquelle « beaucoup de femmes se sont succédé à la tribune : des élues républicaines, des collaboratrices de Trump à la Maison Blanche, des dirigeantes du secteur privé ou encore des membres de la famille ».« Dans le même temps », ajoute l'historienne, l'ancien président « martèle deux sujets de campagne principaux : l'immigration et l'addiction aux opioïdes. Et pour évoquer ces questions complexes, il s'appuie presqu'exclusivement sur des figures féminines, qu'elles soient épouses, mères ou proies sexuelles ». « Il faut croire, conclut Françoise Coste, que cette posture de "protecteur des femmes" est payante, car le candidat y recourt de plus en plus, en jouant à 100 % sur l'émotion, sans se soucier de défendre un projet ».Le JDD et Kamala HarrisDonald Trump a-t-il trouvé dans le Journal du Dimanche un ardent défenseur ? Disons plutôt que le JDD a décidé de descendre en flèche sa rivale Kamala Harris. « En attaquant Trump, estime le journal, la candidate démocrate est surtout en train de flinguer sa propre campagne ». Le Journal du Dimanche appelle cela les « bévues » de la candidate. Prenant exemple d'une interview sur Fox News, « où elle s'est montrée peu convaincante sur l'immigration ». « Sur les questions difficiles », ajoute le JDD, « Kamala Harris se perd toujours dans les explications. Embêtant pour une ancienne procureure. Ses opposants – mais pas seulement eux – parlent de "salade de mots", une sorte de digression sous forme de cadavre exquis, pour éviter les sujets sensibles ».Le Journal du Dimanche fait mine de s'étonner, estimant que « jusqu'ici, la démocrate s'était habilement débarrassée des clichés débités depuis maintenant huit ans par son parti au sujet de son adversaire. Non parce qu'elle avait davantage de respect pour lui que n'en avait Hilary Clinton. Mais pour ne pas injurier des américains qui ont déjà voté pour lui par deux fois ». Deux fois, vraiment ? Le JDD semble oublier, que la deuxième fois, Donald Trump a bel et bien perdu l'élection présidentielle.Intuition et créativitéEnfin, une nouvelle rassurante pour celles et ceux que l'intelligence artificielle effraie. C'est dans le Point, l'interview de Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France où il est titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale… Un professeur qui nous explique que « notre cerveau est plus fort que l'intelligence artificielle ». « Pas question d'avoir des complexes, résume le Point. L'intelligence artificielle n'est pas près de rivaliser d'intuition, de créativité et de sens de l'à-propos, avec notre cerveau ».« Croyez-en vous-même » s'exclame Stanislas Dehaene, « croyez en votre cerveau, apprenez à mieux le connaître, car avec un peu d'effort quotidien, son potentiel d'apprentissage est tout simplement extraordinaire ».
Ioulia Navalnaïa / Stanislas Dehaene / Débat sur les séries politiques / Eddy Mitchell / Gaëlle Choisne
durée : 02:56:20 - Le 7/10 - par : Nicolas Demorand, Léa Salamé, Sonia Devillers, Anne-Laure Sugier - Les invités de la Matinale de France Inter ce mardi 22 octobre 2024 seront : Ioulia Navalnaïa / Stanislas Dehaene / Débat sur les séries politiques / Eddy Mitchell / Gaëlle Choisne
Le cerveau humain, plus fort que l'intelligence artificielle ?
durée : 00:23:00 - L'invité de 8h20 : le grand entretien - Le cerveau humain a besoin "de beaucoup moins de données" que l'IA pour "tirer les conclusions qu'il tire", assure le neuroscientifique Stanislas Dehaene, qui s'attaque aux idées reçues sur ce qui se passe dans notre boite crânienne. - invités : Stanislas DEHAENE - Stanislas Dehaene : Neuropsychologue, professeur au Collège de France
Le cerveau humain, plus fort que l'intelligence artificielle ?
durée : 00:23:00 - L'invité de 8h20 : le grand entretien - Le cerveau humain a besoin "de beaucoup moins de données" que l'IA pour "tirer les conclusions qu'il tire", assure le neuroscientifique Stanislas Dehaene, qui s'attaque aux idées reçues sur ce qui se passe dans notre boite crânienne. - invités : Stanislas DEHAENE - Stanislas Dehaene : Neuropsychologue, professeur au Collège de France
245. Développer sa culture générale (et celle de ses enfants)
Pourquoi chercher à développer sa culture générale ?
Colloque - Approches expérimentales en éducation – Learning Together for Children's Learning: An Interdisciplinary Convening : Reading Acquisition and its Deficits: Advances in Behavioral and Brain Research
Esther DufloCollège de FrancePauvreté et politiques publiques2023-2024Colloque - Approches expérimentales en éducation – Learning Together for Children's Learning: An Interdisciplinary Convening : Reading Acquisition and its Deficits: Advances in Behavioral and Brain ResearchSession 1 – Fundamental LearningColloque organisé par Esther Duflo, Professeur du collège de France, chaire Pauvreté et politiques publiques.Avec le soutien de la Fondation du Collège de France et de ses mécènes.Stanislas Dehaene, Professeur du Collège de France
Colloque - Musique, cerveau et apprentissages scolaires : que dit la science ? - Table ronde : Comment passer de l'expérimentation à la politique éducative ?
Stanislas DehaeneCollège de France - Année 2023-2024Agir pour l'éducationColloque - Musique, cerveau et apprentissages scolaires : que dit la science ? - Table ronde : Comment passer de l'expérimentation à la politique éducative ?Modérateurs : Stanislas Dehaene et Emmanuel BigandParticipants :Lou Aisenberg, Cheffe de projet senior en charge du développement stratégique pour le programme IDEE Jean-Michel Blanquer, ancien Ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sportsAxelle Charpentier,Cheffe de bureau de l'apui à l'évaluation des politiques et de soutien à la recherche, DEPP, ministère de l'Education nationale et des sportsMaria Majno, Vice - Présidente de Sistema Europe Bruno Suchaut, Directeur scientifique de la Fondation VareilleHélène Vareille, Présidente de la Fondation Vareille Olivier Wambecke, Directeur académique des services de l'Education nationale du Val d'OiseCette journée, proposée dans le cadre de l'initiative « Agir pour l'Éducation » du Collège de France en association avec la Fondation Vareille, permettra de mieux comprendre en quoi l'apprentissage d'un instrument, dès le plus jeune âge, peut être un formidable outil au service de la réussite des élèves. Jouer de la musique améliore-t-il les capacités cognitives des enfants ? Quels liens établir entre musique et langage, musique et mathématiques ? Comment évaluer l'impact de la pratique instrumentale sur le développement et les compétences des enfants ?Les Professeurs Stanislas Dehaene et Emmanuel Bigand, chercheurs en psychologie cognitive et neurosciences ont élaboré le programme de ce colloque. Nina Kraus, Assal Habibi et Robert Zatorre, chercheurs de renommée internationale ont répondu positivement à leur invitation, et exposeront en personne leurs travaux les plus récents sur le sujet.La France sera notamment présente au travers de l'expérimentation Un violon dans mon école. Ce dispositif international d'enseignement du violon est en place pour 8 500 élèves de 4 à 8 ans, tous scolarisés en éducation prioritaire. Il fait l'objet de travaux de recherche qui seront présentés par des équipes de laboratoires de Sciences Po/CNRS, de NeuroSpin et de l'École d'économie de Paris.Une occasion unique de faire le point sur un sujet qui interpelle le monde de l'éducation !
Stanislas Dehaene : "Le cerveau de l'enfant est une extraordinaire machine à apprendre"
durée : 00:20:45 - L'invité de 8h20 - Le président du Conseil scientifique de l'Education nationale Stanislas Dehaene vient présenter le livre “Science et école : ensemble pour mieux apprendre” (Odile Jacob), troisième volume des travaux du Conseil, qui regroupe des enseignements en matière de pédagogie.
durée : 02:59:13 - Le 6/9 - Aujourd'hui dans le 6-9, nous recevons, à 7h50, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de l'Europe, vice-président du MoDem et à 8h20 dans le grand entretien, le neuropsychologue Stanislas Dehaene, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale.
Decoding the Enigma: A Summary of Consciousness and the Brain
Chapter 1 What's Consciousness and the Brain Book by Stanislas Dehaene"Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts" is a book written by Stanislas Dehaene, a renowned cognitive neuroscientist. Published in 2014, the book explores the relationship between consciousness and the workings of the brain. Dehaene delves into the fascinating field of neurobiology, discussing how the brain generates different states of awareness and determines our thoughts and perceptions. He explores various experiments, observations, and theories, providing insights into the neural mechanisms that underlie consciousness. Dehaene's book aims to bridge the gap between the field of neuroscience and the concept of consciousness, offering a comprehensive understanding of how our brains give rise to our conscious experiences.Chapter 2 Is Consciousness and the Brain Book A Good BookYes, "Consciousness and the Brain" by Stanislas Dehaene is generally considered a good book. It is highly regarded among scientists and scholars in the field of neuroscience and consciousness studies. Dehaene presents a comprehensive and accessible exploration into the relationship between consciousness and the brain, drawing on both scientific research and philosophical insights. The book offers valuable insights and theories related to the nature of consciousness and how it arises from neural processes. However, as with any book, opinions may vary, so it is a good idea to read reviews and sample some of the content before determining if it aligns with your specific interests and preferences.Chapter 3 Consciousness and the Brain Book by Stanislas Dehaene Summary"Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts" is a book written by Stanislas Dehaene, a renowned cognitive neuroscientist. In this book, Dehaene explores the relationship between consciousness and the brain, aiming to unravel the mechanisms that underlie our thoughts.The book begins with an introduction to the concept of consciousness and the historical debates surrounding it. Dehaene acknowledges that consciousness is a complex phenomenon that has been difficult to understand and define. He then proposes a fresh perspective on consciousness, suggesting that it should be viewed as a representational system in the brain.Dehaene delves into the research and discoveries in the field of neurobiology to support his theories. He introduces the concept of neuronal workspace, which refers to a global workspace in the brain where information from different cognitive functions is integrated. This concept helps explain how we become aware of certain thoughts and disregard others.The book explores various aspects of consciousness, including perception, attention, and decision-making. Dehaene discusses experiments and studies that have shed light on these processes, emphasizing the role of the brain in shaping our conscious experiences.Moreover, Dehaene investigates altered states of consciousness, such as those induced by anesthesia or coma. He examines the patterns of brain activity observed in these states and tries to understand the underlying mechanisms that lead to a loss of consciousness.Throughout the book, Dehaene skillfully combines scientific evidence with philosophical reflections. He addresses questions such as the nature of free will and the relationship between the brain and the mind. Dehaene draws on his extensive research and expertise to offer compelling arguments and theories that challenge traditional views.In conclusion, "Consciousness and the Brain" by Stanislas Dehaene is a thought-provoking exploration of the profound relationship between our conscious experiences and the workings of the brain....
25 - Jessica Colleu Terradas on effective language and literacy screening and intervention practices for at-risk students
In this episode, Brendan Lee speaks with Jessica Colleu Terradas the Senior Officer Teaching and Learning Literacy and Instructional Coach in Canberra and Goulburn Catholic Education. In 2022, she travelled to the USA, England and France where she met with leading experts to investigate effective literacy screening and instructional practices to support older struggling readers as part of her Churchill Fellowship. She details some of the findings from her report in this chat. She speaks about her amazing experience meeting people like Anita Archer and Stanislas Dehaene and goes through some case studies of schools that have implemented a Multi-Tiered System of Support framework effectively. Resources mentioned: Jessica Colleu Terradas Churchill Fellowship: To identify effective language and literacy screening and intervention practices for at-risk students Anita Archer Stanislas Dehaene - How We Learn 2 reports on better supporting students who enter secondary school with gaps in their foundational literacy and numeracy skills and guide about MTSS, published/funded by AERO in partnership with Monash Uni: https://www.edresearch.edu.au/resources/supporting-secondary-students-lacking-foundational-literacy-and-numeracy-skills-research-summaryEEF Diane and James Murphy's book ‘Thinking Reading: what every secondary teacher need to know about reading' https://www.amazon.com.au/Thinking-Reading-Every-Secondary-Teacher/dp/1911382683 Improving literacy in secondary schools, by the Education Endowment Foundation: https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/literacy-ks3-ks4 The national Institute for Direct Instruction (official website): https://www.nifdi.org/ The Theory of Instruction: applications and strategies (1982 Ed.) by Engelmann & Carnine: https://www.researchgate.net/profile/Doug-Carnine/publication/303721842_Theory_of_Instruction_Principles_and_Applications/links/574f661a08aef199238ef8b6/Theory-of-Instruction-Principles-and-Applications.pdf (download a revised copy) . Order a copy: https://www.amazon.com.au/Theory-Instruction-Applications-Siegfried-Engelmann/dp/1880183803 Podcast: the Science of Reading platform with Susan Lambert https://amplify.com/science-of-reading-the-podcast/ You can connect with Jess: Twitter: @JessicaColleu LinkedIn: @jessicacolleu/ You can connect with Brendan: Twitter: @learnwithmrlee Facebook: @learningwithmrlee Website: learnwithlee.net
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain : De l'apprentissage des machines à l'apprentissage des humains
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demainDe l'apprentissage des machines à l'apprentissage des humainsIntervenant(s)Stéphane Mallat, Professeur du Collège de FranceSéance animée par Stanislas Dehaene.Chaque communication de 30' sera suivie de 10' de discussion.RésuméLes machines apprennent en optimisant des modèles de prédiction. La surprise vient de l'extraordinaire capacité des réseaux de neurones à résoudre des problèmes aussi différents que la reconnaissance d'images, la génération de langage ou la prédiction de mesures physiques. Les principes mathématiques de cet apprentissage restent mal compris, ce qui est un enjeu important pour garantir sa fiabilité. Malgré des différences importantes, on observe des convergences avec l'apprentissage humain, et l'on doit maintenant aussi considérer l'impact à venir de l'intelligence artificielle sur l'éducation.
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain : Le sommeil, un temps nécessaire pour les apprentissages
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demainLe sommeil, un temps nécessaire pour les apprentissagesIntervenant(s)Stéphanie Mazza, enseignant-chercheur, professeur de neuropsychologie, université Claude-Bernard à LyonSéance animée par Stanislas Dehaene.Chaque communication de 30' sera suivie de 10' de discussion.RésuméTrop souvent considéré comme une perte de temps dans nos sociétés modernes, le sommeil constitue bien plus qu'une période de repos. Il s'agit d'un élément vital et fondamental au développement, à la santé physique et émotionnelle, aux apprentissages et aux relations interpersonnelles, et cela à tout âge de la vie. Alors que les avancées technologiques nous poussent à retarder notre heure de coucher, nos besoins de sommeil n'ont guère évolué depuis les cent dernières années. Un sommeil régulier, suffisant en quantité et qualité est garant de notre bon fonctionnement et notamment de nos capacités de mémorisation et de consolidation des apprentissages. Ainsi, un enfant qui dort bien est un enfant qui a plus de chance de bien apprendre. Même si le sommeil reste principalement un comportement qui prend place dans l'intimité de la sphère familiale, les principales répercussions sont visibles en classe : endormissement, conflits, manque d'attention, hyperactivité, impulsivité, absentéisme). Les évaluations de programmes d'éducation au sommeil, ou d'expérimentation concernant le changement d'horaires de prise de cours pour les adolescents, produisent des résultats significatifs sur le sommeil et les apprentissages, encourageant la généralisation de ces initiatives.Stéphanie MazzaStéphanie Mazza est professeur de neuropsychologie à l'INSPE de Lyon. Elle réalise ses recherches au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Elle est membre du conseil scientifique de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Ses travaux cherchent à faire le lien entre sommeil et performances. Elle s'intéresse plus particulièrement à l'impact du manque de sommeil sur les performances cognitives : mémorisation, attention, gestion du stress. Elle dirige un projet de recherche évaluant l'implication du sommeil et de ses troubles dans les apprentissages des enfants et adolescents. Elle a co-construit avec des professeurs des écoles un programme d'éducation au sommeil pour les enfants du primaire.
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain : L'extraordinaire efficacité de l'apprentissage chez le jeune enfant
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demainL'extraordinaire efficacité de l'apprentissage chez le jeune enfantIntervenant(s)Anne Christophe, directrice de recherche CNRS, Ecole normale supérieure- PSLSéance animée par Stanislas Dehaene.Chaque communication de 30' sera suivie de 10' de discussion.RésuméÀ leur naissance, les bébés apparaissent comme capables de faire très peu de choses ; et pourtant, très vite, ils apprennent et se développent, au point qu'avant 6 ans, ils sont devenus des locuteurs compétents de leur(s) langue(s) maternelle(s), qui savent aussi compter, faire leurs lacets, courir et grimper, faire des jeux de mots et des farces, etc. Depuis les années 1970, on sait comment faire participer des enfants même très jeunes à des expériences, en utilisant des méthodes dites « comportementales » – on mesure leur comportement, par exemple là où ils regardent, leur comportement de succion, combien de temps ils recherchent un objet caché, etc. – ou des méthodes d'imagerie cérébrale. Ces expériences nous ont permis d'apprendre énormément de choses sur la manière dont les bébés apprennent si efficacement : par exemple, ils devinent le sens des mots grâce à leur contexte, exploitent la « pédagogie naturelle », calculent les intentions de leur interlocuteur, demandent de l'aide quand ils savent qu'ils ne savent pas (faisant preuve d'une capacité de métacognition), etc. Dans cette conférence, nous passerons en revue quelques-uns des résultats phares de ces recherches sur les mécanismes d'apprentissages déployés par les très jeunes enfants.Anne ChristopheDirectrice de recherche au CNRS, elle a dirigé pendant dix ans le Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique (ENS-EHESS-CNRS). Elle étudie l'apprentissage du langage par les bébés, en combinant expérimentation et modélisation, en particulier les mécanismes qui leur permettent d'apprendre le sens des mots, grâce aux synergies entre l'apprentissage du vocabulaire et de la grammaire. Diplômée de l'École polytechnique, elle est entrée au CNRS après un doctorat de psychologie cognitive, et un postdoctorat à University College London. Elle est également membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale.
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain : Excitation/Inhibition, le bon équilibre pour apprendre et réapprendre
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demainExcitation/Inhibition, le bon équilibre pour apprendre et réapprendreIntervenant(s)Alain Prochiantz, Professeur du Collège de France, Administrateur du Collège de France (2015 à 2019)Séance animée par Stanislas Dehaene.Chaque communication de 30' sera suivie de 10' de discussion.RésuméAu cours du développement postnatal, les différentes régions du cortex cérébral doivent s'adapter au monde dans ses multiples composantes. Ces apprentissages, non synchrones mais limités dans le temps, sont médiés par des signaux sensoriels, moteurs, affectifs ou sociaux. Ces signaux initient la maturation d'un circuit d'apprentissage, relativement simple et conservé dans l'entièreté du cortex, fondé sur l'évolution de la balance ente inhibition excitation au sein de ce circuit. Chez l'adulte si la capacité d'apprendre est perdue ou diminuée le cortex peut garder pour la vie des séquelles plus ou moins heureuses de son « aventure développementale ». D'où l'intérêt de moduler transitoirement, chez l'adulte, l'équilibre Excitation/Inhibition afin de rouvrir une période de plasticité favorable à des apprentissages nouveaux ou à la correction d'apprentissages « malheureux ».
Colloque de rentrée 2023 - Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain : Introduction
Colloque de rentrée 2023 : Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demainL'espèce humaine présente deux compétences exceptionnelles : celle d'apprendre, tout au long de la vie, de nouvelles connaissances ; et celle, complémentaire, de les enseigner à d'autres. L'éducation est la condition de la production de savoirs nouveaux propres à répondre aux défis pressants d'aujourd'hui, le levier premier de l'émancipation des individus dans des sociétés démocratiques, et une ressource indispensable à la cohésion des sociétés. Tout au long de son histoire, l'humanité a su se transformer elle-même en se dotant de systèmes éducatifs efficaces – mais demain ? La baisse des résultats scolaires, les inégalités sociales en éducation, et l'avènement de machines capables d'apprendre sont autant de défis auxquels nous sommes tous confrontés, que nous soyons professeurs, parents ou étudiants. Le colloque de rentrée tentera d'apporter quelques réponses en examinant notamment quelles pratiques éducatives ont été adoptées à travers l'histoire et dans diverses parties du monde ; quels mécanismes sous-tendent notre capacité d'apprendre ; et comment mieux les déployer dans nos écoles et nos universités, au service de toute la société.Comité scientifiqueStanislas Dehaene, François Héran et Pierre-Michel Menger.Plan des séancesL'invention de l'éducation, séance animée par François Héran (le 19 matin)Les mécanismes de l'apprentissage, séance animée par Stanislas Dehaene (le 19 après-midi)Les enjeux de l'éducation, séance animée par Pierre-Michel Menger (le 20 matin)À quoi ressemblera l'école de demain ? séance animée par Stanislas Dehaene (le 20 après-midi)Chaque communication de 30 minutes sera suivie de 10 minutes de discussion.Intervenant(s)Thomas Römer, Professeur et administrateur du Collège de France
Ep. 164: Misconceptions about Learning to Read with Carolyn Strom
Resources UFLI Foundations Letterland Spelfabet Stay connected with Carolyn! Stanislas Dehaene, How the Brain Learns to Read (book)Maryanne Wolf, Proust and the Squid (book)Connect with us Facebook and join our Facebook Group Twitter Instagram Don't miss an episode! Sign up for FREE bonus resources and episode alerts at LiteracyPodcast.com Helping teachers learn about science of reading, knowledge building, and high quality curriculum.
Elle semble avoir fait irruption dans l'éducation par effraction, et pourtant l'intelligence artificielle était déjà présente dans bien des pratiques et usages « invisibles » au grand public. Depuis quelques mois, un nouveau bond technologique a été franchi avec l'irruption des IA génératives comme ChatGPT ou Midjourney qui suscitent beaucoup de questions. Avec un peu de recul, cet épisode revient sur le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans le champ éducatif, les nouveaux usages comme les défis éthiques qui y sont liés. En compagnie de deux invités de haut vol, Didier Roy, chercheur en informatique et intelligence artificielle à l'Inria Bordeaux Sud-Ouest et à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et Yann Houry, directeur de l'innovation pédagogique et technologique au lycée français international de Hong Kong, nous allons nous demander si cela peut changer la vie quotidienne d'un enseignant et si tout enseignant peut y trouver son compte… Belle rentrée scolaire à tous ! Intelligence artificielle, dossier thématique de l'Agence des usages, Réseau Canopé. Inspirations des invités : Daniel Andler, Intelligence artificielle, intelligence humaine : la double énigme, Gallimard, 2023. Antoine Bello, Ada, Gallimard, 2016. Stanislas Dehaene, Yann Le Cun et Jacques Girardon, La plus belle histoire de l'intelligence. Des origines aux neurones artificiels : vers une nouvelle étape de l'évolution, Robert Laffont, 2018. Marcel Detienne et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l'intelligence. La mètis des Grecs, Flammarion, 2018. Ian McEwan, Une machine comme moi, Gallimard, 2020. Téléchargez la transcription [DOCX]. Chapitres 02:29 - Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ? 18:14 - IA et apprentissages en classe 34:31 - IA et développement professionnel de l'enseignant 45:46 - Inspirations Chaque dernier mercredi du mois, découvrez un nouvel épisode de « Parlons pratiques ! » sur votre plateforme de podcasts préférée. Suivez-nous, écoutez et partagez… Retrouvez-nous sur : Extraclasse.reseau-canope.fr Apple Podcasts Spotify Deezer Google Podcasts Podcast Addict Extra classe, des podcasts produits par Réseau Canopé. Émission préparée et animée par : Hélène Audard et Régis Forgione Réalisée par : Romuald Herrero avec l'appui technique de Julien Bousson (Atelier Canopé de Mérignac) Directrice de publication : Marie-Caroline Missir Coordination et production : Hervé Turri, Luc Taramini, Magali Devance Prise de son et mixage : Simon Gattegno Secrétariat de rédaction : Marie-Astrid Leroy-Audo Contactez-nous sur : contact@reseau-canope.fr © Réseau Canopé, 2023
Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist
What links conscious experience of pain, joy, color, and smell to bioelectrical activity in the brain? How can anything physical give rise to nonphysical, subjective, conscious states? Christof Koch has devoted much of his career to bridging the seemingly unbridgeable gap between the physics of the brain and phenomenal experience. Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist --part scientific overview, part memoir, part futurist speculation--describes Koch's search for an empirical explanation for consciousness. Koch recounts not only the birth of the modern science of consciousness but also the subterranean motivation for his quest--his instinctual (if "romantic") belief that life is meaningful. Koch describes his own groundbreaking work with Francis Crick in the 1990s and 2000s and the gradual emergence of consciousness (once considered a "fringy" subject) as a legitimate topic for scientific investigation. Present at this paradigm shift were Koch and a handful of colleagues, including Ned Block, David Chalmers, Stanislas Dehaene, Giulio Tononi, Wolf Singer, and others. Aiding and abetting it were new techniques to listen in on the activity of individual nerve cells, clinical studies, and brain-imaging technologies that allowed safe and noninvasive study of the human brain in action. Koch gives us stories from the front lines of modern research into the neurobiology of consciousness as well as his own reflections on a variety of topics, including the distinction between attention and awareness, the unconscious, how neurons respond to Homer Simpson, the physics and biology of free will, dogs, Der Ring des Nibelungen, sentient machines, the loss of his belief in a personal God, and sadness. All of them are signposts in the pursuit of his life's work--to uncover the roots of consciousness. Christof Koch is Professor of Biology and of Engineering at the California Institute of Technology and Chief Scientific Officer of the Allen Institute for Brain Science in Seattle. He is the author of The Quest for Consciousness and other books. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/psychology
Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist
What links conscious experience of pain, joy, color, and smell to bioelectrical activity in the brain? How can anything physical give rise to nonphysical, subjective, conscious states? Christof Koch has devoted much of his career to bridging the seemingly unbridgeable gap between the physics of the brain and phenomenal experience. Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist --part scientific overview, part memoir, part futurist speculation--describes Koch's search for an empirical explanation for consciousness. Koch recounts not only the birth of the modern science of consciousness but also the subterranean motivation for his quest--his instinctual (if "romantic") belief that life is meaningful. Koch describes his own groundbreaking work with Francis Crick in the 1990s and 2000s and the gradual emergence of consciousness (once considered a "fringy" subject) as a legitimate topic for scientific investigation. Present at this paradigm shift were Koch and a handful of colleagues, including Ned Block, David Chalmers, Stanislas Dehaene, Giulio Tononi, Wolf Singer, and others. Aiding and abetting it were new techniques to listen in on the activity of individual nerve cells, clinical studies, and brain-imaging technologies that allowed safe and noninvasive study of the human brain in action. Koch gives us stories from the front lines of modern research into the neurobiology of consciousness as well as his own reflections on a variety of topics, including the distinction between attention and awareness, the unconscious, how neurons respond to Homer Simpson, the physics and biology of free will, dogs, Der Ring des Nibelungen, sentient machines, the loss of his belief in a personal God, and sadness. All of them are signposts in the pursuit of his life's work--to uncover the roots of consciousness. Christof Koch is Professor of Biology and of Engineering at the California Institute of Technology and Chief Scientific Officer of the Allen Institute for Brain Science in Seattle. He is the author of The Quest for Consciousness and other books. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices Support our show by becoming a premium member! https://newbooksnetwork.supportingcast.fm/neuroscience
Stanislas Dehanae: Les quatre piliers de l'apprentissage
"La façon dont le cerveau génère la pensée est l'un des grands mystères de la science", explique le neuroscientifique Stanislas Dehaene, qui a consacré sa vie à décoder le fonctionnement de l'esprit humain. Mathématicien de formation, Dehanae est un pionnier des neurosciences du langage verbal et de la cognition mathématique. Depuis la fin des années 1980, il est responsable de l'unité de neurosciences cognitives de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et, actuellement, il dirige également le centre d'imagerie cérébrale NeuroSpin à Paris. Le scientifique défend qu'un cerveau de bébé vaut mieux qu'un superordinateur : "Un bébé est doué de raison, de logique, de mathématiques, dès la naissance." Ses travaux lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix du cerveau, connu sous le nom de prix Nobel de neurosciences. Dehanae cherche les racines de nos instincts mathématiques, examine les circuits de la lecture, étudie la manière dont nous apprenons et, finalement, enquête sur ce qui rend les êtres humains si spéciaux. Auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il expose les résultats de ses recherches au grand public, il vient de publier "Avec vous... notre cerveau!", où il partage les découvertes historiques de la science du cerveau, de l'Antiquité à nos jours.
Stanislas Dehaene and Marie Amalric investigate whether short online videos are sufficient to teach mathematics concepts.
Eric leads Amanda and Jacob in a thought provoking conversation regarding neuroscience and how we learn and approach education. We react to topics brought up in the Inquiring Minds podcast that references How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now by Stanislas Dehaene.
La Ciencia | Stanislas Dehaene: “Tenemos intuición matemática antes incluso de aprender símbolos o leer”
Pionero de la neurociencia, el francés Stanislas Dehaene es uno de los más prestigiosos del mundo en el estudio del cerebro matemático. Junto a Javier Sampedro, Pere Estupinyà y el también neurocientifico Mariano Sigman, experto en lenguaje, conversa en esta charla sobre las bases neuronales de la lectura, las matemáticas y el aprendizaje.
La Ciencia | Stanislas Dehaene: “Tenemos intuición matemática antes incluso de aprender símbolos o leer”
Pionero de la neurociencia, el francés Stanislas Dehaene es uno de los más prestigiosos del mundo en el estudio del cerebro matemático. Junto a Javier Sampedro, Pere Estupinyà y el también neurocientifico Mariano Sigman, experto en lenguaje, conversa en esta charla sobre las bases neuronales de la lectura, las matemáticas y el aprendizaje.
La Ciencia | Stanislas Dehaene: “Tenemos intuición matemática antes incluso de aprender símbolos o leer”
Pionero de la neurociencia, el francés Stanislas Dehaene es uno de los más prestigiosos del mundo en el estudio del cerebro matemático. Junto a Javier Sampedro, Pere Estupinyà y el también neurocientifico Mariano Sigman, experto en lenguaje, conversa en esta charla sobre las bases neuronales de la lectura, las matemáticas y el aprendizaje.
Shannon and Mary chat with Dr. Marnie Ginsberg from Reading Simplified about what happens in the brain during reading. We talk about the reader's journey to whole word recognition and how reading teachers can help their readers bolt on the orthography to what students already know in spoken language and language comprehension. Listeners will learn how to build a strong foundation for reading and how to help their students build flexible decoding strategies. Teachers will also hear examples of feedback to provide to readers in order to promote orthographic mapping. Check out this episode to learn all about how the brain learns to read. Episode Links for Resources mentioned:Twitter image of the Reading Brain image by @empoweredliteracyOur Brains Were not Born to Read...right?Brain Builders Amplify-video seriesThe Brain DictionaryDr. Molly McCabe on the Science of Reading videoLecture by Dr. Stanislas Dehaene on "Reading the Brain"Cortex in the Classroom videoReading in the Brain: The New Science of How We Read by Sanislas Dehaene *Amazon affiliate link, where we earn a small commission from your purchase*Proust and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain by Maryanne Wolf *Amazon affiliate link*Keys to Literacy: How the Brain Learns to Read Lexia Learning: How the Human Brain Learns to Read Hill Learning Center: The Reading Brain videoCognitive LoadReading Brain patternsEternal Triangle Model The Role of Set for Variability (Reading Rockets)Reading Simplified Switch It ActivityReading Simplified's YouTube ChannelReading Simplified on IGCOME JOIN THE CONVERSATION!Our WebsiteFacebookInstagramShannon's TpT StoreSupport the show
Dans cet épisode, Valérie et Julie nous parlent avec passion de métacognition. Il s'agit ici de donner à l'enfant le pouvoir de l'apprentissage, en rendant explicites les différentes petites étapes qu'il a à mettre en place, lui, pour y arriver ensuite de façon autonome. On parlera ensemble "flagrant délit de compétences" et métaphore "Reflecto". Références bibliographiques citées dans cet épisode: -conférence TEDX: Adele Diamond : https://www.youtube.com/watch?v=StASHLru28s -Pierre Paul GAGNE « Apprendre avec Reflecto », ed Pirouette en France -Pour découvrir l'Attention en BD : Jean-Philippe LACHAUX « Les petites bulles de l'attention » ; du même auteur « La magie de la concentration » (2020) -Rémi SAMIER et Sylvie JACQUES : « Neuropsychologie et stratégies d'apprentissage » (2019) -Stanislas DEHAENE, « Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines » (2018) -Isabelle ROSKAM « l'évaluation du comportement chez le jeune enfant » (en lien avec le programme INEMO cité plus bas) -Olivier HOUDE ; « Apprendre à résister » (2014) PROGRAMMES de Recherche mis en oeuvre au sein des écoles -ATOLE, programme un programme de découverte et d'apprentissage de l'attention en milieu scolaire, pour apprendre l'ATtention à l'écOLE -INEMO : IN pour Inhibition et EMO pour émotions (INEMO permet aux enseignants de stimuler de manière ludique les capacités d'inhibition et apprendre aux enfants à gérer leurs émotions et les situations de conflit, grâce à des outils scientifiquement validés, qui pourront également être utilisés à la maison. Ces outils ont été validés ces 5 dernières années et montrent qu'il est possible d'agir de manière préventive). FORMATIONS possibles POUR les ORTHOphonistes -Formations PREDECC : Programme d'Entrainement et de développement des compétences cognitives -Infos sur le site memoaction.com -Formations APSTRACO : APprentissages, STRAtégies et COgnition (Sylvie Jacques et Rémi Samier) : "Attention, Fonctions Cognitives, mémoires, Métacognition et jeux" -Formations d'Anick Pelletier, Orthopédagogue Canadienne, possible via l'organisme de Formation de l'école Française d'Orthopédagogie : "remédiation des fonctions exécutives par l'approche OPTIFEX"
AF - By Default, GPTs Think In Plain Sight by Fabien Roger
Welcome to The Nonlinear Library, where we use Text-to-Speech software to convert the best writing from the Rationalist and EA communities into audio. This is: By Default, GPTs Think In Plain Sight, published by Fabien Roger on November 19, 2022 on The AI Alignment Forum. Epistemic status: Speculation with some factual claims in areas I'm not an expert in. Thanks to Jean-Stanislas Denain, Charbel-Raphael Segerie, Alexandre Variengien, and Arun Jose for helpful feedback on drafts, and thanks to janus, who shared related ideas. Main claims GPTs' next-token-prediction process roughly matches System 1 (aka human intuition) and is not easily accessible, but GPTs can also exhibit more complicated behavior through chains of thought, which roughly matches System 2 (aka human conscious thinking process). Human will be able understand how a human-level GPTs (trained to do next-token-prediction) complete complicated tasks by reading the chains of thought. GPTs trained with RLHF will bypass this supervision. System 2 and GPTs' chains of thought are similar A sensible model of the human thinking process Here is what I feel like I'm doing when I'm thinking: Repeat Sample my next thought from my intuition Broadcast this thought to the whole brain When you ask me what is my favorite food, it feels like some thoughts “pop” into consciousness, and the following thoughts deal with previous thoughts. This is also what happens when I try to prove a statement: ideas and intuitions come to my mind, then new thoughts about these intuitions appear. This roughly matches the model described in Consciousness and the Brain by Stanislas Dehaene, and I believe it's a common model of the brain within neuroscience. How GPTs “think” Autoregressive text models are performing the same kind of process when they generate text. Sampling text is using the following algorithm: Repeat: Do a forward pass, and sample the next token from the output distribution Add the generated token to the input. It makes it part of the input for the next forward pass, which means it can be used by lots of different attention heads, including specialized heads at earlier layers. This looks similar the human thinking process, and the rest of the post will be exploring this similarity and draw some conclusion we might draw from this. System 2 and GPTs' chains of thought have similar strengths A theoretical reason The sample + broadcast algorithm enables the execution of many serial steps. Neurons take about 1ms to fire, which means that if a thought takes 200ms to be generated, the brain can only do 200 serial operations. This is similar to the hundredths of serial matrix multiplications GPT-3 does in its 96 layers. But by sampling and thought and broadcasting it, both GPT-3 using chains of thought and the brain using System 2 can in principle implement algorithms which require much more serial steps. More precisely, in a Transformer, the number of serial steps used to generate one token is #layers (no matter the prompt length), whereas the number of serial steps used to generate N tokens is N×#layers (where one step is one path trough a block made of an attention layer, an MLP, and a residual connection). As you can see in the figure below, each path the information can take to generate the first token is exactly #layers long, but paths to generate the last token can be up to N×#layers long. (Connections skipping more than 2 positions were omitted to increase readability.) The actual number of FLOPs used is the same when generating N tokens from an M token prompt and when generating 1 tokens from and N+M−1 token prompt because a large prompt enables more parallel computations to take place. But parallel computations are not always the bottleneck, and in particular, I think that planning to deceive humans and taking control is the kind of task which requires a large number of serial steps. Empirical evidence Chains of thought helped complete tasks which human need System 2 for: for ex...
L'espace classe, lieu d'apprentissage, de socialisation et même lieu de vie, est au centre des réflexions pédagogiques en maternelle. L'aménagement des espaces a donc une incidence directe sur les apprentissages et le climat scolaire, mais aussi sur la posture des enseignants. Quels aménagements des espaces éducatifs permettent de favoriser le vivre-ensemble, la coopération et le développement des compétences psychosociales ? Quels changements peut-on attendre grâce à cette « pédagogie des espaces », mais aussi quels sont les points de vigilance ? Ève Leleu-Galland, conseillère du recteur de Paris sur l'enseignement préscolaire, qui a mené plusieurs missions d'expertise dans le monde, et Délia Gobert, enseignante en maternelle et formatrice, nous expliquent pourquoi et comment faire évoluer l'espace de sa classe à l'école maternelle et élémentaire. Dans la même thématique sur Extra classe : Les Énergies scolaires #53 - EPS en maternelle : aménager l'espace pour libérer les corps du 6 juillet 2022. Les Énergies scolaires #50 - Acquérir des compétences douces à travers un espace flexible du 8 juin 2022. Les Énergies scolaires #37 - Classe ouverte en maternelle du 9 février 2022. Parlons pratiques ! #3 - Et si on essayait la classe flexible ? du 26 mai 2021. Références des invitées : Gobert Délia, « QUID #4 : la classe maternelle multiâge », Archiclasse, 2021. Visite virtuelle de la classe maternelle de Délia Gobert à l'école maternelle Victor-Hugo de Châlons-en-Champagne, Archiclasse, 2022. Leleu-Galland Ève, « Une salle de classe, ça doit bouger ! », témoignage publié sur le blog Aménagement des espaces éducatifs - Classe de demain, 2020. Faillet Vincent, Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie, Réseau Canopé, 2019. L'agencement de l'espace au service de la pédagogie et du bien-être, des propositions d'accompagnement de vos projets d'aménagement par Réseau Canopé. La transcription de cet épisode est disponible après les crédits. Chaque dernier mercredi du mois, découvrez un nouvel épisode de « Parlons pratiques ! » sur votre plateforme de podcasts préférée. Suivez-nous, écoutez et partagez… Retrouvez-nous sur : Extraclasse.reseau-canope.fr Apple Podcasts Spotify Deezer Google Podcasts Podcast Addict Extra classe, des podcasts produits par Réseau Canopé. Émission préparée et animée par : Hélène Audard et Régis Forgione Réalisée grâce à l'appui technique de : Héloïse Balzac (Atelier Canopé 51) et Floriane Le Maître Directrice de publication : Marie-Caroline Missir Coordination et production : Hervé Turri, Luc Taramini, Magali Devance Enregistrement et mixage : Simon Gattegno Secrétariat de rédaction : Aurélien Brault Contactez-nous sur : contact@reseau-canope.fr © Réseau Canopé, 2022 Transcription : HÉLÈNE AUDARD : Notre « Parlons pratiques ! » d'aujourd'hui s'intéresse à l'aménagement des espaces dans la classe. Un sujet sur lequel Extra classe s'est déjà penché, n'est-ce pas Régis ? RÉGIS FORGIONE : Effectivement, un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. D'ailleurs, vous pourrez retrouver des épisodes « Énergies scolaires » et « Parlons pratiques ! », notamment sur la classe flexible. Mais, aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur la maternelle. HA : Et il faut dire que, à la maternelle, l'aménagement des espaces est très lié au vécu des jeunes enfants et cet aménagement impacte beaucoup leurs apprentissages, on va le voir. RF : Avec pas mal de questions : quel lien entre espace et pédagogie ? Par quoi commencer ? Quels pièges éviter peut-être ? Quels enseignements et généralisations pour les cycles supérieurs ? HA : Nous allons donc essayer de répondre à toutes ces questions et nous irons aussi chercher peut-être des inspirations dans d'autres univers scolaires, en Europe et au-delà. RF : Bienvenue dans notre programme d'exploration de l'espace classe en compagnie d'Ève Leleu-Galland et de Délia Gobert. HA : Ève Leleu-Galland, bonjour ! ÈVE LELEU-GALLAND : Bonjour ! HA : Vous êtes conseillère du recteur de Paris sur l'enseignement préscolaire et vous avez mené plusieurs missions et projets d'expertise au sein de plusieurs écoles dans le monde. RF : Délia Gobert, bonjour ! DÉLIA GOBERT : Bonjour ! RF : Vous êtes professeure des écoles et maîtresse formatrice dans une école maternelle à Châlons-en-Champagne [51]. DG : Oui. HA : Commençons alors par le sujet, la classe – et notamment en maternelle –, un lieu d'apprentissage, de socialisation, un lieu de vie qui est plus ou moins flexible, modulable. Comment, pourquoi est-ce que cet espace classe revient ou se trouve toujours – vous allez nous le dire – au centre des réflexions pédagogiques en maternelle ? Ève Leleu-Galland, on peut entendre parfois que l'environnement spatial est un troisième enseignant dans la classe. Qu'est-ce que cela signifie ? ÈLG : Alors ça, c'est l'approche italienne de Reggio Emilia qui a, depuis maintenant de nombreuses années, identifié dans l'environnement la notion de troisième professeur. Le premier, c'est l'enseignant bien sûr. La deuxième identité – j'allais dire d'apprentissage –, c'est le groupe des pairs. Et le troisième, et c'est très formalisé, c'est à la fois l'aménagement de l'environnement, le matériel qui est proposé aux enfants et la manière dont ils peuvent évoluer à travers des espaces qui sont dédiés et qui sont orientés. Mais peut-être pour donner deux ou trois petits points d'appui pour savoir pourquoi aujourd'hui, à nouveau, on se pose la question de l'aménagement en maternelle, j'allais dire qu'il y a trois entrées importantes. La première, c'est celle des mots importants du programme de l'école maternelle. On parle d'une école bienveillante, d'une école qui donne la confiance et on parle surtout de la socialisation comme étant une compétence fondamentale à construire à l'école maternelle. Donc l'impulsion a été redonnée par l'orientation du programme. Le deuxième élément, c'est la recherche scientifique. On sait depuis quelques années maintenant, à travers Catherine Gueguen, à travers des gens comme Stanislas Dehaene ou bien Olivier Houdé, que le développement et la construction du cerveau du très jeune enfant sont fortement impactés par la nature et la qualité des expériences et des relations qu'il peut mener dans cet environnement. Donc ça veut dire qu'il y a une relation directe entre ce qu'il vit, ce qu'il observe, ce qu'il ressent et la manière dont se développent la compréhension et les apprentissages. Et le troisième élément, que je trouve important, ce sont des recherches qui ont été menées – plutôt sur la toute petite enfance – par Anne-Marie Fontaine et par Alain Legendre sur ce qu'on appelle l'approche écologique qui montre en fait que, selon la manière dont on organise l'environnement de vie, d'évolution, d'apprentissage, de construction de la relation aux autres dans une classe, selon la manière des choix qu'on fait, ça impacte directement : – 1 : la qualité des relations entre les enfants ; – 2 : la manière dont ils vont pouvoir s'inspirer et s'imiter les uns des autres, puisqu'on apprend aussi par imitation ; – et 3 : c'est un point important, ça a un impact direct sur le climat de classe. Un climat de classe serein, c'est un cerveau qui fonctionne bien, qui est en paix et qui est complètement tourné vers les apprentissages. RF : Merci pour ces éléments éclairants, Ève Leleu-Galland. Délia, on a l'impression que la classe maternelle a un peu toujours travaillé dans ce sens-là, avec des espaces distincts, des ateliers. Mais on se demande si ces aménagements en classe maternelle sont complètement nouveaux. Une entrée, qui serait peut-être intéressante, serait de savoir comment vous en êtes venue à l'aménagement des espaces classe avec vos élèves de maternelle ? DG : Oui, c'est quelque chose qui a toujours existé, ce fonctionnement en ateliers par exemple. Après, chaque enseignant utilise le mot « atelier » différemment. Et je pense qu'on a été obligé de se questionner là-dessus, sur ce fonctionnement en ateliers, sur les espaces, parce qu'on accueille de jeunes enfants. Alors moi, spécifiquement dans ma classe, j'accueille les 3 ans, les 4 ans et les 5 ans. J'ai les trois sections dans ma classe donc du coup ça fait des enfants vraiment différents. Et j'en suis venue à ce questionnement sur l'aménagement des espaces après plusieurs années en maternelle, en observant les élèves et en [me] rendant compte que, comme le disait Ève, l'aménagement des espaces joue beaucoup sur le climat de classe et le climat de classe joue aussi beaucoup sur l'aménagement des espaces. En fait, les deux sont liés. Il y a des groupes classes aussi qui réagissent plus ou moins bien à des aménagements. On va prendre plus de temps pour expliquer certaines règles, certains cadres, etc. Donc j'en suis venue en observant les enfants, en voyant que, par exemple, des petites sections ont besoin de beaucoup de mouvements, donc du coup de beaucoup plus d'espace. Et puis après je pense aussi que c'est avec l'expérience, avec l'expertise… Et puis après se dire aussi : « Voilà, j'ose le faire, j'ose les regarder et j'ose me dire qu'un enfant a peut-être le droit de faire un puzzle par terre s'il est mieux dans cette position-là par exemple. » Je reviens toujours aussi à ce que nous on vit en tant qu'adultes : on ne travaille pas tous sur le même plan, on ne travaille pas tous à notre bureau, on travaille certains sur le sol, certains sur le canapé, etc. Les enfants, c'est pareil. Et Ève le disait, un climat de classe serein, ça va être un cerveau tourné vers les apprentissages. Mais ce que je vois aussi avec ces aménagements des espaces, en prenant compte des besoins des enfants, c'est que la motivation va être différente aussi. Un enfant à qui on donne une activité en lui imposant une posture de travail qui ne va peut-être pas lui plaire sera moins motivé. Il va le faire parce qu'il écoute l'enseignante. Alors que pour un enfant qui a cette même activité avec le choix de le faire assis par terre, allongé ou avec un copain avec qui il a envie d'être – et pas l'enfant à côté de qui la maîtresse veut l'asseoir –, la motivation ne sera pas la même et obligatoirement l'apprentissage sera différent. ÈLG : Peut-être pour compléter ce que dit Délia, ce qu'on sait aujourd'hui effectivement c'est que le bien-être corporel de nos enfants qui vivent dans une société où, en définitive, on veut qu'ils soient actifs, on les stimule – on est quand même dans une société de surstimulation en dehors de l'école… En tout cas, quand ils arrivent à l'école, il ne faut pas les figer, c'est un non-sens. Et il faut effectivement utiliser cette envie qu'ils ont de mobiliser en fait leur énergie à la fois physique, mais aussi de projection dans des activités, pour qu'ils puissent tirer le meilleur de la situation. Il faut leur donner les conditions nécessaires, quelle que soit la posture dans laquelle ils se sentent bien. HA : Alors est-ce que vous pouvez nous donner justement, Ève Leleu-Galland, les grandes lignes de ce que serait cette pédagogie des espaces et de ce que ça apporte concrètement aux élèves ? ÈLG : Ce qui est évident – Délia le dira sûrement –, c'est qu'à partir du moment où on commence à observer l'espace dans lequel on accueille des élèves et dans lequel on conçoit des activités d'apprentissage – parce qu'on a toujours les deux liens à tenir à l'école maternelle –, on est forcément obligé de modifier sa posture d'enseignant et, j'allais dire, un peu les pédagogies qu'on utilise. Et les pédagogies qui vont de pair avec une réflexion sur les incidences entre l'aménagement, le matériel mis à disposition, les regroupements d'élèves, les circulations dans la classe, sont basées sur : – les pédagogies de l'activité, c'est parce qu'ils agissent qu'ils apprennent ; – la pédagogie de l'explicitation, c'est-à-dire que j'explique très précisément ce qui est comme intention explicite dans l'activité que je propose ou dans l'atelier que j'ai installé ; – une pédagogie dite positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les enfants essaient, même en se trompant ou en ayant à certains moments le sentiment de ne pas réussir, on les engage à aller plus loin, à recommencer, à refaire ; – et une pédagogie aussi qui est liée à la valorisation de l'activité de l'enfant. Ça, c'est très important. RF : Délia, une question pour vous. Qui dit maternelle dit Atsem [Assistant territorial spécialisé des écoles maternelles]. Quelle est la place de l'Atsem dans vos pratiques autour de l'aménagement ? Est-ce qu'il y a une place particulière ? Est-ce qu'il y a des éléments qui changent ? C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que c'est particulier pour le coup. DG : Comme le dit Ève, la pédagogie est vraiment liée à l'aménagement des espaces. Et du coup il faut expliquer ça aussi, autant aux élèves qu'à l'Atsem. J'ai la chance de travailler depuis plusieurs années avec la même Atsem. Donc, au fil des ans, elle connaît mon fonctionnement, je sais comment elle réagit, elle a appris aussi à utiliser ces espaces différents et je pense que la difficulté – je ne sais pas si c'est une difficulté mais peut-être le frein un petit peu au début –, que ce soit pour l'Atsem mais aussi pour les enfants, est de comprendre à quoi sert chaque espace. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé de cette pédagogie des espaces et qu'il faut aussi que chacun y mette du sens derrière. Donc nous, on explique : « Voilà, la période se termine, on vient de passer une période… » Donc c'est quand même deux mois de l'année où on explique où sont rangées les activités, pas juste pour une question matérielle, mais pédagogiquement, au niveau des apprentissages, pourquoi je vais ranger cette activité-là ? Pourquoi je vais me tourner vers tel espace si je veux apprendre les nombres ? Donc ça c'est un travail qu'on doit faire avec les enfants mais qu'il faut aussi expliquer à l'Atsem. Bien sûr, c'est vrai qu'avec moi, en début d'année, l'Atsem se situe plutôt dans deux ou trois espaces parce qu'elle va gérer plutôt des activités de motricité, de manipulation pour les petits, qui sont peut-être plus simples à expliquer. Je vais me tourner vers des activités avec des consignes plus conséquentes, plus pédagogiques pour les grands. Mais voilà, après, c'est un travail d'équipe. En fin de compte, c'est ce que je dis aux enfants, on est une grande famille : il y a l'Atsem, les deux enseignantes – moi, je partage ma classe –, et les enfants. On fait tous partie de cette famille et du coup on doit tous respecter et comprendre les espaces ensemble. HA : On va rentrer un peu plus dans le détail et essayer de donner des pistes pour mettre ça en œuvre. Mais juste avant cela, Ève Leleu-Galland, vous qui avez exploré pas mal d'autres écoles dans le monde – et donc d'autres approches j'imagine –, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire si ce qu'on dit là c'est quelque chose qui est tout à fait répandu et admis ailleurs, est-ce que ça vient aussi d'autres influences ? ÈLG : Alors il est vrai que l'Europe du Nord est très en avance par rapport à cette question-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, le modèle éducatif et pédagogique de l'Europe du Nord est un modèle où l'enfant est accompagné dans son parcours, dans son projet d'apprendre, où les adultes mettent à sa disposition un certain nombre de moyens matériels. Or, nous, en France – je vais être un tout petit peu critique –, on a quand même globalement un modèle de classe qui n'a pas changé depuis que j'étais une jeune enseignante en école maternelle il y a très très très longtemps [rires]. À part quand justement les enseignants en équipe se disent : « On a envie de bouger notre espace et on a envie de faire en sorte qu'il réponde très précisément à des besoins et qu'il soit un espace de convivialité et d'apprentissage, parce que tout ce qu'on propose a du sens pour les enfants », globalement quand même, en France, on ne fait pas beaucoup changer le modèle. Par contre, quand je suis allée aux USA, dans le réseau des écoles françaises, notamment en Californie, je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient intégré notamment le travail d'un architecte spécialisé dans les aménagements et les conceptions d'espace scolaire, qui s'appelle Prakash Nair, qui est un Indien de culture indienne et qui avait introduit des paramètres très très intéressants. Et ce n'est pas très compliqué à faire : – le [premier] paramètre est celui de l'utilisation du mobilier pour concevoir des circulations. C'est-à-dire que le meuble n'est pas simplement un meuble de rangement. Il va structurer l'espace d'évolution des enfants ; – [le second, c'est] l'utilisation des meubles bas plutôt que les meubles hauts parce que les petits, notamment, ont besoin d'avoir en fait un point visuel, une espèce de rapport visuel à l'enseignant – ou aux adultes d'ailleurs –, qui fonctionne comme des vigies, comme des phares. Et donc ils renvoient en fait des messages dans le non-verbal pour les enfants en besoin ; – le troisième élément qu'ils utilisent beaucoup en Europe du Nord, c'est l'élément lumière que moi je trouve très intéressant, le fait qu'on fasse rentrer la lumière dans les classes et qu'on fasse rentrer aussi la nature. Donc, le dedans-dehors c'est quelque chose qui est travaillé pour que les enfants aient l'impression que, dans cet environnement, ils ne sont pas dans un espace artificiel coupé du monde, ils sont dans un espace qui va un peu mimer l'espace social. C'est ce qu'on fait avec les coins de jeux en maternelle – coin poupées, coin voitures, coin dînette –, ce sont des mini-mondes. Et là on peut aller un petit peu plus loin dans la conception des espaces pour que le monde ne soit pas laissé à la porte de la classe. RF : Dans ce que vous dites Ève, on arrive à se projeter, on voit des images et ça me permet de faire une belle transition vers la deuxième partie de l'émission – en précisant que vous retrouverez sur Archiclasse la captation de la classe de Délia en 360° [où] on voit des choses un peu concrètes. Et pour aller du côté du concret, donc vers les pistes concrètes pour passer à l'acte et pour réaménager un peu ces espaces pédagogiques, on a essayé de faire remonter quelques questions pour préparer cette émission – on ne va pas forcément nommer ceux qui ont posé les questions. On a eu une question qui nous a paru particulièrement intéressante. Elle vient un peu gratter ce vernis. On nous dit que dans les nouveaux aménagements, sur les réseaux sociaux, on voit des ballons, des tapis, des élastiques sous les tables. C'est quoi ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est pour faire joli ? Vous voyez l'idée derrière la question ? ÈLG : Délia est parfaitement au courant de la manière dont on peut choisir les assises en fonction des intentions pédagogiques qu'on a. DG : Oui, c'est ça. En fait, je pense que le mot qu'il faut retenir, c'est « intention pédagogique ». En fin de compte, les élastiques, les ballons – alors on en voit dans les classes –, je pense que, comme tout ce qu'on utilise en fait dans nos classes – un livre, une tablette, un élastique, un ballon –, il faut se demander toujours pourquoi. Et, comme je le disais en début d'émission, il y a des groupes par exemple qui ne réagissent pas du tout pareil. Donc, spécifiquement dans ma classe, j'ai un ballon qui me sert plutôt à moi parce que des petits de 3 ans ont du mal à s'asseoir sur le ballon. [Eux], ils testent, ils l'utilisent plutôt pour rouler dessus, etc. Donc après il y a aussi des limites à mettre, il y a des règles à respecter, etc. Et puis les élastiques, par exemple, on n'en a pas dans la classe, alors peut-être parce qu'il y a aussi d'autres éléments qui font qu'ils peuvent bouger en même temps. Et je pense que ces différents outils, que ce soit le ballon, les élastiques ou les assises comme le dit Ève – parce que dans la classe, on a des assises qui ont été réfléchies à partir des demandes des élèves, qui ont été faites chez Nathan –, on [les a mis en place] en fonction de leur demande. Donc eux, ils voulaient des assises qui peuvent être stables mais à la fois qui peuvent être mobiles. Alors soit pour les mêmes enfants, parce que des fois ils ont envie d'être… Elles sont mobiles parce qu'ils peuvent se balancer d'avant en arrière. Alors les mêmes enfants peuvent être avec des envies stables ou mobiles en fonction du moment de la journée, en fonction de l'activité… Mais aussi parce que dans la classe on a différents enfants et du coup chacun à un profil différent. Par exemple, dans la classe, j'ai des enfants qui ne restent que sur les chaises. À l'inverse, il y en a, dès qu'ils peuvent être allongés par terre… Ils l'ont fait encore tout à l'heure. Voilà, un collage, ils l'ont fait par terre, alors que certains étaient assis à des chaises de manière plus classique. HA : Alors, avec cette question des assises, on avance déjà sur la question du corps aussi, qui fait partie des apprentissages pour des jeunes enfants comme ça aussi. Ève Leleu-Galland, le corps c'est aussi un des paramètres très important dans cet aménagement ? ÈLG : C'est évident. Donner une place à l'évolution motrice et à une certaine activité corporelle dans la classe – en dehors de tout ce qui peut être enseignement de l'EPS en salle de motricité –, c'est permettre aux enfants, en fait, de construire leur schéma corporel et leurs repères spatio-temporels dans un espace dans lequel ils vont pouvoir effectivement identifier un certain nombre de points d'appui. Et Délia le dit à très juste titre, ils sont différents nos enfants. Ils sont différents parce qu'ils n'évoluent pas du tout dans les mêmes contextes éducatifs. Par exemple, il y a des familles qui engagent des enfants à aller... – je le vois dans les squares quelquefois quand je regarde les enfants – à aller dans une activité physique, ils les engagent à aller vers les autres, etc. Il y a des familles, au contraire, qui posent des sortes de limites à leurs enfants parce qu'elles ont un petit peu peur en fait que le corps déborde et qu'il aille trop loin. Et, en plus de cela, il y a dans nos classes la question des traits de culture. Donc, en définitive, l'école – cette question de la socialisation qui va passer par la construction de repères spatio-temporels –, va aider les enfants en fait à construire un certain nombre de points d'appui qui seront très utiles quand ils vont arriver au CP. RF : On sent, dans ce que vous dites Ève Leleu-Galland, l'intrication forte entre la pédagogie et les espaces – et tout ce qu'il y a en creux. Dans cette section sur les conseils justement, Délia, si je suis un enseignant ou une enseignante de maternelle, je vous écoute et j'ai envie de me lancer, j'ai vu passer des choses à droite et à gauche. Quel premier conseil donneriez-vous pour se lancer ? DG : Un premier conseil, je dirais juste un verbe, c'est « oser » déjà, ne pas avoir peur. Donc c'est-à-dire essayer. Mais essayer – on sait que c'est comme avec nos élèves –, ça veut dire que ça peut réussir mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Et ce n'est pas grave. Déjà oser. Et après, comme on le disait au début, c'est un lieu de vie pour tout le monde, pour les enfants, pour nous – mais surtout pour les enfants, ils sont quand même plus souvent dans la classe que nous. Moi qui partage ma classe par exemple, ils y sont plus. Et se mettre à leur hauteur, c'est-à-dire déjà les regarder, voir ce qui est occupé et ce qui n'est pas occupé comme espace. Mais aussi quels jeux sont sortis le plus souvent, quels jeux ne sont pas du tout utilisés donc, du coup, quels jeux on pourrait enlever de la classe ou à l'inverse quels jeux il faudrait peut-être mettre en double parce que ça crée des tensions tous les matins parce qu'ils sont deux ou trois à le vouloir. Donc il y a [le fait de] les observer comme ça et il y a aussi vraiment de se mettre à leur hauteur. Ève le disait tout à l'heure par rapport aux meubles bas. Alors c'est vrai dans la classe mais des fois on ne fait pas attention aux portes. Et la porte par laquelle rentre l'enfant le matin, si on se met à sa hauteur – alors parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, on n'y a jamais fait attention –,des fois il y a un bureau ou il y a un meuble et la première chose en fin de compte que l'enfant voit de son petit mètre, c'est comme si c'était un mur pour lui. On parlait d'accueillir, d'espaces bienveillants, des choses comme ça… [Et là], ça ne donne pas forcément envie d'entrer. Et ce n'est pas une erreur en fin de compte, c'est qu'on n'y a peut-être jamais pensé. Et après si vraiment, dans un premier geste, j'ai envie de dire, on voulait commencer – avant même de trier les jeux, des choses comme ça –, c'est enlever son bureau parce que souvent, en maternelle – encore plus qu'en élémentaire –, il ne nous sert pas vraiment, juste pour s'asseoir le midi ou le soir, et encore. Et en fait on se rend compte que – quand j'ai enlevé le bureau, j'ai ouvert des tiroirs, je me suis dit : « Mais mon Dieu, le bazar qu'il y a là-dedans qui ne sert à rien » –, un bureau, en fin de compte, c'est vite 2, voire 4 m2 parce qu'on laisse la chaise, on laisse l'espace pour déplacer la chaise, etc. Et sur une salle de classe, quelle que soit sa taille, quand on libère 4 m2 – sans pour autant le remplir –, ça fait déjà une masse énorme en moins visuellement et en plus ça permet soit d'agrandir un espace soit de laisser aussi un espace libre pour que les enfants puissent s'installer où ils ont envie, puissent se déplacer facilement, etc. HA : Une question qui nous est remontée aussi sur les espaces interstitiels – alors c'est comme ça que c'était nommé –, c'est-à-dire le couloir, le préau, même la cour peut-être. Est-ce que ça rentre aussi dans votre réflexion ? ÈLG : Ils font partie de la réflexion parce que la classe par elle-même, c'est quand même une boîte, c'est un espace clos. Il faut l'ouvrir, donc il faut investir les couloirs si l'on peut. Il faut aussi se poser la question de savoir de quelle manière les enfants se repèrent dans l'école de manière globale, c'est-à-dire : est-ce qu'ils ont des repères dans les couloirs ? Est-ce qu'ils savent que derrière telle porte c'est le bureau de la directrice ? Qui est la directrice ? Est-ce qu'ils savent se repérer tout seuls dans l'école, y compris à 3 ans, quand on les envoie par exemple porter un courrier à la directrice ? Est-ce qu'ils savent repérer les lieux où ils vont pouvoir se prendre en charge au niveau de l'hygiène personnelle en toute autonomie ? Donc on a intérêt en fait à considérer que l'espace classe s'inscrit dans une approche systémique, dans un réseau total qui doit être ouvert à l'appropriation des enfants. DG : Si je peux me permettre, je pense aussi qu'il y a l'espace classe où on est quand même tous ensemble. Des fois, ce n'est pas toujours évident selon les activités qu'on veut faire. Du coup, les différents espaces, que ce soit la cour, le couloir ou si on a une salle vide – j'ai la chance d'avoir une salle vide à côté de la classe –, ça peut être aussi pour un objectif pédagogique, une intention pédagogique particulière. Je sais qu'on travaille beaucoup avec le numérique donc soit pour écouter soit pour s'enregistrer. Quand on veut vraiment du silence, les enfants savent qu'ils ont le droit d'aller dans le couloir en autonomie, qu'ils ont le droit d'aller dans la salle de classe à côté. Alors bien sûr c'est une confiance, c'est un contrat de confiance qui s'établit au fur et à mesure des semaines, des mois et des années [quand on] les garde trois ans. Et le couloir je sais que je l'investis aussi des fois avec un groupe – souvent les petits – parce qu'on a besoin dans une séance de maths de se déplacer donc il nous faut une distance un peu plus longue. Ou dans une séance de sciences quand on fait le transport de l'eau, par exemple, on est beaucoup mieux dans le couloir parce qu'on a une grande distance, on ne dérange pas les groupes qui sont en classe à côté en autonomie parce qu'on va parler fort, parce que ça va nous faire rire, etc. Donc c'est aussi pour une intention pédagogique différente. Mais que ce soit avec la maîtresse, en autonomie ou à deux ou trois, je sais que dans la classe les règles sont différentes en fonction de ce que l'on veut faire dans l'espace. RF : Cette notion-là d'intention pédagogique, d'élan pédagogique, que vous avez évoquée toutes les deux plusieurs fois, elle amène assez naturellement une question entre espace et pédagogie, c'est : dans quel ordre ? Qui modifie quoi ? Qui impacte sur quoi ? La poule, l'œuf, cette fameuse question. Je dis cela car on entend parfois de manière assez dogmatique dire : « Non, non, mais ne bouge pas ta classe, réfléchis d'abord à ta pédagogie et ensuite bouge des choses. » Et j'ai l'impression – ce n'est pas qu'une impression – que ce que vous dites c'est : « Bouge les choses et ta pédagogie va évoluer aussi quelque part. » C'est ça Ève ? ÈLG : Faut bouger les deux. D'abord, il faut avoir envie aussi de remettre un petit peu en cause ce qu'on fait et puis peut-être de regarder différemment sa nouvelle année scolaire. Il faut avoir envie. Et puis, à partir du moment où on bouge le mobilier, le matériel, on va toucher à l'espace, à la gestion du temps, à l'organisation dans le temps, à la manière de faire travailler les élèves, au type de regroupement. Et puis on va toucher aussi bien sûr au rôle qu'on a. Ce n'est pas simplement la posture qu'on a par rapport aux enfants, c'est aussi ce qu'on a en fait comme visée pédagogique, en utilisant tous les paramètres sur lesquels on a introduit de la mobilité. HA : Maintenant, on va peut-être un petit peu soulever des difficultés parce que, dans tout ce qu'on entend, tout est extrêmement attirant, donne envie, il y a des enseignants qui se lancent et, pour autant, ça ne fonctionne peut-être pas toujours comme on l'imagine ou comme on le dit aujourd'hui. Donc on aimerait bien avoir un peu un retour de votre part par rapport à ça. Par exemple, il y a des enseignants qui estiment que les enfants sont plus autonomes et plus « heureux » dans ce type de fonctionnement. Mais ils ont l'impression qu'ils survolent peut-être un peu les activités, qu'ils abandonnent assez vite s'ils ont une difficulté, parce qu'ils vont partir sur un autre atelier ou dans un autre espace qui va peut-être leur demander moins d'effort. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce type de questions ? ÈLG : L'instauration des règles, hein Délia ? Ça veut dire effectivement, à partir du moment où on offre d'autres activités, d'autres manières de fonctionnement, d'autres manières de fonctionner, il va falloir quand même poser le cadre. DG : C'est ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. Des fois quand on parle d'aménagement des espaces, de classes flexibles, on a l'impression que c'est une grosse fiesta et qu'en fin de compte tout le monde fait ce qu'il veut dedans. Non, pas du tout, il y a un cadre. Alors, oui, il y a peut-être plus de liberté que dans certains fonctionnements de classe mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce cadre. Et sur l'exemple que tu donnais sur les activités, eh bien j'ai eu le cas cette année où on a dû réexpliquer qu'une activité n'est pas juste faite pour être sortie, essayée deux secondes et la ranger. Déjà, il y a une règle, c'est que : « si je n'y arrive pas, je demande à un enfant avant de demander à un adulte de nous aider et peut-être que si je n'y arrive pas, c'est qu'elle n'était pas adaptée à mon niveau, à mes compétences du moment parce que, normalement, je ne sors pas une activité que je ne connais pas ou je la sors avec un enfant plus expert qui va jouer avec moi ou qui va me montrer. » Voilà, ça va être des choses comme ça. Après, comme dans tout fonctionnement en fin de compte, il y a des règles. Peut-être que celles-là… Elles ne sont pas plus lâches mais le cadre est plus grand, avec plus de liberté dedans. RF : Pardon, vous voulez dire quelque chose Ève ? ÈLG : Je dis que ce fonctionnement par essai-erreur qu'on permet aux enfants, il faut aussi se l'autoriser pour soi-même car, il y a des années, j'ai des équipes d'enseignantes qui m'ont dit : « Eh bien cette année, on a toutes décidé en fait de modifier notre espace de regroupement par exemple. » Et je les revois à la fin de l'année, elles me disent : « En définitive oui, on a gardé cette idée de regroupement central mais par contre on a modifié l'organisation de nos coins et espaces de jeu parce qu'on a vu que ça ne fonctionnait pas. » RF : Il y a un autre élément de tension – dans le bon sens du terme – qui revient parfois dans les interrogations, c'est qu'on va vers une sorte d'individualisation des apprentissages. Est-ce que c'est un objectif en soi ? Et quelle articulation avec le rôle du collectif dans les apprentissages ? Dans ces classes où on voit un petit peu les élèves qui travaillent peut-être parfois chacun dans leur coin. Comment se fait l'articulation ? Peut-être Délia. DG : L'individualisation me paraît nécessaire et je vais [même] dire obligatoire parce qu'on l'a déjà dit, on accueille un groupe d'enfants mais ils sont tous différents. Un enfant de 3 ans n'est pas identique de son voisin de 3 ans et un de 4 ans peut être comme un de 3 ans. On sait qu'ils sont tous différents avec leurs capacités et leurs difficultés. L'individualisation, oui, mais on n'oublie pas le collectif. Et pour moi, c'est important. L'émulation, elle est là : on a besoin de moments collectifs pour chanter, pour raconter des histoires mais aussi des moments de regroupement où chacun explique ce qu'il a fait le matin. Donc, en fin de compte, ces moments collectifs vont permettre à chaque individu d'expliquer ce qu'il a fait individuellement et ça va permettre – quand tout le monde l'écoute – à un autre enfant de se dire : « Ah bah tiens, demain je ferais bien cette activité », « Oui moi je l'ai faite mais je ne l'ai pas faite de cette manière, etc. » Donc je pense qu'il y a une individualisation qui est nécessaire par rapport aux capacités des enfants – et c'est ce qui nous est demandé aussi dans les programmes –, mais je pense qu'il y a des moments, dans l'emploi du temps, où il faut ces moments collectifs qui sont, pour moi, vitaux pour cette vie de famille qu'on essaye de mettre dans notre espace classe. HA : Alors il y aurait encore peut-être beaucoup de choses à voir ensemble mais peut-être une question sur ce qui se passe après la maternelle parce que parfois l'écart est bien grand quand un élève arrive en CP. Comment est-ce qu'on peut gérer cette liaison en fait ? Et est-ce que c'est le CP qu'il faut modifier ? Comment pensez-vous qu'il faudrait faire pour que les élèves aient un parcours qui soit peut-être moins heurté en arrivant dans le cycle 2 ? ÈLG : J'allais dire qu'il faut faire confiance en fait aux rencontres et aux échanges d'expériences entre enseignants – je l'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire dire que l'école maternelle a toujours développé une pédagogie un petit peu expérimentale et un petit peu novatrice par rapport à l'école élémentaire – parce qu'on avait un petit peu plus d'espace, de liberté. Et là, je vois dans les réflexions que les pratiques de l'école maternelle contaminent – au moins au niveau du CP –, transmettent des bonnes idées. Et quand on a mis en place ces fameux CP dédoublés, on s'est aperçu en fait que les équipes d'enseignants s'étaient inspirées de ce qui se passait à la maternelle pour pouvoir justement gérer des petits groupes, des demi-groupes et qu'on a vu réapparaître dans des classes de CP des coins dédiés, des espaces dédiés avec des activités qui étaient en accès autonomes pour certains élèves. Donc je trouve que cette diversification a pu effectivement profiter à l'école élémentaire et je l'ai même vu sur des classes de cycle 3 où j'ai vu des choses très intéressantes sur le choix des assises et la place du corps des enfants dans l'espace avec des projets coopératifs et ce qu'on appelle des travaux collaboratifs. Ça c'était super intéressant. RF : On peut renvoyer, on le disait en introduction, vers l'épisode de « Parlons pratiques ! » dédié aux classes flexibles qui amène quelques éléments autour de ce que vous dites, Ève. On se dirige gentiment vers la dernière partie de l'émission. On aimerait échanger tellement plus de choses autour de ces questions-là. J'imagine Hélène qu'il y aura sans doute d'autres épisodes autour de cette question, que ce soient des « Énergies scolaires » ou des « Parlons pratiques ! ». Mais on a pour tradition de terminer l'émission en demandant à nos invités, à toutes les deux, une inspiration autour de cette thématique. Alors on va commencer peut-être par Délia ? DG : Pour moi, l'inspiration c'est plutôt visuel. Ce sont des photos de classe – et Ève tu en parlais tout à l'heure –, des pays du Nord qui sont très aérées, qu'on peut voir sur les réseaux, que ce soit Pinterest, Instagram, etc. – je n'ai pas de lien particulier. Mais, en fait, il y a ces photos d'espaces aérés et en fin de compte d'un espace où on se dit : « J'ai envie de rentrer et si déjà j'ai envie de venir, je vais avoir envie d'apprendre. » Alors il y a ces espaces très épurés et – je ne sais pas si c'est à l'inverse – il y a aussi ces écoles, ces classes américaines qui sont très différentes, très colorées avec du fluo, des couleurs, etc., mais qui ont un fonctionnement en espace où l'élève a une place vraiment différente de notre fonctionnement. Donc pour moi, c'était ça et après – je ne peux pas ne pas en parler –, ce sont les échanges avec les collègues et les enfants en fait : les observer, discuter avec eux, que ce soit avec les enfants ou avec les collègues. Et ça, ça apporte beaucoup à la pratique je trouve. ÈLG : Oui, tout à fait, tu as raison Délia. Sur les réseaux sociaux – enfin moi je suis beaucoup sur les réseaux en ce moment parce que je travaille sur un autre projet, sur la première année d'école maternelle –, il y a plein de très bonnes démarches, de très bonnes pratiques qui s'échangent entre les enseignants. Alors toi, tu as parlé des images. Moi, je vais parler du son, Délia. J'ai eu le plaisir de faire avec deux enseignantes – une en toute petite section de maternelle et une qui travaillait à l'époque en cycle 3 et qui maintenant travaille en cycle 2. Ce sont deux influenceuses entre guillemets, deux maîtresses en baskets, Nina et Anaïs. Et on s'est rencontrées à l'occasion d'un projet de chez Nathan pour faire un podcast qui s'appelle « Voix d'école ». Et j'ai trouvé qu'à cette occasion – moi qui ai beaucoup appréhendé la pédagogie et le fonctionnement de la classe en tant qu'observatrice, parce que c'est mon boulot d'aller voir un petit peu comment ça se passe et je recueille énormément d'éléments d'observations, c'est-à-dire que je connais quand même bien plein de paramètres sur lesquels on peut agir –, j'ai échangé avec ces deux maîtresses. Et en fait on est tombées d'accord sur plein de choses, avec des origines de réflexions différentes. On était en accord total sur : « Voilà ce qui marche avec les enfants. » HA : Merci Ève Leleu-Galland. Vous anticipez un petit peu sur un prochain « Parlons pratiques ! » qui sera consacré aux profs influenceurs justement ! En conclusion, on vous remercie beaucoup toutes les deux pour ces approches. Finalement, l'inspiration c'est la maternelle, c'est elle qui contamine, qui peut contaminer les autres cycles. C'est ce que je retiens. Donc on espère avoir donné quelques clés d'inspiration dans ce sens. Merci beaucoup à toutes les deux. DG : Merci à vous. ÈLG : Merci. RF : Merci beaucoup.
Comment notre cerveau déchiffre-t-il l'écriture ?
Nous avons tous appris à déchiffrer un subtil cryptogramme : l'écriture alphabétique que vous lisez en ce moment même. Grâce à l'imagerie cérébrale, mon laboratoire essaie de comprendre comment l'apprentissage de la lecture s'inscrit dans le cerveau en développement. Nous commençons à décrypter le code neural qui, dans le cortex occipito-temporal gauche, enregistre les statistiques des lettres écrites et nous permet de reconnaître les mots, quelles que soient leur taille ou leur police. Mais l'élève n'a pas besoin d'être un Champollion : un enseignement explicite du code grapho-phonologique lui permet de modifier ses circuits cérébraux en quelques mois. En conclusion, je résumerai ce que l'on sait des pédagogies les plus efficaces pour enseigner la lecture.Intervenant(s)Stanislas Dehaene, Professeur du Collège de France
#120 L'impact du mouvement sur l'apprentissage et la cognition
Dans cet épisode, je vous parle de l'impact du mouvement sur l'apprentissage en m'appuyant sur les travaux de Maria Montessori, d'Angeline Stoll Lillard et de Stanislas Dehaene. Dans l'éducation Montessori, le mouvement est placé au centre. Et des études ont prouvé l'efficacité de ce principe. Bonne écoute ! Pour soutenir le podcast https://anchor.fm/cline-guerreiro/subscribe Pour recevoir la newsletter du vendredi et des clés pour développer le plein potentiel de vos élèves https://mailchi.mp/294c8a97c044/videogratuite
Jorge Fontevecchia entrevista a Stanislas Dehaene - Agosto 2022
Jorge Fontevecchia en entrevista con el neurocientífico francés
Comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même ? Et jusqu'où ? Pistes de recherche en images, forcement cérébrales, par l'un des plus éminents neuroscientifiques français, le professeur Stanislas Dehaene. (Rediffusion du 05/10/2021). Ravis de vous retrouver pour un face à face avec notre cerveau, devenu en quelques décennies à peine, quasiment transparent grâce à l'imagerie cérébrale et aux avancées de neurosciences qui ont ouvert la boîte noire, notre boîte crânienne, mais jusqu'où ? Jusqu'où est-il possible qu'un cerveau s'observe lui-même et ce qui s'y déroule, comme dans un miroir révélateur de notre intimité la plus profonde, de nos pensées et de tout ce que nous sommes. Notre esprit, notre corps, nos souvenirs, notre volonté, notre conscience (et tout ça dans un kilo et demi de matière blanche et molle, explorée dans toutes ses circonvolutions par notre invité, le professeur Stanislas Dehaene). Avec Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Psychologie cognitive expérimentale et membre de l'Académie des Sciences. Depuis 2018, il préside le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Son nouvel ouvrage Face à face avec son cerveau vient de paraître chez Odile Jacob.
Have you ever pondered the letter P, or maybe reflected on the letter R? As in, thought about their structures, their shapes, and how they came to be. I, to be honest, had not. I have never given these letters—or any other letters—much thought. But that's what we're up to today. In this episode, we're looking across the world's hundred plus scripts and asking some basic questions: How are they alike? How do they differ? And why do they have the shapes that they do? My guests are Dr. Yoolim Kim and Dr. Olivier Morin. Yoolim is a Psycholinguist at the Korea Institute at Harvard University, and Olivier is director of the Minds and Traditions research group (aka ‘The Mint') at the Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena, Germany. Olivier and Yoolim, along with other colleagues, have recently launched a new online game called Glyph. You can play right now. It asks players to help describe, break down, and classify the characters of dozens of writing systems around the world. Here, we talk about Glyph and what Yoolim and Olivier hope to learn from it. We do a bit of ‘Writing Systems 101' and shine a spotlight on two scripts with fascinating origin stories: Hangul, the Korean script which was devised in the 15th century and Vai, a script invented in Liberia in the 19th century. We also talk about how universal cognitive factors shape writing systems and about whether the writing system you use shapes how you think. Finally, we discuss the earliest writing systems and what they were used for; the myth that the alphabet is the most advanced type of writing system; and the understudied—but not uncommon!—phenomenon of “biscriptalism.” If you enjoy this episode, be sure to check out Glyph. It sounds super fun and engrossing—and I'll definitely be playing it myself! On to my conversation with Dr. Yoolim Kim and Dr. Olivier Morin. Enjoy! A transcript of this episode will be available soon! Notes and links 2:30 – You can sign up to play Glyph and watch a video about the game here. 6:30 – The International Phonetic Alphabet or IPA. 10:00 – In addition to writing, Dr. Morin's group at the MPI has also studied coin designs and other aspects of visual culture. 16:30 – A paper by Dr. Morin and colleagues about writing as one of many kinds of “graphic codes.” 18:40 – An explanation of the international laundry symbols. 19:50 – A video about how Egyptian hieroglyphs were decoded. A website where you can see your name written in Egyptian hieroglyphs. 24:50 – An article laying out five major types of writing system, distinguished by the linguistic unit they encode. 27:40 – More information about Hangul and Vai. 33:00 – A pioneering early paper by Mark Changizi and colleagues about the origins of letter shapes. 34:00 – A research paper by Dr. Morin about how cognitive biases for cardinal shapes and vertical symmetry shape letter forms. 37:30 – A cuneiform tablet, which shows how the script has a distinctive three-dimensional “wedge-shaped” quality. 41:30 – A research paper by Dr. Morin and colleagues on how the Vai script seems to have gotten simpler over its short history. A general audience treatment of the same study by co-author Piers Kelly. 42:00 – A research paper by Dr. Helena Miton and Dr. Morin about what determines the complexity of written letters. 45:00 – The Ogham script, which may have needed to grow more complex over time rather than simplify. 46:00 – An article on the origins of writing in different parts of the world. An article on the rebus principle. 48:30 – Our earlier essay on footprints, which discusses the idea that bird tracks inspired the Chinese writing system. 50:00 – A paper in which Dr. Morin and colleagues discuss the role of early writing in “recitation practices”. 52:00 – The idea that literacy profoundly affects cognition was famously articulated by Jack Goody in The Domestication of the Savage Mind. A paper by Stanislas Dehaene and a colleague about the “Visual Word Form Area” and how it becomes rapidly specialized for reading. 55:00 – Korean readers are often “biscriptal” in that they are familiar with both Hangul and Hanja. 57:30 – A paper by Dr. Kim and colleagues on whether Hanja shapes the mental lexicon of Korean speakers. 59:00 – A research paper examining some of the effects of biscriptalism. 1:03 – A paper by Isabelle Dautriche and colleagues about how word forms are clustered in the lexicon. Dr. Kim recommends: In the Land of Invented Languages, by Arika Okrent Highly Irregular, by Arika Okrent Frindle, by Andrew Clements Dr. Morin recommends: The Greatest Invention, by Silvia Ferrara Stories of Your Life, by Ted Chiang Codes of the Underworld, by Diego Gambetta You can read more about Dr. Morin's lab on the Mint website and follow him on Twitter. You can read more about Dr. Kim's research here. Many Minds is a project of the Diverse Intelligences Summer Institute (DISI) (https://disi.org), which is made possible by a generous grant from the Templeton World Charity Foundation to UCLA. It is hosted and produced by Kensy Cooperrider, with help from assistant producer Cecilia Padilla. Creative support is provided by DISI Directors Erica Cartmill and Jacob Foster. Our artwork is by Ben Oldroyd (https://www.mayhilldesigns.co.uk/). Our transcripts are created by Sarah Dopierala (https://sarahdopierala.wordpress.com/). You can subscribe to Many Minds on Apple, Stitcher, Spotify, Pocket Casts, Google Play, or wherever you like to listen to podcasts. **You can now subscribe to the Many Minds newsletter here!** We welcome your comments, questions, and suggestions. Feel free to email us at: manymindspodcast@gmail.com. For updates about the show, visit our website (https://disi.org/manyminds/), or follow us on Twitter: @ManyMindsPod.
Sobre el comentario de Ilya Sutskever, surge la pregunta sobre si puede o no un IA tener conciencia. Sobre tweet de la idea de que GPT-3 pueda tener leve conciencia salieron al paso Yan LeCun y Stanislas Dehaene, negando total probabilidad de que lo afirmado tenga un grado de verdad. […] La entrada ¿Una IA puede tener conciencia? se publicó primero en Fuc**** Futuro.
https://astralcodexten.substack.com/p/your-book-review-consciousness-and Finalist #1 of the Book Review Contest [This is one of the finalists in the 2022 book review contest. It's not by me - it's by an ACX reader who will remain anonymous until after voting is done, to prevent their identity from influencing your decisions. I'll be posting about one of these a week for several months. When you've read them all, I'll ask you to vote for a favorite, so remember which ones you liked - SA] Imagine that there was a generally acknowledged test for artificial intelligence, to find out whether a computer program is truly intelligent. And imagine that a computer program passed this test for the first time. How would you feel about it? The most likely answer is: disappointed. We know this because it happened several times. The first time was in 1966, when ELIZA passed the Turing test. ELIZA was a chatbot who could fool some people to believe that they talk with a real human. Before ELIZA, people assumed that only an intelligent machine could do that, but it just turned out that it is really easy to fool others. Other tests for intelligence were playing chess, playing a whole variety of games, or recognizing cat images. Machines can do all this by now, and this is awesome. And yet, every success sparked new disappointment, because we didn't find any magic ingredient, some quality that would make a difference between intelligent and non-intelligent. When the groundbreaking GPT-3 and DALL-E suddenly could write news articles or poetry, or could dream up snails made of harp... the main improvement was that they used more raw computation power than the previous versions. If you find this disappointing, then you will also be disappointed by "Consciousness and the Brain" by Stanislas Dehaene. The book is the condensed wisdom of three decades of cognitive research, and it tells you what consciousness is, how it operates, and why we have it. The book actually answers these questions. But if you were hoping that the book would Resolve Philosophy, tell you What Makes Humankind Unique, or whether Free Will exists, it doesn't do that. It only tells you what consciousness is.
Les Énergies scolaires #40 - Orthographe : le pari de l'enthousiasme
Anne Mallet, professeure des écoles, participe à l'opération « Enthousiasme orthographique » initiée en 2019 dans la circonscription du Creusot. Cette nouvelle méthode vise à améliorer l'apprentissage de l'orthographe. En 2021, elle a reçu le prix « Chercheurs en Actes » du Conseil scientifique de l'Éducation nationale dans la catégorie « Égalité des chances ». Trois chercheurs accompagnent ce dispositif qui propose des outils innovants pour la classe (arbre programmatique, boîte mémoire, cartes d'encodage, etc.) conçus à partir d'études en neurosciences. Actuellement, plus de 2000 élèves bénéficient de ces innovations pédagogiques permettant d'entrer avec enthousiasme dans l'écriture orthographiée et la lecture dès la grande section, et de construire des bases solides en orthographe jusqu'à la fin du cycle 3. Anne Mallet nous emmène dans sa classe pour nous parler de l'enthousiasme orthographique et comment ces outils l'aident dans sa pratique pédagogique. Opération « Enthousiasme orthographique », site présentant la méthode et les outils de ce dispositif. Le prix Chercheurs en Actes du CSEN (conseil scientifique de l'Éducation nationale), site de Réseau Canopé. La transcription de cet épisode est disponible après les crédits. Retrouvez-nous sur : Extraclasse.reseau-canope.fr Apple Podcasts Spotify Deezer Google Podcasts Podcast Addict Extra classe, des podcasts produits par Réseau Canopé. Émission préparée et réalisée par : Floriane Le Maître et Michèle Berteau Réalisée par : Floriane Le Maître Directrice de publication : Marie-Caroline Missir Coordination et production : Hervé Turri, Luc Taramini, Magali Devance Mixage : Laurent Gaillard Secrétariat de rédaction : Nathalie Bidart Contactez-nous sur : contact@reseau-canope.fr © Réseau Canopé, 2022 Transcription : Je m'appelle Anne Mallet, j'ai 57 ans. Je suis enseignante depuis l'âge de 21 ans, donc voilà, ça fait… ça commence à faire… [Extrait : l'accueil des élèves par Anne Mallet] « Plusieurs voix d'élèves : Bonjour ! ANNE MALLET : [rire] Allez, range ta balle. UN ÉLÈVE : J'la mets là ? ANNE MALLET : Oui. » [Fin de l'extrait] Au mois de septembre, j'ai accepté l'opportunité de travailler à mi-temps sur le poste d'enseignante à l'école des Prés-Calards au Breuil, et à mi-temps, à l'inspection, auprès de l'inspectrice pour travailler en collaboration avec Marc Boudot sur le projet « [Opération] Enthousiasme orthographique ». [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « ANNE MALLET : T'es avec qui Noah ? NOAH : Ben… UNE ÉLÈVE : Moi, je suis avec Molly. ANNE MALLET : OK. Allez, à vos places. Préparez-vous… » [Fin de l'extrait] Moi, quand j'avais ma classe, avant « Enthousiaste orthographique », je faisais deux séances d'orthographe par semaine : une séance d'orthographe lexicale où, effectivement, je faisais copier des mots et je faisais une dictée, et une séance d'orthographe grammaticale où je faisais des préparations de dictée. Il y a toujours eu des enfants qui étaient bons en orthographe, qui font des dictées sans faute ou quasiment sans faute, et puis il y a des enfants qui sont en grande difficulté. Moi, je ne suis pas tellement du genre à regarder en arrière, je suis plutôt du genre à me dire : « Bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Donc, je continue mes séances d'orthographe et orthographe grammaticale avec ma propre façon de faire, mais j'ai introduit l'orthographe lexicale avec la méthode « Enthousiasme orthographique ». Et, effectivement, dans les évaluations que j'ai faites en classe et dans les évaluations que j'ai pu faire aussi dans les classes visitées, il s'avère que les enfants font assez peu de fautes dans les mots qu'ils ont préparés. [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « ANNE MALLET : Allez, on s'installe… [Murmures entre deux élèves : – Vrai… Non, vrai – Quoi ? – Vrai – Eh ben…] ANNE MALLET : Mets-le dans un contexte, Jessyca, s'il ne comprend pas le mot. JESSYCA : Mmmm. C'est ‟vrai”. ANNE MALLET : Ah, voilà… UN ÉLÈVE : Ah, vrai ? JESSYCA : Oui. » [Fin de l'extrait] Il y a une chose qui est très intéressante, c'est l'arbre à mots, l'arbre programmatique qu'on appelle l'arbre à mots. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien fait. En fait, Marc est parti du postulat qu'il y a 37 sons et 151 manières d'écrire avec des graphèmes. Donc, il a regroupé chaque phonème avec toutes les façons différentes de l'écrire. Par exemple, le son /f/. Il peut s'écrire soit « f », soit « deux f », soit « ph ». Et les enfants voient que la plus grosse étiquette, c'est le « f », parce que c'est celle qui est utilisée le plus souvent dans l'orthographe française. Et qu'est-ce qu'il y a à côté du « f » ? Il y a une petite fée. Voilà. Le mot est écrit par transparence sur l'album [Tatou] et il va le trouver dans le livret. Dans le livret, il va écrire le mot « mensonge » avec le /ɑ̃/ [prononcer « en »] de mensonge qui est le « e-n ». Donc, c'est un graphème difficile. Donc, le « e » va être en couleur et le /ʒ/ [prononcer « ge »] de mensonge, comme ce n'est pas le /ʒ/ le plus connu – le /ʒ/ le plus connu, c'est le « j » –, ça va être en rouge aussi. Le lendemain, il va l'écrire sur son ardoise, « mensonge », en gris. Le lendemain, le copain va lui demander de l'épeler, il va dire : « m-e-n-s-o-n-g-e ». Et le lendemain encore, l'enfant va dire l'opacité, c'est le /ɑ̃/, « e-n », et c'est le /ʒ/, « g-e ». Si les trois étapes sont validées, il prend sa petite étiquette et il la colle dans son album Tatou. C'est un peu une réminiscence des albums Panini. Voilà, c'est comme ça que la méthode a été construite par Marc Boudot. Mais là, les enfants ne l'ont vu que quatre fois, le mot. Et ce n'est pas tellement « expansé », quatre fois. D'où l'intérêt de ce qu'on va voir cet après-midi, ce sont les « dictées hasard ». [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « ANNE MALLET : Qu'est-ce qu'il y a, Jessyca ? JESSYCA : S'il s'est trompé, on fait quoi ? ANNE MALLET : Alors, s'il s'est trompé, ben on laisse. Là, on est en évaluation. » [Fin de l'extrait] Des « dictées hasard », j'en deux par semaine. J'en fais le lundi et le jeudi. Les CE2 vont piocher dix mots et les CM1 vont piocher treize mots. Les enfants prennent l'album Tatou du copain et regardent les mots qui ont été collés et ils leur posent des questions. Ils leur demande d'épeler, ou d'écrire, ou de donner l'opacité des mots qui ont été collés. Donc, ça fait travailler autant celui qui pose des questions que celui qui écrit. En fait, l'enthousiasme vient du fait qu'ils sont autonomes à leur tâche, qu'ils s'autoévaluent et qu'on n'est pas sur des mots qu'on copie dix fois à la maison, par exemple, et qu'on doit restituer le lendemain sous la contrainte de la dictée. [Extrait : remise du prix Chercheurs en Actes] « STANISLAS DEHAENE : Je vais vous parler donc du troisième prix, le prix ‟Égalité des chances” ; avec un lauréat : l'‟Opération Enthousiasme orthographique”. [Applaudissements] » [Fin de l'extrait] C'était en octobre. On est montés à Paris. Donc, c'est monsieur Stanislas Dehaene qui nous a remis le prix et c'était le prix « Égalité des chances » pour [le prix] Chercheurs en Actes. Pourquoi c'est l'égalité des chances ? Parce qu'en fait, tout le travail se fait en classe. L'entièreté du travail se fait en classe parce que copier les mots, les épeler, donner l'opacité et les dictées hasard se font par le copain, sur le temps d'accueil. Ce n'est pas très long. On préconise 20 minutes d'orthographe lexicale par jour. Ça fait 20 minutes. Copier trois mots le matin, ça prend, allez, ça prend 3-4 minutes. Et puis, le rituel de l'après-midi, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Donc, on est à 20 minutes par jour. S'ils ont réussi à terminer le travail qu'on leur propose, ils devraient avoir appris et collé 300 mots ; qui ne sont pas les mêmes que les 300 mots de CE2 ou de CM1, ou de CM2. Ce sont des mots différents pour chaque classe. En fait, ce sont les mots les plus usités dans la langue écrite française. Ce sont les travaux de Nina Catach, qui a fait un travail de collecte de mots dans des textes, en voyant quels sont ceux qui sont les plus usités, à l'écrit, dans la langue française. [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « UNE ÉLÈVE [lisant le cahier Tatou d'un autre élève] : … expression… marchand… L'AUTRE ÉLÈVE [comptant les mots] : Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze… » [Fin de l'extrait] J'ai tout simplement commencé par aller voir sur le site. Voila. J'ai écouté les enseignants qui expliquaient leur expérience. Et puis, tout est écrit, et sur la boîte et dans les albums [Tatou], c'est tout écrit. C'est-à-dire que, pour quelqu'un qui débute, il est tout à fait possible de suivre le tuto et de s'en sortir. Les enfants savaient que je travaillais le jeudi et le vendredi pour la boîte-mémoire. Je leur avais dit : « De toute façon, on va travailler ensemble pour améliorer la façon de s'en servir. » Donc, on a changé plusieurs fois le rituel dans l'année, mais ça ne les a pas dérangés. [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « ANNE MALLET : Ouuuuh, un dur, alors attention. Personnage. Personnage… Combien de consonnes ? UN ÉLÈVE : Trois. ANNE MALLET : Alors, il en faut combien ? UN ÉLÈVE : Deux ? » [Fin de l'extrait] Il s'avère que la méthode « Enthousiasme orthographique » connaît un vif succès auprès de pas mal d'enseignants de la circonscription. Elle commence à essaimer auprès d'autres circonscriptions. Et voilà, on m'a demandé de travailler avec Marc Boudot pour apporter une… On va dire pour apporter une consistance un peu pédagogique. Parce que je travaille en étroite collaboration avec lui, mais aussi avec l'inspectrice. On se voit très régulièrement pour faire le point, pour échanger sur la pédagogie, sur la méthode. Il y a aussi le fait que je vais voir les enseignants dans les classes qui pratiquent la méthode pour récolter les façons de l'amener en classe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Marc Boudot est aussi très à l'écoute de ça, parce qu'il a envie que sa méthode perdure. Ce que je comprends, parce que c'est une méthode intéressante et pour qu'elle se perfectionne. Et du coup, mon travail, c'est aussi ça. [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] ANNE MALLET : Ouaaaah ! Alors là c'est très, très bien, zéro faute. UN ÉLÈVE : Ooooooh ! Oooh… ANNE MALLET : Bon, c'est du bol, ça, non ?... Non ! C'est du travail, il faut dire ! » [Fin de l'extrait] Je suis attirée par cette façon d'aborder l'orthographe parce que ça fait partie de mes convictions profondes que, quand un enfant vient dans la classe, j'ai envie qu'il vienne avec plaisir. Voilà. Donc, tout ce qui peut participer à ça… est une chose qui m'intéresse. [Extrait : séance éducative d'Anne Mallet] « ANNE MALLET : Allez, à vos places... » [Fin de l'extrait]
Revoir les intégrales : C l'hebdo
La conciencia: el material de que está hecho el pensamiento por Stanislas Dehaene
Tomado del libro La conciencia en el cerebro: descifrando el enigma de cómo el cerebro elabora nuestros pensamientos de Stanislas Dehaene
Book Summary: Consciousness and the Brain by Kaj_Sotala
Welcome to The Nonlinear Library, where we use Text-to-Speech software to convert the best writing from the Rationalist and EA communities into audio. This is: Book Summary: Consciousness and the Brain , published by Kaj_Sotala on the AI Alignment Forum. One of the fundamental building blocks of much of consciousness research, is that of Global Workspace Theory (GWT). One elaboration of GWT, which focuses on how it might be implemented in the brain, is the Global Neuronal Workspace (GNW) model in neuroscience. Consciousness and the Brain is a 2014 book that summarizes some of the research and basic ideas behind GNW. It was written by Stanislas Dehaene, a French cognitive neuroscientist with a long background in both consciousness research and other related topics. The book and its replicability Given that this is a book on psychology and neuroscience that was written before the replication crisis, an obligatory question before we get to the meat of it is: how reliable are any of the claims in this book? After all, if we think that this is based on research which is probably not going to replicate, then we shouldn't even bother reading the book. I think that the book's conclusions are at least reasonably reliable in their broad strokes, if not necessarily all the particular details. That is, some of the details in the cited experiments may be off, but I expect most of them to at least be pointing in the right direction. Here are my reasons: First, scientists in a field usually have an informal hunch of how reliable the different results are. Even before the replication crisis hit, I had heard private comments from friends working in social psychology, who were saying that everything in the field was built on shaky foundations and how they didn't trust even their own findings much. In contrast, when I asked a friend who works with some people doing consciousness research, he reported back that they generally felt that GWT/GNW-style theories have a reasonably firm basis. This isn't terribly conclusive but at least it's a bit of evidence. Second, for some experiments the book explicitly mentions that they have been replicated. That said, some of the reported experiments seemed to be one-off ones, and I did not yet investigate the details of the claimed replications. Third, this is a work of cognitive neuroscience. Cognitive neuroscience is generally considered a subfield of cognitive psychology, and cognitive psychology is the part of psychology whose results have so far replicated the best. One recent study tested nine key findings from cognitive psychology, and found that they all replicated. The 2015 "Estimating the reproducibility of Psychological Science" study, managed to replicate 50% of recent results in cognitive psychology, as opposed to 25% of results in social psychology. (If 50% sounds low, remember that we should expect some true results to also fail a single replication, so a 50% replication rate doesn't imply that 50% of the results would be false. Also, a field with a 90% replication rate would probably be too conservative in choosing which experiments to try.) Cognitive psychology replicating pretty well is probably because it deals with phenomena which are much easier to rigorously define and test than social psychology does, so in that regard it's closer to physics than it is to social psychology. On several occasions, the book reports something like “people did an experiment X, but then someone questioned whether the results of that experiment really supported the hypothesis in question or not, so an experiment X+Y was done that repeated X but also tested Y, to help distinguish between two possible interpretations of X”. The general vibe that I get from the book is that different people have different intuitions about how consciousness works, and when someone reports a result that contradicts the intuitions of other researchers, those other researchers are going to propose an alternative interpretation that...
durée : 00:52:59 - L'Heure bleue - par : Anne-Sophie DAZARD, Laure Adler - Stanislas Dehaene dans "Face à Face avec son Cerveau" revient sur une aventure intellectuelle, la découverte et la conquête des mystères du cerveau, en partageant avec nous une centaine d'images spectaculaires.
En busca de la mente por Stanislas Dehaene
Tomado del libro Eso lo Explica Todo: ideas bellas, profundas y elegantes sobre cómo funciona el mundo. Edición de John Brockman.
Toma de decisiones y algoritmos mentales por Stanislas Dehaene
Tomado del libro Eso lo Explica Todo: ideas bellas, profundas y elegantes sobre cómo funciona el mundo. Edición de John Brockman.
paru aux éditions Odile Jacob.
La Grande Librairie consacre une émission exceptionnelle à l'écrivain qui sait le mieux parler de la mémoire et de l'oubli : Patrick Modiano. Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature en 2014, interroge la mémoire, l'oubli et le temps qui passe dans son 30ème roman, Chevreuse (Gallimard) : entre hier, aujourd'hui et avant-hier, un écrivain plonge dans le passé ; Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, est l'un de nos plus grands scientifiques. Il raconte, dans Face à face avec son cerveau (Odile Jacob), une véritable aventure intellectuelle qui interroge sur ce qui caractérise la nature humaine ; Edouard Baer est actuellement à l'affiche au théâtre Antoine, à Paris, pour son spectacle Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce (Seuil) dans lequel il rend hommage à Patrick Modiano mais aussi à Boris Vian, Malraux, Gombrowicz et tant d'autres écrivains qu'il aime ;
Autour de la question - Comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même ?
Comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même ? Et jusqu'où ? Pistes de recherche en image, forcement cérébrales, par l'un des plus éminents neuroscientifiques français, le professeur Stanislas Dehaene. Ravis de vous retrouver pour un face à face avec notre cerveau, devenu en quelques décennies à peine, quasiment transparent grâce à l'imagerie cérébrale et aux avancées de neurosciences qui ont ouvert la boîte noire, notre boîte crânienne, mais jusqu'où ? Jusqu'où est-il possible qu'un cerveau s'observe lui-même et ce qui s'y déroule, comme dans un miroir révélateur de notre intimité la plus profonde, de nos pensées et de tout ce que nous sommes. Notre esprit, notre corps, nos souvenir, notre volonté, notre conscience (et tout ça dans un kilo et demi de matière blanche et molle), exploré dans toutes ses circonvolutions par notre invité, le professeur Stanislas Dehaene. Avec Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Psychologie cognitive expérimentale et membre de l'Académie des sciences. Depuis 2018, il préside le Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Son nouvel ouvrage Face à face avec son cerveau vient de paraître chez Odile Jacob.
EP 19 - How We Learn Like A Scout: Critically Thinking About Critical Thinking
Visit our website BeautifulIllusions.org for a complete set of show notes and links to almost everything discussed in this episodeSelected References:2:15 - Listen to Beautiful Illusions Episode 18 - Making Progress Better from September 20218:36 - AP English Language and Composition (College Board)12:23 - The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don't by Julia Galef12:26 - How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine...for Now by Stanislas Dehaene12:53 - See an outline of The Scout Mindset (Effective Altruism Forum)13:41 - See the “hyperreality” Wikipedia entry and read “On Exactitude in Science” by Jorge Luis Borges14:27 - See “Soldier Mindset / Scout Mindset” comparison table21:08 - See “Carol Dweck: A Summary of Growth and Fixed Mindsets” (fs Blog)21:58 - See the “testing effect” Wikipedia entry and “The Ultimate Learning Machine”, a summary of an interview with Stanislas Dehaene: “One of the most surprising insights coming from current research is that we learn more from regular testing than we do from extra lesson time. Testing doesn't necessarily entail doing a formal exam, it's more about brief, daily testing during class and can involve doing an exercise, using flashcards or having the teacher ask questions after introducing a new concept. The best is to alternate teaching and testing, even within a single lesson. “Teachers think that evaluation is for them to get an idea of what the kids are doing, but according to the recent science, testing is really for the learner,” Dehaene says. “It's an essential part of the learning algorithm. You learn when you test yourself.” In this sense, testing and evaluation are misunderstood by teachers, he believes.”22:58 - See “Bloom's Taxonomy” (Vanderbilt University Center for Teaching) and the “Bloom's taxonomy” Wikipdedia entry34:58 - Listen to Beautiful Illusions Episode 06 - What We Talk About When We Talk About Politics from November 202035:10 - Difficult Conversations by by Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen39:09 - For a nice summary of Dehaene's 4 pillars see ”Did neuroscience find the secrets of learning?” (Article by Stanislas Dehaene, Paris Innovation Review, 2013) and “Science: These are the 4 Pillars of Learning” (Daniel Gogek)40:59 - See an outline of The Scout Mindset (Effective Altruism Forum)41:00 - Watch Julia Galef's TED Talk “Why you think you're right — even if you're wrong”43:51 - See “What are Book Clubs?” (Fountas & Pinnell Literacy Blog)57:36 - Listen to Brain Science Episode 167 - Stanislas Dehaene on “How We Learn” from February 20201:02:50 - See Metacognition (Vanderbilt University Center for Teaching) and the “Metacognition” Wikipdedia entryThis episode was recorded in August 2021The “Beautiful Illusions Theme” was performed by Darron Vigliotti (guitar) and Joseph Vigliotti (drums), and was written and recorded by Darron Vigliotti
durée : 01:59:27 - Le 7/9 - par : Ali Baddou - Stanislas Dehaene, neuroscientifique, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, est l'invité du 7/9 de France Inter. - invités : Stanislas DEHAENE - Stanislas Dehaene : Professeur au Collège de France
Stanislas Dehaene : "c'est un scandale, nous sommes les derniers en maths de l'Union européenne"
durée : 00:22:39 - L'invité de 8h20 : le grand entretien - par : Ali Baddou - Stanislas Dehaene, neuroscientifique, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale, est l'invité du Grand entretien de France Inter. - invités : Stanislas DEHAENE - Stanislas Dehaene : Professeur au Collège de France
Stanislas Dehaene - Retrouvez la nouvelle adresse sur www.college-de-france.fr
Stanislas Dehaene Collège de France - Année 2020-2021 Chaire de Psychologie Cognitive Expérimentale http://podcast.college-de-france.fr/xml2/cdf3-5.xml https://podcasts.apple.com/fr/podcast/psychologie-cognitive-exp%C3%A9rimentale-coll%C3%A8ge-de-france/id868740725
Confinement, numérique et neurosciences : les apprentissages face à la pandémie. Avec Stanislas Dehaene
durée : 01:59:36 - Les Matins - par : Guillaume Erner - . - réalisation : Vivien Demeyère
The Brain and Reading: Why Learning to Read Is Hard and What to Do About It
This edWeb podcast is sponsored by Readable English.The webinar recording can be accessed here.Have you ever wondered why we are facing a literacy crisis? A look at The Nation's Report Card reveals that there has been no improvement to the low reading rates of our students for the past 30 years, despite increases in special education, Title I and school improvement grant dollars, technology, and the influx of countless intervention programs. This edWeb podcast will explore the underlying causes of literacy failure and how understanding the connections between the brain, reading, and the English language will help. In this edWeb podcast, listeners learn about:The complexities of the English languageThe brain and reading – understanding cognitive load and orthographic mappingWillingham's cognitive model and Stanislas Dehaene's neuronal recycling hypothesisA solution to address the intrinsic problems of learning to read EnglishThis edWeb podcast is of interest to K-12 principals, reading teachers, reading specialists, literacy coaches, classroom teachers, curriculum coordinators, federal program directors, and all educators who have a role in improving student literacy.Readable English Readable English simplifies and accelerates the process of learning to read.
BS 179 14th Annual Review Episode
Brain Science with Ginger Campbell, MD: Neuroscience for Everyone
It's time for our 14th Annual Review Episode! Despite the challenges of 2020, it has been an outstanding year for Brain Science: the show passed 11 million downloads and Dr. Campbell released of second edition of Are You Sure? The Unconscious Origins of Certainty. This episode is also a great introduction for new listeners. It can be enjoyed even if you haven’t listened to the episodes being discussed. A free transcript is also available for this episode. Here is a list of this year's episodes: BS 165 (encore) Stephen L. Macknik and Susana Martinez-Conde, authors of Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals about Our Everyday Deceptions BS 166 Stephen Macknik describes new a visual prosthesis BS 167 Stanislas Dehaene, author of How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now BS 168 Cecelia Heyes, author of Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking BS 169 (encore) R. Douglas Fields The Other Brain BS 170 Andreas Nieder, author of The Number Instinct BS 171 Matthew Cobb, author of The Idea of the Brain: The Past and Future of Neuroscience BS 172 György Buzsáki, author of The Brain from Inside Out BS 173 Excerpt from Are You Sure? The Unconscious Origins of Certainty by Virginia "Ginger" Campbell BS 174 Georg Northoff, author of The Spontaneous Brain: From the Mind–Body to the World–Brain Problem BS 175 Carol Tavris, co-author of Mistakes Were Made (but not by me)- an exploration of cognitive dissonance BS 176 Seth Grant explains synapse complexity BS 177 Bernard Baars and David Edelman talk about consciousness BS 178 Peter Sterling, author of What Is Health?: Allostasis and the Evolution of Human Design Note: the transcript for this episode is Free. Additional show notes and more episode transcripts are available at brainsciencepodcast.com. Please Visit Our Sponsors: TextExpander at textexpander.com/pocasts The Neurology Podcast at ann.com/podcasts Announcements: Brain Science comes out on 4th Friday each month. Support Brain Science by buying Are You Sure? The Unconscious Origins of Certainty by Virginia "Ginger" Campbell, MD. (autographed copies are available) Learn more ways to support Brain Science at http://brainsciencepodcast.com/donations Sign up for the free Brain Science Newsletter to get show notes automatically every month. You can also text brainscience to 55444 to sign up. Check out the free Brain Science Mobile app for iOS, Android, and Windows. (It's a great way to get both new episodes and premium content.) Connect on Social Media: Twitter: @docartemis Facebook page: http://www.facebook.com/brainsciencepodcast Contact Dr. Campbell: Email: brainsciencepodcast@gmail.com Voicemail: http://speakpipe.com/docartemis
TIP321: Investing & The Brain w/ John Gald (Business Podcast)
In this episode, you'll learn:How we process information subconsciously and how we can take advantage of it How reflexivity functions between the conscious and subconscious mind.How the brain tricks us into making investing mistakes How the best investors use the biases of other investors to achieve superior stock returnsBOOKS AND RESOURCES MENTIONED IN THIS EPISODEAntonio Damasio's book, Self Comes to Mind – Read reviews of this bookNorman Doidge's book, The Brain that Changes Itself – Read reviews of this book Stanislas Dehaene's book, Consciousness and the BrainTwitter profile: John GaldGet a FREE book on how to systematically identify and follow market trends with Top Traders Unplugged. Make hiring efficient and effective. Get a quality candidate within the first day with ZipRecruiter. BlockFi provides financial products for crypto investors. Products include high-yield interest accounts, USD loans, and no fee trading. For a limited time, you can earn a bonus of $25 when you open a new account. Just go to theinvestorspodcast.com/blockfi to start earning today.Experience savings in your shipping cost with Pitney Bowes SendPro.Capital One. This is Banking Reimagined. What’s in your wallet?Get the most competitive rate if you’re looking to get a mortgage or refinance in Canada with Breezeful. Plus, get a $100 Amazon.ca gift card at your closing.Enjoy Dedicated Account Management Support from Telstra, now with messaging, for every business.Browse through all our episodes (complete with transcripts) here.Support our free podcast by supporting our sponsors.
Comment apprendre tout au long de sa vie ?
Tu veux apprendre un savoir-faire, tout seul, en auto-formation sur Internet quel que soit ton âge ? Dans cette vidéo, je t'explique comment transformer une connaissance en habitude. Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici : http://jbv.ovh/jeanviet --------- Pour te procurer le magazine Chut! n°3 d'octobre 2020 Vas, vis et apprends https://echoppe.chut.media/products/chut-n-3-va-vis-et-apprends La version podcast gratuite de 5 articles https://chut.media/tech/magazine-3-va-vis-apprends-articles-sonores-podcast/ L'article "Toutes et tous profs ?" en version audio gratuite https://chut.media/influence/article-sonore-toutes-et-tous-profs/ --------- Navigue dans la vidéo Intro 00:00 Les 4 piliers de l'apprentissage 01:28 1- L'attention 02:11 2- L'engagement actif 03:40 3- Le retour d'information 06:11 4- La consolidation 07:26 --------- LES 4 PILLIERS DE L'APPRENTISSAGE 1- L'attention 2- L'engagement actif 3- Le retour d'information 4- La consolidation Pour aller plus loin, va voir cette excellente vidéo de Stanislas Dehaene : https://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-10h00.htm --------- Les autres liens et ressources cités dans la vidéo Final Cut Pro X gratuit https://www.youtube.com/watch?v=N69tpcIH-Ew Pour Apprendre le développement Android https://www.udacity.com/course/new-android-fundamentals--ud851 Pour passer le code de la route en candidat libre https://www.youtube.com/watch?v=4CgF6MISv0w Mon Compte Formation https://www.youtube.com/watch?v=AGF_mgatA5g Philippa Lally et les 66 jours pour déclencher une habitude https://www.ucl.ac.uk/hbrc/diet/lallyp.html --------- Si tu veux devenir un bon YouTubeur, lis mon livre ici : http://jeanviet.info/youtubeur/ --------- Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici : http://jbv.ovh/jeanviet --------- Musiques : 8 bit March Bensound : Creatives minds, Little Idea, Ukulele ---------
Consciousness and the Brain Book Summary Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts
Human consciousness is invisible and impalpable; it seems to be an untraceable mystery. Throughout history, consciousness has always been a conundrum for scientists. The author of this book, Stanislas Dehaene, combines his cutting-edge achievements in experimental studies and consciousness research to describe how to study consciousness scientifically. He also discusses the applications of consciousness research, leading us to understand the creation and role of consciousness and providing insight into the development and challenges of neuroscience.
CM 164: Stanislas Dehaene On How We Learn
What are the skills that can help us learn new things more quickly and efficiently? Our ability to learn sets us apart from other species. Yet few of us understand how to maximize this ability. Stanislas Dehaene, Director of the NeuroSpin Brain Imaging Center in Saclay, France, and Professor of Experimental Cognitive Psychology at the College de France, can help. In his latest book, How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine...for Now, he explains how the human brain is designed for learning. Next, he shares exactly what we need to optimize our learning. Sleep is one example. We know it's important, but we may not know just how critical it is for learning. Stanislas explains, "So we re-learn, we replay during sleep, the things we've begun to learn during the day. In this way, we are able to multiple the learning examples." At the same time, we may not be aware of what Stanislas calls "the secret ingredients of successful learning." These are the four pillars that, when present, speed up the learning process, namely, attention, active engagement, error feedback, and consolidation. Finally, Stanislas explains the connections between artificial intelligence and the human brain. Though he's convinced that future AIs will surpass the capabilities of the human brain, he readily shares just how amazing our brains are: "I don't think that the brain is intrinsically better than machines. I think the brain is an extraordinary machine." Stanislas has written extensively on the topic of human learning. His previous books include, Reading in the Brain, Consciousness and the Brain, and The Number Sense. The Team Learn more about host and creator, Gayle Allen, and producer and editor, Rob Mancabelli, here. Episode Links Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World by Maryanne Wolf Explicit Memory Creation During Sleep Demonstrates a Causal Role of Place Cells in Navigation by G. de Lavilleon, M. M. Lacroix, L. Rondi-Reig, and K. Benchenane Coordinated Memory Replay in the Visual Cortex and Hippocampus During Sleep by Daoyun Ji and Matthew A. Wilson Error-correction Learning for Artificial Neural Networks Using the Bayesian Paradigm by Smaranda Belciug and Florin Gorunescu Infants Grasp Gravity with Innate Sense of Physics by Joseph Castro Community-induced Memory Biases in Preverbal Infants by Jennifer M. D. Yoon, Mark H. Johnson and Gergely Csibra Illiterate to Literate: Behavioural and Cerebral Changes Induced by Reading Acquisition by S. Dehaene, L. Cohen, J. Morais, and R. Kolinsky Seymour Papert Alexander Grothendieck National Education Scientific Council Support Us Rate and review the podcast on iTunes or wherever you subscribe. Tell a friend or family member about the show. Subscribe so you never miss an episode. Where to Find Curious Minds Spotify iTunes Tunein Stitcher Google Play Overcast
Neuropapo em educação - Episódio 9 - Dislexia e Desempenho
Neste episódio falamos sobre Dislexia e Desempenho. Contamos com a presença de da Prof. Dra. Katerina Lukasova, que é professora do Bacharelado em Neurociência da UFABC. Possui interesse na área de psicologia cognitiva e neuropsicologia e atua principalmente nos seguintes temas: leitura e escrita, distúrbios de aprendizagem, instrumentos e jogos digitais para educação regular e inclusiva. Falamos sobre tipos de dislexia, diagnóstico, tratamentos e muitos outros assuntos relacionados. Referências Associação Brasileira de Dislexia www.dislexia.org.br Cosenza, R. & Guerra, L. (2011). Neurociência e Educação: como o cérebro aprende. Artmed. Como o cérebro aprende a ler. Prof. Stanislas Dehaene. https://www.youtube.com/watch?v=3PooUrq7VdA
Patrick Cohen avec Marie-Paule Kieny, Stanislas Dehaene et Marylin Maeso
Intellectuels, chefs d'entreprises, artistes, hommes et femmes politiques... Dans “C’est arrivé cette semaine”, pendant une heure, Patrick Cohen reçoit, des personnalités de tous horizons pour éclairer différemment et prendre du recul sur l'actualité de la semaine écoulée le samedi. Même recette le dimanche pour anticiper la semaine à venir. Un rendez-vous emblématique pour mieux comprendre l'air du temps et la complexité de notre monde.
We talk to French neuroscientist Stanislas Dehaene about his new book How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine … for Now. Support the show: https://www.patreon.com/inquiringminds See omnystudio.com/listener for privacy information.
BS 167 Stanislas Dehaene explores "How We Learn"
Brain Science with Ginger Campbell, MD: Neuroscience for Everyone
This is an interview with Stanislas Dehaene about his new book How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now. According to neuroscientist Dehaene neuroscience has revealed that human babies are incredible "learning machines" whose abilities exceed those of the best current artificial intelligence. We explore why this is so and how this information could be used to help learners (and teachers) of all ages. Links and References: How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine . . . for Now by Stanislas Dehaene Visit http://brainsciencepodcast.com for additional references and episode transcripts. Announcements: A 2nd expanded edition of Dr. Campbell's book Are You Sure? The Unconscious Origins of Certainty will be released in May 2020. Please join the Brain Science podcast Group on Goodreads at http://brainscienceforum.com. Brain Science comes out on the 2nd and 4th Friday each month. To win an Amazon gift certificate: post a review of Brain Science in iTunes and send me a screenshot. Learn how you can support Brain Science at http://brainsciencepodcast.com/donations Sign up for the free Brain Science Newsletter to get show notes automatically every month. Check out the free Brain Science Mobile app for iOS, Android, and Windows. (It's a great way to get both new episodes and premium content.) Send email to brainsciencepodcast@gmail.com or post voice feedback at http://speakpipe.com/docartemis. Connect on Social Media: Twitter: @docartemis Facebook page: http://www.facebook.com/brainsciencepodcast Group on Goodreads at http://brainscienceforum.com Contact Dr. Campbell: Email: brainsciencepodcast@gmail.com Voicemail: http://speakpipe.com/docartemis
Stanislas Dehaene on why our brains learn better than computers (1/28/20)
The human brain is an extraordinary machine. Its ability to process information and adapt to circumstances by reprogramming itself is unparalleled and it remains the best source of inspiration for recent developments in artificial intelligence. In his new book “How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine…for Now,” Stanislas Dehaene decodes the brain's biological mechanisms, delving into the elaborate processes taking place inside our heads. Join us for a discussion of the finer points of the human mind in this installment of Leonard Lopate at Large on WBAI.
Stanislas Dehaene : "Nos enfants sont des super-ordinateurs"
durée : 00:54:48 - Le Grand Face-à-face - par : Ali Baddou - Peut-on apprendre à apprendre ? En 2018, Jean-Michel Blanquer créait un Conseil scientifique de l'Éducation nationale. À sa tête, un spécialiste du cerveau, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France. Les neurosciences sont-elles l'avenir de l'école ? Débat dans le Grand Face-à-Face.
Stanislas Dehaene, neuroscientifique : "Notre école est profondément inégalitaire"
durée : 00:17:20 - L'invité du Week End - par : Eric Delvaux - Le neuroscientifique, professeur au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'Education nationale Stanislas Dehaene est l'invité d'Eric Delvaux pour son livre "La science au service de l’école", paru aux éditions Odile Jacob.
En este episodio nos acompaña Lucía Gallego Guía AMI 0-6 años y presidenta de la Asociación Montessori Esplugues con quien hablamos de la lecto-escritura en Montessori, no sin antes hablar de la ciencia detrás de ello y apoyadas en el trabajo del neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene. Mil gracias por escucharnos!
En este episodio nos acompaña Lucía Gallego Guía AMI 0-6 años y presidenta de la Asociación Montessori Esplugues con quien hablamos de la lecto-escritura en Montessori, no sin antes hablar de la ciencia detrás de ello y apoyadas en el trabajo del neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene. Mil gracias por escucharnos!
Mamedi Diarra : Toi-même tu peux défendre les droits des enfants placés
Pour le dernier épisode de cette saison (eh oui déjà), je reçois Mamedi Diarra. A 26 ans, il s’engage dans plusieurs causes, en témoigne la longue liste de ses activités mentionnées dans sa signature de mail. En voici quelques unes : Conseiller municipal de la ville de Vincennes, Etudiant en master à l'Ecole de Droit de la Sorbonne, Président de Repairs! 94 - ADEPAPE 94, Président de l'association Appellation d'Origine Citoyenne qui accompagne les 16-25 ans dans la réalisation de leurs projets, Ancien membre du C.A./Trésorier du Forum Français de la Jeunesse... Aujourd’hui, c’est en sa qualité de président de l’ADEPAPE 94 (l’association des enfants accueillis et des anciens bénéficiaires de l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne) que je le reçois dans Toi-même tu peux. Dans cet épisode, Mamedi a accepté de nous partager son vécu imprégné d’une enfance compliquée à plusieurs égards. Mais, ce n’est pas pour faire pleurer dans les chaumières que j’ai souhaité l'interviewer mais plutôt pour savoir et comprendre comment il a fait pour transformer ce parcours en action, comment il s’est servi de cette énergie pour porter aujourd’hui ce combat politique afin d'aider d’autres enfants.Se repérer dans l'épisode :2:42 : Mamedi évoque son enfance et son placement en foyer.5:55 : Il raconte son expérience dans une institution maltraitante et fait le point sur la fréquence des mauvais traitements en foyers.7:54 : Son cheminement vers l'engagement...10:38 : ... et le déclic qui l'y a définitivement conduit.12:14 : Mamedi revient sur son engagement pour la protection de l'enfance.15:18 : Le contexte de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) en France.19:11 : Mamedi compare le système français à des choses qui existent ailleurs dans le monde et en particulier en Europe.21:09 : Il évoque le travail autour d'une loi sur l'ASE passée à l'Assemblée Nationale et pourquoi il se bat pour la faire évoluer.23:26 : Les recommandations lecture de Mamedi : La cause des adolescents de Françoise Dolto, Apprendre à lire de Stanislas Dehaene, Petite poucette de Michel Serres, Génération Y de Monique Dagnaud.Pour retrouver les ressources évoquées par Mamedi Diarra dans cet épisode, c’est par ici (sur Facebook Messenger) !C'est la fin de cette 1ère saison de Toi-même tu peux. Pour nous donner votre avis sur ce que vous en avez pensé, rendez-vous dans ce questionnaire, ça prend 3 minutes et ça nous aiderait beaucoup !PS : Cet épisode est sponsorisé par la Représentation en France de la Commission Européenne.Crédits interview et voix : Esther ValencicCrédits montage et mixage audio de l’épisode : Esther Meunier Voir Acast.com/privacy pour les informations sur la vie privée et l'opt-out.
Pas la peine de se mentir, personne ne connaît sur le bout des doigts les accords du participe passé. Reste que les erreurs que nous faisons à l’écrit peuvent nous coûter cher : une mauvaise note, un·e prétendant·e qui ne répond pas à nos messages, voire même un travail. C’est que notre maîtrise de la langue française est souvent résumée, à tort, à notre connaissance (ou non) du code orthographique.En quoi certaines règles, censées faciliter les échanges, sont-elles devenues facteur de discrimination ? Pourquoi l’orthographe française est-elle si compliquée par rapport aux autres langues ? Qu’est ce que l’insécurité linguistique ? À quoi sert l'orthographe, une norme construite, en partie, de manière arbitraire ? Et surtout, à qui sert-elle? Pour répondre à ces questions, Laélia Véron a reçu Cécile Mallot, institutrice entre autres dans des écoles spécialisées ainsi qu’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, anciens enseignants, auteurs et interprètes de « La Convivialité », un spectacle sur l’orthographe.PS : Nénufar ou nénuphar ?RECOMMANDATIONS ET COUPS DE CŒURLA CITATION D’ARNAUD : « Quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l’Académie » de Georges Bernanos.LA CITATION DE JÉRÔME : « Ce que nous demandons à tous, c’est de nous faire des hommes, pas des grammairiens (…). À l’abus de la dictée, il faut substituer un enseignement plus libre, plus vivant, plus substantiel. » de Jules Ferry.LA CITATION DE CÉCILE : l’adage « L’orthographe est la science des ânes », attribué à Napoléon. RÉFÉRENCES CITÉES DANS L’ÉMISSIONLe chercheur en neurosciences cognitives Stanislas Dehaene, le linguiste William Labov, « L’Orthographe » de Claire Blanche-Benveniste et André Chervel (1969), le linguiste Bernard Cerquiglini auteur de « L’accent du souvenir » (1995), « La convivialité » de Ivan Illich (1973).ARCHIVESMédine ft. Booba - KYLL (Clip Officiel) (Medine, YouTube, 2019), extrait de 24h Pujadas avec Eugénie Bastié et Rokhaya Diallo (LCI, 11 février 2019), Pierre Perret - La réforme de l’orthographe (Pierre Perret, YouTube, 2016), « L'accent circonflexe ne disparaît pas », assure Najat Vallaud Belkacem (BFMTV, YouTube, 4 février 2016), extrait de la matinale de Franceinfo du 6 septembre 2018, La faute de l'orthographe | Arnaud Hoedt Jérôme Piron | TEDxRennes (TEDx Talks, YouTube, 2019)CRÉDITSParler comme jamais est un podcast de Binge Audio animé par Laélia Véron, avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Cet épisode a été enregistré en octobre 2019 au studio V. Despentes de Binge Audio (Paris, 19e), avec la collaboration scientifique de Maria Candea, enseignante-chercheuse à l’université de Paris 3. Réalisation : Quentin Bresson, Solène Moulin, Thomas Plé et Victor Dubin. Générique : Thomas Oger. Chargées de production et d’édition : Diane Jean et Camille Regache. Identité graphique : Sébastien Brothier (Upian). Direction des programmes : Joël Ronez. Direction de la rédaction : David Carzon. Direction générale : Gabrielle Boeri-Charles. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.
Les neurosciences à l'ère du transhumanisme (avec Terence Ericson) [PODCAST] | The Flares
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c’est Gaëtan qui vous parle. Je reçois Terence Ericson, neuroscientifique à l'institut Curie à Paris, spécialisé dans la neurobiologie synthétique et membre de l'association française de transhumanisme. Il a crée et organise de nombreux événements autour des réflexions sur le futur et de la vulgarisation scientifique notamment H+ for good. Il anime également la chaine YouTube : explorons nos futurs. https://www.youtube.com/channel/UC1QfxJ9W8aRRMyCuv7avc0g Pendant cette conversation, on aborde de nombreux sujets entourant le cerveau et ses mystères. La conscience, les psychédéliques, les maladies liées aux cerveaux et les promesses de guérisons, mais également les augmentations cognitives et la lutte contre le vieillissement. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d’écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l’écouter n’importe où. Il suffit de chercher « The Flares » sur iTunes ou Podcast Addict (ou autre appli de podcast). Profitez-en pour vous abonnez afin de ne pas manquerez les prochains podcasts. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libres de les poster en commentaires juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Terence Ericson : Son site : https://terenceericson.wixsite.com Sa chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC1QfxJ9W8aRRMyCuv7avc0g Ressources mentionnées dans ce podcast : - Le code de la conscience - Stanislas Dehaene : https://www.amazon.fr/code-conscience-Stanislas-Dehaene/dp/2738131050 Pour nous soutenir : ➡ Sur Tipeee: https://www.tipeee.com/the-flares Nos contenus exclusifs Premium : https://the-flares.com/abonnement Intelligence artificielle : L'ultime révolution (Livre par Gaëtan Selle) : ➡ Ebook : https://www.amazon.fr/dp/B07MYYLHXN ➡ Broché : https://www.amazon.fr/dp/1794271392 Si vous en voulez plus : Articles, histoires courtes de science fiction, podcasts, visitez le site The flares : http://the-flares.com/ Pour nous suivre : Facebook : https://www.facebook.com/wearetheflares/ Twitter : https://twitter.com/wearetheflares Discord : https://discord.gg/BqNMdfv A propos de The Flares : L’avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d’avancer aveuglément. Nous cultivons chaque jour la volonté de vous raconter ce que le futur pourrait être. Nous sommes vos « fusées éclairantes ». Nous sommes The Flares …
BS 160 Neuroscience of Consciousness
Brain Science with Ginger Campbell, MD: Neuroscience for Everyone
This month's episode is the beginning a four part series about the Neuroscience of Consciousness. This month I am discussing and comparing the ideas from several recent books on the subject in preparation for several upcoming interviews on the subject. Many people consider consciousness to be the biggest mystery of all, but in this episode we explore how progress has been made in unraveling the ultimate "mystery of how our brain makes us human." Books featured in BS 160 (listed in the order cited): Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts by Stanislas Dehaene (2014) The Big Picture: On the Origins of Life, Meaning, and the Universe Itself by Sean Carroll (2016) The Strange Order of Things: Life, Feeling, and the Making of Cultures by Antonio Damasio (2018) From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds by Daniel C. Dennett (2017) Consciousness Demystified by Todd E. Feinberg, MD and Jon M. Mallatt, PhD Links and References: Please visit http://brainsciencepodcast.com for additional references and episode transcripts. Announcements: Please complete a brief Audience Survey. Send email to brainsciencepodcast@gmail.com or post voice feedback at http://speakpipe.com/docartemis. To win an Amazon gift certificate: post a review of Brain Science in iTunes and send me a screenshot. Learn about Premium Content at http://brainsciencepodcast.com/donations Learn about Dr. Campbell's new coaching efforts at http://brainsciencepodcast.com/coaching Sign up for the free Brain Science Newsletter to get show notes automatically every month. Check out the free Brain Science Mobile app for iOS, Android, and Windows. Connect on Social Media: Twitter: @docartemis Facebook page: http://www.facebook.com/brainsciencepodcast Please Visit This month's sponsors: TextExpander at textexpander.com/podcast Audible at audible.com/ginger Please Visit Our Sponsors TextExpander Audible
Stanislas Dehaene investigates how certain areas of the brain might be related to mathematical ability.
Building conscious machines, tracing asteroid origins, and how the world's oldest forests grew
This week we hear stories on sunlight pushing Mars's flock of asteroids around, approximately 400-million-year-old trees that grew by splitting their guts, and why fighting poverty might also mean worsening climate change with Online News Editor David Grimm. Sarah Crespi talks with cognitive neuroscientist Stanislas Dehaene of the Collège de France in Paris about consciousness—what is it and can machines have it? For our monthly books segment, Jen Golbeck reviews astronaut Scott Kelly's book Endurance: A Year in Space, A Lifetime of Discovery. Listen to previous podcasts. [Image: NASA/Goddard; Music: Jeffrey Cook]
Building conscious machines, tracing asteroid origins, and how the world’s oldest forests grew
This week we hear stories on sunlight pushing Mars’s flock of asteroids around, approximately 400-million-year-old trees that grew by splitting their guts, and why fighting poverty might also mean worsening climate change with Online News Editor David Grimm. Sarah Crespi talks with cognitive neuroscientist Stanislas Dehaene of the Collège de France in Paris about consciousness—what is it and can machines have it? For our monthly books segment, Jen Golbeck reviews astronaut Scott Kelly’s book Endurance: A Year in Space, A Lifetime of Discovery. Listen to previous podcasts. [Image: NASA/Goddard; Music: Jeffrey Cook]
Comment mieux apprendre sans aller à l'école ?
Tu veux apprendre un savoir, tout seul, en auto-formation ? Dans cette vidéo, je te montre comment ouvrir ton cerveau à la connaissance et te former gratuitement ou à bon prix sur Internet. Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici : http://jbv.ovh/jeanviet --------- MULTIPLIONS LE SAVOIR ENSEMBLE ;) 1 mois d'abonnement offert à Audible (lien affilié) pour écouter gratuitement le livre "Libérez le cerveau" d'Idriss Aberkane : https://www.amazon.fr/dp/B01AUIE0CK?tag=jeanvietinfo-21 "Libérez votre cerveau" d'Idriss Aberkane en ebook Kindle / livre papier (lien affilié) : http://amzn.to/2uxxjm0 Le site d'Idriss Aberkane https://idrissaberkane.org/index.php/fr/ --------- REAGIS DANS LES COMMENTAIRES Tu n'as pas encore d'abonnement Audible ? Indique-moi dans les commentaires la connaissance qui te passionne et je partagerai aux 10 premiers l'audiobook "Libérez votre cerveau". --------- LES 3 INGREDIENTS POUR APPRENDRE 1- Le temps 2- L'attention 3- L'amour Pour aller plus loin, va voir cette excellente vidéo d'Idriss Aberkane : L'économie de la connaissance https://www.youtube.com/watch?v=dM_JivN3HvI --------- LES 4 PILLIERS DE L'APPRENTISSAGE 1- L'attention 2- L'engagement actif 3- Le retour d'information 4- La consolidation Pour aller plus loin, va voir cette excellente vidéo de Stanislas Dehaene : https://www.youtube.com/watch?v=4NYAuRjvMNQ --------- LES APPLIS ET SERVICES POUR APPRENDRE SUR INTERNET DuoLingo https://fr.duolingo.com/ Tuto.com https://fr.tuto.com Udemy Lien de Blogmotion pour choper les formations à 10€ https://www.udemy.com/?pmtag=BLOGMOTIONJUN17&utm_source=direct-buy-intl&utm_medium=udemyads&utm_term=&utm_content=_._pn__._ci__._sl_FRA_._la_FR_._&utm_campaign=FRA-Blogmotion-10ans via http://blogmotion.fr/le-blog/10a-formation-udemy-16224 Prends cette formation à 10€ (Créer son Podcast de Matthieu Blanco), si tu veux améliorer ta diction / ta prise de parole sur YouTube : https://www.udemy.com/creer-son-podcast Code Academy https://www.codecademy.com Dataquest https://www.dataquest.io Fun Mooc https://www.fun-mooc.fr/ Cours que je vais suivre : MOOC créer des vidéos pros avec son smartphone des Gobelins http://www.iphon.fr/post/mooc-gobelins-apprendre-realiser-films-pro-smartphone-885502 Stats avec R https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPSUD+42001+session08/about DraftQuest (MOOC pour écrire un roman) http://www.draftquest.fr/ --------- - Suis-moi sur Twitter : https://twitter.com/jeanviet - Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/jeanviet.info --------- Si tu veux devenir un bon YouTubeur, lis mon livre ici : http://jeanviet.info/youtubeur/ --------- Abonne-toi à ma chaîne YouTube ici : http://jbv.ovh/jeanviet --------- Musiques : Locally Sourced Carefree par Kevin MacLeod est distribué sous la licence Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Source : http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400037 Luvly by Joakim Karud https://www.youtube.com/watch?v=adinH9Z7xAg Dreams by Joakim Karud https://youtu.be/VF9_dCo6JT4 Soundcloud - https://soundcloud.com/joakimkarud Website - http://www.joakimkarud.com/ ---------
Antonio Battro, pionero en neurociencias en educación hace referencia a la importancia del cerebro númerico, a la historia del cerebro que cuenta y al trabajo de Stanislas Dehaene respecto al cerebro matemático.
Antonio Battro, pionero en neurociencias en educación hace referencia a la importancia del cerebro númerico, a la historia del cerebro que cuenta y al trabajo de Stanislas Dehaene respecto al cerebro matemático.
Practical Typographic Advice and Building an Education Business Alongside a Design Firm with Michael Stinson
Michael Stinson (@MWStinson) is a veteran designer, educator, and business owner. In addition to his work as a professor of graphic design, he also runs Ramp Creative, a branding studio in Los Angeles, as well as Type Ed, a dedicated typographic education business which helps creative pros return to form in the fields of typesetting and layout. Together in this conversation we unravel some of today's worst typographic habits, and how to overcome them, share a few tips that all creatives can use to improve their type usage, and discuss some processes for working with clients. Catch up with Michael on his website, MichaelStinson.com, or through Type Ed. Get The Episode Download The Busy Creator Podcast, episode 97 (MP3, 52:40, 25.4 MB) Download The Busy Creator Podcast, episode 97 (OGG, 52:40, 22 MB) Subscribe to Get New Episodes Subscribe to The Busy Creator Podcast on iTunes, on Google Play Music, on Android, on iHeart Sponsor Freedcamp, the finest free online project management software Bandwidth for The Busy Creator Podcast is provided by Freedcamp, Group Efforts Made Effortless. Freedcamp is best free online project management software available. By using the built-in functions and additional tools like time tracking, invoices, milestones, file storage, and more, teams can customise the software for the task at hand! The Busy Creator Podcast itself is managed and operated on Freedcamp. Get started for free on Freedcamp.com Show Notes & Links Michael is the first person from Los Angeles to join The Busy Creator Podcast Ramp Creative handles a lot of variety — digital, print, mobile Type Ed is an Education Organization, founded 2012 UI/UX design has eroded traditional type study High School scribbles are largely typography Michael was taught both ends of the type spectrum — hand lettering and typesetting (3 words or 300) "I'm not training you to be designers; I'm training you to be Creative Directors some day." —Michael Stinson Tweet This Phonetics Whiskey Labels, an underrated technical as well as artistic challenge "Everyone likes to do logos but wordmarks are extremely challenging." —Michael Stinson Tweet This Chronicle Books Typography for Lawyers, great site for anyone, not just lawers "Designers these days don't like process. They want to jump to making it look good." —Michael Stinson Tweet This "If you get your process in place, you can design anything." —Michael Stinson Tweet This Michael is a former Aerospace Engineer; Prescott studied Mechanical Engineering Prescott — in spite of the hyphen in his last name — doesn't like to use hyphens in his paragraph text "Imagine if you're reading War & Peace in all caps — how far would you get?" —Michael Stinson Tweet This Milton Glaser's Bob Dylan poster Bob Dylan by Milton Glaser Michael was accepted to study Physics at Berkeley, but received scholarships in Art "The beauty of graphic design is that it works both sides of the brain." —Michael Stinson Tweet This Additive & Subtractive Colours Lithographic printing Calculus Ramp Creative is 2 principals and 1 designer "If you follow the right words the path will take you to the promised land of the visuals." —Michael Stinson Tweet This Different methodologies — layer cake vs. pay-as-you-go Lots of Jewish families in New York City worked in the garment industry "You're an actor, you're a leader, you're an entrepreneur, you're a psychologist, you're a therapist ... all at the same time." —Michael Stinson Tweet This Building Brands, a Step-By-Step Guide for Creative Pros to Develop Strategy and Design Identity — original eBook by Prescott Perez-Fox Building Brands eBook "You're not going to use a crescent wrench for a hammer. Right tool for the right job." —Michael Stinson Tweet This "Never stop noticing design." —Michael Stinson Tweet This The most stringest morning routine ever described on The Busy Creator Podcast was that of Michael Bierut Reading in The Brain by Stanislas Dehaene on Amazon The Intellectual Devotional by David Kidder & Noah Oppenheim on Amazon and on Audible "Type isn't all about the characters themselves, it's about the space they take up and the negative space that's left." —Michael Stinson Tweet This Michael defines himself as an introvert Douglas Davis, another educator to appear as a guest Cat Rose discussed creative introverts on The Busy Creator Podcast Type Ed MichaelStinson.com RampCreative.com Michael Stinson on Twitter Michael Stinson on Facebook Michael Stinson on Instagram Michael Stinson on LinkedIn Type Ed on Twitter Type Ed on Facebook Tools InDesign Basecamp Harvest Techniques Use Tables in InDesign for grid-based layouts (restaurant menus) Build type hierarchy from the body copy up (subheads, etc.) If you're setting more than 35 words, don't use All Caps, Italics, Centered Don't be afraid to use hyphens, but with discipline. (e.g., don't use hyphens in the first line) Don't use more than 13 words on a line (left-aligned), or 7 words on a line (centered) Aim for 50-70 characters per line (type size in points x 2 = measure width in picas) Don't build websites in Photoshop — it's not made for layout Habits Keep the reader in your mind. Think of them first. Always take clients through a verbal discovery phase first before visuals Give your print partners multiple files — flattened, outlined, original files, native links, etc. — make their lives easier Constantly observe and comment on design around you Try Audible.com Free for 30-Days Visit BusyCreatorBook.com for your free trial Get The Intellectual Devotional Modern Culture: Revive Your Mind by David Kidder & Noah Oppenheim as a free audiobook
Stanislas Dehaene investigates how certain areas of the brain might be related to mathematical ability.
Pourquoi la maladie de Lyme est arrivée au Québec ? Quels liens existe-il entre la biodiversité et changements climatiques ? On reçoit Dre. Virginie Millien, ou plutôt, elle nous reçoit au Musée Redpath à McGill pour réaliser l'entrevue au sujet de la maladie de Lyme au Québec et de son quotidien de paléo-écologiste. Élyse Caron-Beaudoin nous explique dans sa chronique toxicologie, le déversement de 8 milliards de litres d'eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent, que la ville de Montréal avait envisagé ses derniers jours. Tristan Lamour a lu "Les neurones de la lecture" pour sa chronique science et littérature, de Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France et titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. photo : Wikimedia Commons
Fumer de la dynamite; Les carnets insolites du prof Durand; Dogteur de compagnie; Doc / Post-doc: Caroline Bois; La règle de 3; Défier la sclérose en plaques; Matière condensée; Le courrier des Années lumière; Le maître de la conscience : Stanislas Dehaene.
Stanislas Dehaene - Faut-il avoir peur des avancées en psychologie cognitive ?
Stanislas Dehaene Collège de France Chaire Psychologie cognitive expérimentale Faut-il avoir peur des avancées en psychologie cognitive ?
Stanislas Dehaene - Where do mathematical intuitions come from?
Stanislas Dehaene interview Collège de France Experimental Cognitive Psychology Where do mathematical intuitions come from?
Stanislas Dehaene - D'où proviennent nos intuitions mathématiques
Stanislas Dehaene Collège de France Chaire Psychologie cognitive expérimentale D'où proviennent nos intuitions mathématiques
Stanislas Dehaene - Faut-il avoir peur des avancées en psychologie cognitive ?
Stanislas Dehaene Collège de France Chaire Psychologie cognitive expérimentale Faut-il avoir peur des avancées en psychologie cognitive ?
Stanislas Dehaene - Where do mathematical intuitions come from?
Stanislas Dehaene interview Collège de France Experimental Cognitive Psychology Where do mathematical intuitions come from?
Stanislas Dehaene - D'où proviennent nos intuitions mathématiques
Stanislas Dehaene Collège de France Chaire Psychologie cognitive expérimentale D'où proviennent nos intuitions mathématiques


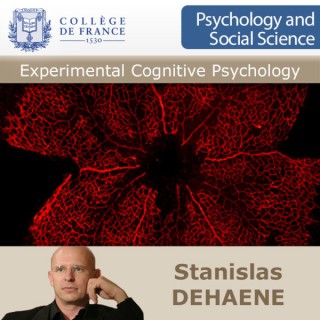
















































![Le monde de demain - The Flares [PODCASTS]](https://ivyfm.s3.amazonaws.com/i320/820588.jpg)










